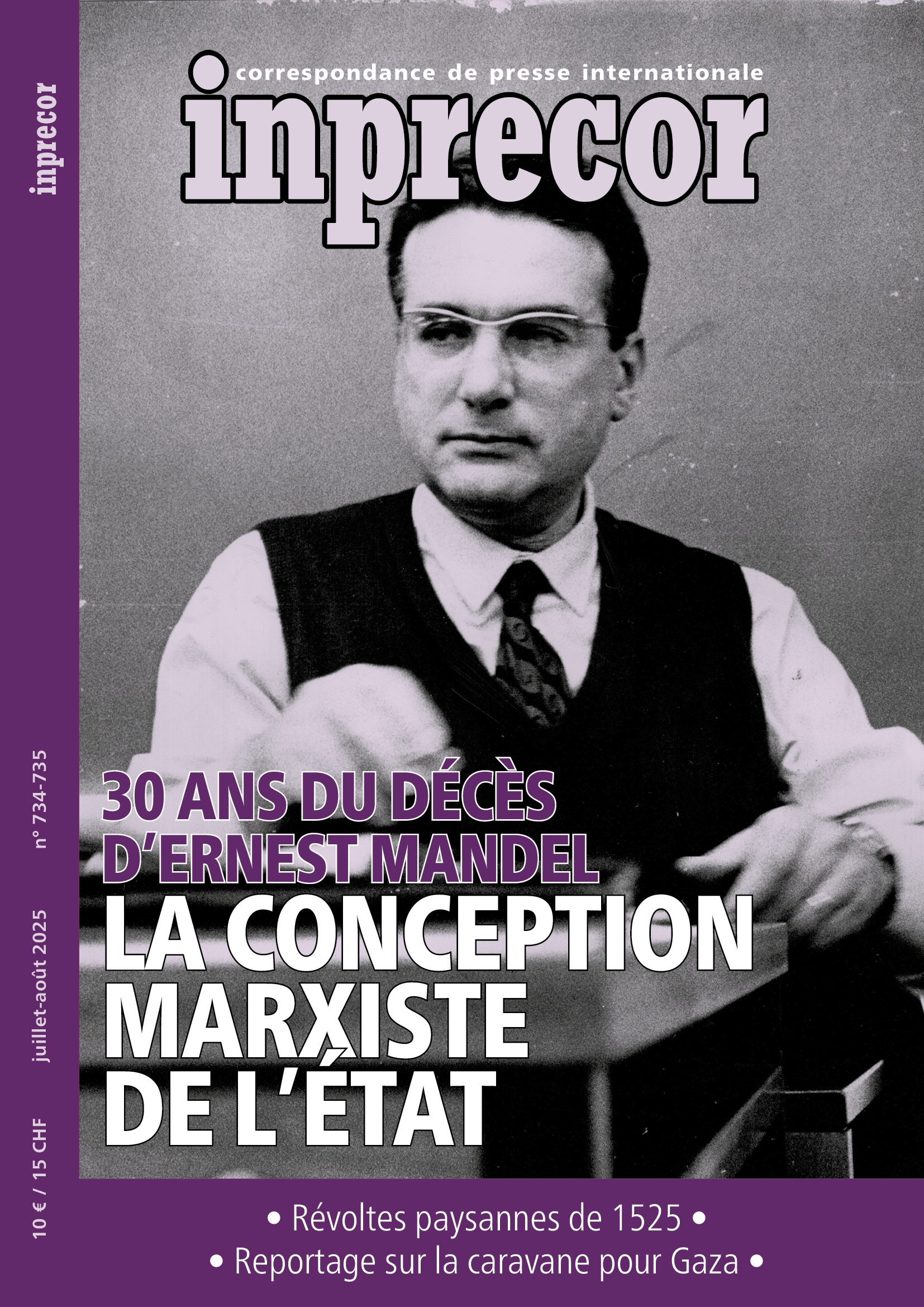Les manifestations qui ont éclaté en Serbie suite à l’effondrement de la canopée de la gare de Novi Sad, le 1er novembre dernier, ne cessent de prendre de l’ampleur. Elles ont déjà contraint à la démission le premier ministre, le maire de la Novi Sad, et ébranlent profondément le pouvoir du président Aleksandar Vučić. Cet accident a mis en lumière les défaillances systémiques d’un capitalisme de connivence, basé sur les relations incestueuses entre intérêts privés et pouvoir politique.
Dans cet article, Tamara Kamatović, enseignante-chercheuse à l’université d’Europe centrale de Vienne, elle-même originaire de Novi Sad, analyse la dynamique de ces manifestations de masse et les perspectives qu’elles ouvrent pour le changement social et politique dont la Serbie a besoin.
Peu après l’effondrement du toit de la gare centrale de Novi Sad, qui a fait quinze morts, un journaliste de la télévision a demandé au journaliste local Igor Mihaljević de réagir à l’événement. Son jugement, dévastateur et incisif, a fourni le contexte qui manquait à la couverture médiatique occidentale de l’accident et des manifestations de ces derniers mois.
Selon Mihaljević, il s’agit du dernier drame en date dans l’histoire souvent tragique de la deuxième ville de Serbie. Dans le passé, Novi Sad a subi la campagne génocidaire de l’armée hongroise qui a massacré des Juifs, des Serbes et des Roms dans toute la région. C’était à l’époque de l’occupation militaire dévastatrice de la Yougoslavie par l’Allemagne nazie et ses États satellites. Plus récemment, en 1999, il y a eu la campagne de bombardement de l’OTAN, qui a duré de soixante-dix-huit jours a causé la mort de 527 Yougoslaves et paralysé de grandes villes comme Novi Sad en détruisant des infrastructures essentielles. Mais cette fois-ci, selon Mihaljević, c’est différent : c’est désormais l’État serbe lui-même qui tue son peuple.
L’effondrement de la gare a laissé la ville et le pays en état de choc, déclenchant des peurs archaïques de voir le ciel s’effondrer. De nombreux Serbes, en particulier à Novi Sad, se méfient désormais des structures aériennes, certains évitant même la nouvelle ligne de chemin de fer à grande vitesse financée par la Chine. Toutefois, les conséquences ont également déclenché une puissante vague de mobilisations, si intenses qu’elles menacent de renverser le président Aleksandar Vučić et ébranlent son Parti progressiste serbe (SNS), notoirement corrompu.
Manifestations étudiantes
Emmené par des étudiant·es de plus de trente universités et facultés – notamment de la faculté d’art dramatique de Belgrade, qui a lancé l’appel à l’action à la fin du mois de novembre – le mouvement s’est constitué autour de quatre revendications clés.
La première est la publication de tous les documents internes relatifs aux travaux de rénovation de gare de Novi Sad, réalisés par Serbian Railway Infrastructure, l’État serbe, China Railway International et China Communications Construction Company, qui ont commencé la construction de la gare en 2021. Les autres revendications concernent l’abandon toutes les charges retenues contre les étudiant·es et les jeunes manifestant·es arrêtés et détenus qui manifestent depuis l’effondrement de la canopée, l’engagement de poursuites pénales et l’inculpation des responsables de la répression à l’encontre des étudiant·es et des enseignant·es, ainsi qu’une augmentation de 20 % des crédits budgétaires alloués aux établissements publics d’enseignement supérieur en Serbie.
Depuis novembre, les étudiant.e.s ont organisé des grèves massives, avec notamment un rassemblement de plus de 100 000 personnes sur la place Slavija de Belgrade le 22 décembre. Les manifestations se sont poursuivies jusqu’au Nouvel An, les manifestant.e.s déclarant qu’il n’y avait rien à « fêter » tant que justice n’était pas rendue. Ces manifestations se poursuivent et ont contraint, le 28 janvier, le premier ministre Milos Vučević et le maire de Novi Sad, Milan Đurić, à démissionner.
Les étudiant·es ont organisé des assemblées et transmis efficacement leur message aux médias. Avec un sens aigu des moments Instagramables, ils ont gracieusement dirigé des campagnes sur les médias sociaux, souvent avec des images de drones des manifestations et des visuels accrocheurs. Leurs actions et revendications n’ont pas seulement remis en question le pouvoir de l’État, elles constituent critique sévère d’une corruption systémique plus profonde : un système judiciaire corrompu qui soutient un État mafieux et un gouvernement qui non seulement manque à ses devoirs envers ses citoyen·nes, mais se fait complice de leur mort.
Ce qui a commencé comme une réaction dans les grandes villes de Serbie s’est transformé en un mouvement national, s’étendant également à des villes plus petites. Comme l’a fait remarquersur X/Twitter Aleksandar Matković, militant et universitaire de Novi Sad, la carte des manifestations, qui couvre presque toutes les municipalités du pays, montre que la situation risque de dégénérer en une crise gouvernementale ou en un conflit plus important.
Les événements ont également suscité de profondes inquiétudes culturelles liées à l’identité nationale. Lundi, l’Église orthodoxe serbe a publié un article dénonçant les manifestations étudiantes, affirmant qu’elles véhiculaient un « récit et un mode de vie anti-saint Sava, anti-chrétien et anti-serbe ». L’affirmation selon laquelle les étudiant·es vivent dans un « univers parallèle » a été démentie dans un communiqué publié mardi, qui précise que le texte ne reflète pas la position du plus haut dignitaire religieux de l’Église, le patriarche Porfirije.
Récemment, les manifestations ont pris une tournure violente, les manifestant.e.s s’engageant dans des affrontements de rue avec les partisans du parti au pouvoir, le SNS. Dans la nuit de mardi à mercredi, vers 3 heures du matin, un groupe de partisans du SNS a attaqué des étudiants à Novi Sad. De nombreux Serbes ont été particulièrement choqués par une série d’attentats à la bombe. Les médias ont largement donné la parole à des partisans du SNS de la ville de Jagodina qui ont dénoncé avec virulence les étudiant·es. Un homme d’un certain âge a même déclaré qu’il serait heureux que sa fille soit battue s’il s’avérait qu’elle participait aux manifestations.
Des nationalistes au service des multinationales
Nous vivons un moment où l’on s’intéresse de façon croissante à la capacité des mouvements de masse à susciter des changements politiques. À la suite du retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, la couverture médiatique obsessionnelle présente souvent la corruption et la vénalité de cet homme comme ayant été rachetées par son investiture en tant que chef d’État. Les parallèles avec Vučić [le président serbe] sont frappants, d’autant plus que Trump et son gendre Jared Kushner ont récemment finalisé un accord commercial visant à construire un hôtel de luxe de la franchise Trump sur le site de l’ancien ministère yougoslave de la Défense à Belgrade. Ce site, bombardé par l’OTAN en 1999, est longtemps resté un symbole des bombardements et des menaces représentées par l’Alliance atlantique.
Aujourd’hui, le deal signé avec Kushner, négocié avec des agents immobiliers à Abou Dhabi, reflète une réalité plus large dans les Balkans : la multiplication de projets immobiliers conçus comme un échange de méga-cadeaux entre des chefs d’État et des chefs d’entreprise des États-Unis, de l’Union européenne, de la Chine et d’ailleurs. Ces arrangements ne profitent en fin de compte qu’à un très petit nombre de personnes, mais ils bénéficient d’une protection judiciaire. En revanche, les revendications des étudiant·es – axées sur le renforcement de l’éducation et la création d’institutions véritablement au service de la population, ainsi que sur la restauration de la légitimité du procureur de la République – remettent directement en cause les intérêts des autocrates et des promoteurs capitalistes que ceux-ci protègent.
Une grande partie de la couverture médiatique occidentale de l’accident de Novi Sad et des manifestations qui en ont résulté est inexacte, dans la mesure où elle souligne les liens étroits de la Serbie avec la Russie et laisse entendre que les manifestations étudiantes s’inscrivent dans une tradition antirusse semblable à celle de Maidan [en Ukraine, en 2014]. Si ce cadrage vise à attirer l’attention sur les manifestations, il est trompeur quant à l’enjeu réel. La préoccupation ici n’est pas l’ingérence étrangère d’un autre pays, elle touche à la corruption intérieure, à la criminalité et à la question fondamentale de savoir à quoi l’État sert vraiment et au service de qui il agit.
Des analystes comme le politologue Florian Bieber, qui insistent sur la nécessité pour le mouvement de s’aligner sur les partis d’opposition serbes, oublient que ces défis ne sont pas propres à la Serbie, mais qu’ils s’inscrivent dans une crise mondiale de la gouvernance. De ce fait, la victoire électorale ne peut être le seul objectif de la politique. Comme l’a relevé le [théoricien marxiste] regretté Fredric Jameson, nous assistons à une érosion globale du pouvoir de l’État. Jameson a évoqué à un « double pouvoir » dans lequel des structures alternatives émergent pour remplir les fonctions essentielles que l’État n’a pas réussi à assurer. Les manifestations étudiantes traduisent cette idée dans la pratique, par le biais de soupes populaires, de réseaux d’autodéfense et d’autres formes de solidarité collective. Les étudiant·es ne se contentent pas d’exiger un changement, mais démontrent activement à quoi pourrait ressembler une alternative autonome et gérée par la communauté.
Une alternative face à l’effondrement
De nombreuses suites étaient envisageables après le désastre de Novi Sad. Les relations commerciales entre l’État serbe et la Chine risquaient d’alimenter la xénophobie à l’encontre de l’importante communauté chinoise de Serbie. L’effondrement de la canopée de la gare aurait pu être oublié, et vu comme une tragédie isolée. Au lieu de cela, les étudiant.e.s serbes ont démontré qu’il est possible de remettre en question un systèmes corrompu. Le succès dépend maintenant de notre capacité à exploiter le potentiel des formes nouvelles et émergentes de cohésion sociale.
Les mouvements étudiants serbes ont déjà été à l’origine de changements politiques majeurs. En 1968, ils ont obtenu des concessions de la part de Josip Broz Tito, qui avait reconnu la validité de nombre de leurs revendications économiques et politiques. Le président Vučić peut parfois se présenter comme le successeur de Tito, mais il n’offre que des promesses vides, ne parvenant pas à mettre en œuvre de véritables changements. En 2000, le président Slobodan Milosević a été renversé après une lutte interne de trois ans déclenchée par le mouvement Otpor ! dirigé par des étudiant·es.
Plus récemment, les protestations contre le soutien du gouvernement serbe au projet d’extraction de lithium de la multinationale britannique Rio Tinto – qui ignore les risques environnementaux bien documentés – se sont multipliées. a mis en évidence la résistance croissante à l’extractivisme parrainé par l’État. Les pressions exercées ont finalement contraint, en 2022, le gouvernement à faire volte-face et à bloquer les projets de l’entreprise dans le pays. Cet épisode souligne une fois de plus que la rhétorique nationaliste masque souvent une collusion avec des intérêts capitalistes étrangers, qui donnent la priorité aux accords économiques plutôt qu’au bien- être de la population. Les manifestations étudiantes actuelles se sont appuyées sur cette dynamique, creusant davantage ces contradictions et remettant en question les réseaux bien établis entre pouvoir politique et intérêts économiques.
L’effondrement de la canopée de la gare de Novi Sad est une métaphore grotesque de l’incertitude qui règne en Serbie. en 1964, cette construction symbolisait une époque où l’État yougoslave était prospère et se modernisait – une ère de projets d’infrastructure ambitieux et de progrès social. Mais la négligence dans son entretien et son effondrement final rappellent brutalement l’incapacité de Vučić à maintenir un tel héritage en état de fonctionnement. Alors qu’il se présente comme un dirigeant fort, sa gouvernance été marquée par l’inégalité économique, la répression politique et l’incapacité à investir dans les institutions et les biens publics qui définissaient naguère la vision yougoslave du progrès collectif.
Les étudiant·es qui aujourd’hui descendent dans la rue ne protestent pas seulement contre un accident isolé ; ils et elles affrontent un système qui a longtemps privilégié la survie politique au détriment du bien-être de la population. Si ce mouvement réussit, il pourra enfin briser ce cycle infernal et pousser la Serbie vers un avenir où l’État sera vraiment au service pour son peuple. S’il échoue, l’effondrement de la canopée pourrait servir d’avertissement terrible d’une nouvelle décadence à venir. Il ne nous reste plus qu’à espérer une victoire.
Cet article a été initialement publié le 1er février dans Jacobin (États-Unis). Traduction Contretemps.