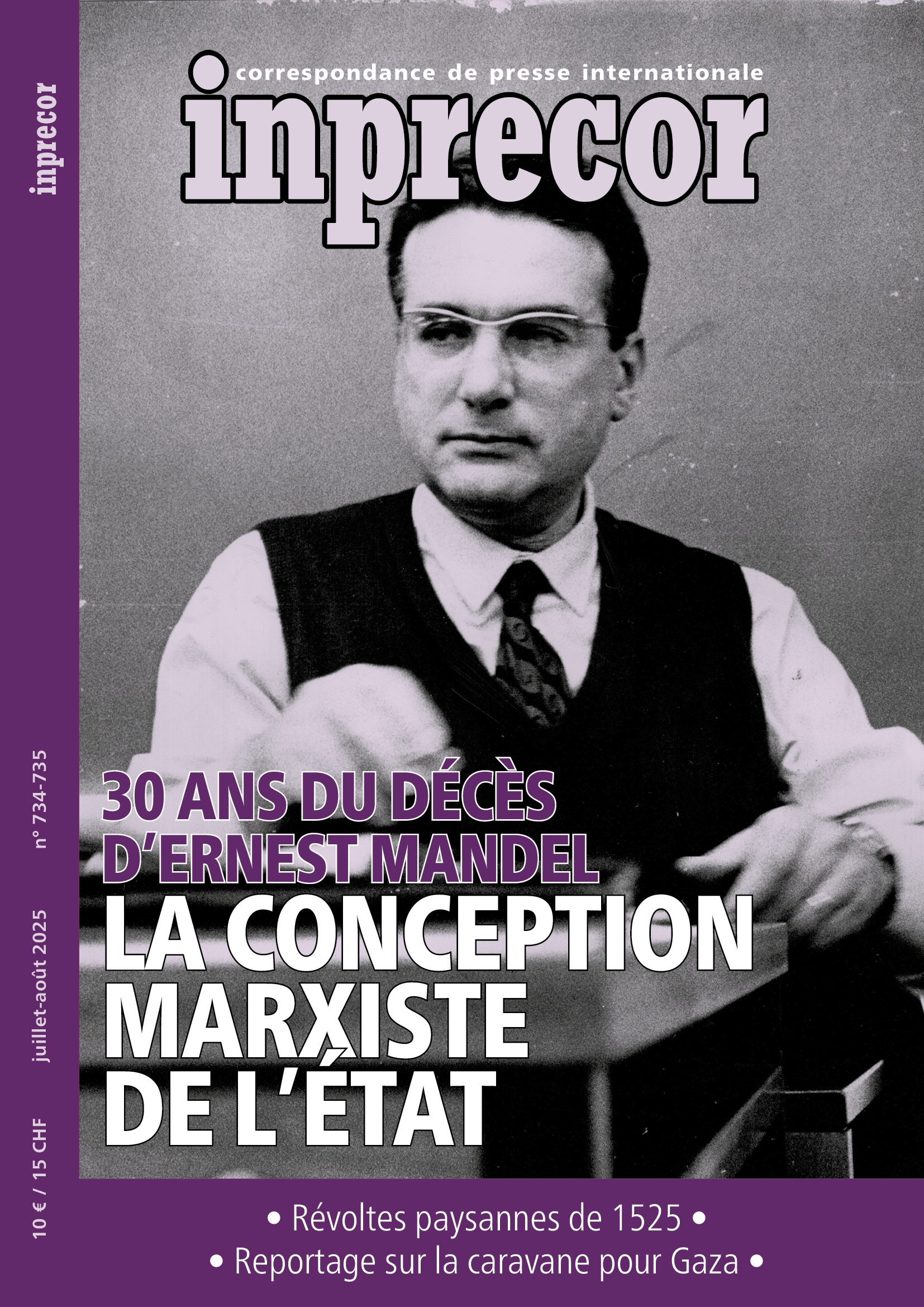Depuis novembre 2024, les étudiant·es serbes mènent une révolte sans précédent contre le gouvernement corrompu de Vučić. Avec deux camarades belges de la Gauche anticapitaliste, nous nous sommes retrouvé·es à Belgrade pour les rencontrer.
Devant la fac de philosophie de Belgrade : une table et des chaises de camping sont installées. Une dizaine d’étudiants et étudiantes emmitouflé·es dans des couettes surveillent l’entrée. Sur la table, des sudokus et des paquets de clopes pour faire passer le temps. Les étudiant·es font des tours de garde de 8 heures pour sécuriser la faculté devenue à la fois dortoir et Assemblée populaire. Plusieurs fois par semaine, des cours sont organisés et accessibles à toutes et tous. S’y déroulent également des assemblées décisionnaires où se dessine l’avenir du mouvement. Les étudiant·es nous accueillent avec le sourire, prennent la parole à tour de rôle, puis tous en même temps. Ils disent être là depuis le jour 0, six mois déjà.
Pour rappel, le 1er novembre dernier, l’effondrement de l’auvent de la gare de Novi Sad faisait 15 morts 1. Très vite, les étudiants se mobilisent contre le régime autoritaire d’Aleksandar Vučić, accusé d’avoir confié les travaux à des entreprises corrompues et incompétentes 2. Dans un pays où il est difficile de critiquer le pouvoir en place, les étudiants ont réussi un tour de force : ils « dépolitisent » le mouvement et refusent d’en faire une lutte partisane dans un pays traversé par des clivages profonds. Cette stratégie permet de rassembler largement, au-delà des lignes idéologiques. Ils articulent le mouvement autour de quatre revendications simples :
1. Publication de l’intégralité des documents relatifs à la reconstruction de la gare de Novi Sad, actuellement inaccessibles au public.
2. Confirmation par les autorités compétentes de l’identité de toutes les personnes raisonnablement soupçonnées d’avoir agressé physiquement des étudiant·es et des professeur·es, ainsi que l’engagement de poursuites pénales contre elles.
3. Abandon des charges contre les étudiant·es arrêté·es lors des manifestations, ainsi que la suspension de toute procédure pénale en cours.
4. Augmentation de 20 % du budget alloué à l’enseignement supérieur.
Sur ces revendications, la mobilisation est massive. Les étudiant·es parviennent à rallier une bonne partie du pays en usant de diverses techniques de mobilisation comme des marches à travers tout le pays pour déjouer la propagande d’État. La mobilisation atteint son apogée le 15 mars 2025 où 400 000 personnes déferlent sur la capitale3. Mais que s’est-il passé depuis ? Pourquoi les médias français ne donnent plus de nouvelles des Balkans ?
Le gouvernement joue l’usure face à des jeunes à bout de souffle
Face à cette contestation persistante, le gouvernement n’a pas tardé à réagir en jouant la montre et en instrumentalisant le calendrier universitaire. Nous sommes fin mai, les examens approchent. Le gouvernement utilise le calendrier en sa faveur pour faire pression sur les étudiant·es. Leur décision est prise : ils passent les examens, conscients d’aller à l’échec. Ils décident de sacrifier une année d’apprentissage pour l’avenir de leur pays.
En réponse à un potentiel échec généralisé aux examens de fin d’année, le gouvernement serbe menace de privatiser les universités en prétextant l’insuffisance du système public qui ne parviendrait pas à garantir le succès de ces élèves. Face à ce jeu d’échecs, les étudiants, de moins en moins nombreux, témoignent d’un épuisement général : « at the beginning people came, now we are burnt out » (Au début, les gens venaient, maintenant nous sommes épuisé·es). Bien que toujours soutenu·es par une majorité de la population, le nombre de militant·es actifs s’amenuise : « we are not enough people, now our shifts are from 8 to 11 hour » (Nous n’avons pas assez de monde, nos équipes sont actives de 8 à 11 heures). Ils sont de moins en moins nombreux à venir tenir les barricades universitaires : « we are the bravest soldiers » (Nous sommes les soldats les plus courageux) disent les dernier·es restant·es.
En plus des pressions du gouvernement, ils doivent faire face aux magouilles de ce dernier, qui use de techniques de propagande et de décrédibilisation peu fairplay. Les étudiant·es dénoncent les Studenti koji žele da studiraju littéralement les « étudiant·es qui veulent étudier », terme qui désigne un groupe orchestré par le gouvernement qui campe devant le parlement pour contrecarrer les protestataires 4.
Malgré la fatigue et les stratégies politiques vicieuses, le mouvement résiste, notamment grâce à un fonctionnement horizontal très bien rodé.
Un mouvement qui se revendique sans hiérarchie, apolitique et apartisan
Devant l’université, les étudiant·es prennent la parole à tour de rôle, aucun ne se démarque vraiment des autres. Au début du mouvement certain·es auraient essayé de s’imposer mais ont été rapidement écarté·es. Le mouvement ne revendique aucun·e chef·fe. Dans les médias, ce ne sont jamais les mêmes visages : « we want to promote the demands, not people » (Nous voulons mettre en avant des revendications, pas des personnes). Le mouvement revendique une horizontalité totale : « we are against hierarchy » (nous sommes contre la hiérarchie).
Ils se revendiquent également apolitiques et apartisan·nes pour rassembler le plus largement possible et prévenir les tentatives de récupération par l’opposition politique voire même par certain·es professeur·es qui veulent tirer profit du mouvement pour obtenir des postes dans un éventuel gouvernement d’expert·es.
Dans les faits le mouvement est traversé par des divisions politiques profondes
Derrière cette façade apolitique, se dessine pourtant une ligne idéologique plus affirmée. Les étudiant·es de la faculté de philosophie expliquent : « this is a communist movement by essence » (Le mouvement est communiste par nature). Ils défendent l’idée d’un Social Front qui donnerait le pouvoir au peuple : « let the people decide » (laissons le peuple décider). Le Social Front n’existe pas encore en tant qu’entité formelle en Serbie, mais il s’agit d’une proposition politique émanant du mouvement étudiant. L’idée est de créer un réseau large et horizontal regroupant étudiant·es, travailleur·ses, agriculteur·ices et autres groupes sociaux, unis par une opposition commune à la corruption et à l’autoritarisme du gouvernement Vučić. Ce projet vise à dépasser les clivages traditionnels, en refusant les récupérations partisanes et en promouvant une démocratie directe et participative5.
La faculté de philosophie dont font partie les étudiant·es interviewé·es, ancrée à gauche, critique ouvertement les autres établissements jugés trop conciliants avec les institutions libérales. Eux défendent une ligne anti-européenne et souverainiste, convaincue que l’UE méprise la jeunesse serbe. À plusieurs reprises, ils ont tenu l’UE responsable des bombardements de 1999 « we are not fond of the EU » (nous ne sommes pas favorables à l’UE) 6. À l’inverse, d’autres universités restent tournées vers Bruxelles et semblent attendre une réponse de l’Union européenne et souhaitent reproduire des sociétés libérales sur le modèle des autres pays européens. Mi-mai, une vingtaine d’étudiants ont parcouru 2 000 km en courant de Novi Sad à Bruxelles en espérant une réponse des institutions européennes, qui affichent un soutien discret au gouvernement Vučić 7
Comment l’Europe et la France négocient-elles les droits humains et la démocratie ?
La France ou la « grande démocratie européenne » qui vend des Rafale à un autocrate
Le 9 avril dernier, Emmanuel Macron a reçu le président Vučić, sans un mot pour le mouvement étudiant ni pour la dérive autocratique du pays8. Comment expliquer que face à un déni démocratique aussi évident, les pays européens détournent le regard ?
La complicité silencieuse française pourrait s’expliquer au regard des intérêts économiques et géopolitiques. Depuis 2019 et sa réinsertion dans les Balkans, la France affiche une stratégie qui privilégie la coopération en matière de sécurité et d’économie, au détriment des exigences démocratiques. Paris préfère ouvrir un nouveau marché pour ses investisseurs, plutôt que de lutter contre la corruption. En juillet 2023, Vučić signait avec Macron un contrat historique : l’achat de douze avions de chasse Rafale pour un montant de 3 milliards d’euros. Le président français saluait alors une « démonstration d’esprit européen » 9. Une somme colossale pour un pays où le salaire minimum ne dépasse pas 400 euros mensuels, mais qui renforce les liens militaro-industriels entre Paris et Belgrade. Et la France ne s’arrête pas là. Elle est engagée dans plusieurs projets stratégiques en Serbie : Vinci exploite l’aéroport de Belgrade, Michelin y possède une usine de pneus à Pirot, et des discussions sont en cours pour la construction de centrales nucléaires en partenariat avec EDF et Framatome.
Cette politique s’inscrit dans un cadre plus large nommé « stabilocratie »10, soit le soutien tacite à des régimes autoritaires dès lors qu’il garantit la sécurité politique et l’accès aux marchés. En préférant ses contrats à ses principes, la diplomatie française alimente un statu quo géopolitique qui enracine un régime autoritaire au détriment d’une société civile qui réclame la démocratie.
L’Europe du marché, pas des peuples
Le silence français fait écho au silence européen. Le président serbe a même été publiquement félicité par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, saluant son « sens des responsabilités » et le « potentiel économique » du pays, sans un mot pour les violations démocratiques et la corruption du régime. En 2023, sous couvert de transition écologique, l’Union européenne a relancé le très controversé projet minier de Rio Tinto, suspendu en 2022 grâce à une mobilisation écologiste et citoyenne. Un projet d’extraction de lithium pour alimenter l’industrie européenne, au mépris des écosystèmes locaux et de la population directement concernée. La jeunesse serbe est sacrifiée sur l’autel de la transition « verte » européenne 11. La même année, la Serbie a reçu la plus grosse subvention européenne de son histoire, soit plus d’un demi-milliard d’euros pour la rénovation du corridor ferroviaire Belgrade-Niš.
Il faut aussi rappeler que la Serbie est un point stratégique pour Bruxelles. Elle se situe sur la route des Balkans et permet d’externaliser le contrôle migratoire. La Serbie fait office de tampon et s’autorise refoulements illégaux, violences policières et négations des droits de humains 12. Ainsi, l’Europe ne se mouille pas les mains et Vučić en se faisant le gardien de la « forteresse » s’achète l’indulgence politique de Bruxelles. L’UE craint aussi un basculement vers la Russie, partenaire économique et marché potentiel. Malgré son statut de pays candidat à l’adhésion, la Serbie refuse d’aligner ses sanctions sur celles de l’Union européenne contre Moscou. En maintenant des liens économiques avec la Russie, Vučić joue habilement de cette position de « non-aligné », oscillant entre promesses d’intégration européenne et proximité assumée avec le Kremlin. Ce double jeu inquiète Bruxelles, qui redoute que Belgrade ne devienne un cheval de Troie russe au cœur du continent. Autant d’intérêts économiques et géostratégiques qui justifient, pour les dirigeants européens, de fermer les yeux sur un gouvernement illibéral et des pratiques autoritaires. On peut se demander à quoi sert l’Union européenne si elle sacrifie sa jeunesse au nom du libre-échange, de la sécurité et des rapports géopolitiques ? 13)
Et après ? Est-ce que « l’histoire est terminée » ?
La mobilisation s’essouffle 14. Vučić annonce à ses partisans que « l’histoire est terminée ». Lucides sur la situation, les étudiant·es de la faculté de philosophie n’envisagent plus que deux options : « either we stop or there will be civil war » (Soit nous arrêtons, soit il y aura une guerre civile). Ils insistent de nouveau, leur objectif principal est de mobiliser les Serbes avant tout : « we want to mobilise our people » (nous voulons mobiliser notre peuple). Ils ne veulent pas simplement changer de gouvernement, mais le système tout entier. Alors que les étudiant·es serbes nous rappellent que l’émancipation ne viendra ni des gouvernements ni des institutions, mais des peuples en lutte, nous pouvons nous poser la question de notre rôle dans cette solidarité internationaliste qu’il reste à construire.
Le 29 mai 2025
- 1
- 2
Pour plus de contexte voir « Serbie : Premières victoires des mobilisations étudiantes », Catherine Samary, 6 février 2025, L’Anticapitaliste et « Manifestations étudiantes en Serbie : “Le mouvement ne peut pas se permettre de s’arrêter maintenant” », Vladimir Unkovski-Korica, 4 février 2025, Inprecor.
- 3
« Serbie : marée humaine à Belgrade contre la corruption », 15 mars 2025, le Monde avec AFP.
- 4
Voir « Camp de protestation Ćaciland », Wikipedia.
- 5
« Mouvement étudiant en Serbie : “Un État-providence, c’est ce dont notre pays a besoin” », Novi Plamen, 25 février 2025, Contretemps et « Serbie : un nouveau front étudiants-travailleurs », Patrick Le Trehondat, 4 avril 2025, Cerises la coopérative.
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
« Serbie: malgré des résultats, les manifestations anti-Vucic perdent de leur ampleur », Laurent Rouy, 22 mai 2025, RFI.