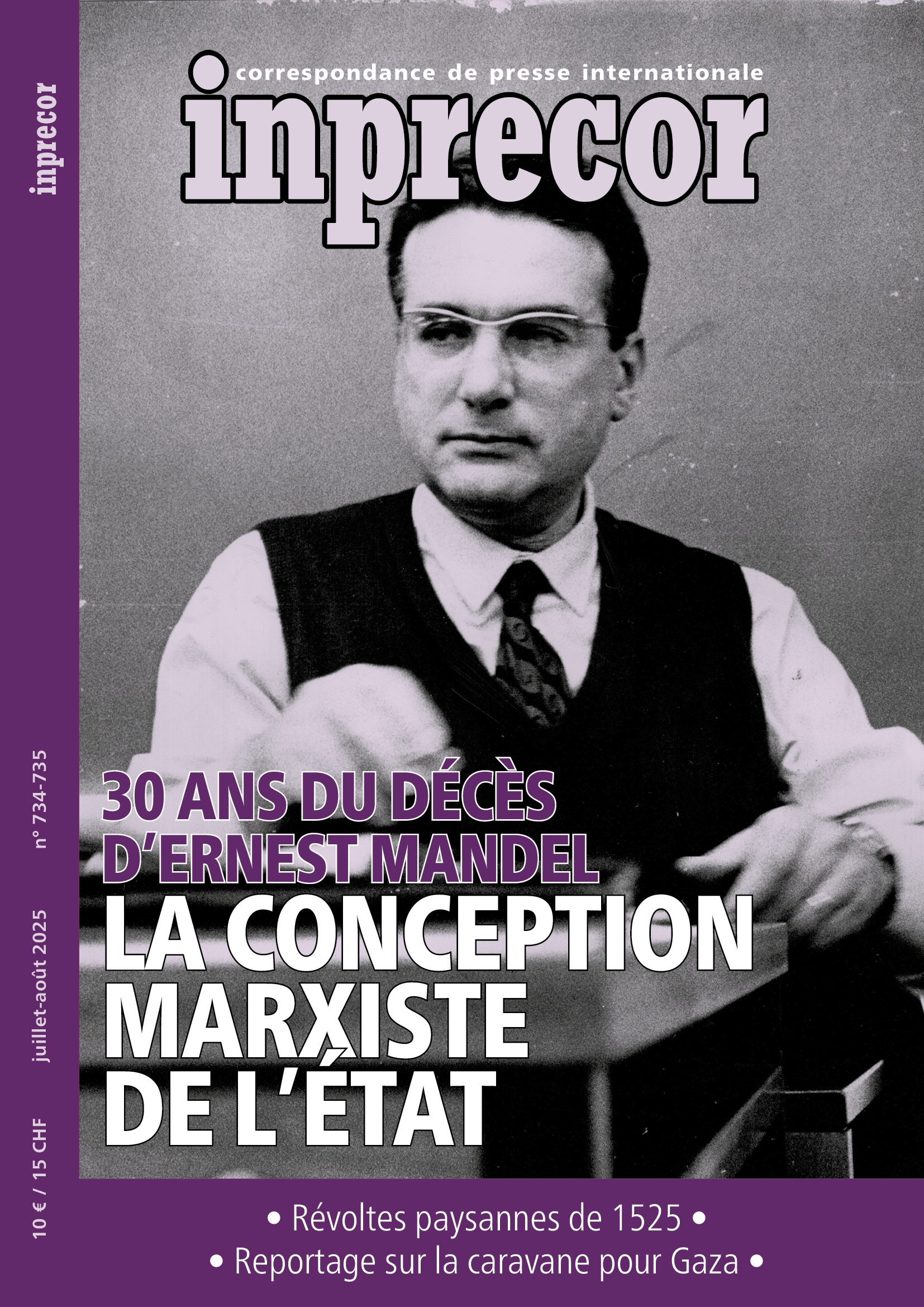Les changements politiques intervenus en Syrie après l’effondrement du régime, suivis d’une autre dynamique de changement dans la structure du pouvoir politique au Liban voisin et surtout dans la guerre génocidaire menée par Israël contre le peuple palestinien, annoncent un changement fondamental et assez significatif pour le devenir de cette partie du monde qui est le Moyen-Orient.
Ces changements coïncident avec le retour au pouvoir de D. Trump. S’agit-il d’une simple coïncidence dans cette suite d’événements ou peut-on dire que l’un est la conséquence de l’autre ? Question importante au regard de la posture de « procureur du monde » affichée par le président américain.
Avec un léger recul, ces changements prennent toute leur signification : il y a une sorte de consensus recherché entre les puissances économiques et militaires du nouveau monde impérialiste. En effet, le retrait silencieux de l’armée de Poutine de la Syrie, laissant le pouvoir de B. el Assad totalement désarmé devant l’insurrection de l’armée d’al-Joulani, qui n’est par ailleurs qu’une insurrection d’un groupe armé, le silence lointain de la Chine, l’acquiescement des européens à ce changement qui leur a échappé, le consentement du monde arabe et surtout la rapide valse diplomatique de tout ce beau monde pour la légitimation du pouvoir désormais entre les mains de celui considéré il y a quelque temps de « terroriste », sont autant de signes qu’un nouveau rapport de force est désormais établi. Ça sonne plus comme une allégeance au nouvel homme fort, mais une allégeance avec des soubresauts inattendus.
Même le repli sans gloire de l’Iran, qui prétend incarner « l’axe de résistance », apparaît comme une retraite négociée dans les coulisses de la diplomatie des vainqueurs. Seule la résistance réelle des palestinien·nes et des libanais·es est la grande perdante. Toutefois sur ce dernier point, si le cessez le feu acquis constitue dans le court terme un apaisement salutaire pour le Palestine, le Liban voire la Syrie, dans l’attente d’une réorganisation des forces de résistances capables de mener les populations de la régions vers un avenir juste et démocratique à la hauteur de leurs aspiration légitimes, il ne constitue pas une victoire du Hamas ou encore une défaite d’Israël, même si symboliquement, on doit au Hamas le mérite et surtout la légitimité de sa résistance.
Des effets de la nouvelle donne politique en Syrie au niveau régional
Nous savons que toute la stratégie des États-Unis, des penseurs et des spécialistes militaires qui dirigent ce pays est que la seule façon de maintenir l’hégémonie américaine est de tout fragmenter en petits bouts, de sorte qu’aucun pays n’émerge qui puisse les défier. Et c’est ce qu’ils tentent de faire partout de manière souvent aventureuse voire irréfléchie. C’est ce qu’ils ont encouragé en Yougoslavie, c’est ce qu’ils ont fait au Moyen-Orient en déstabilisant les pays qui ont des armées qui menaçaient Israël et l’hégémonie américaine dans la région, sans parler de l’Afghanistan et des tentatives de déstabiliser l’Amérique latine, etc.
Mais dans l’immédiat, c’est la Libye qui subit la première les dégâts collatéraux d’un redéploiement militaro-sécuritaire des puissances régionales. En effet, la Libye est affectée par la chute surprise du régime Assad en Syrie. Les autorités de l’ouest libyen de Tripoli, sous l’impulsion de la Turquie, se sont empressées de nouer des relations avec le nouveau pouvoir syrien, alors que les autorités de l’est du Maréchal Haftar accueillent de plus en plus de matériels militaires issus des bases russes installées en Syrie.
Profitant des nouvelles donnes politiques et diplomatiques de la région, la Turquie qui ambitionne d’accroître davantage son influence au Moyen-Orient comme en Afrique, est en train d’ancrer sa présence en Libye. Le transfert depuis la Syrie de lourds matériaux militaires russes vers l’est libyen renforce l’idée d’Ankara de se maintenir en Libye où elle possède plusieurs bases militaires aériennes et maritimes. Elle soutient l’un des deux camps libyens rivaux, en l’occurrence celui de l’ouest libyen à caractère islamiste. Ce qui met mal à l’aise le pouvoir algérien qui considère que la Libye est sa chasse gardée notamment vis-à-vis du pouvoir russe qu’il considère comme un allié. De même pour l’Égypte qui est réticent face au nouveau pouvoir islamiste syrien, très lié à Ankara. Elle est en concurrence économique avec cette dernière en Libye et trouve que l’intervention militaire turque nourrit la division libyenne, ce qui menace directement sa sécurité.
De « l’axe de résistance » au repli nationaliste de l’Iran
La déroute militaire de l’Iran et la défaite du Hezbollah au Liban puis en Syrie bouleverse le logiciel socio-politique et géopolitique de la République islamique iranienne qui est désormais contrainte de se replier sur son territoire, sur ses enjeux nationaux et ses ambitions de puissance régionale, au moment où Israël multiplie les appels aux États-Unis pour qu’ils interviennent militairement.
Après l’attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, à part un discours de soutien, l’Iran a tout fait pour ne pas être impliqué directement dans une guerre qui lui semblait sans issue et retire la plupart de ses milices du Liban et de Syrie, prévoyant un repli en bon ordre. Les « Gardiens de la révolution » n’ont pas combattu et se sont presque enfuis quand, en décembre 2024, les rebelles venus d’Idleb ont pris Alep puis Damas.
Les échecs militaires tant en Syrie qu’au Liban et l’incapacité du régime à riposter vigoureusement aux attaques israéliennes, en se contentant d’annonces de ripostes futures, effacent les succès militaires qui ont fait la gloire des pasdaran (gardiens de la révolution) dans le passé. Ces échecs les affectent aussi dans leur fondement idéologique. Le Guide suprême Ali Khamenei se retrouve à chercher surtout, avec ce repli, de sauver un régime islamique en perdition sous la pression des sanctions économiques américaines, de l’opposition internationale à son programme nucléaire, et surtout sous la pression de la société iranienne au niveau interne.
L’absence de commentaires de fond sur les événements du Liban et de Syrie montre qu’une page vient de se tourner et que l’intérêt supérieur de la République islamique n’est plus dans la résistance ou dans une intervention directe. En effet, le Guide suprême Ali Khamenei s’est contenté de déclarer que « ce qui s’est passé en Syrie est le résultat d’un plan conjoint américano-sioniste », pour reconnaître plus tard que l’Iran « n’avait pas besoin de relais dans la région ». Chacun a compris que « l’axe de la résistance » était brisé.
Il est toutefois un peu tôt pour faire des déductions sur le devenir prochain de la République islamique. La vitalité du nationalisme iranien et le consensus qui existe en Iran sur la souveraineté du pays restent solides. Il reste pour le guide suprême, à court terme, de négocier la question nucléaire pour une levée des sanctions économiques.
Pour Donald Trump qui ne regarde le monde que du point de vue des intérêts économiques et des profits que peuvent engranger les entreprises américaines, l’Iran pourrait devenir, avec ses richesses en hydrocarbures et ses 90 millions d’habitants dont le niveau d’instruction est élevé, un terrain économique favorable et un moyen de contrer les ambitions chinoises. L’Iran ne peut pas être sourde aux attentes de D. Trump, dans la perspective de se construire comme une puissance régionale capable de contribuer avec l’Arabie saoudite à la « sécurité de la région » et peut-être au « règlement de la question palestinienne », au moment où Trump déclare « ne pas vouloir de changement de régime ni de conflit armé ».
C’est dans ce sens que le repli de l’Iran et l’abandon de « l’axe de résistance » semble être le fruit d’une négociation en sourdine.
Les priorités américaines
Le retour au pouvoir de Donald Trump semble donc avoir des conséquences, peut-être même être la cause, des changements en cours dans ce Moyen-Orient géopolitiquement stratégique pour le développement du capital désormais mondial et transnational.
De ce point de vue, on peut considérer que si le 7 octobre 2023 le Hamas a replacé la question palestinienne au cœur des enjeux proche-orientaux et internationaux, Netanyahou est parvenu à rebattre les cartes en Palestine comme dans la région de manière spectaculaire, en détruisant Gaza, en affaiblissant l’Iran et le Hezbollah et en favorisant, par conséquent et involontairement, la chute du régime de Bachar el Assad.
Dans ces conditions, on peut estimer que la nouvelle administration de Donald Trump, face à la concurrence croissante avec la Chine, cherchera à renforcer ses alliances pour réaligner la région sur les priorités américaines en évitant l’affrontement avec l’Iran affaiblit.
Mais, les intérêts américains dans la logique de D. Trump, pourrait entrer dans un conflit difficile avec ses principaux alliés, l’Europe et Israël. Ce dernier pourrait se sentir encouragé à attaquer l’Iran pour déstabiliser d’avantage la région, dans une logique de fuite en avant.
Mais les grands perdants de cette montée de l’Amérique de D. Trump semblent être les Européens. Ces derniers ont, séparément, applaudi les changements en cours en Syrie et en Palestine mais avec toutefois de la méfiance à l’endroit des États-Unis. Cette méfiance s’est accentuée après l’investiture du nouveau président face à son approche jugée très perturbatrice et ses objectifs incompatibles avec ceux du vieux continent. Ce n’est pas tant la volatilité et la cruauté du président qui dérange, comme le présentent les médias, mais c’est surtout le consensus recherché auprès des nouveaux puissants, russes et asiatiques, qui perturbe le capitalisme européen malmené par la crise ukrainienne, par le redéploiement russe au sahel subsaharien et les investissements chinois en Afrique et le monde arabe et qui se voient renvoyés à la périphérie du nouveau capitalisme qui se dessine.
C’est dans ce sens qu’il faut situer et comprendre la crise européenne et ses contradictions internes, particulièrement au niveau énergétique en Allemagne et en France. C’est ce qu’explique en partie la montée de l’extrême droite fascisante et ses corollaires la tension diplomatique Franco-algérienne mais aussi Franco-africaine.
L’opportunisme algérien douteux.
L’Algérie de Tebboune, encore sous l’onde de choc du Hirak, est malmenée et fragilisée par manque de légitimité politique. Le régime maintient une gestion de main fer au niveau interne. Mais se sentant rassuré par son autonomie financière et fort par la position géostratégique du pays au niveau énergétique et gazier, mais aussi sur le plan militaire pour jouer son rôle dans la bataille « sécuritaire » dans cette région du sahel subsaharien, le couple Tebboun/Chengriha répond vigoureusement aux injections diplomatiques de la France « Macroniste » et de son extrême droite et caresse dans le sens du poil la fierté nationale face à l’ancien colonisateur, comme dosage idéologique.
Mais, si cette posture de dignité nationale reste politiquement juste et légitime pour la souveraineté du pays, elle reste molle et hypocrite se noyant dans du discours sans actions. Car les engagements réels politiques, économiques et militaires de l’Algérie s’éloignent de plus en plus de la neutralité anti-impérialiste voire de l’antisionisme.
Proche de cet « axe de résistance » autour du soutien à l’ancien régime syrien, le gouvernement de Tebboune accuse la défaite de celui-ci et tente de s’éloigner et de tourner la page moyen-orientale et de la question palestinienne. Les pourparlers avec l’OTAN augurent un rapprochement avec l’axe des puissants et des vainqueurs du moment. L’adhésion au BRICS est renvoyée aux calendes grecques. De ce point de vue, la polémique diplomatique avec l’extrême droite française sert à cacher ses déboires régionaux.
Il affiche néanmoins une stabilité et une « sérénité » au niveau interne. Il exhorte la population à faire preuve de résilience avant que l’économie ne se redresse dans ses projets de long terme. Son pouvoir absolue ne semble pas inquiété. Le régime Tebboune/Chengriha incarcèrent à volonté toute voix discordante, s’engage dans la « discipline » de la finance, purge de façon répétée l’appareil et l’administration, l’état-major de l’armée, les services secrets… L’Algérie reste un marché régional qui ne peut être ignoré, mais y investir est devenu un jeu risqué, plongeant dans l’hésitation le capital international. On peut parler d’une fragilité du régime aux soubresauts imprévisibles.
Il reste en arrière-plan les protestations et grèves des étudiant·es de médecine, de la jeunesse des lycées et celles du monde enseignant, qui tentent d’émerger, mais que personne n’évoque, ni les média, ni les forces politiques, ni même les réseaux sociaux,
Il y a dans le l’univers du militantisme algérien une sorte de déracinement politique et un exil intérieur qui se manifeste par un intérêt pour les affaires du monde, au détriment de celles de leur propre pays. Ce phénomène traduit un sentiment profond d’impuissance et de désillusion face à la situation nationale, et un repli stratégique vers des débats extérieurs sans conséquence réelle sur leur quotidien. il y a surtout l’exil des nouvelles générations, une jeunesse qui n’habite plus vraiment ce pays, si ce n’est physiquement.
Pour ne pas conclure….
Dans un récent article sur la Chine et l’ambivalence de D. Trump, P. Rousset souligne que « La mondialisation heureuse (pour le Capital) appartient à un passé déjà lointain. La crise de la démondialisation lui a succédé, ouvrant un espace aux conflits géopolitiques entre États et à des replis protectionnistes partiels. Cependant, on ne se libère pas facilement des interdépendances tissées par la formation d’un marché mondial unique et l’internationalisation des chaînes de production. Elles sont toujours vivaces, alors que d’autres enjeux s’invitent à l’attention des gouvernants, comme les guerres et le réchauffement climatique ».