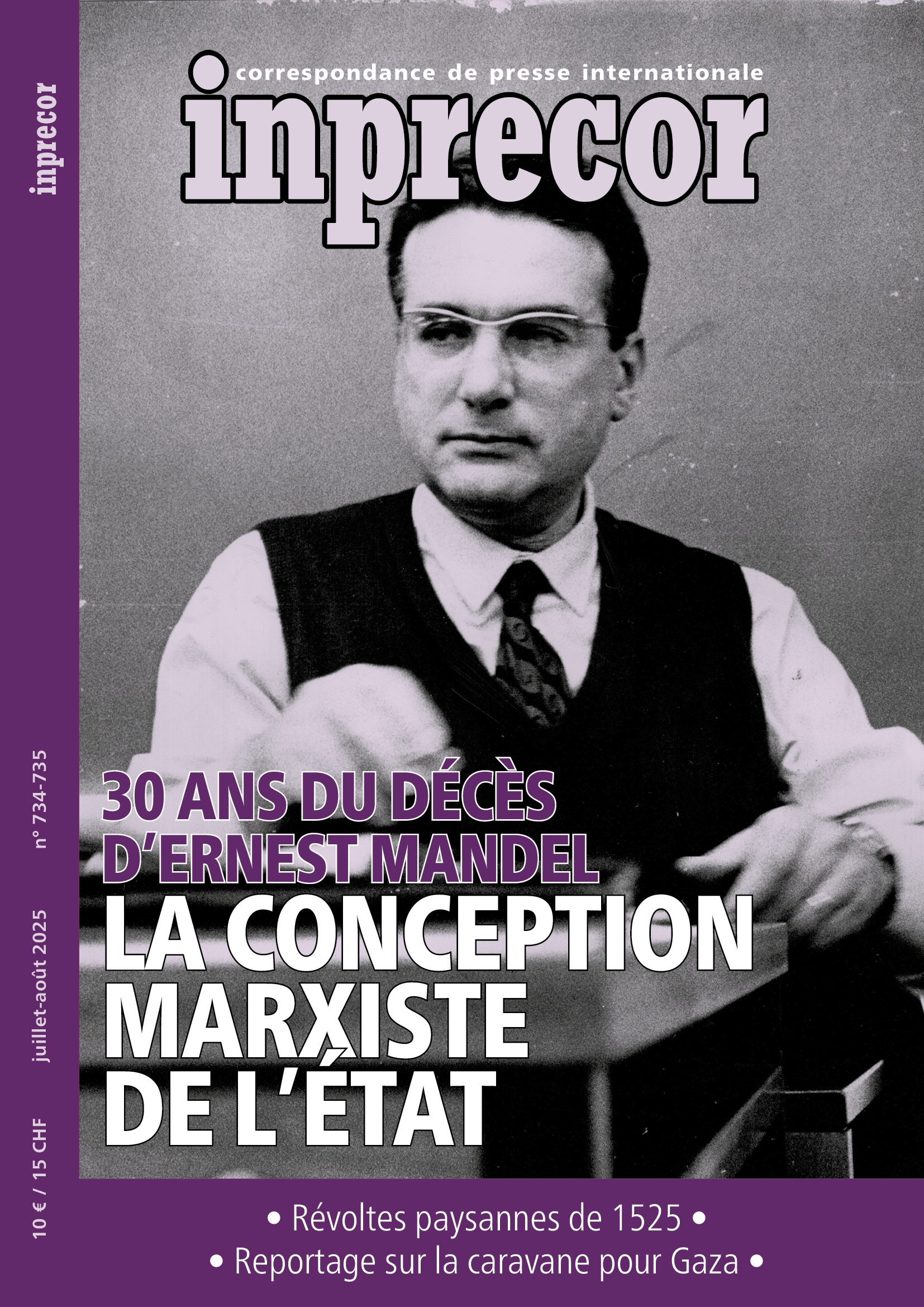11 juin 2025, aéroport d’Alger. Quatre valises s’alignent sur le tapis de contrôle. À l’intérieur, ni drapeaux ni banderoles : juste des vêtements neutres, des maillots de bain et des batteries portables. Sarah Lalou, Yakouta Benrouguibi, Doha A. et Amel Hadjadj jouent les touristes. Leur véritable but ? Rejoindre la Global March to Gaza, une mobilisation internationale pour briser le blocus de Gaza.
En Algérie, où les manifestations sont étroitement contrôlées, notre participation relève du pari. Pourtant, en 48 heures, le mouvement féministe algérien s’est auto-organisé pour rendre possible cette mission : sécuriser les visas selon des options stratégiques, acheter les billets, contacter les camarades en Égypte, et élaborer un plan de communication sécurisé.
6 juin - Préparer l’impossible : logistique et sororité, dans un mouvement éclair
Prendre la décision de participer au nom du mouvement féministe s’est imposé dans la précipitation, après un échange téléphonique début juin avec la réalisatrice et actrice algérienne Adila Bendimerad, qui m’a dit : « La force des masses peut faire pression, et nous n’avons pas le droit d’être absentes face à l’atrocité que vivent les Palestinien·nes ».
Je me suis interrogée : est-ce une action qui a du sens, ou juste une agitation ? Qu’est-ce que cela peut apporter à ces milliers de personnes sous les bombes ? J’avais du mal à décider. Puis j’ai consulté mes camarades féministes pour trouver qui accepterait de m’accompagner pour cette marche de trois jours dans le désert égyptien jusqu’à Rafah.
Louisa Aït Hamou, Soumia Salhi, Fatma Oussedik – toutes ont accueilli avec enthousiasme cette nouvelle forme d’action de masse, un internationalisme renouvelé qui ne se limite pas à l’occidentalisme. Elles voulaient toutes participer, mais ont reculé face aux conditions physiques, vu leur âge. J’ai multiplié les appels à mes camarades de ma génération. Certaines étaient réticentes, d’autres partantes mais freinées par leurs situations – maternité, responsabilités immédiates.
Ma décision s’est cristallisée en écoutant l’intervention de l’eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, parlant depuis le bateau Madleen de la Flottille de la liberté : « On tente d’apporter un minimum. Cela ne suffira pas à répondre aux besoins des Gazaouis, mais symboliquement, cela ouvrira une brèche et fera pression sur les États qui n’agissent pas concrètement ».
Au début, je rejoins le groupe de la délégation des artistes constitué par Adila Bendimerad : partage d’infos, relais des messages des organisateurs/trices de la Global March, suivi et analyse de la trajectoire de la caravane Soumoud et de la flottille. De l’autre côté, les messages continuent à circuler chez les copines féministes.

9 juin - Construire une équipe
Trois jours après l’achat de mon billet d’avion, le jour où la Flottille de la liberté a été kidnappée en eaux internationales par l’entité sioniste, deux camarades féministes, Yakouta et Sarah, me contactent pour m’informer qu’elles se sont rendues disponibles pour la Global March. Je décide alors, avec les autres membres du Journal féministe algérien, de centraliser l’information, sortir des communications téléphoniques bilatérales et rédiger un email à l’ensemble de nos partenaires du mouvement féministe, en précisant le besoin d’aide pour porter cette action.
Les réponses ne tardent pas : dès les premières minutes, plusieurs expliquent qu’elles y pensaient, mais avaient du mal à accéder aux informations concrètes. Pas une seule réponse négative. Chacune tente d’apporter ce qu’elle peut : un contact, la prise en charge d’un billet, une batterie portable, un message de soutien, un conseil…
C’était un moment qui rappelait que ce mouvement n’est pas la reproduction d’un féminisme blanc ou bourgeois : c’est un mouvement profondément anticolonialiste et décolonial. Dans toute notre diversité, nous partagions la même colère et la même énergie, active, prête à tout risque pour les peuples opprimés.

10 juin
Au matin, une camarade féministe, Lyna TBD, nous apprend qu’une autre jeune féministe, Doha, essaie de partir et voudrait rejoindre cette mini-délégation. Le reste des camarades est informé, et une nouvelle course commence pour intégrer la jeune Doha au groupe.
11 juin au soir
Embarquer vers un acte de solidarité
Alors que nous nous préparions à prendre l’avion, la nouvelle tombe : des refoulements et des contrôles démesurés se multiplient en Égypte. C’est comme un coup de foudre. Panique dans les deux délégations qui partent ensemble (artistes et féministes). Puis, nous nous ressaisissons.
La consigne est claire : ne pas reculer, rester vigilantes, se faire passer pour des touristes, comme prévu. Entre le 12 et le 15 juin, les organisateurs devaient négocier les autorisations pour partir à Rafah. Il fallait aussi changer nos bagages, vu les fouilles attendues à l’aéroport du Caire : plus de drapeaux, enlever les tentes et sacs de couchage, préparer des valises avec des affaires de touristes.
Ce jour-là, le communiqué que nous devions lancer une fois arrivées à Rafah a abouti à un texte final soumis à signature et traduction.
Les informations sur les contrôles et risques d’expulsion ont poussé les camarades égyptiennes à nous proposer de nous héberger chez elles. Imane, mon amie égyptienne, m’a contactée et a insisté bien que je lui aie expliqué et répété qu’on risquait d’être retenues des heures à l’aéroport du Caire : « Quand vous serez chez moi, on dormira toutes pour récupérer ».

Arrivée au Caire : contrôle, visas, fouille
À l’aéroport du Caire, la tension est immédiate. L’obtention des visas et le passage à la police des frontières prennent des heures. Les contrôles sont renforcés, les bagages fouillés dans le moindre détail : chargeurs, affaires personnelles. Chaque objet est scruté, chaque geste surveillé. Nous restons fermes, répétant inlassablement : « Nous sommes là pour le tourisme ».
Alors que nous attendons notre tour, nous sommes témoins d’une scène glaçante : un groupe d’Algériens est expulsé. Ils scandent haut et fort des slogans de résistance au milieu d’un couloir gardé par des policiers lourdement armés, équipés comme s’ils étaient prêts à la guerre. Leur présence imposante et leur posture martiale rappellent la militarisation du contrôle des frontières dans les États dits autoritaires, où la répression des voix dissidentes s’exerce par une violence physique et psychologique systématique. Cette militarisation et cette surveillance accrue ne sont pourtant pas l’apanage des seuls régimes autoritaires : dans lesdites démocraties, le contrôle des frontières peut être plus subtil, mais reste tout aussi violent, en particulier par l’imposition de politiques migratoires racistes et discriminatoires qui restreignent le droit fondamental à la libre circulation.
Cette scène d’expulsion illustre brutalement la dimension politique de notre voyage. Le contrôle étatique ne se limite pas à la simple gestion des flux de visiteurs, mais s’inscrit dans une logique sécuritaire visant à étouffer toute forme de contestation ou de solidarité internationale susceptible de remettre en cause l’ordre impérialiste et colonial.
12 juin
L’accueil d’Imane : un refuge fraternel
Ce n’est que vers 6 heures du matin que nous sortons enfin de l’aéroport, épuisées mais soulagées.
Dehors, le taxi pour aller chez Imane nous attend. Elle a insisté : nous ne devons pas aller à l’hôtel, trop dangereux à cause des contrôles et des surveillances. Sa maison devient notre premier refuge. Nous dormons quelques heures pour reprendre des forces.
S’organiser, se déclarer, rester prudentes
La journée est d’abord consacrée au repos et aux démarches imposées.
La Global March to Gaza nous demande de déclarer nos noms, ce que nous faisons. Nous prenons aussi contact avec l’ambassade d’Algérie en Égypte, qui nous écoute et assure un suivi prudent, sans promettre de protection directe en cas d’arrestation.
Le sit-in au syndicat des journalistes : un premier acte collectif
En fin d’après-midi, vers 19 h, nous rejoignons discrètement le sit-in devant le syndicat des journalistes égyptiens, guidées par nos camarades égyptiennes.
Autour de nous : militantes et militants de la gauche égyptienne, journalistes, anciens détenus d’opinion. Les slogans exigent l’autorisation de la Global March, la levée du blocus, la fin de la complicité des États.
Nous tentons de nous fondre dans la foule, de passer pour des Égyptiennes, mais la prudence est de mise, la tension permanente.
Les consignes des organisateurs : l’attente du point de départ
Tard le soir, les organisateurs nous annoncent : le lieu de départ sera communiqué le lendemain à 10 h 30. Nous restons en veille, prêtes à agir, conscientes des risques.
13 juin - La journée où tout bascule
Un petit-déjeuner plein de sens
Avant de recevoir les consignes pour notre départ, nous partageons un moment suspendu : un petit-déjeuner palestinien avec la mère de Bissan Aouda, la conteuse, créatrice de contenus et journaliste de Gaza, connue pour sa phrase qui a traversé les écrans et les frontières : « I’m Bissan, I’m still alive. »
La mère de Bissan, réfugiée au Caire depuis quelques mois, est là avec ses quatre sœurs et ses deux frères, tous déracinés par la violence de la guerre. Ensemble, iels tentent de reconstruire un semblant de quotidien, loin de Gaza mais le cœur toujours tourné vers leur terre.
Autour de ce repas simple et fort – pain frais, huile d’olive, zaatar 1, olives, labneh – les échanges sont intenses. La mère de Bissan nous parle des conditions de vie des réfugié·es palestinien·nes au Caire, des épreuves quotidiennes, de l’exil qui s’éternise sans réponse.
La conversation glisse vers la vision politique des femmes palestiniennes, la douleur des pertes récentes, mais aussi la force incroyable des femmes dans la continuité de la lutte. Elle évoque ce que la résistance signifie aujourd’hui : « Nous résistons par la vie, par la reproduction, par le refus de l’extermination. Chaque enfant qui naît est un non à l’effacement ».
Ce moment nous bouleverse. Il nous rappelle que notre marche, nos actes, nos slogans ne sont qu’un fil parmi d’autres de cette immense tapisserie de luttes, portée au quotidien par ces femmes.

10 h 30 - Les consignes du départ vers Ismaïlia
Les consignes tombent : impossible de partir vers Al Arish depuis Le Caire, il faut se rapprocher au maximum, Ismaïlia devient notre prochaine destination. Nous devons partir en petits groupes, en taxi, sous couvert de tourisme.
Yakouta Benrouguibi, juriste et militante féministe, relit les lois égyptiennes et rappelle la gravité des risques encourus en cas d’arrestation : « Tentative de franchissement de zone militaire, atteinte à la sûreté de l’État » peuvent conduire à la prison pour des décennies.
Nous décidons d’y aller malgré tout.
13 h 30 - Un trajet sous tension
Un VTC accepte de nous emmener, tentant un itinéraire par Port Saïd, plus long mais qui nous mettrait hors de soupçon en cas d’arrestation et de contrôle policier.
Chaque checkpoint est un gouffre dans l’estomac, avec messages d’alerte sur des arrestations et confiscations de passeports.
Dans le véhicule, le silence est lourd, et le poste radio est mis à fond à chaque checkpoint pour convaincre qu’on est des touristes emportées par les vibrations de la musique.

Le blocage à Ismaïlia
Arrivées aux abords d’Ismaïlia, tout s’arrête. Les forces de l’ordre bloquent l’entrée. Nos passeports sont confisqués. On nous ordonne de faire demi-tour, et nous sommes escortées hors de la ville. Au premier checkpoint, on nous fait descendre. Le chauffeur ne peut pas attendre.
Nos passeports sont rendus nationalité par nationalité. Pour les Algérien·nes, l’attente est plus longue, l’incertitude plus pesante.
Enfin, nous atteignons les abords d’Ismaïlia. Mais là, tout s’arrête net. Les forces de l’ordre bloquent l’entrée : plus personne ne passe. Nos passeports sont confisqués sans un mot. « On a senti que ça se resserrait, que la marge de manœuvre disparaissait » témoigne l’une d’entre nous.
On nous ordonne de faire demi-tour, escortés hors de la ville. À la sortie de cette dernière, au checkpoint le plus proche, on nous fait descendre. Le chauffeur, inquiet, ne peut pas attendre. Nous récupérons nos affaires, épuisées mais déterminées.
Les passeports sont rendus nationalité par nationalité. Pour les Algérien·nes, l’attente est plus longue, l’incertitude plus pesante. Nous apercevons les drapeaux, les visages, les regards de celles et ceux qui comme nous n’ont pas renoncé.
La naissance d’un sit-in international
C’est là, au checkpoint, que la solidarité se matérialise. Un drapeau palestinien se lève. Puis un autre. Puis un drapeau algérien, un drapeau suisse, marocain, tunisien. Les slogans fusent : « Free Palestine ! » « End the blockade ! » « Stop bombing Gaza ! »
Nous sommes des dizaines, puis des centaines à nous asseoir sur l’asphalte brûlant. Un moment de révolte partagée, un cri commun né du désespoir et de la dignité. Des copines en Algérie assurent la communication. Le communiqué part, relayé au-delà des frontières.
Ce communiqué était au cœur de notre engagement. Fruit d’une écriture collective, de réflexions, de relectures, d’émotions partagées et de convictions ancrées. Intitulé « Nous, militantes et organisations féministes algériennes, marchons vers Gaza », ce texte portait la voix d’un féminisme algérien profondément anti-impérialiste et décolonial, fidèle à l’héritage des luttes de notre peuple contre la colonisation. Nous y affirmions que notre combat pour les droits des femmes est indissociable de celui contre l’oppression des peuples, contre le colonialisme et contre l’impérialisme qui écrasent les vies, en Palestine comme ailleurs.
Ce communiqué ne se voulait pas un simple texte d’intention : il était un acte politique en soi, un cri partagé avec plus de 3 000 participant·es venu·es de 80 pays qui s’étaient joints à la Global March for Gaza – et au convoi terrestre Sumud. Il rappelait que la marche n’était pas une solution miracle, mais un refus de l’inaction, une manière de briser le silence complice face au génocide en cours à Gaza, perpétré par l’occupation sioniste et ses alliés. Chaque mot y portait la douleur des milliers de morts, des enfants affamés, des femmes assassinées sous les bombes, mais aussi la dignité d’un peuple debout et la responsabilité des États et des peuples de se tenir à ses côtés.
Nous y dénoncions sans ambiguïté la complicité des puissances qui arment l’oppresseur, nous appelions les États à briser leur silence, à agir pour un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus, la fin de l’occupation. Nous appelions les peuples à marcher, partout, parce que rester immobiles serait trahir. Et nous affirmions : « Nous ne trahirons pas ».
Ce texte, signé par nos organisations, par nos noms, était aussi un bouclier moral face aux accusations possibles, une manière d’expliquer, d’assumer nos choix, tout en rappelant que notre action restait pacifique, respectueuse des lois locales, mais ferme dans ses revendications. Il portait ce qui faisait l’essence même de notre présence : dire que la Palestine sera libre, et que tant que l’injustice règnera, nous marcherons.

Le soir - Le piège se referme et la répression est brutale
Le jour décline, les négociations au point mort, les forces de l’ordre arrivent en nombre : bus, camions, véhicules blindés. Le message tombe : « Vous avez fait passer votre message. Maintenant, partez ».
Nous refusons : comment partir alors que des camarades n’ont pas récupéré leurs passeports ? Que Gaza saigne ? Les menaces montent : « Soit vous partez, soit c’est l’expulsion immédiate ».
La nuit tombe. Des hommes en civil, masqués, surgissent. Ils frappent, arrachent, humilient. « C’était une violence froide, méthodique. Rien de sauvage, mais tout d’efficace ». Les manifestant·es sont traîné·es, embarqué·es dans des bus vers des destinations aléatoires : aéroport, commissariats, autoroutes abandonnées.
Nous, par chance ou par malheur, nous sommes dans le bus qui ne sera pas concerné par les expulsions immédiates.
Dans le bus : la confusion, et la nouvelle qui nous traverse
Nous sommes, par la force physique et la violence, monté·es dans le bus, les corps endoloris, les nerfs à vif. À l’intérieur, le silence est lourd, entrecoupé de soupirs, de larmes étouffées, de regards échangés pour tenter de se rassurer. Chacun et chacune essaie de comprendre : où allons-nous ? Quelle sera la prochaine humiliation ?
Et c’est dans ce huis clos étouffant qu’une information surgit sur Facebook : l’Iran a répondu à l’attaque d’Israël. Un manifestant, téléphone encore tremblant dans sa main, souffle : « L’Iran… L’Iran vient de bombarder Tel-Aviv ». Un frisson parcourt le bus. Nous nous regardons, sidéré·es. Ce n’est pas la peur, ni la joie simple : c’est la conscience d’un basculement inattendu.
Un manifestant à côté de moi lâche, presque à voix basse : « Ça doit être le seul point positif de l’histoire du régime des mollahs ». Une autre, plus jeune, nuance aussitôt : « Il faut aller doucement… L’Iran ou pas, ça reste des terres palestiniennes. »
Les mots flottent, suspendus, alors que le bus cahote dans la nuit. Chacun et chacune pèse ce que cela veut dire : une riposte légitime, oui, mais une guerre qui s’étend, un risque plus grand, des peuples pris en étau.
Ce moment, dans ce bus exigu, avec la peur dans nos ventres et les voix basses qui analysent, témoigne de l’esprit de cette Global March : sa radicalité. Une radicalité consciente, critique, collective.
Et en regardant autour de nous, nous le voyons clairement : les groupes dominants dans cette marche, ceux qui restent jusqu’au bout, ce sont des anarchistes, des militant·es d’extrême gauche, des féministes anticolonialistes. Celleux qui n’ont aucun drapeau d’État, seulement celui des peuples.
Finalement, on est déposées à 20 minutes du centre du Caire, par un hasard miraculeux. Nous avons vécu la peur, la colère, mais aussi la beauté d’une solidarité sans frontières. Ce que je retiens ? L’extraordinaire courage des gens qui nous ont aidé·es : le peuple égyptien, les camarades anonymes, ceux qui ont pris des risques pour nous héberger, protéger, nourrir.
Nous avons vu les limites de la diplomatie, la brutalité des États, mais aussi la force des peuples. Aucune lutte féministe n’est complète si elle ignore l’ordre colonial global. Ce jour-là, nous avons vu ce que cela veut dire : résister, ensemble, sans drapeau d’État, mais avec les drapeaux des peuples.
Par précaution, nous décidons de ne pas rentrer tout de suite chez Imane, de peur de l’exposer si nous étions suivies.
Presque trois heures plus tard, sur la route vers la maison de notre hôte, notre VTC est arrêté, nos passeports confisqués de nouveau. Le chauffeur, solidaire, improvise une histoire : nous serions ses clientes, des touristes. Il négocie, nous récupérons nos passeports.
Chez Imane, l’accueil est d’une chaleur réconfortante, un prolongement de la solidarité internationale.

14 juin
Bilan et prudence
L’ambassade d’Algérie au Caire nous contacte de façon inattendue. L’interlocuteur salue notre engagement en nous qualifiant d’« héritières des moudjahidate », mais rappelle les limites de la diplomatie : en cas d’arrestation, peu pourra être fait. Il propose une aide matérielle que nous refusons, ne voulant pas exposer Imane.
Nous restons confinées, par prudence, en contact avec nos camarades et organisateurs. Il est inutile de risquer des arrestations dans un contexte de refus radical des autorités égyptiennes.
16 juin
Dernières heures au Caire
Après une journée calme, nous préparons nos bagages. L’après-midi, nous participons à une réunion au siège du parti El Karama, avec des partis de gauche, pour parler de la marche, de la caravane Soumoud, du contexte régional et de la riposte iranienne.
Plus tard dans la nuit, nous partons pour l’aéroport. Nos contrôles se passent bien, d’autres subissent fouilles et arrestations. Dans l’avion, les slogans montent, un dernier cri collectif.
Nous assistons alors à un acte de solidarité inattendu : Un pilote refuse de décoller tant que les 15 Algériens arrêtés ne sont pas libérés. Après deux heures, l’avion décolle enfin.
C’était seulement symbolique : mais c’était important
Cette expérience est une illustration concrète du féminisme intersectionnel et décolonial qui marque le mouvement féministe algérien contemporain. Nous ne sommes pas simplement des femmes marchant pour Gaza ; nous portons une critique globale du système mondial d’oppression, un héritage des luttes anticoloniales algériennes qui se traduit aujourd’hui par un engagement internationaliste solidaire.
La répression vécue démontre comment l’ordre mondial capitaliste et impérialiste, consolidé par des États complices, s’emploie à museler toute voix contestataire, en particulier celles qui défendent les opprimé·es et les peuples colonisés. Notre démarche féministe refuse la fragmentation des luttes : les droits des femmes sont intrinsèquement liés à la lutte contre le racisme, le colonialisme, le capitalisme et le militarisme.
En rejoignant la Global March to Gaza, nous avons voulu matérialiser ce féminisme politique qui prend en compte l’interconnexion des dominations. Cette action collective, même si limitée par la répression, est un acte de résistance politique féministe qui refuse de laisser les femmes, les enfants et hommes palestinien·nes isolé·es, invisibilisé·es ou réduit·e.s à des victimes passives. Elles et ils sont actrices/eurs de leur lutte, et notre solidarité se veut un appui à leur pouvoir de vie, de résistance et de transformation sociale.
L’épreuve du voyage, les tensions, les refus d’entrée, la brutalité policière ont aussi mis en lumière la précarité politique du militantisme internationaliste, soumis aux logiques sécuritaires des États, mais aussi la force du collectif et de la sororité transnationale.
Ce parcours montre aussi que l’action féministe politique ne se limite pas à un espace symbolique : elle engage des corps, des risques, des stratégies, et nécessite des réseaux de soutien solides et agissants.
Ce périple, marqué par la solidarité, la violence étatique, et la détermination, est un témoignage éclatant de la nécessité d’un féminisme décolonial, antiraciste et internationaliste. Nous, militantes féministes algériennes, avons incarné la continuité d’un combat historique contre toutes les formes d’oppression, des femmes algériennes moudjahidate aux femmes palestiniennes sous blocus.
Notre marche n’était pas une simple promenade, mais un acte politique radical, un refus clair de l’injustice et de la complicité silencieuse des États. Dans un monde où les frontières se durcissent, où les solidarités sont souvent empêchées, notre action a dessiné un espace de résistance transnationale, porté par la force collective des femmes et des peuples en lutte.
Ce jour-là, au milieu de la répression, nous avons appris que la solidarité féministe internationale est un rempart face à la barbarie, une source d’espoir et une arme contre l’oppression.
Parce que tant que Gaza saignera, tant que la Palestine est sous occupation, tant que les femmes, les minorités politiques et tou·tes les opprimé·es resteront éloignées de leurs droits, tant que l’impérialisme et le capitalisme priorisent la militarisation, l’armement et la guerre : notre lutte féministe et décoloniale ne saurait s’arrêter.
Le 28 juin 2025
- 1
Le zaatar est mélange d’épices du Moyen-Orient. Le labneh est un fromage frais salé, du yaourt égoutté.