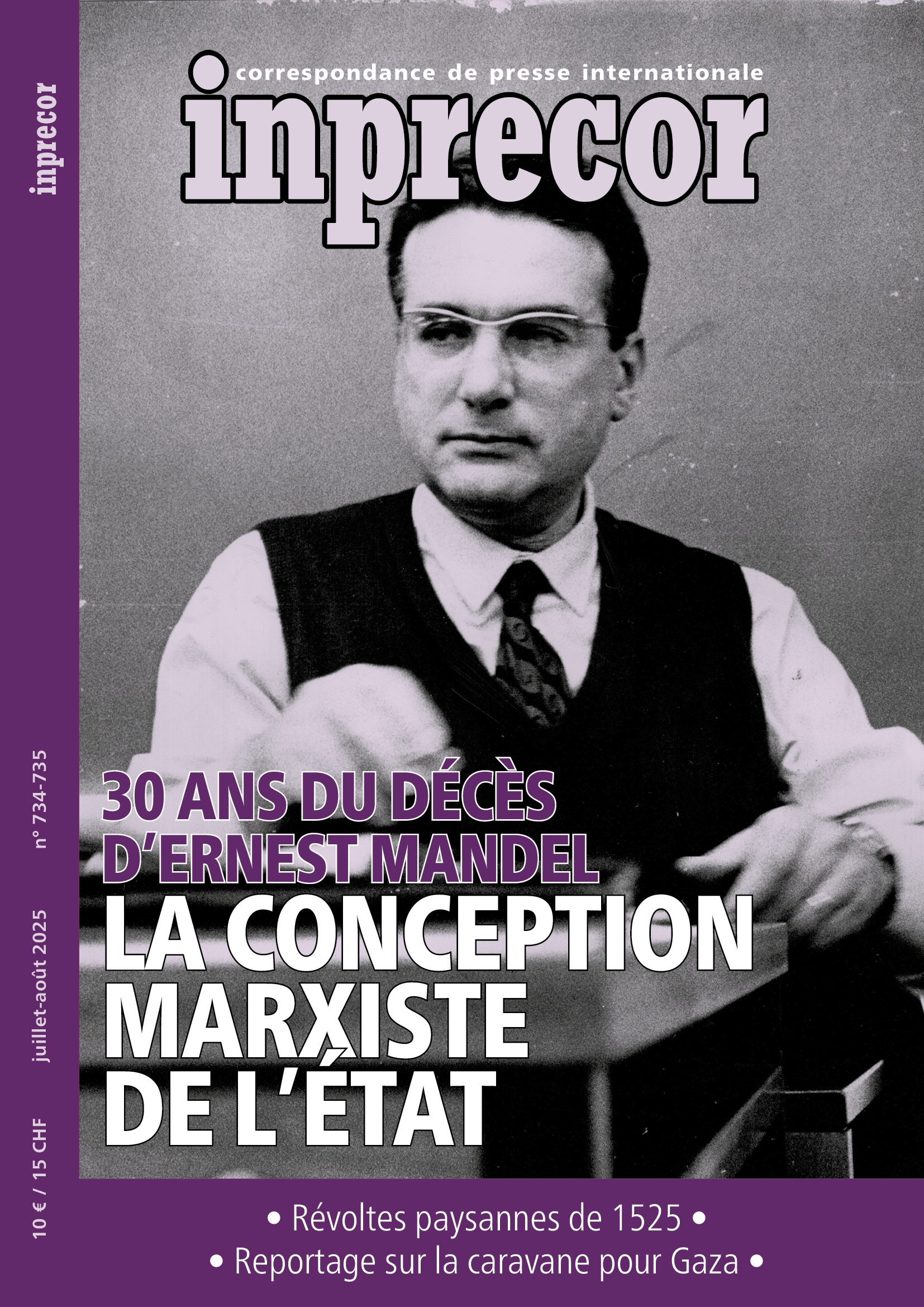La panne d’électricité du 28 avril dernier a bouleversé pendant quelques heures la péninsule ibérique et le sud de la France. Toutes celles et ceux qui y vivent ont été touchés d’une manière ou d’une autre. Cela a fait l’objet de nombreuses discussions qui, pour ne pas rester au stade de l’anecdote, compte tenu des risques systémiques qu’une telle situation se reproduise, exigent une analyse et une réflexion approfondies. Il faut en tirer des leçons pour l’avenir.
En ce sens, on peut dire que le système énergétique se trouve à un tournant historique. L’urgence climatique, la fragilité géopolitique et la raréfaction des ressources nous obligent à repenser la manière dont nous produisons, distribuons et consommons l’énergie. Dans ce contexte, l’augmentation de la capacité énergétique basée sur les énergies renouvelables apparaît comme un enjeu crucial.
Mais tout développement n’est pas bon à prendre : il reproduit en effet bon nombre des logiques du système fossile qu’il est censé remplacer, car le modèle de transition énergétique actuel est mené par de grandes entreprises privées, dont l’objectif est la rentabilité. Un oligopole privé a pénétré et accaparé toutes les sources et technologies, y compris les énergies renouvelables, et est protégé par l’État et par un système de prix qui lui garantit des marges et un marché, dans le secteur le plus rentable de l’économie espagnole. Face à cette situation, il est urgent de défendre une transition écosocialiste juste, démocratique et planifiée qui place au centre la vie et le bien-être collectif.
Comment fonctionne le système électrique ?
Le système électrique n’est pas la forme principale sous laquelle l’énergie nous parvient et ne représente que 24 % du total de l’énergie utilisée, le reste provenant de sources fossiles utilisées pour le transport ou le chauffage. Le réseau électrique nécessite une infrastructure complexe qui permet à l’électricité produite d’atteindre les points de consommation de manière instantanée, continue et sûre. Pour comprendre les défis actuels et les décisions que suppose sa transformation, il est important de connaître ses éléments clés et leurs interactions.
Le système électrique comprend quatre grandes phases :
• Production d’électricité dans des centrales (thermiques, nucléaires, hydroélectriques, solaires, éoliennes, etc.).
• Acheminement de l’électricité à haute tension sur de longues distances via un réseau de lignes de transport.
• Distribution de l’électricité en moyenne et basse tension aux foyers, aux entreprises et aux services.
• Consommation : utilisation finale de l’énergie électrique par les utilisateurs domestiques, industriels ou publics.
Le système électrique centralisé exige que la production et la consommation soient équilibrées à tout moment. Cela nécessite un contrôle technique continu, généralement automatisé, afin d’ajuster l’offre à la demande réelle, la production à la consommation, seconde par seconde. Pour répondre à cette exigence, il faut non seulement une surveillance et une coordination adéquates, mais aussi combiner des technologies présentant des caractéristiques très différentes, certaines plus difficiles à gérer que d’autres – c’est le cas des énergies renouvelables – dans la production qui contribue au système électrique.
Les caractéristiques des technologies de production d’électricité
En résumé, les principales technologies actuelles présentent les caractéristiques suivantes.
Centrales thermiques fossiles (gaz, charbon, fioul)
Elles contribuent à la gestion du système électrique centralisé actuel en ayant l’avantage de pouvoir être mises en marche ou arrêtées en fonction de la demande. Elles ont également une puissance installée et une inertie élevées qui assurent la stabilité au système.
Cependant, elles sont très polluantes, émettent de grandes quantités de CO₂ et d’autres gaz, sans oublier la dépendance extérieure qu’entraîne le recours à l’importation de ces sources, l’incertitude causée par les troubles géopolitiques et d’autres risques environnementaux et sanitaires graves.
Centrales nucléaires
On attribue souvent à cette technologie le mérite d’une production continue et contribuant à la stabilité du réseau, en raison de son inertie. Mais il faut savoir que cette continuité n'est pas un avantage, mais un élément de rigidité, car si les centrales peuvent être arrêtées, leur remise en service est très lente et très coûteuse. Le fait de devoir produire en permanence est exactement le contraire de ce dont le système de réseau centralisé a besoin. Les lobbies nucléaires essaient de promouvoir leur technologie, avec le mantra de sa stabilité, mais elle implique d’adapter le système et le reste des sources d'énergie.
Il est également vrai qu’elles n’émettent pas directement de CO₂, mais différents éléments rendent totalement inenvisageables leur utilisation dans le cadre de la transition écologique à moyen et long terme : même si leurs coûts d’exploitation sont faibles, leurs coûts d’investissement sont élevés, ce qui les rend peu rentables ; leur durée de vie est limitée à quelques décennies et il en découle des coûts de démantèlement et de réinvestissement très élevés ; la gestion des déchets radioactifs s’étend à l’échelle géologique et il n’existe pas de conteneurs capables de résister à la corrosion pendant plus d’un siècle ; et malgré les améliorations en matière de sécurité, les risques à long terme font de l’improbable un danger certain, comme pourrait l’affirmer Ulrich Beck1, sans oublier la consommation d’eau nécessaire au refroidissement des centrales.
Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables représentent l’alternative, mais elles ne sont pas exemptes de contraintes. Tout d’abord, le système de réseau électrique centralisé est mal adapté aux énergies renouvelables.
L’énergie éolienne est propre, ainsi que l’énergie solaire photovoltaïque, et celle-ci est en outre modulaire et facile à installer. Toutes deux ont de faibles coûts d’exploitation. Mais elles sont intermittentes, plus difficiles à gérer, nécessitent de grandes surfaces disponibles et le modèle technologique actuel ne génère pas d’inertie. Pour accroître leur compatibilité dans un environnement stable, avec le système actuel, elles nécessitent des solutions de stockage ou de secours, qui sont aujourd’hui insuffisantes. Dans les pays où l’eau est abondante, comme les pays scandinaves, les centrales hydroélectriques fonctionnent bien, mais dans les pays touchés par des sécheresses récurrentes, comme le nôtre, les batteries constituent une alternative. Celles-ci sont également coûteuses, tant en termes économiques qu’en termes de matériaux critiques (lithium, cobalt, nickel), avec l’empreinte écologique qui en découle, tandis que l’hydrogène est peu efficace comme accumulateur et que ses utilisations seront limitées.
Plus on intègre d’énergies renouvelables intermittentes, plus le réseau électrique devient techniquement complexe. C’est pourquoi, parallèlement à la production renouvelable, il est indispensable de promouvoir un modèle décentralisé et distribué de manière à ce que l’autoconsommation dans des communautés énergétiques, qui réduit la pression sur le réseau central, soit privilégiée. Il faut aussi appliquer des politiques de gestion de la demande qui encourage la consommation aux heures où la production est la plus élevée. À cet égard, certaines mesures peuvent déjà être prises. Dans la mesure où le système électrique nécessite une synchronisation entre la production et la consommation, quel sens cela-t-il qu’au printemps et en été, la tranche de consommation la plus chère corresponde aux heures les plus ensoleillées ? Il faudrait au contraire que l’électricité soit moins chère pendant les heures les plus ensoleillées de la journée à cette période de l’année.
Ce qui ne fonctionne pas dans le développement actuel des énergies renouvelables
Loin de constituer une véritable alternative au système fossile, le déploiement actuel des énergies renouvelables est guidé par la logique du marché et non par les besoins sociaux ou écologiques. Les entreprises privées investissent de manière désordonnée, en privilégiant les zones où le raccordement au réseau électrique est le plus accessible et rentable, et celles où la consommation est plus importante, sans tenir compte des conséquences sur les territoires et des conflits avec les besoins des communautés rurales, qui sont souvent situées à proximité de ces mêmes points de raccordement.
Cette logique extractiviste des renouvelables ne réduit pas vraiment le recours aux sources non renouvelables : dans de nombreux cas, elle s’y ajoute simplement, tandis que les systèmes fossiles et nucléaires se maintiennent tant qu’ils continuent à générer des profits. En outre, la centralisation du système – qui reproduit le modèle fossile – à travers des méga-installations solaires et éoliennes et un réseau électrique centralisé qui nécessite une part importante d’énergies polluantes pour être stable, entre souvent en conflit avec les populations rurales, les usages agricoles traditionnels et la biodiversité.
Au lieu d’avancer vers une réduction de la consommation et une réorganisation du modèle énergétique, on reproduit un modèle productiviste qui se heurte de front aux limites écologiques de la planète.
Vers un modèle énergétique juste et durable
L’énergie est un bien commun essentiel. Elle doit donc être gérée par une planification publique, avec une participation démocratique communautaire, et non comme un domaine lucratif. Il est indispensable que les pouvoirs publics reprennent l’initiative dans la conception du système énergétique, en s’orientant vers un modèle qui combine :
• Les énergies renouvelables comme source principale, en réduisant et en remplaçant progressivement les énergies fossiles et nucléaires.
• Une distribution décentralisée et communautaire, avec des systèmes d’autoconsommation, des réseaux locaux et un stockage de l’énergie adapté à chaque territoire.
• Une collaboration avec les communautés rurales et urbaines, en intégrant des critères sociaux, environnementaux et paysagers dans le choix des sites et des modèles de gestion.
• Une participation démocratique aux décisions énergétiques, en reconnaissant l’énergie comme un droit et non comme une marchandise.
Ce modèle nécessite un investissement public soutenu, non seulement dans les infrastructures de production, mais aussi dans les réseaux de distribution intelligents, le stockage, l’efficacité énergétique et l’éducation technique et citoyenne. Un investissement public ne peut se limiter au financement des infrastructures dont les entreprises privées tirent profit ; il doit profiter à l’ensemble de la société. Par exemple, la location massive de batteries et de systèmes de stockage, bien qu’elle puisse contribuer à stabiliser le réseau électrique, revient également à réduire les coûts d’investissement que les entreprises privées auraient dû assumer. Si le secteur public loue des batteries à grande échelle, alors il serait logique que l’ensemble du système soit public, par une socialisation de ce secteur stratégique. Le coût, bien qu’élevé, sera toujours inférieur aux 5 % de dépenses prévues pour la Défense d’ici à 2030. Il s’agirait sans aucun doute d’une bien meilleure option.
Mettre en œuvre la socialisation n’est toutefois pas suffisant. Cela doit s’accompagner d’une planification du redéploiement des infrastructures et de modifications technologiques. Fondé sur les énergies renouvelables – et de manière marginale, sur le gaz pour les situations d’urgence – ce modèle doit remplacer les autres technologies et sources d’énergie, déployer un modèle décentralisé, et adapter les sources aux spécificités des territoires, par les décisions démocratiques de chaque communauté concernant l’emplacement des installations. De même, il semble indispensable que la réorganisation et le redéploiement des infrastructures s’effectuent dans le cadre d’une transition appuyée sur la recherche et l’innovation. Ainsi, elle pourra reposer de plus en plus sur des technologies low tech – appelées également « modestes » ou « légères » – indépendantes de l’industrie fossile et capables de minimiser l’utilisation des matériaux et de l’énergie, et s’inscrivant dans une « économie en spirale », dans laquelle on réintègre autant que possible les matériaux dans le cycle de la nature – en gardant à l’esprit que la thermodynamique est têtue à cet égard, comme le souligne souvent le professeur José Manuel Naredo 2. Tout en fournissant un service suffisant à l’ensemble de la population.
Souveraineté énergétique et territoire
Dans un monde de plus en plus marqué par les tensions autour du contrôle des ressources, l’autosuffisance énergétique devient un élément clé de la souveraineté. La péninsule ibérique, et en particulier le sud, dispose d’un potentiel énorme, suffisamment important pour satisfaire une grande partie de sa demande avec des énergies renouvelables. Mais cela exige un changement de modèle : il ne suffit pas de changer les sources énergétiques, il faut également transformer les rapports de forces qui structurent le système.
Une véritable souveraineté énergétique implique de décider collectivement quelle énergie doit être produite, comment, où, pour qui et avec quels impacts. Cela suppose de reconnaître que l’énergie n’est pas neutre, que son accès inégal conditionne tous les aspects de la vie et que toute transformation doit s’accompagner d’une justice territoriale et sociale, dont le premier pas est l’éradication de la précarité énergétique, en garantissant l’approvisionnement de base à toute la population, et en tenant compte des limites de notre biosphère.
Cette justice implique également, comme nous l’avons indiqué, de convenir de l’emplacement des installations selon des critères qui ne compromettent pas les possibilités et les besoins de la production agricole, ni les besoins des communes rurales, et qui incluent l’adaptation technique des infrastructures nécessaires. Par exemple, développer des éoliennes sans pales, qui transfèrent l’énergie par le biais de vibrations induites par des vortex – car les oiseaux suivent le même chemin que le vent exploité par ces dispositifs –, ou installer les fermes solaires sur des parkings, sur les toits des bâtiments et des industries et dans les zones rurales, de façon à avoir un impact moindre sur les populations, l’agriculture et la biodiversité.
Gardons également à l’esprit que nous devons multiplier ces infrastructures basées sur les énergies renouvelables – non pas pour les additionner aux technologies fossiles et nucléaires, mais pour les remplacer dans leur immense majorité.
Les limites biophysiques : la face cachée de la transition
On ne peut pas parler de transition énergétique sans reconnaître les limites matérielles de la planète. L’électrification de l’économie, nécessaire à bien des égards, ne doit pas être conçue dans le cadre d’une croissance illimitée de la production d’énergie renouvelable. Il semble nécessaire d’augmenter radicalement la capacité actuelle, à condition que cela ne se fasse pas de manière désordonnée et selon des critères de marché, mais en tenant compte des besoins et des conditions sociales, environnementales et techniques. Mais nous devons être conscients que cela implique de disposer de matériaux en quantités énormes, tels que le cuivre, le lithium et les terres rares, dont la disponibilité est limitée et dont le cycle de vie pose d’énormes défis écologiques. Cela impliquera également de poursuivre la recherche scientifique et de développer des infrastructures pouvant utiliser d’autres matériaux abondants, tels que l’aluminium qui, bien que moins bon conducteur que le cuivre, pourrait convenir à certaines activités.
Les infrastructures renouvelables actuelles dépendent indirectement des énergies fossiles pour leur extraction, leur fabrication, leur transport ou leur maintenance. Leur durée de vie est limitée – généralement pas plus de 30 ans –, ce qui implique de les reconstruire, et elles génèrent des déchets. Il ne suffit donc pas de changer les sources d’énergie, il est indispensable de transformer le modèle économique pour une économie sobre et juste, opérant des choix dans les besoins énergétiques à satisfaire, en évitant les consommations excessives et superflues, au lieu d’essayer de maintenir le même niveau de consommation.
Cela implique :
• De promouvoir des modes de vie et de consommation sobres, efficaces et partagés, sans renoncer à satisfaire les besoins liés au bien-être et à un mode de vie digne.
• De parier sur la mobilité publique, collective et électrifiée, en donnant la priorité au transport par rail et tramway, mais aussi par bus ou métro, et de réserver l’usage des voitures électriques en milieu urbain pour les services essentiels (taxi, ambulance, pompiers). Il s’agit aussi de développer des systèmes municipaux de transport partagés permettant de desservir les zones rurales non desservies.
• Donner la priorité à l’utilisation de l’énergie pour couvrir les besoins fondamentaux et les activités à forte utilité sociale.
Quelle politique économique pour quel modèle énergétique ?
Une transition énergétique écologique exige une politique économique au service du bien commun. Il ne s’agit pas seulement de changer la matrice énergétique, mais de construire un autre modèle de développement. Un modèle qui ne recherche pas une croissance illimitée, mais l’équilibre avec les limites naturelles et la justice sociale.
Cela nécessite :
• Une planification publique à long terme, avec des critères techniques, sociaux et écologiques ;
• Une négociation et une participation démocratique des communautés aux décisions stratégiques ;
• Une reconversion de l’emploi et de la formation professionnelle vers des secteurs écologiques ;
• Une décentralisation des systèmes de production et de distribution, en maintenant une articulation, voire une synergie, entre les différents systèmes.
Les élites économiques et politiques mondiales semblent avoir choisi une voie opposée : une transition autoritaire et antisociale, fondée sur le contrôle des ressources stratégiques, l’extractivisme, le recours croissant à la force, les inégalités et l’exclusion. Il s’agit d’un modèle où les combustibles fossiles, l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables extrêmement centralisées coexistent dans un système de plus en plus instable, extractif et militarisé. Un modèle qui se barricade pour faire face aux protestations, restreint les droits et consolide les privilèges d’une minorité.
Cette voie est non seulement socialement injuste, elle est aussi anti-écologique et politiquement insupportable. Elle va à l’encontre des intérêts de la majorité, en particulier des classes populaires et des peuples du Sud, et bloque toute possibilité de transition réelle vers un avenir viable.
Le modèle énergétique n’est pas une simple question technique : c’est une question profondément politique. Il détermine quelle vie est possible et pour qui. C’est pourquoi la lutte pour un nouveau système énergétique est aussi une lutte pour la démocratie, la justice et la dignité. De même, le système électrique n’est pas seulement un réseau technique : c’est aussi un champ de décisions politiques, sociales et écologiques. Chaque technologie a ses conditions, ses avantages et ses limites, et aucune, pas même les énergies renouvelables, n’est exempte d’impacts. C’est pourquoi une transition énergétique juste nécessite non seulement davantage d’énergies renouvelables, mais aussi une planification démocratique consciente, à partir du secteur public et des communautés, qui donne la priorité aux usages socialement nécessaires, minimise les impacts et distribue l’énergie de manière plus démocratique.
Éviter les coupures d’électricité à l’avenir ne dépend pas seulement de l’installation de plus de panneaux solaires ou d’éoliennes, mais d’une profonde refonte de notre mode de vie, de production et d’organisation. Nous avons besoin d’un modèle public, démocratique, à la hauteur des besoins, écologique et juste. Et nous devons le développer dès maintenant, car le modèle actuel est de plus en plus incertain et dangereux.
Le 6 juin 2025
- 1
Ulrich Beck (1944-2015), est un sociologue allemand, enseignant-chercheur à la London School of Economics, auteur de la Société du risque (1986), et de nombreux ouvrages et réflexions sur la gestion et la mitigation politique et économique des risques dans les sociétés occidentales contemporaines.
- 2
José Manuel Naredo Pérez (1942-…) est un économiste et statisticien espagnol, pionnier, chercheur et vulgarisateur de l'économie écologique en Espagne, domaine dans lequel il a apporté d'importantes contributions en tant qu’auteur et éditeur.