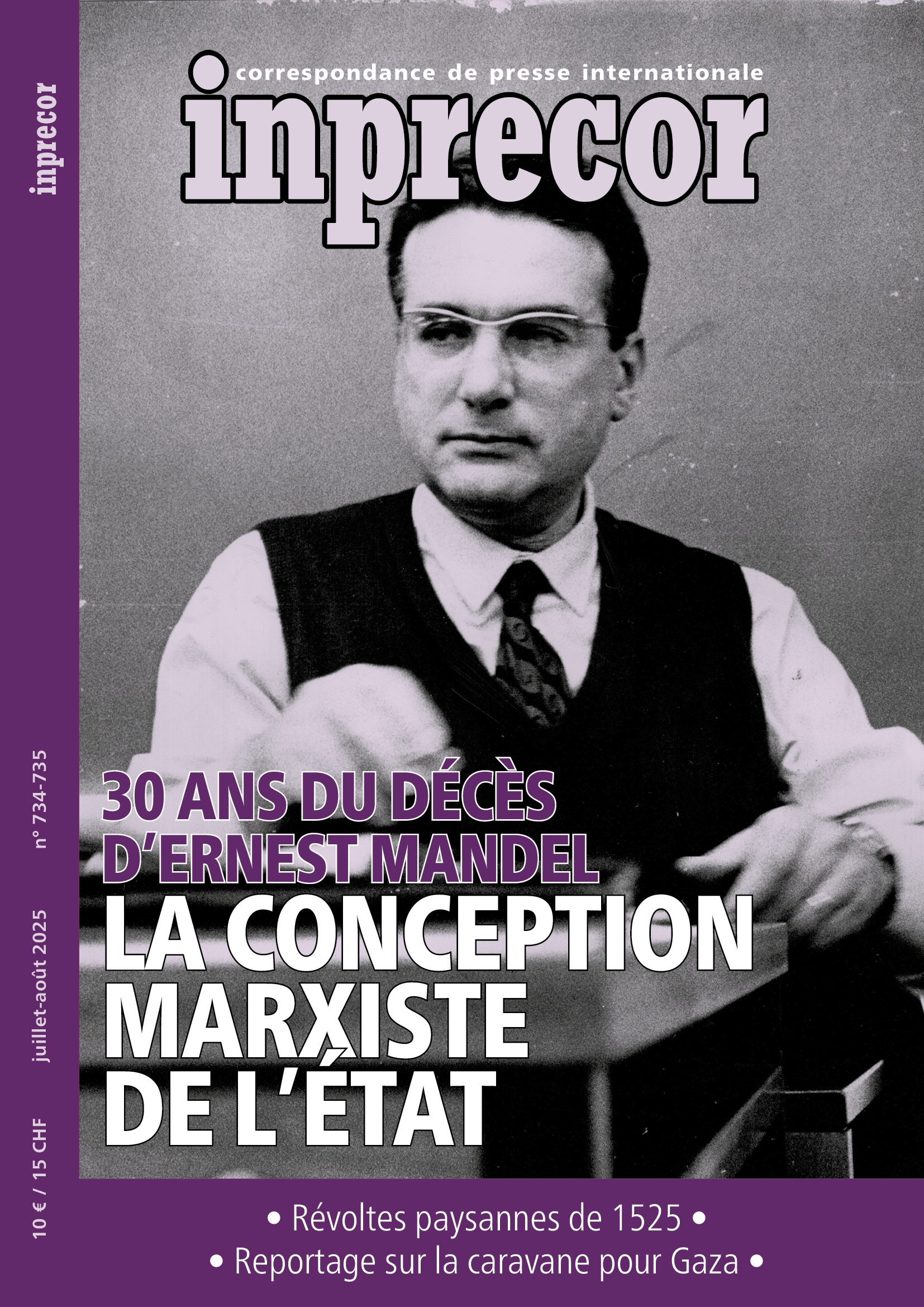Après le vote du dégel du corps électoral en Kanaky Nouvelle-Calédonie, qui rompt avec les accords de Nouméa signés à la fin des années 1990 et le processus de décolonisation de l’archipel, en vue de son accession à l’indépendance, après plus de 170 ans de colonisation de la Kanaky par la France. Exténuée par la surdité du gouvernement français et une situation sociale dégradée profondément injuste, qui discrimine majoritairement les populations kanak, une partie de celle-ci et notamment la jeunesse s’est soulevée. Des actions de blocage des routes et de quartiers ont eu lieu. Dès lors, des milices de colons armés se sont mis en place. Entretien avec Rock Haocas de l’USTKE, l’Union syndicale des travailleurs Kanak et exploités, et Dominique Fochi, secrétaire générale de l’Union calédonienne.
Comment les événements ont démarré là il y a quelques jours en Kanaky ?
Dominique Fochi : Tout ça aurait pu être évité si on nous avait écoutés. Déplacer autant de militaires, des GIGN, ça coûte de l’argent. Il fallait tout simplement retirer le projet de texte, parce qu’on avait expliqué, que ce soit aux parlementaires, au gouvernement, nos différents responsables ont expliqué aux différents représentants de l’État, le danger que représentait cette réforme. Nous, on est arrivés dans le cadre d’une mission de lobbying auprès des députés. Ça fait trois semaines qu’on est là. On est arrivés avant la commission des lois de l’Assemblée nationale et avant la séance publique, on a rencontré tous les groupes politiques de l’Assemblée nationale pour leur expliquer les dangers et les risques encourus en Nouvelle-Calédonie. Tout simplement parce que les 35 ans de paix au biais des accords de Matignon et des accords de Nouméa ont été construits sur des principes. Le premier, c’est celui du consensus. Or, ce projet de loi constitutionnel a été déposé sans consensus local. Le deuxième, c’est l’impartialité de l’État. Le titre 1 de l’accord de Matignon, qui a été signé au sortir des événements des années 80, une quasi guerre civile en Nouvelle-Calédonie, était : « La paix durable en Nouvelle-Calédonie est un État impartial au service de tous ». Donc, c’était sur ces principes-là qu’étaient basés le dialogue, les équilibres qui ont été trouvés dans le cadre des accords de Matignon et de Nouméa. Tous les gouvernements successifs se sont attachés à suivre cette voie-là. La Nouvelle-Calédonie est un territoire colonisé par la France. C’est une histoire douloureuse entre le peuple Kanak et les représentants de la France. Il y a eu différentes révoltes. Ces 35 ans de paix ont réussi un petit peu à rétablir les équilibres, même s’il y avait beaucoup de choses qui restaient à faire. Depuis la 3e consultation du 12 décembre 2021, l’État a choisi son camp, c’est-à-dire le camp de ceux qui sont pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République. Même si d’autres gouvernements avant l’ont annoncé, ils n’avaient jamais autant de partis pris depuis l’imposition de la 3e consultation, sans que le peuple Kanak n’ait participé. L’État français a choisi de reconnaître et de valider les résultats, donnant comme perspective à la Nouvelle-Calédonie un statut définitif au sein de la République. Depuis 2021, on alerte sur les risques pour la paix civile en Nouvelle-Calédonie, que les poignées de main de Jean-Marie Tjibaou et de Jacques Lafleur ont été construites pour concilier ses équilibres. En déposant le projet de loi constitutionnel, Emmanuel Macron, le président de la République ainsi que le gouvernement, sont revenus sur le tabou. C’est un tabou pour nous, c’est celui de la paix de main entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Il ne fallait pas déposer ce projet de loi constitutionnel. L’État français sort unilatéralement de l’accord de Nouméa sans qu’une des parties soit d’accord. C’est ça le problème.
Il y a eu des appels à la grève, puis il y a eu des barrages sur les routes, et quelques actions de perturbation. Était-ce spontané ? Vous y attendiez-vous ?
Rock Haocas : En fait, l’insurrection était prévisible, mais la spontanéité a surpris tout le monde, puisque la société n’a pas appelé à faire des exactions. Aujourd’hui, il faut trouver une solution politique. Il y a beaucoup de décès, beaucoup sont des jeunes. Le fait d’envoyer le GIGN, de couper TikTok, l’état d’urgence, de rajouter une privation de liberté à une situation qui est déjà compliquée, la réponse sécuritaire ne répond pas à la cause du problème. À côté de ça, il y a des milices qui circulent, et donc ça oblige chacun à se protéger. Le réveil est populaire, mais c’est aussi la résultante d’une politique mise en place jusqu’à aujourd’hui, à la main de la droite locale, et des inégalités sociales aussi. Donc c’est le résultat d’une politique qui est mise en œuvre. Depuis la prise de possession en 1853, les Kanak se sont opposés à la colonisation, mais ils construisent un projet de société avec l’ensemble des personnes qui sont sur ce pays. Le fond du problème, c’est la colonisation et la volonté de la population kanak, principalement concernée par la colonisation, de construire un autre pays, un autre modèle, différent des modèles occidentaux, et de sortir de ce système qui oppresse le peuple du pays. Tant qu’on n’a pas résolu ce problème-là, il y aura toujours des révoltes. Aucun pays dans le monde n’a accepté la colonisation.
Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est le projet de société que vous défendez pour la vie de votre pays après l’indépendance ?
D. Fochi : C’est vrai que l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, c’est l’histoire de la colonisation mais d’un melting-pot aussi. Il y a eu la colonisation libre, la colonisation pénale, l’arrivée des travailleurs, les Wallisiens, les Javanais, les Japonais, ce qui fait aujourd’hui que la Nouvelle-Calédonie est un territoire, une mosaïque culturelle où il y a plusieurs communautés avec le peuple kanak. Les Kanak représentent à peu près 40 % de la population, ensuite il y a les caldoches et puis les autres communautés. On n’a jamais appelé à mettre dehors qui que ce soit. Au congrès de la Nouvelle-Calédonie, la majorité sur laquelle les indépendantistes s’appuient, c’est l’Éveil océanien, un parti politique qui regroupent des personnes issues de la communauté wallisienne et futunienne. Un certain discours nous prête l’intention de virer les Wallisiens, les Blancs, etc. Mais c’est impensable, puisqu’en juillet 1983, avec l’accord de Nainville-les-Roches, le FLNKS et les coutumiers ont ouvert le droit à l’autodétermination partagé avec les autres communautés qui sont arrivées sur le territoire dans le cadre de la colonisation. C’est unique au monde. À l’ONU, aucun peuple colonisé au monde n’a partagé son droit à l’autodétermination. C’est ce qui a permis aux autres, justement, aux autres communautés, de pouvoir voter au référendum puisque c’est un geste, c’est une main tendue du peuple kanak aux autres, pour pouvoir faire peuple et pouvoir construire un pays souverain indépendant. Et ça, il y en a plein aujourd’hui qui ne l’ont pas compris, qui ont des raisonnements simplistes pour dire qu’on veut rejeter les autres. Le principe, il est simple. Il faut nous respecter et puis c’est tout. Il faut se respecter mutuellement. Si on ne nous respecte pas, c’est difficile. Aujourd’hui, on a des loyalistes et des responsables du rassemblement que moi je qualifie d’irresponsables, va-t-en-guerre, parce que le pays est en feu et ils sont en train d’en rajouter.
R. Haocas : La plupart des mouvements indépendantistes portent le nom ou la marque de cette ouverture. Pour le cas, par exemple, de l’Union calédonienne, c’est deux couleurs, un seul peuple. Dans FLKNS, il y a le S de socialisme. Dans l’USTKE, il y a Kanak et exploités. On a toujours construit avec les autres. Et principalement, sur la question du corps électoral. C’est une élection locale pour gérer le pays. Et ça fait des années qu’on gère le pays ensemble. Les Français qui sont là-bas ont toujours le droit de vote. Ils sont inscrits sur la liste générale. Ils votent normalement comme s’ils étaient en France. Mais là, ça concerne la gestion du pays. Ça concerne l’avenir du pays. Donc ça concerne principalement les Calédoniens qui sont installés durablement dans ce pays. Il ne faut pas oublier non plus qu’on est toujours dans un système colonial et la Nouvelle-Calédonie est inscrite sur la liste des pays à décoloniser. Donc elle doit être en marche vers la pleine souveraineté. C’est le cas des accords de Nouméa. Donc souvent, on oppose la question de la démocratie avec la question de décolonisation. Là, on est en train d’assister à une recolonisation de peuplement.
Propos recueillis par Nico Dix
Publié par l’Anticapitaliste le 30 mai 2024
Voir la vidéo, Kanaky, le soulèvement contre l'ordre colonial