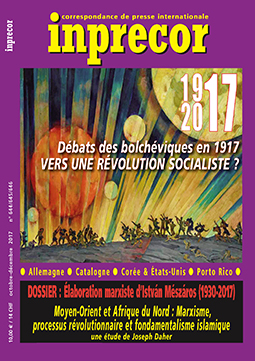L'élection au Bundestag de 2017 est un tournant important dans l'histoire politique de la République fédérale allemande. Elle marque la fin de la relative stabilité politique du pays économiquement le plus puissant et prédominant de l'Union européenne.
Les électeurs se sont largement détournés des deux partis de la grande coalition qui jusqu'alors gouvernaient ensemble. Avec 33 %, l'Union chrétienne-démocrate/Union chrétienne-sociale (CDU/CSU) a obtenu le plus mauvais résultat de son histoire et perdu 2,5 millions de voix. Le Parti social-démocrate (SPD) est lui aussi tombé au plus bas niveau jamais atteint et a perdu 1,75 million de voix. Avec une augmentation de la participation (de 71,5 % à 76,2 %), c'est une claire condamnation de la grande coalition. La CDU/CSU perd 1,3 million de voix en faveur du Parti libéral-démocrate (FDP), et presque un million pour l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) d'extrême droite.
Synthèse
Le SPD répartit sa perte de près de 2 millions de voix de façon quasiment égale (400 000 à 450 000 voix) entre le FDP, Die Linke (La Gauche), l'AfD et les Grünen (Verts), qui en profitent le moins.
La cassure de la grande coalition a provoqué un glissement à droite sur le plan parlementaire. L'AfD, qui avait raté de peu son entrée au Bundestag en 2013, a pu triompher avec 12,6 % des voix, dont la plupart (1,8 million) proviennent d'abstentionnistes et d'électeurs de différents tout petits partis de droite, mais aussi un million des chrétiens-démocrates (CDU/CSU), environ 400 000 du SPD et autant de Die Linke. C'est maintenant la troisième force au Bundestag.
Il faut aussi considérer le retour du FDP au Bundestag, avec 10,7 % des suffrages exprimés, comme un glissement à droite, après son échec de 2013. Pour ce qui concerne les réfugiés, il veut limiter leur protection dans le temps et instaurer une loi d'immigration sur le modèle canadien. Sur le plan européen, il veut obtenir une modification des traités qui permette d'exclure de l'Union monétaire des États comme la Grèce, et de supprimer " à longue échéance » le mécanisme de stabilité monétaire européen. Sur ces deux questions il y a compétition à droite entre la CSU bavaroise, le FDP et l'AfD. D'autre part le FDP ne veut pas entendre parler de transition énergétique.
Avec 8,9 %, les Grünen ont le plus petit groupe au Bundestag.
Étant donné que le SPD a déclaré dès le soir de l'élection qu'il n'était plus disposé à participer à une grande coalition, et comme tous les partis excluent une coalition avec l'AfD, il ne reste donc arithmétiquement que la possibilité d'une coalition dite " jamaïcaine », c'est-à-dire noire-verte-jaune. On peut pronostiquer que ce sont les Grünen qui y perdraient le plus de plumes ; ils font tout actuellement pour être considérés comme capables d'assurer des responsabilités gouvernementales et se présentent comme les garants de la stabilité d'un futur gouvernement.
L'AfD
L'AfD est née comme une opposition bourgeoise et conservatrice au cours pro-européen qui fut celui du gouvernement CDU/CSU-FDP lors de la grande crise financière. Mais lors de " l'été des réfugiés » elle s'est imposée comme le porte-parole politique du mouvement PEGIDA (1), et depuis elle a fait du refus de toute immigration et de la haine des musulmans ses thèmes principaux. Ses fondateurs ont depuis longtemps quitté le parti. Il est actuellement aux mains d'une alliance de courants de droite qui tolèrent des positions ouvertement nazies et antisémites dans ses rangs. Ce parti a réussi à maintenir sous le boisseau l'opposition entre les courants avant l'élection, mais elle est apparue au grand jour aussitôt après : l'AfD doit-elle s'installer à long terme dans l'opposition et y rassembler les mécontents sur une base ultra-droite voire fasciste, jusqu'à être assez forte pour imprimer son cours à un gouvernement, ou doit-elle chercher à participer au gouvernement dès que possible. Cette dernière position est celle de l'ancienne présidente du parti Frauke Petry, dont l'objectif est de provoquer un " tournant conservateur en Allemagne » d'ici 2021. Juste après l'élection, elle a annoncé qu'elle ne serait pas membre du groupe AfD au Bundestag et qu'elle démissionnait du parti. Elle va vraisemblablement chercher à créer un nouveau parti. À en juger d'après l'expérience de son prédécesseur, le fondateur du parti Bernd Lucke, ses chances de succès sont faibles. Il est de la même façon difficile de pronostiquer si après cette scission le courant fascistoïde de l'AfD se maintiendra.
L'AfD a obtenu des scores à deux chiffres dans l'ancienne Allemagne de l'est (Mecklenbourg-Poméranie occidentale, Saxe-Anhalt, Thuringe, Saxe et Brandebourg), à Berlin, mais aussi en Bavière et en Bade-Wurtemberg ; en Saxe elle est même devenue le parti le plus important. Pour l'Allemagne de l'est on peut dire qu'il y a une profonde rancœur surtout à l'égard de la CDU, qui lors de la chute du Mur avait promis monts et merveilles à la population, mais qui est aussi responsable du fait que, 27 ans après la réunification, les retraites et les salaires sont toujours plus bas qu'à l'ouest, y compris dans les services publics, et que 90 % des actifs se retrouvent aujourd'hui entre les mains de gens de l'ouest. Au point que les bases du développement d'une industrie régionale autonome dans le domaine de l'énergie solaire ont même été détruites parce que la concurrence chinoise était moins chère. Mais ces raisonnements ne s'appliquent pas quand il s'agit des deux Lõnder du sud, qui sont parmi les plus riches du pays.
Les meilleurs résultats de l'AfD correspondent aux plus fortes pertes de l'Union CDU/CSU. C'est dans les trois Lõnder de l'est, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe, et dans les deux Lõnder méridionaux de Bavière et de Bade-Wurtemberg, que l'Union a perdu le plus de voix. C'est une défaite amère, surtout pour la CSU bavaroise (-10 %), qui s'est efforcée de limiter les défections pour l'AfD par une politique dure à l'égard des réfugiés.
Le bilan que la bourgeoisie peut tirer de la grande coalition est dans l'ensemble fort positif, mais depuis des années Angela Merkel doit faire face à des critiques violentes issues de ses rangs. On reproche à celle qui est aussi la présidente de la CDU de l'avoir social-démocratisée au point de la rendre méconnaissable, et, comme en ce qui concerne le mariage homosexuel, d'avoir abandonné des valeurs fondamentales pour les conservateurs (Angela Merkel avait accordé la liberté de vote aux députés, et donc levé la discipline de groupe, bien qu'elle ait voté contre à titre personnel, sachant que la loi serait adoptée par une majorité de voix provenant du SPD, de Die Linke et des Grünen)
Le SPD : la loyauté inconditionnelle ne paye pas
Les pertes du SPD peuvent être simplement expliquées par le fait qu'il n'a dans un premier temps pas laissé apparaître d'autre perspective gouvernementale que la reconduction de la grande coalition. Lorsque Martin Schulz fut désigné pour conduire la campagne en février dernier, il a pour un temps donné l'impression de vouloir prendre ses distances avec la politique de l'Agenda 2010 en faisant de la " justice sociale » son cri de guerre. Immédiatement le SPD monta de 10 points dans les sondages et sa candidature suscita un incroyable engouement. Il ne tarda cependant pas à rétropédaler, il n'allait quand même pas prendre le risque de rompre avec l'Agenda 2010, et les mesures qui auraient dû concrétiser ce qu'il entendait par " justice sociale » se révélèrent fort dérisoires. Enfin, lors de son duel télévisé avec Merkel, il est apparu plus comme un partenaire que comme un adversaire. C'est à partir de ce moment que l'opinion s'est mise à rejeter la grande coalition.
Synthèse
Les directions syndicales souhaitaient une reconduction de la grande coalition. Mais le bilan de ce que le SPD a pu en obtenir est plus que maigre : la mesure la plus importante, c'est le salaire minimum légal, une première dans l'histoire allemande. Il ne faut pas surestimer le rôle qu'il peut jouer dans la stabilisation des salaires dans les secteurs précaires. Certes le gouvernement a fait fi des protestations massives des capitalistes, mais le niveau fixé est ridicule : 8,84 euros de l'heure actuellement. Et sa mise en place est trop peu contrôlée.
Le SPD a pu obtenir des succès sur les retraites mais ils sont à double tranchant : la retraite à 63 ans avec 45 années de cotisation n'est pour l'essentiel accessible qu'aux membres masculins du personnel des grosses entreprises en contrat à durée indéterminée, qui peuvent se prévaloir d'une carrière sans interruptions. Bien qu'elle ait elle aussi été violemment combattue par le patronat, elle a en même temps servi à acheter l'absence de résistance des syndicats au recul de l'âge de la retraite à 67 ans. La retraite maternelle, que la CDU/CSU a fait passer en même temps que la retraite à 63 ans, a une portée bien plus large : deux années consacrées aux enfants sont prises en compte et payées par les caisses de retraite, alors que cela devrait relever d'une prise en charge fiscale. Au même moment, alors que la social-démocrate Andrea Nahles était ministre du travail, la retraite d'entreprise, conçue comme second pilier, à financement privé, du système de retraites, a été renforcée. Les syndicats gèrent maintenant ces caisses avec le patronat, ce qui réduira certainement leur ardeur à défendre le principe de solidarité d'un système de retraites garanti par la loi.
L'affaiblissement stratégique de la position des salariés et des syndicats apparaît encore plus nettement si l'on considère la loi " d'unicité de convention tarifaire » (Tarifeinheitsgesetz), que la grande coalition a fait adopter, là encore avec la collaboration des grands syndicats. Là où plusieurs organisations syndicales sont présentes (comme par exemple dans les chemins de fer avec la Deutsche Bahn, dans les aéroports et dans les hôpitaux), la convention tarifaire doit avoir été négociée avec le syndicat le plus important de l'entreprise. C'est un coup contre les syndicats de métier qui organisent des professions très qualifiées comme les conducteurs de train, les pilotes ou les médecins, à qui leur position dans l'entreprise donne une grande capacité de lutte, et qui ces dernières années ont réussi à résister à toutes les tentatives de leur faire perdre " leurs privilèges ».
Ainsi la participation du SPD à la grande coalition a eu pour effet d'engluer davantage encore les syndicats dans un co-management de la restructuration néolibérale des systèmes sociaux en cours depuis longtemps.
Die Linke
Avec 9,2 %, Die Linke a pu améliorer légèrement le nombre de voix obtenues. Dans tous les Lõnder de l'ouest, il est maintenant au-dessus de 5 %. Ses résultats sont particulièrement bons dans les villes-États de Hambourg et de Brême (12 %) ainsi que dans le Land de Sarre (plus de 13 %). À Berlin, avec presque 19 %, il prend même la deuxième place. Chez les électeurs de moins de 30 ans, il est à 11 % au-dessus de la moyenne. Mais cela ne saurait dissimuler ses pertes importantes à l'est, particulièrement marquées en Thuringe et en Brandebourg, là où il gouverne les Lõnder en coalition avec le SPD. De toute évidence, il n'y est plus perçu comme le " parti de l'est », qui s'attachait à prendre en compte les demandes et les besoins des gens de l'est.
Situation économique
La situation est contradictoire. D'un côté le produit intérieur brut a augmenté depuis 2010, la plupart du temps de manière minime, mais constante. Le marché du travail a lui aussi connu un redémarrage. Après une baisse constante ou une stagnation entre 2000 et 2013, les salaires ont recommencé à augmenter depuis deux ou trois ans. Mais cette progression est plutôt due à une inflation très faible qu'à des augmentations de salaires palpables, pour lesquelles l'Allemagne est toujours lanterne rouge dans l'Union européenne. Le taux de chômage officiel, au-dessous de 6 %, est à son plus bas niveau depuis 1990, le taux d'activité à un niveau historiquement élevé. Des résultats obtenus au prix d'un nombre croissant de personnes qui gagnent moins de 10 euros de l'heure : pour l'ensemble du pays, cela représentait l'an dernier 20 % des actifs, et dans l'est plus de 30 %. Les caisses de l'État fédéral et de quelques Lõnder sont pleines, et même les caisses des organismes sociaux sont excédentaires. Cependant, quelques Lõnder comme la Rhénanie du nord-Westphalie, Brême et la Sarre sont fortement endettés.
La moitié du PIB va à l'exportation, l'excédent commercial a atteint en 2016 un montant obscène de 256 milliards d'euros, au point que le grand syndicat patronal BDI parle de " danger ». On danse sur un volcan.
Dans le même temps, les traces laissées par 25 ans de privatisations finissent par se voir. Les équipements sont de plus en plus délabrés. La compagnie de chemins de fer Deutsche Bahn a inauguré avec fierté une nouvelle ligne à grande vitesse qui permet d'aller de Munich à Hambourg en quatre heures, mais les trains régionaux utilisés par celles et ceux qui vont au travail sont de plus en plus chers, bondés ou supprimés parce que le conducteur est malade ou que le manque d'entretien ne permet plus d'autoriser la circulation. Le mot ponctualité a disparu du vocabulaire. 6 000 ponts routiers sont en mauvais état, dont 78 ponts autoroutiers. Le béton s'effrite. La ruine menace des bâtiments scolaires. Il ressort d'enquêtes menées par des journalistes à l'occasion de la rentrée scolaire un déficit de 5 000 enseignants, surtout dans les écoles primaires ; un adulte sur sept ne maîtrise pas la lecture et l'écriture. Le syndicat Ver.di parle de grève parce que les hôpitaux manquent de personnel de façon chronique. Il manque environ 150 000 logements, surtout des logements que l'on peut se payer, car la puissance publique a abandonné le logement social, tandis que dans les grandes villes les loyers ont atteint des niveaux records. Le dispositif de freinage des loyers mis en place par la coalition ne fonctionne pas
Le gouvernement fédéral est assis sur des caisses pleines, s'adresse de préférence pour les grands travaux d'équipement à des entreprises privées qui font faillite et cherchent à se retourner contre le gouvernement si leurs profits n'atteignent pas les sommes qu'elles escomptaient (c'est le cas actuellement pour le concessionnaire d'une partie de l'autoroute A1). C'est ce qui explique pourquoi aussi bien la mise au point de réseaux électriques intelligents que la réalisation d'infrastructures pour les voitures électriques ou l'extension de la fibre optique nécessaire à des communications électroniques plus rapides n'avancent pas.
Depuis l'entrée en fonction du gouvernement Schröder-Fischer (1998-2005), les inégalités ont constamment augmenté. L'Allemagne est avec la Grèce et le Portugal le pays de l'Union européenne où les différences de revenu avant impôt et transferts sociaux sont les plus fortes. C'est aussi le pays où l'écart de revenus entre hommes et femmes est le plus important. L'écart entre les riches et les pauvres est encore plus flagrant : 10 % des ménages disposent de la moitié des richesses. 16 % des gens vivent aujourd'hui sous la menace de la pauvreté, 19 % des enfants sont pauvres et à l'est cela atteint même 25 % Et cette situation se transmet par héritage. Le nombre de chômeurs de longue durée dans l'ensemble des sans-emplois est à peu près constant à 36 %, depuis 8 ans malgré la bonne conjoncture, le système scolaire à trois branches empêche les enfants des classes inférieures de fréquenter des écoles qui leur permettraient une promotion. 6 % des enfants quittent l'école sans diplôme.
Synthèse
Le cumul de ces facteurs ne produit pas seulement des divisions qui rendent plus difficile la formulation d'intérêts de classe communs (particulièrement entre l'espèce en voie de disparition des ouvriers bien payés en CDI prêts à tout pour garder leur boulot, et la nouvelle catégorie en expansion des bas-salaires, qui ont parfois plusieurs minijobs, des horaires à rallonge et qui doivent quand même faire une demande de Hartz IV, parce que ça ne suffit pas : c'est la situation de presque 600 000 personnes.).
Il en résulte une ambiance générale caractérisée par un mélange de repli sur la gestion du quotidien individuel, d'insatisfaction passive à l'égard de tout " ce qui ne marche pas », de peur de l'avenir et d'espoir fragile qu'on " va y arriver » grâce à la force de l'industrie allemande, à ses exportations et à sa haute technologie. On sait plus ou moins que ces succès sont obtenus aux dépens d'autres pays. Mais rares sont ceux qui voient comment ça pourrait fonctionner autrement. Rester en tête de la compétition internationale semble pour la plupart (y compris parmi les salariés) le seul moyen d'échapper au sort des pays du sud de l'Europe. On veut rester champion du monde.
On ne peut pas continuer comme ça ! Mais sinon quoi ?
La campagne de la chancelière a tourné autour du slogan : " On continue comme ça », et de l'opposition entre la situation enviable des habitants de l'Allemagne et celle de bien des pays et régions du monde. Tout comme Hillary Clinton, elle a dû faire le constat des dangers de cette argumentation car, pour de plus en plus de gens, cela n'est pas vrai. Lors de sa tournée à l'est, elle a été confrontée dans plusieurs villes à des manifestations de haine.
Après l'élection, ça ne continuera pas comme ça. La phase de conjoncture insolemment bonne ne durera pas éternellement, d'autant plus qu'aucun des problèmes économiques structurels n'a été réglé : surcapacités industrielles, contrôle des marchés financiers insuffisant qui n'a pas permis par exemple de se débarrasser de crédits frauduleux, manque d'opportunités d'investissement productifs pour les capitaux, déficit structurel d'emplois stables, etc.
Parallèlement et pour la première fois, des signes montrent que le modèle industriel allemand, dont l'industrie automobile constitue la colonne vertébrale, n'a pas d'avenir. Le " Dieselgate » est bien plus qu'une tentative de fraude à grande échelle. C'est la preuve que le diesel n'est pas une solution de remplacement de l'essence, parce que le diesel propre n'existe pas. L'essence est surtout responsable des importantes émissions de CO2, le diesel est responsable de celles d'oxyde d'azote et donc de particules fines dans les grandes villes. Leur concentration a augmenté au point que certains maires ne voient plus d'autre possibilité que d'interdire la circulation : pour l'industrie automobile, l'équivalent d'un accident nucléaire majeur. Celle-ci a bien compris que la voiture électrique était incontournable, mais elle veut une très longue période de transition et, plus important encore, elle fait tout pour augmenter la production et la mise en circulation de véhicules individuels, alors que l'on commence à discuter dans des cercles de plus en plus larges des formes que pourrait prendre la mobilité sans véhicules individuels privés. Du point de vue du bilan climatique, le modèle " production de masse de véhicules individuels mais avec moteur électrique » est une catastrophe, parce que l'électricité qu'il faudrait ne peut plus être produite par les énergies renouvelables exclusivement, et qu'on subirait donc la contrainte de faire fonctionner les centrales au lignite au-delà de la limite fixée (2050).
" Le site de production Allemagne » est manifestement tout disposé à continuer comme avant.
Points de départ pour transformer le système
Si l'on prend en compte les suppressions d'emploi massives qui menacent par suite du processus de digitalisation de la production, force est de constater que nous sommes au cœur d'une crise systémique qui s'accompagnera d'une transformation du système social, si l'on veut que les objectifs de la conférence de Paris sur le climat soient atteints et les besoins sociaux satisfaits. La liaison entre ces deux aspects permet de ne pas se contenter de réagir de façon défensive à la façon dont le capitalisme gère les crises, mais d'introduire une perspective écosocialiste dans les combats en cours. Le point clé, c'est la question de la reconversion de la production et de la création d'emplois dans de nouveaux secteurs.
Cette question n'est désormais plus seulement théorique, elle est pratique. C'est ainsi que les actions de désobéissance civile de " Ende Gelõnde » (2) contre l'exploitation du lignite dans la région du Lausitz en Brandebourg et dans la région du Rheinland près de Bonn ont conduit à des conflits avec le syndicat de services Ver.di et avec le syndicat de l'énergie IGBCE ; celui-ci en particulier a, pendant le camp climat, essayé de mobiliser les travailleurs de la compagnie énergétique RWE contre les protecteurs de l'environnement. Au cours de la mobilisation et des confrontations il a été aussi possible d'avoir des échanges auxquels la population locale a participé et qui doivent avoir un prolongement. Au sein de Ver.di s'est constitué un groupe d'initiative qui se donne pour tâche de s'adresser aux employés des centrales et aux administrations et élus des communes qui détiennent des parts du fournisseur d'électricité RWE et alimentent une partie de leur budget avec leurs dividendes. Les mouvements de protestation contre la pollution aux particules fines dans les grandes villes ont un potentiel similaire.
Synthèse
Un autre domaine dans lequel les luttes dans l'entreprise doivent absolument être reliées à des alternatives sociales, c'est celui de la dramatique pénurie de soignantes et soignants dans les hôpitaux. Lors du renouvellement de la convention tarifaire, le syndicat Ver.di a essayé de faire pression pour obtenir de nouvelles embauches, mais une première tentative à l'hôpital de la Charité de Berlin n'a apporté que des améliorations minimes. C'est la raison pour laquelle à Hambourg a été constitué un collectif avec des patients et des scientifiques, qui font ensemble des actions de rue. Seules quelques sections du syndicat sont partie prenante, dans son ensemble le syndicat n'a pas pour orientation de chercher la convergence des luttes dans l'entreprise avec les mobilisations sociales, par peur d'être accusé d'organiser des grèves politiques, qui sont interdites en Allemagne. La pénurie de personnel soignant est une chose qui remue beaucoup l'opinion publique. C'est une opportunité pour le mouvement des femmes, ou ce qu'il en reste, d'organiser en commun avec les infirmières, les éducatrices, etc., le combat pour une revalorisation radicale du travail de reproduction sociale. L'alliance Care Revolution (3) est un bon point de départ, mais elle est encore très faible.
Pour la plupart, les luttes sont cependant des luttes de résistance, même s'il arrive qu'elles soient menées victorieusement. C'est le cas pour l'essentiel de luttes contre la privatisation de régies publiques d'eau ou d'électricité le plus souvent ; dans plusieurs villes, il a été possible, au moyen de consultations de la population, d'imposer le retrait d'une privatisation. La très large mobilisation contre le TAFTA entre aussi dans cette catégorie.
En revanche, les luttes de résistance dans les entreprises (provoquées surtout par des conditions de travail et des salaires lamentables, mais aussi par l'acharnement contre des délégués ou même l'interdiction de l'activité syndicale) restent souvent isolées, même quand elles ont l'opinion publique avec elles. Les salaires de misère sont rejetés par la société, mais quand il s'agit de pilotes et autres conducteurs de train, le patronat et les médias parviennent à monter l'opinion publique contre ceux qui ne défendent que " leurs privilèges ».
La question qui domine reste la justice sociale. Les gens seront d'accord avec qui pourra les convaincre qu'il a une " stratégie » crédible pour rompre avec l'Agenda 2010. Si le SPD avait eu cette orientation dans la campagne électorale, les électeurs seraient accourus et il aurait pu remplacer la CDU/CSU, tout au moins comme leader d'opinion. Die Linke dit pour sa part clairement " Plus de Hartz IV ! », et il propose aussi de bonnes mesures pour rétablir plus de justice sociale, mais il a un problème : pour l'opinion, l'heure n'est pas au retour d'une coalition rouge-rouge-vert, le bilan dans les Lõnder où Die Linke participe au gouvernement, comme en Thuringe ou maintenant de nouveau à Berlin, est mauvais : les belles promesses ont vite été oubliées et Die Linke gère les affaires comme les autres.
L'absence d'issue à gauche alors que tant d'éléments de la situation objective manifestent l'exigence pressante de changements radicaux, voilà ce qui rend possible le gonflement continu de l'extrême droite. Pendant la campagne électorale, il y a quand même eu localement de fortes mobilisations contre l'AfD, comme à Cologne où elle a à peine pu se montrer dans les rues. Cela ne l'empêche bien sûr pas de grossir électoralement. On ne pourra pas se débarrasser de l'AfD si l'on se limite à lui disputer l'espace public et à contester sa légitimité politique, aussi important cela soit-il. La gauche doit lui enlever toute raison d'être en apportant d'autres réponses et en démontrant qu'on peut les mettre en œuvre. ■
* Angela Klein, rédactrice en chef du mensuel SoZ - Sozialistische Zeitung, fait partie de la direction de l'Internationale Sozialistische Organisation (ISO, section allemande de la IVe Internationale). (Traduit de l'allemand par Pierre Vandevoorde).
2. " Ende Gelõnde » (qu'on peut traduire par " Stop ! On n'ira pas plus loin ») est un mouvement de masse de désobéissance civile qui lute pour la protection du climat, pour laisser dans le sol les combustibles fossiles et pour une économie juste avec l'énergie renouvelable à 100 %.
3. L'alliance Care Revolution a été mise en place après la conférence d'action Care Revolution tenue à Berlin en mars 2014, où 500 personnes de différents domaines du travail de soins (parents, soignants, éducateurs, infirmières, travailleurs sociaux, assistance, services sexuels et ménage) et des représentants d'initiatives politiques se sont réunis. Des groupes locaux ont été établis dans les villes de Berlin, Bielefeld, Francfort, Fribourg, Hambourg, Hanovre, Lübeck et Thuringe, et le réseau national se réunit deux fois par an. En 2015, lors des grèves dans les services sociaux et éducatifs, ainsi que dans l'hôpital de la Charité de Berlin, le réseau Care Revolution a souligné l'importance de la coopération entre les parents, les garderies, les patients et les infirmières.