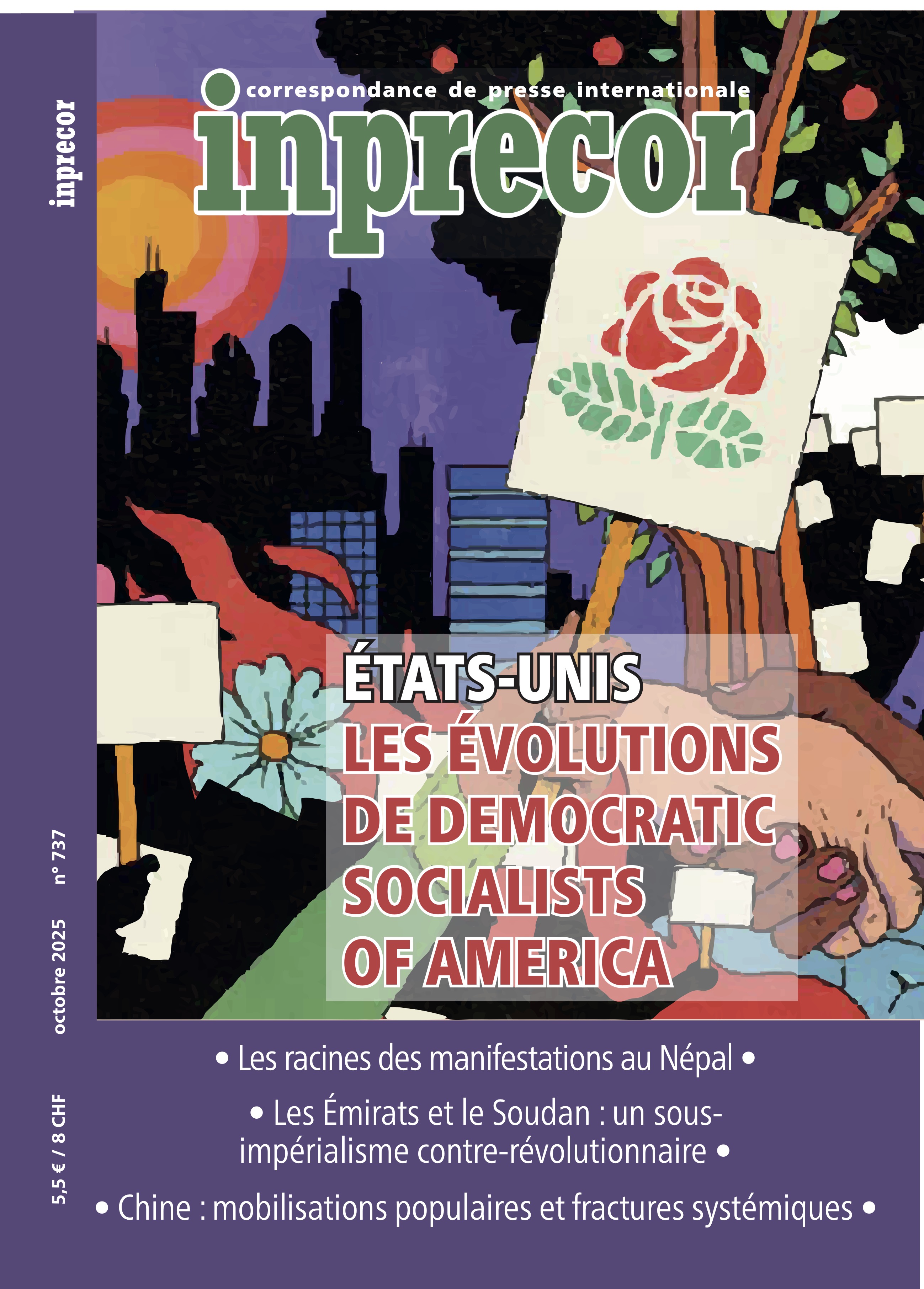À la suite du discours du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou reprenant le concept de « Grand Israël » et de ses allusions répétées à l’élargissement des frontières de l’État d’Israël, la région est confrontée à des bouleversements géopolitiques majeurs.
Les ambitions de l’État d’Israël sont révélatrices des périls qu’entraînerait une escalade imminente, à un moment où les prises de position internationales sont divisées entre le soutien envers lui, le maintien d’un cadre de négociations pour réactiver la solution à deux États, et une effervescence diplomatique visant à freiner l’extrême droite sioniste et mettre un terme au génocide en cours à Gaza.
Il n’est pas encore clairement établi qu’Israël, avec à sa tête Netanyahou et les forces d’extrême droite, s’emploie à redessiner provisoirement les frontières sécuritaires et militaires en échange d’importantes concessions politiques et sécuritaires des pays de la région, notamment l’abandon complet et définitif de la cause palestinienne et l’interdiction de l’existence d’un État palestinien indépendant, même sur une petite portion de la Palestine historique. En revanche, il est certain que les déclarations relatives au « Grand Israël » sont graves et requièrent le plus haut niveau de vigilance et de préparation pour faire face à des dangers sécuritaires imminents, notamment dans les pays contre lesquels Israël viole systématiquement les accords de paix, à savoir l’Égypte et la Jordanie.
La relance de ce plan, dans les discours de Netanyahou, coïncide avec l’incursion de ses forces militaires en territoire syrien, l’exploitation des massacres de Soueïda et la montée de l’islam sunnite extrémiste en Syrie d’une part, et l’attachement de l’Iran à ses milices qui menacent de déclencher des guerres civiles d’autre part. La situation actuelle dans les pays de la région agit donc comme un catalyseur pouvant accélérer et concrétiser ce plan, même si sa mise en œuvre demandera des dizaines d’années de guerre permanente et un changement démographique via le transfert et la colonisation.
Le « Grand Israël » pour l’extrême droite biblique religieuse
Le « Grand Israël » n’a pas de définition unique et fixe dans la politique israélienne, mais recouvre un ensemble de visions politiques et idéologiques. La principale convergence entre ces dernières est l’annexion de tous les territoires de la Palestine historique à l’État d’Israël. Mais le pôle d’extrême droite adopte le concept de la Torah fondé sur la « Terre Promise » ou la « Terre de Canaan », en tant que « choix religieux sacré ». C’est la terre où Dieu a promis à Abraham que les juifs reviendraient et restaureraient leur gloire sous la conduite du messie attendu et rédempteur.
L’idée du « Grand Israël » n’a pas reçu d’accueil favorable large au niveau international et n’est pas officiellement adoptée en Israël, mais les ambitions de Netanyahou se sont accrues, particulièrement après que le président américain Donald Trump a approuvé l’expansion du territoire israélien l’été dernier.
Selon l’Ancien Testament 1, au sud, les frontières du « Grand Israël » vont du désert jordanien – qui chevauche le désert de la péninsule arabique –, jusqu’au golfe d’Aqaba 2 en passant par les monts et vallées qui séparent la mer Morte de la Palestine historique 3 en passant par le fleuve Arish dans le Sinaï pour arriver à la mer 4 – bien que des interprétations inexactes suggèrent que le fleuve d’Égypte fait référence au Nil, les références de l’Église copte orthodoxe indiquent qu’il s’agit du fleuve Arish, soit la frontière au sud-ouest du pays de Canaan, un cours d’eau sec en été.
Il s’étend à l’ouest jusqu’à la mer Méditerranée 5 et atteint la ville de Sidon (jusqu’à Tyr et Sidon selon les références du Monastère de Saint Macaire le Grand).
Il s’étend ensuite au nord, de la mer Méditerranée au mont Hor Hahor 6. Puis, du mont Hahor en passant par les territoires syriens pour arriver à l’entrée de Hama et la ville syriaque historique de Sadad dans le gouvernorat de Homs 7 en passant par la ville de Zaafraniya Al Sharqiya dans les alentours nord de Homs à côté de la zone de Rastan 8 pour atteindre la ville de Qariataïn dans le centre de la Syrie au sud-est de Homs du côté du désert syrien 9, en d’autres termes le village des sources, soit Qariataïn qui se situe dans une oasis du désert syrien).
À l’est, il s’étend du centre de la Syrie jusqu’à Ras El Assi dans le district d’Hermel sur les rives de l’Assi 10pour atteindre Ribla dans le gouvernorat de Homs 11puis le lac de Tibériade 12pour arriver à la mer Morte 13.
Pourtant, selon Saint Jérôme, vers l’an 400 de l’ère chrétienne, le « Grand Israël » s’étend du sud de la Turquie, pour atteindre les monts Taurus et Mersine (Zephirium en Cilicie), en d’autres termes tout le Liban et les territoires côtiers syriens sans exception.
Le « Grand Israël », une réalité évolutive depuis 1967
D’après l’Institut Akevot de recherches sur le conflit israélo-palestinien, le 18 octobre 1967, Yigal Allon, alors ministre du Travail, a soumis, huit mois avant de devenir vice-Premier ministre d’Israël, au Comité ministériel des affaires de sécurité, une proposition 14 de suppression de la ligne verte des cartes israéliennes officielles, d’annulation des accords d’armistice de 1949, et de redéfinition des frontières. La nouvelle carte incluait la Cisjordanie, la bande de Gaza, le plateau du Golan syrien et la péninsule du Sinaï.
Le Comité adopta la proposition et ratifia la décision trois semaines plus tard. Le 12 novembre 1967, le même ministre proposa, lors d’un conseil des ministres, d’imposer une censure sur la publication de la décision d’imprimer des cartes gommant les lignes d’armistice. Les ministres approuvèrent la proposition à une large majorité. Le conseil promulgua la décision (cote B/9). Cette décision de rayer la ligne verte de la carte fut classée « top secret » et ne fut pas publiée pendant des années.
Ce plan qui visait à étendre les frontières officielles d’Israël après la guerre de 1967, a commencé à perdre en importance après la guerre d’octobre 1973. Son application se concentra sur les zones de la Palestine historique, où des mouvements de colonisation extrémistes, tels le « Gush Emunim » ont émergé, et qui ont vu l’intensification et l’expansion des colonies. Le retrait du plan en échange de l’imposition d’une trêve, de la paix et de la normalisation convenait à la partie israélienne à cette étape, soit depuis la signature par la Syrie de l’accord de « désengagement » dans le Golan en 1974, suivie par la possibilité pour l’Égypte de recouvrer sa souveraineté sur la péninsule du Sinaï en 1982. Et ceci, en dépit de l’invasion israélienne du Liban en juin 1982, qui a débouché sur une occupation militaire directe de 18 années, jusqu’au 25 mai 2000. Néanmoins cette occupation n’a pas donné lieu à une véritable colonisation, comme ce fut le cas sur le plateau du Golan.
Cependant, ce plan a retrouvé sa pertinence pour le camp sioniste d’extrême droite – que Netanyahou essaie de rallier –, à la suite des succès militaires remportés depuis octobre 2023. Il est clair que Netanyahou se considère comme un grand dirigeant du mouvement sioniste, comparable à Theodor Herzl, et qu’il a commencé à poser les bases de l’émergence du « Grand Israël ». Il a ainsi déclaré être porteur d’un message historique et spirituel et adhérer à la vision de la « Terre Promise », dans un extrait 15 que la chaîne israélienne s’est empressée de couper de l’interview sur toutes ses plateformes. Les déclarations de Netanyahou ont déclenché une vague de condamnations de la part des pays arabes directement concernés, suivie d’un communiqué de condamnation commun 16 de 31 ministres des Affaires étrangères.
Dans ce contexte, l’incursion israélienne progressive sur le territoire syrien depuis l’opération « Flèche de Bashan » de décembre 2024, au prétexte d’établir une « zone tampon » – en dépit de l’existence d’une zone tampon déjà occupée –, peut être vue comme une mise en œuvre effective, lente, mais déterminée, du plan du « Grand Israël ». Ce plan n’implique pas une expansion des implantations humaines, mais il impose un contrôle direct des ressources et richesses naturelles, au premier rang desquelles l’eau. Si l’objectif avait été la colonisation, l’armée israélienne n’aurait pas arrêté les colons du groupe extrémiste « les pionniers de Bashan » après leur incursion en territoire syrien et leur inauguration de la première colonie israélienne nommée « Neve Habashan ».
L’État d’Israël a mis à profit l’absence d’État syrien après la chute du régime d’Assad pour justifier au niveau international ses incursions et il est probable qu’il fasse de même au Liban, à une échelle plus vaste, dans une période de guerre interne menaçant un État libanais déjà fragile. Les tentatives d’Israël d’interdire la prolongation du mandat de la FINUL et de fixer à cette dernière une date de fin de mission – les seules forces dont la présence au sol en mesure de poser un problème politique et de constituer un obstacle en cas de projet d’invasion israélienne de large envergure ne bénéficiant pas d’approbation au niveau international – s’inscrivent dans ce contexte.
Il est cohérent que la FINUL se maintienne en place jusqu’au déploiement total de l’armée libanaise au Sud Liban. Les propos américains prônant la réduction des coûts de la FINUL – sous prétexte que ses missions ne seraient plus réalisables, ou en raison de soupçons de corruption –, ne tiennent pas la route et ne tiennent pas compte du déséquilibre des forces. Le maintien des forces de la FINUL est essentiel jusqu’au déploiement de l’armée libanaise dans l’ensemble des zones du sud et jusqu’à ce que cette dernière dispose d’armement défensif lui permettant de constituer une force de dissuasion capable d’infliger des pertes réelles à toute partie attaquante – même si cela ne pourrait empêcher que les attaques atteignent leurs objectifs ultimes. Mais cela complexifierait l’équation d’une invasion et en augmenterait le coût humain et matériel.

La multiplication des milices et le défi de la désintégration de l’État-nation
La consolidation et la légitimation de milices armées confessionnelles et nationalistes sont au cœur de ce déséquilibre historique, qu’Israël met pleinement à profit maintenant en prélude à une nouvelle phase d’expansion. En dépit de leurs succès au Liban, en Irak et en Syrie – avec notamment la libération des régions du sud de l’occupation israélienne, et leur combat aux côtés de forces de la coalition internationale contre Daech, et de là, la chute du régime d’Assad –, elles constituent globalement (quelles que soient leurs différences, mineures ou majeures, et malgré leur chevauchement de l’État à tel ou tel degré, dans tel ou tel cas) un levier stratégique du projet de « Grand Israël », la réalisation de ce dernier étant inversement proportionnelle à la désintégration de l’État-nation. À l’inverse, le renforcement du rôle de l’État-nation est inversement proportionnel à la croissance des milices armées, notamment celles qui sont soutenues de l’étranger et hostiles aux solutions nationales.
Le fait que les armes soient uniquement entre les mains de l’État en Irak et au Liban, met en exergue l’échec de l’agenda iranien dans la région, mais prive également l’Iran d’atouts cruciaux dans une période délicate, après les frappes aériennes sensibles sur son programme nucléaire. Avec l’affaiblissement du programme nucléaire, les milices soutenues par l’Iran sont redevenues la principale force de la politique extérieure iranienne. Malgré les coups durs portés au Hezbollah, et tandis que le gouvernement irakien tente de contenir les forces de la mobilisation populaire. Cependant, la politique de lutte menée par l’Iran contre l’influence américaine conduira à terme l’expansion de cette dernière, au lieu de l’affaiblir, et, de surcroît, consacrera la domination militaire israélienne.
L’État est le point faible
Le processus de renforcement des milices dans la région au détriment de l’État-nation, indépendamment de leur politique intérieure ou extérieure, revient à désintégrer ces États conformément aux intérêts du plan israélien. Ce dernier ne peut être mis en œuvre sur le terrain par le biais de la seule force, mais il a besoin que soient créées les conditions propices au déclenchement de guerres civiles et de conflits internes, exactement à l’instar de ce qui se passe aujourd’hui dans la région de Soueïda, où Israël apparaît comme le sauveur des Druzes face aux milices extrémistes sunnites déguisées en État.
Ces conditions sont alimentées par les milices confessionnelles et nationalistes, notamment celles soutenues par l’Iran et la Turquie. Elles ont provoqué, provoquent et provoqueront des troubles et des tensions au sein du tissu social arabe, notamment en Irak, en Syrie et au Liban où elles peuvent alimenter les extrémismes sunnite et chiite, et précipiter le projet du « Grand Israël » au prétexte de la protection des minorités et de la « défense de la civilisation contre la barbarie ». Comme elles ont ouvert la voie à davantage d’interventions étrangères américaines, britanniques, russes ou autres.
La domination des milices soutenues par des forces régionales place les sociétés du Moyen-Orient dans un état d’affrontement permanent, pour des raisons confessionnelles et nationalistes enchevêtrées, tout en renforçant le rôle de l’influence politique et idéologique des États qui les soutiennent et les financent. La prolifération de ces milices ouvre une perspective positive au grand rêve israélien dans l’esprit de beaucoup d’Israélien·nes, ce rêve n’étant fondé que sur la division de la région sur les ruines des États-nations. Par conséquent, le récit de la « résistance » que certaines milices tentent de reproduire pour le court terme, est voué à l’échec à long terme, nonobstant les énormes sacrifices consentis.
Le cas syrien n’est qu’un exemple de division profonde entraînée par l’intervention militaire du Hezbollah pour sauver le régime d’Assad. Le sentiment de haine au sein de la société syrienne est passé de la haine envers Israël à une haine décuplée contre l’Iran et ses alliés. Cela a impacté le discours politique de l’opposition qui a adopté fin 2024 le discours du nouveau pouvoir, faisant passer l’ennemi principal d’Israël à l’Iran. Bien que le sentiment anti-iranien ait été depuis longtemps présent, c’est l’intervention des milices chiites dans le bourbier du conflit syrien qui lui a fait atteindre un point de non-retour, et a exacerbé l’influence de Al-Qaïda, représentée par le Front Al Nosra (rebaptisé Front Fatah al-Cham en 2016 lorsqu’il rompt avec Al-Quaïda).
Les Libanais·es sont prisonnier·es de deux illusions majeures qui se perpétuent depuis la guerre civile. La première, à laquelle beaucoup s’accrochent toujours, est entretenue par les forces de droite. C’est l’illusion selon laquelle Israël serait un ami du Liban, niant ses ambitions et la menace qu’il représente ne serait-ce que parce qu’il exploite les circonstances et les contradictions de la guerre civile. Cette illusion est renforcée par le discours de la restriction selon lequel le monopole des armes par l’État permettrait de réduire la menace israélienne et sur l’idée qu’Israël arrêtera spontanément ses exactions au Liban après le démantèlement des milices. La deuxième illusion, entretenue par les forces de gauche, et à laquelle beaucoup s’accrochent farouchement également, a pour postulat principal que « l’État libanais est incapable d’affronter militairement l’État sioniste », et que les Libanais doivent donc rejoindre des milices et des factions militaires non étatiques. Ce second postulat est aussi dangereux que le premier, car il empêche l’édification d’un État et, comme le premier, il sert les intérêts israéliens.
Dans le cas palestinien également, l’existence de factions armées ne pose pas de problème stratégique à Israël, mais ce dernier exagère leur puissance et la menace qu’elles représentent afin de réaliser des objectifs de colonisation plus ambitieux et tuer des milliers de Palestinien·nes sous prétexte de prétexte de protéger la population israélienne. Le problème fondamental de l’État d’Israël, au niveau stratégique, est la création d’un État palestinien indépendant, doté d’une armée et d’institutions indépendantes, non soumises à l’administration israélienne, reconnues au niveau international, même si cet État ne représente que 22 % de la superficie de la Palestine historique.
En calculant les coûts et les avantages, si Israël avait donné son accord à la solution à deux États, il aurait obtenu un traité de paix historique avec l’Arabie saoudite, qui lui aurait permis d’accéder presque totalement au monde arabe. Mais Israël considérait la reconnaissance d’un État palestinien via la solution à deux États – ce qui suppose des accords militaires incluant le démantèlement des colonies construites après 1967 et le retour des réfugié·es, même s’ils ne revenaient pas dans leurs terres d’origine mais rejoignaient le futur État palestinien – comme une perte plus grande par rapport à la création de relations politiques et économiques avec l’Arabie saoudite. Selon le journal Israël Hayom, le ministre des Affaires étrangères Gidéon Sa’ar a même préconisé la fermeture du consulat de France à Jérusalem en représailles contre la décision du président français Emmanuel Macron de reconnaître un État palestinien.
Ceci impose de s’arrêter pour réfléchir. Israël a raté une occasion historique de nouer des relations normales avec l’ensemble des pays du Golfe et il est prêt à rompre ses relations diplomatiques avec la France, ce qui pourrait créer une crise dans ses relations avec des pays de l’Union européenne, pour ne pas reconnaître l’existence d’un État palestinien, même sur moins de 22 % de la superficie de la Palestine historique, et avec le contrôle militaire et politique israélien quasi total sur l’Autorité palestinienne actuelle. Cela signifie que le projet du « Grand Israël » est déjà à l’œuvre, et qu’il en est à ses débuts depuis des décennies, la première étape visant à transférer toustes les habitant·es de Gaza et de Cisjordanie.
Mobilisation arabe et signes de changements géopolitiques ?
Certains pays arabes ont commencé à pressentir le danger israélien croissant, dont nous avons vu les prémisses en Syrie et au Sud Liban. L’obstination de l’État d’Israël à vouloir transférer des habitant·es de Gaza et occuper complètement la bande de Gaza, conjuguée aux allusions de plus en plus nombreuses au « Grand Israël », sont de nature à laisser croire que le péril pourrait bien s’étendre aux régions occidentales de la Jordanie et à la péninsule du Sinaï à plus ou moins court terme. Il semble qu’Israël ne se soucie plus de se conformer aux traités de paix, dont il viole les dispositions, comme s’il voulait remodeler ces derniers en fonction du nouveau rapport de forces imposé par ses méthodes violentes dans la région.
Dans ce contexte, l’annonce de la remise à l’ordre du jour du service militaire obligatoire en Jordanie est intervenue quelques jours après la condamnation par le ministre jordanien des Affaires étrangères des déclarations de Netanyahou concernant le « Grand Israël ». Un pays comme la Jordanie n’a évidemment pas la capacité de mener une escalade contre Israël et a même tenté de se soumettre à ce dernier, notamment lors du dernier conflit irano-israélien. Pourtant les Jordanien·nes ressentent la menace israélienne et ne se contentent plus de déclarations de condamnation : ils prennent des mesures de sécurité concrètes, tout en étant conscients de leur insuffisance.
En Égypte, la situation est beaucoup plus compliquée, du fait notamment du soutien total d’Israël à l’Éthiopie qui construit le barrage de la Renaissance, ce dernier menaçant non seulement la sécurité alimentaire, mais toutes les formes de vie en Égypte et au Soudan. L’Égypte dépendant du Nil pour 90 % de ses ressources en eau, cette menace est donc une question de vie ou de mort pour les Égyptien·nes. Les menaces israéliennes compliquent la situation, notamment après un rapport publié par le site israélien nziv.net le 10 février 2025 17, sur un scénario généré par l’intelligence artificielle en cas de bombardement du Haut Barrage d’Assouan, pouvant entraîner la destruction des infrastructures et la mort immédiate de milliers d’Égyptiens.
Les tentatives de transfert des habitants de Gaza vers le Sinaï, puis les déclarations sur le « Grand Israël », ont rendu le danger plausible pour les Égyptien·nes, en dépit du soutien de l’Égypte à Israël dans son blocus de Gaza. L’Égypte ne s’est pas contentée de publier des communiqués de condamnation, mais a commencé à prendre des mesures sécuritaires concrètes et à intensifier ses manœuvres militaires dans la région nord. Ces développements sont à replacer également dans le contexte du renforcement de l’alliance militaire entre l’Égypte et la Turquie, d’exercices militaires conjoints et de l’annonce de la fabrication et de développement militaires, notamment du projet d’avions de combat TAI TF Kaan, en coopération avec l’industrie aérospatiale turque, et dont l’entrée en service est attendue pour 2028. De surcroît, l’armée égyptienne insiste sur la diversification de ses sources d’approvisionnement en armement, en important des systèmes de défense aérienne sophistiqués et des missiles antichars de divers pays, principalement de Chine. Là réside peut-être la cause principale des provocations d’Israël et de l’évocation de la destruction du Haut Barrage.
L’État d’Israël se joue des États-Unis… mais !
La dynamique des relations entre Israël et les États-Unis a énormément évolué depuis le retour de Trump à la présidence. Même si le premier a pu contenir la folie de Netanyahou dans certaines situations – tout en s’étant parfois avéré plus fou que lui –, l’orientation que Netanyahou a pu imposer aux États-Unis par son contrôle quasi total sur l’administration précédente ne permet pas à Trump de le contraindre à un changement, quand bien même le voudrait-il. Dans ce contexte, les appels du gouvernement libanais aux États-Unis pour qu’ils fassent pression sur Israël afin que ce dernier applique l’accord de cessez-le-feu apparaissent absurdes.
À l’étape actuelle, il semble qu’Israël n’envisage pas de rester sur le territoire libanais sans contrepartie politique et sécuritaire directe. Par son incursion terrestre dans de vastes zones et par l’établissement de relations directes avec les Druzes de Soueïda – conséquences des crimes perpétrés par les autorités syriennes et leurs milices alliées –, la véritable brèche qu’il a suscitée dans le sud syrien lui permettra d’entraîner les autorités syriennes dans des négociations sur la question militaire, d’une manière à servir les intérêts d’Israël et accroître l’influence de ce dernier sur la politique syrienne. Israël ne pourra pas continuer la guerre sur plusieurs fronts simultanément, notamment par des incursions militaires terrestres, mais il s’emploiera à renforcer sa présence politique et sécuritaire à chaque occasion, afin de ne pas répéter l’erreur passée de son occupation du Liban.
Israël est aujourd’hui le moteur de la politique américaine au Moyen-Orient, contraignant les États-Unis à mener de nouvelles guerres, telle la dernière, menée contre l’Iran. Et peut-être va-t-il les obliger à en mener d’autres dans un futur proche contre d’anciens alliés. Ce changement qualitatif contredit l’image dominante du leadership américain sur Israël. Ce dernier a atteint un niveau lui permettant d’exploiter son intégration sécuritaire et technologique avec les États-Unis et l’imbrication de la sécurité nationale américaine avec ses intérêts régionaux pour intensifier le processus d’épuisement des États-Unis par tous les moyens. Et c’est peut-être pour cette raison que Trump sollicite maintenant le président russe Vladimir Poutine pour parvenir à un accord mettant un terme à la guerre russo-ukrainienne.
Israël n’est pas une simple « colonie » ou un prolongement mécanique de la colonisation occidentale, comme le prétend une certaine gauche postmoderne qui construit son idéologie à partir de la haine de « l’homme blanc », à l’origine de tous les maux. C’est un État colonial au plein sens du terme, qui impose des processus expansionnistes en partant de ses propres décisions, obligeant ses alliés occidentaux à rallier ses guerres, quand bien même cela leur coûterait des pertes économiques et financières importantes, sans parler de violents troubles sociaux. Mais rien ne garantit la perpétuation de cette situation, surtout si le « Grand Israël » se concrétise à travers une épopée apocalyptique, dans laquelle aucune puissance « civilisée » n’aurait intérêt à s’embourber.
La politique étrangère américaine est complexe historiquement. En dépit des nombreuses guerres menées par les États-Unis. Elle repose sur le soft power depuis l’arrivée de Barack Obama, la guerre restant une exception, au contraire de la politique étrangère agressive d’Israël, qui repose sur la violence et les massacres. La solution pacifique est l’exception, notamment depuis l’arrivée de l’extrême droite sioniste au pouvoir. Cette distinction entre les deux politiques étrangères est essentielle, car même si elles se complètent dans une certaine mesure, cette complémentarité se transformera en contradiction explosive un jour ou l’autre, les États-Unis n’étant pas prêts à perdre tous leurs alliés et à pousser le monde à s’allier contre eux au nom d’Israël.
Excluons, métaphoriquement s’entend, l’Iran et ses milices de la scène géopolitique : l’impasse croissante, et les changements qui ont commencé à survenir dans les relations entre Israël et les pays de la région, passant de la normalisation politique ou économique quasi naturelle à des relations marquées par la tension et la prudence mutuelles, cette impasse marque le début d’un processus cumulatif qui imposera une prise de distance stratégique entre Israël et les États-Unis. La politique d’asservissement total pratiquée par Israël dans ses relations avec ses voisins, qu’ils soient alliés ou adversaires, entrera en conflit à long terme avec les intérêts américains au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cet asservissement implique d’une part qu’Israël épuise les ressources des États-Unis, et il a un impact négatif sur les intérêts commerciaux et financiers américains, notamment dans les pays du Golfe d’autre part. L’une de ses conséquences pourrait être un choc économique mondial que les États-Unis ne seraient pas en mesure d’encaisser.
Le 21 août 2025
Hani Adada est militant du Groupe communiste révolutionnaire, au Liban, membre de la IVe Internationale.
Publié par Daraj et traduit par Luiza Toscane.
- 1
Livre des Nombres, chapitre 34.
- 2
Idem, 3, Edom, le côté du royaume d’Edom.
- 3
Idem, 4, Aqaba/Aqrabbim, ou la ville d’Akrabattene, Qadech Barnea, Hatsar-Adar et Atsmon.
- 4
dem, 5, d’Atsmon au fleuve d’Égypte.
- 5
Idem, 6, la mer Méditerranée constituera votre frontière à l’ouest.
- 6
Idem, 7, de la Grande Mer jusqu’au mont Hor. Le mont Aaron n’est pas le lieu où a été enterré Aaron, qui a été enterré à Pétra en Jordanie, mais c’est l’une des montagnes de la chaîne du Liban occidental surplombant la mer Méditerranée)
- 7
dem, 8, les marches s’étendront jusqu’à Zedad.
- 8
Idem, 9, les marches atteindront Zephron.
- 9
Idem, 9, les marches atteindront Hatsar-Enan.
- 10
Idem, 10, de Hatsar-Enan jusqu’à Chepham.
- 11
Idem, 11, de Chepham à Ribla, à( l’est de Aïn.
- 12
Idem, 11, la mer de Tibériade.
- 13
Idem, 12, la mer salée.
- 14
« Erasure of the Green Line » (« C’est ainsi que la ligne verte a été effacée de la carte » dans la version en hébreux), juin 2022, Institut Akevot. La ligne verte est le nom de la ligne de démarcation établie après la guerre de 1948-1949 entre les forces armées israéliennes et les forces armées arabes par les accords d’armistice conclus en 1949 entre Israël d’une part et les États de Syrie, Liban, Transjordanie et Égypte d’autre part. Son tracé accroît la « superficie effective » de l’État d’Israël par rapport à ce que prévoyait le plan de partage de la Palestine adopté par l’ONU en 1947, et de diviser la zone internationale de Jérusalem en deux secteurs, Jérusalem-Ouest administré par Israël, et Jérusalem-Est administré par la Jordanie jusqu’en 1967.
- 15
« Netanyahu exprime son identification à la vision d’un Grand Israël », 13 août 2025, Al Jazeera et « Que signifie l’attachement de Netanyahou à la vision d’un “Grand Israël” et à sa mission “historique et spirituelle” ? », 13 août 2025, Al Jazeera.
- 16
- 17