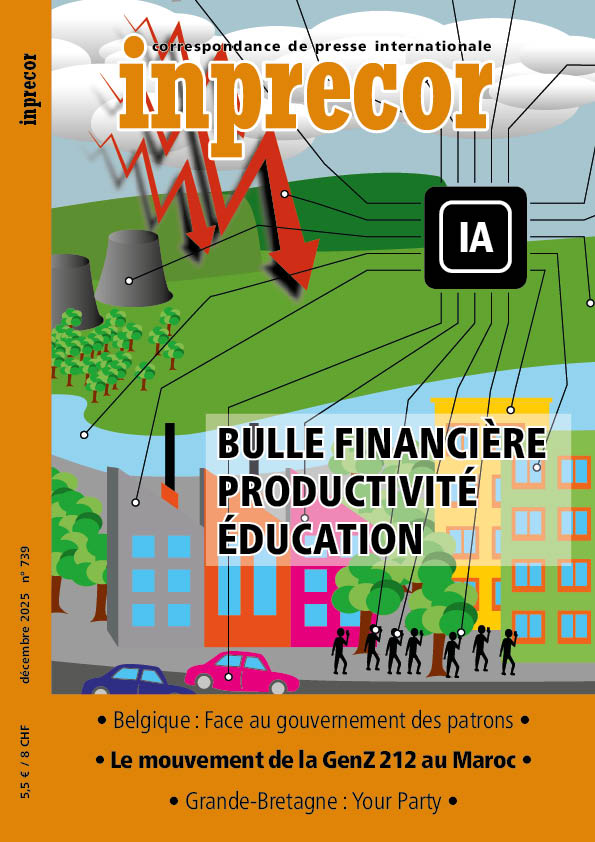Depuis le début de l’année, la Belgique est traversée par un mouvement de plus en plus massif contre le nouveau gouvernement fédéral, qui est pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale dirigé par un Premier ministre d’extrême droite, Bart de Wever. L’accord de coalition qui a permis à ce gouvernement, ainsi qu’à ses déclinaisons locales, de se former, prévoit une vague d’attaques sans précédent. Entretien avec Simon Bolanz.
La Belgique est en train de connaître un mouvement assez important d’opposition aux gouvernements en place, notamment le gouvernement fédéral. Pour comprendre ce qui se joue, il faut sans doute remonter au moment où les partis qui composent ce gouvernement ont obtenu la majorité des sièges au Parlement, la triple élection du 15 juin dernier. Peux-tu rappeler le contexte de cette élection, et son résultat ?
En effet, au mois de juin 2024, les Belges ont voté à la fois pour les élections fédérale, régionales et européennes. Auparavant, la Belgique avait un gouvernement fédéral appelé la « Vivaldi »1, qui avait mis très longtemps à se former, et qui rassemblait les libéraux, les sociaux-démocrates et les écologistes des deux communautés linguistiques2, ainsi que les chrétiens-démocrates néerlandophones. Un gouvernement dont le centre de gravité était censé se trouver au centre-gauche, mais qui n’a en réalité apporté que peu de progrès pour la population.
Un boulevard s’est donc ouvert pour la droite ; notamment, du côté francophone, pour le Mouvement réformateur, qu’on peut ranger dans la catégorie des droites libérales sous stéroïdes, qui penchent de plus en plus clairement vers l’extrême droite. Même s’il faisait partie de la coalition au pouvoir, le MR a su se distancier de son bilan et mener une campagne très agressive, et particulièrement démagogue, en laissant entendre qu’il augmenterait tous les salaires de 500 euros par mois. Il a obtenu 28 % des voix en Wallonie, 10 % à l’échelle nationale. En Flandre, c’est l’extrême droite autonomiste qui a tiré les marrons du feu : le Vlaams Belang, un parti fascisant qui reste pour l’instant ostracisé par le reste du champ politique, a frôlé les 22 % (12 % à l’échelle du pays), et la NVA, plus institutionnelle3, a décroché la première place avec 26 % (16 % à l’échelle du pays). Ce résultat a été un choc pour la gauche, bien sûr, mais aussi pour les militant·es syndicalistes, puisqu’il signifiait que beaucoup de travailleurs et travailleuses affilié·es avaient voté pour l’un de ces partis.
La région flamande et la Wallonie se sont rapidement dotées d’un gouvernement. En Flandre, il est composé de la NVA, des chrétiens-démocrates et de Vooruit, qui est ce qui reste du parti socialiste flamand. En Wallonie et pour la communauté francophone, il s’agit de la coalition « Azur », qui rassemble le MR et les Engagé·es, nouveau nom du parti chrétien-démocrate.
Au niveau fédéral, les négociations ont été beaucoup plus longues, mais ont sans surprise abouti à un gouvernement composé de ces cinq partis, qu’on a appelé « Arizona » (les couleurs du drapeau de l’État américain correspondant à celle des formations politiques). L’accord de gouvernement est sorti en janvier 2025, et c’était une attaque contre tous les conquis sociaux du mouvement ouvrier.
Hormis la région de Bruxelles pour laquelle il n’y a toujours pas d’accord à ce jour, l’architecture politique de la Belgique se retrouve donc exceptionnellement alignée, avec un triple gouvernement de droite, au fédéral, en Wallonie et en Flandre. Aujourd’hui, quelles sont les principales caractéristiques de cet attelage réactionnaire ?
Ce serait très long de détailler l’ensemble des mesures que contiennent les accords. De manière générale, le gouvernement fédéral, avec l’appui des gouvernements régionaux, souhaite démanteler la Sécurité sociale, qui en Belgique, malgré toutes ses faiblesses, reste plus protectrice que dans de nombreux autres pays. Un des projets phares, qui est déjà en train d’être mis en œuvre, c’est la limitation dans le temps des allocations de chômage (dont la durée était illimitée jusque-là), combinée à un durcissement de l’accès. C’est donc un véritable drame social qui se prépare : à partir du 1er janvier et tout au long du printemps, ce sont presque 200 000 travailleur·ses sans emploi, selon les modes de calcul, qui seront brutalement exclu·es des allocations. Y compris de nombreux·ses travailleur·ses à temps partiel qui, tout en touchant leur allocation de chômage, exercent une profession, souvent dans les métiers du soin ; ou d’intérimaires qui, en fait, travaillent très régulièrement, mais ne cumulent pas assez de jours de travail pour maintenir leurs droits.
Un deuxième aspect, c’est aussi celui des attaques contre l’ensemble des services publics, et en particulier contre les fonctionnaires qui bénéficiaient d’un statut spécifique pour garantir leur indépendance par rapport à l’État. Un troisième, ce sont des attaques contre tout ce qui constitue le droit social en Belgique, et le droit du travail en particulier. Une mesure parmi d’autres consiste à introduire des « horaires accordéons », à la carte : 50 heures pendant une semaine, 20 heures la semaine suivante, le décompte des heures étant simplement annualisé. Ils souhaitent aussi supprimer l’interdiction du travail de nuit (et donc le sursalaire que touchent les travailleur·ses de nuit), continuer le blocage des salaires…
Et puis, il y a les attaques sur les pensions. La Belgique a déjà eu un gouvernement MR-NVA, la Suédoise, en 2014, qui avait repoussé l’âge légal pour la pension à 67 ans, mais avait laissé la possibilité de partir en pension anticipée après 42 annuités complètes. L’Arizona veut introduire un malus de 5 années entre l’âge réel et l’âge légal : par exemple, un·e travailleur·se qui partirait à 63 ans grâce à ce dispositif pourrait perdre 20 % de sa pension (– 5 % pour chaque année). On estime qu’une femme sur deux et un homme sur trois seraient touché·es, et y perdraient, en moyenne, environ 350 euros par mois.
Attaques sur la sécurité sociale avec le chômage en ligne de mire, attaques sur les services publics, attaques contre le droit du travail, attaques contre les pensions : c’est, en tout cas dans les syndicats, ce qui fait le plus réagir.
Et en dehors des sujets classiquement syndicaux, il y a aussi beaucoup à dire, par exemple, de leur politique migratoire…
Oui, bien sûr, et de beaucoup d’autres choses ! Leur politique pénale, avec la volonté d’enfermer toujours plus et de sous-traiter les détenu·es en les envoyant dans d’autres pays. Leur politique climaticide, avec notamment le ministre de l’Emploi qui affirme qu’il faut faire une pause sur les politiques climatiques, alors qu’elles sont déjà totalement insuffisantes. Et les menaces contre l’État de droit et la démocratie, avec des restrictions toujours plus importantes au droit de manifester et au droit de grève, et avec la volonté d’interdire des organisations jugées « radicales » ou extrémistes »… mais pas radicales ou extrémistes comme le MR ou la NVA, non : on parle d’organisations de défense des droits humains, de solidarité avec la Palestine, ou de collectifs antifascistes.
Et puis, donc, des politiques racistes vis-à vis des migrant·es, avec le durcissement des conditions d’accès au territoire, de l’accès à la nationalité, et des conditions d’hébergement des demandeur·ses d’asile. La Belgique a déjà été condamnée des milliers de fois par les tribunaux belges parce qu’elle ne fournissait pas de lieu d’hébergement pour les demandeurs d’asile. L’État s’assied complètement sur ces condamnations, et maintenant, l’Arizona va encore empirer la situation. C’est donc une déferlante d’attaques à laquelle on fait face : elles vont dans tous les sens, mais elles sont organisées, méthodiques.
Mais vous y faites face. Tout au long de l’année dernière, la Belgique a connu un mouvement social important, on le disait, de réaction face à ces attaques. Peux-tu en résumer les grandes étapes ?
La première chose intéressante à noter, c’est que ce mouvement de lutte contre le gouvernement Arizona a débuté avant même que celui-ci soit formé. Le front commun syndical a mis en place un plan avec des rassemblements réguliers, qui traitaient des différentes thématiques sur lesquelles les négociations en cours faisaient peser une menace. Il y a eu une large manifestation au mois de janvier, suivie d’une grève générale4 au mois de février, assez bien suivie. Quelques autres dates de ce genre se sont succédé, toujours assez espacées.
Mais on a dû aussi faire le constat qu’après le choc des élections, où l’équilibre politique du pays a largement basculé à droite, les organisations du monde du travail et plus largement les organisations sociales rencontraient des difficultés à mobiliser. Il a fallu mettre du cœur à l’ouvrage pour effectuer un travail d’explication dans les entreprises, sur le terrain, parce que les attaques qui se dessinaient devant nous nécessitaient une mobilisation encore bien plus massive.
Au début, les réactions ont été relativement timides. D’une part parce que les directions syndicales ne voulaient plus repartir sur un plan d’action comme en 2014, contre la Suédoise, plan d’action qui avait été très intense au début pour atterrir sur de très maigres acquis. D’autre part, parce qu’on constatait qu’il y avait, malheureusement, une relative adhésion de la population par rapport à certaines mesures du gouvernement, en particulier sur la limitation dans le temps des allocations de chômage. D’où un vrai travail au corps à corps pour convaincre les travailleur·ses et les citoyen·nes.
Mais au fur et à mesure que les mesures étaient implémentées, on a senti la colère monter petit à petit. Au printemps 2025, cette colère était encore difficile à traduire en mobilisation. Plusieurs journées de grève et de manifestation ont constitué des succès relatifs, mais sans déboucher sur un véritable rapport de forces. Mais maintenant, à l’automne 2025, on sent qu’elle se répand dans toute la population.
Comme souvent dans les mouvements qui s’ancrent dans le temps long, il y a eu un moment de flottement pendant l’été. Mais la Belgique a connu de nouvelles journées de grève et de manifestation, et en particulier celle du 14 octobre, puis maintenant « l’appel de novembre » pour trois journées de mobilisation à la fin du mois. Ça reprend ?
Comme je le disais, les mesures commencent à s’appliquer, notamment l’exclusion du chômage : des milliers de personnes ont reçu une lettre pour leur dire qu’elles allaient perdre leur droit aux allocations, et souvent se retrouver sans revenu. Les gens ont pu voir que les personnes concernées n’étaient pas des profiteur·ses imaginaires, mais leur voisin·e, leur cousin·e… et dans le même temps, ils ont pu voir que le salaire en plus qui avait été promis n’arriverait jamais, et qu’au contraire, on cassait leurs conditions de travail et qu’on leur retirait de la rémunération.
La mobilisation du 14 octobre a été un vrai succès : il y avait plus de 140 000 personnes dans les rues de Bruxelles, plus que la Belgique n’en avait connu depuis les années 2000. Mais bien sûr, le plus dur reste à faire, parce que le gouvernement est solidement campé sur ses appuis et ne va pas reculer sans qu’on l’y force. Il reste donc un travail énorme de sensibilisation, de propagande, et surtout d’organisation : il faut construire notre force. La mobilisation du 14 octobre est un bon point d’appui, parce qu’elle donne de la fierté et de la confiance aux travailleur·ses. Mais ça ne sera pas suffisant en soi : il faut construire un mouvement à la fois syndical et populaire pour combattre le gouvernement pied à pied et le faire reculer, puis chuter. Le faire reculer d’abord, parce que si on n’y arrive pas, on n’arrivera jamais à le faire chuter ; puis le faire chuter, parce que c’est bien ça l’objectif.
Tu l’as dit, votre principale difficulté, c’est que vous faites face à un gouvernement particulièrement déterminé. Mais on a aussi entendu des critiques sur la stratégie des syndicats, qui depuis janvier, sont ceux qui mènent le mouvement…
La critique principale, c’est l’absence de perspectives concrètes, l’absence d’un plan d’action qui soit crédible, qui permette de mobiliser les travailleur·ses à la hauteur des attaques. Ce qu’il faut comprendre, c’est que les directions syndicales ont peur. Elles ont peur parce qu’elles se font aussi attaquer en tant que telles. Elles ont peur d’avoir perdu une certaine influence sur leurs affilié·es et sur le monde du travail. Et elles ont peur qu’en luttant, elles soient encore plus prises pour cible.
Mais il y a des secteurs qui sont à l’avant-garde de la mobilisation, en organisant leurs propres grèves : les enseignant·es, les cheminot·es, et dans une moindre mesure les services publics en général. Mais les syndicalistes et les travailleur·ses doivent s’adresser à leur direction pour exiger ce plan d’action qui leur fait défaut. On a vécu une mobilisation historique le 14 octobre, mais dans les journées qui ont suivi, et jusqu’à l’annonce de « l’appel de novembre », il n’y avait aucun élément d’une suite pour des actions intersectorielles en front commun, ce qui veut dire que les travailleur·ses encouragé·es par le succès de cette journée n’avaient aucune perspective pour la suite.
Mais il faut aussi rester conscient·es du fait qu’il y a encore des travailleur·ses qui ne sont pas informé·es des mesures du gouvernement, ou ne sont pas convaincu·es qu’il faut les combattre. Exiger un plan d’action est donc une part importante du travail, mais dans le même temps, on doit continuer à informer, à sensibiliser sur les lieux de travail, et en dehors, parce qu’on doit avoir tout le monde avec nous. Et que si on a un plan d’action combatif qui n’est suivi que par un secteur ou que par certaines franges du monde du travail, on en sentira rapidement les limites.
La Gauche anticapitaliste s’est fortement engagée dans ce mouvement, en participant directement aux mobilisations et à travers son investissement dans les luttes des travailleurs ; mais aussi d’une autre manière, notamment en participant à construire la plateforme Commune Colère, qui revendique la chute de l’Arizona. Quelle est la perspective ?
Le point de départ, c’est que dès la formation du gouvernement, beaucoup – au sein même des syndicats – ont constaté l’absence de volonté des directions syndicales de s’engager dans un grand travail de sensibilisation des travailleur·ses et de la population et d’organiser une riposte à la hauteur des attaques. Il est donc apparu que l’urgence était d’avoir un cadre d’action déterminé et souple – un cadre radical et unitaire. C’est de cette manière qu’a émergé Commune Colère, d’abord à Bruxelles, puis dans l’ensemble des grandes villes francophones – le travail reste à faire en Flandre.
L’idée était de réunir des syndicalistes combatif·ves, des activistes, des citoyen·nes qui cherchaient un cadre organisationnel pour soutenir les luttes syndicales tout en menant des actions moins conventionnelles, et en participant à ce nécessaire effort d’information, de politisation et de radicalisation. Le mouvement a rencontré de très belles réussites en termes d’actions, mais il lui reste aussi toute une série de défis à relever, en particulier celui de la massification et de la jonction avec les travailleur·ses de base, ou au moins les travailleur·ses syndiqué·es et combatif·ves – pas simplement les militant·es syndicalistes. Mais c’est une initiative sur laquelle on peut s’appuyer pour le futur.
Et maintenant, quelle est la prochaine étape ?
Le front commun syndical appelle, pour la première fois, à une mobilisation de quatre jours d’affilée fin novembre. La manifestation contre les violences faites aux femmes du 23 novembre sera suivie par une journée de grève des transports, une grève des services publics pour culminer le 26 novembre dans une grève générale. Tout le mouvement social va s’y préparer en continuant cet indispensable travail d’agitation et de propagande, pour que cette nouvelle étape soit également un succès. Et pour la suite, plus que jamais, on doit continuer à revendiquer la construction, par la base, d’un plan d’action qui soit à la hauteur de l’enjeu, qui permette de s’organiser dans les entreprises, de se mettre en grève, de produire du rapport de force et de faire reculer l’Arizona. En dernière analyse, l’Arizona, c’est le gouvernement des patrons : c’est aussi sur eux qu’il faut faire pression, pour faire reculer ce gouvernement et le faire tomber.
Le 4 novembre 2025
- 1
En Belgique, il est fréquent de donner des surnoms aux gouvernements de coalition, notamment fédéraux. La « Vivaldi » est nommée ainsi d’après les Quatre saisons, du compositeur du même nom : libéraux, sociaux-démocrates, chrétiens-démocrates et écologistes.
- 2
La Belgique est divisée en trois régions : la Wallonie, francophone (avec une petite communauté germanophone), la Flandre, néerlandophone, et Bruxelles, théoriquement bilingue. Chacune de ces régions a un parlement et un gouvernement.
- 3
Les médias et observateurs flamands classent généralement la NVA à droite, et elle n’est pas concernée par la tradition du « cordon sanitaire », qui interdit toute alliance avec l’extrême droite. À l’échelle internationale, pourtant, elle laisse peu d’ambiguïté : au Parlement européen, elle siège dans le groupe ECR, dirigé par les néofascistes de Fratelli d’Italia.
- 4
En Belgique, le terme « grève générale » est communément utilisé pour ce qu’on appellerait en France une « grève interprofessionnelle ».