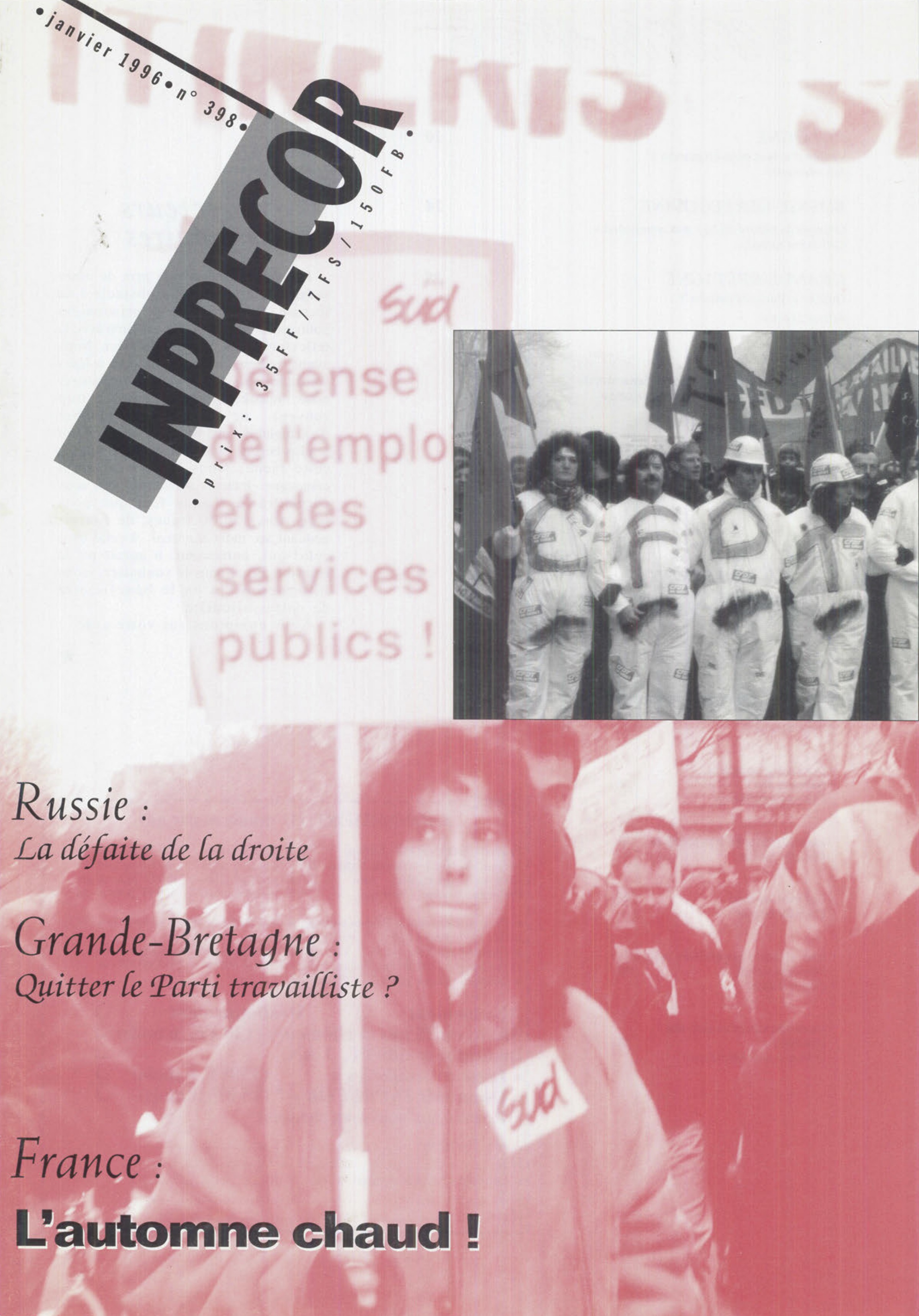Les mutations économiques qui touchent désormais les pays européens proviennent d’un socle commun. Les déréglementations et privatisations répondent, en effet, à des besoins nouveaux du capital. Ce qui diffère par contre d’un pays à l’autre ce sont les formes politiques et sociales que prend la mise en œuvre de ce changement. La France n’échappe pas à ses propres particularités, avec des facteurs historiques anciens (rôle et poids des services publics par exemple) et des facteurs plus récents comme la politique suivie depuis près de quinze ans par des gouvernements socialistes ou de droite.
C’est la combinaison de ces facteurs qui a fait de la résistance au plan gouvernemental un mouvement social sans précédent depuis 1968. Or, la plupart des commentateurs français ont appuyé la propagande gouvernementale sur le thème de la « juste réforme », de la nécessité de « préparer l’avenir » en résorbant les « privilèges ». Telle est, du moins, la rationalité invoquée, car, en réalité, ce discours ne tient pas un instant à l’analyse. La vraie rationalité est ailleurs : ce sont les besoins du capital et les échéances politiques et économiques du Traité de Maastricht qui, désormais, accélèrent le processus.
Le patronat français a mené depuis plusieurs années une bataille contre le taux « trop élevé » des charges sociales qu’il est appelé à payer sur les salaires distribués. Ce faisant, il a pu s’attaquer à la fois au coût direct du travail et à son coût indirect, puisque les charges sociales forment, dans un pays comme celui-ci, un indicateur de la socialisation de certains besoins.
Les déficits des comptes sociaux (dont il est tant question pour justifier la réforme) s’expliquent en grande partie par cette dévalorisation du travail et par le niveau du chômage, puisque la protection sociale est financée par les revenus du travail.
D’autre part, la manière dont le pouvoir aborde les problèmes d’endettement public montre de manière très limpide son caractère de classe. Désormais un « droit acquis » est devenu un privilège ; l’abolir est donc un moyen de réduire les coûts de fonctionnement de l’État. C’est le message émis par les milieux bourgeois et les faiseurs d’opinions les plus aisés et les plus privilégiés du pays.
Un peu d’histoire
En France, comme dans d’autres pays européens, le temps est bien fini où les salaires suivaient les gains de productivité et épousaient la hausse des prix, après un délai plus ou moins important selon l’ampleur des conflits revendicatifs. À partir de la récession de 1981-1982, on a effectivement assisté en France (et dans beaucoup de pays européens) à une déconnexion grandissante entre les salaires et la progression de la productivité (l’inflation pour sa part enregistrant une baisse durable).
Les gains de productivité ont donc servi à améliorer le taux de marge des entreprises et ne se sont reportés qu’accessoirement sur les salaires.
Au début, il était encore possible d’interpréter ce processus comme un effet conjoncturel de la crise. Mais, cette tendance s’est approfondie au cours des dix années suivantes, quelle que soit la situation économique. Durant la reprise de 1987 à 1990, la hausse du salaire réel a été inférieure à celle du PIB et de la productivité. Puis dans la phase de récession (1991-1993), l’évolution de ces trois indicateurs a été plus ou moins la même. Mais lors des deux années suivantes, alors que le PIB croît de plus de 3 % et la productivité de plus de 2 %, le taux de croissance du salaire réel continue à baisser (voir tableau).
Sur l’ensemble de ce cycle économique, la progression du salaire est donc restée inférieure à celle de la productivité. C’est ainsi que s’est progressivement dessiné un changement structurel de la formation des salaires, déconnectée de la conjoncture. Ce phénomène ne touche évidemment pas que la France, mais il y a pris un tour singulier (par la faible résistance des travailleurs) en s’amorçant sous des gouvernements socialistes.
Dévalorisation du travail
Aussi, ce mécanisme s’étend-il peu à peu aux différents secteurs et à leurs entreprises. Les métiers et les catégories professionnelles qui échappent à cette tendance sont aujourd’hui minoritaires (ce qui ne veut pas forcément dire marginaux).
Les différents niveaux de qualification sont progressivement dévalorisés selon un processus qui mêle les restructurations industrielles et l’existence d’une « réserve » d’effectif constituée par un chômage touchant pratiquement toutes les catégories professionnelles.
Finalement, c’est la valeur de la force de travail qui est globalement tirée vers le bas.
| 87-90 | 90-93 | 93-95 | |
| PIB | +4,0% | +0,3% | +3,1% |
| Salaires | +1,3% | +0,8% | +0,1% |
| Productivité | +2,7% | +0,8% | +2,2% |
Le marché du travail, lui-même, s’est modifié progressivement en fabriquant ou en développant des formes de contrats qui font définitivement voler en éclats la notion de salaire minimum.
C’est évidemment le cas pour le travail à temps partiel et c’était en 1993 le sens de la proposition du gouvernement de droite d’instaurer un salaire minimum jeune inférieur à celui des adultes.
Il est tout aussi significatif que pour répondre à des besoins nouveaux en matière de services publics, notamment territoriaux ou sociaux, on fasse de plus en plus appel à des emplois dont le coût est inférieur au salaire minimum. Il s’agit donc bien d’emplois nécessaires (et non plus d’assistance) dont le coût est administrativement abaissé.
Les salairesLa part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises qui était, en France, supérieure à 70 % au début des années 80, oscille aujourd’hui entre 61 % et 62 %. En 1985, cette part des salaires en France passe au-dessous de la moyenne européenne et de la moyenne des plus grands pays industriels (OCDE). En une dizaine d’année, le partage du revenu entre entreprises et salariés, s’est ainsi modifié d’environ sept points au profit des premières. |
La pression du chômage
Du coup, c’est la notion même de contrat de travail qui est progressivement mise sur le gril. Pourquoi, en effet, ne pas considérer chaque salarié comme une petite entreprise de service proposant une prestation ?
En poussant la logique du travail précaire jusqu’au bout, les patrons cherchent à rompre avec ce qu’ils appellent le « carcan ».
Quelques uns n’ont pas caché leurs intentions : « On ne retrouvera pas le plein emploi salarié, mais on créera de nouvelles formes de travail et on libérera les initiatives » ou encore il faut « remplacer le contrat salarié traditionnel par un contrat commercial entre une entreprise et un entrepreneur individuel » (Alain MADELIN, alors Ministre des Entreprises, Les Echos, 6 septembre 1994) 1
C’est dans ce contexte que, désormais, gouvernement et patrons avancent des formules de « réduction du temps de travail » pour, disent-ils, limiter le nombre des licenciements et « sauver des emplois ».
Au fil des années, de nombreux accords et réglementations ont été passés permettant de renforcer la flexibilité du travail et de réguler le temps de travail sur l’année et non plus sur une base hebdomadaire.
Ces dispositifs ont permis d’améliorer la gestion des effectifs par les patrons tout en éliminant les « surcoûts salariaux » traditionnels. Il s’agit, une fois encore, de dégager de nouveaux gains de productivité et, sous couvert de « sauver des emplois », d’abaisser la valeur du travail.
Transfert des salariés de l’État vers les entreprises
On comprend, dès lors, la difficulté qu’il peut y avoir à maintenir un haut niveau de protection sociale fondée sur les revenus du travail, alors que ce même travail est en cours de dévalorisation. Le fléchissement de la masse salariale a, par ailleurs, de fâcheuses conséquences sur les recettes fiscales de l’État. En 1994, la France a connu une légère augmentation des emplois, mais la nature de ceux-ci (temps partiel, travail précaire) a finalement effacé l’impact fiscal que l’on pouvait en escompter. La dévalorisation du travail a donc des conséquences directes sur les comptes sociaux et sur les revenus de l’État. Il n’en est que plus scandaleux de demander à ceux dont le travail a été ainsi dévalué de couvrir maintenant le manque à gagner.
Les déficits publics
L’État doit faire des économies et, pour cela, réduire ses frais de fonctionnement. Pour justifier ce douloureux programme, la presse aux ordres rappelle que tout cela est, finalement, payé par les contribuables à travers des impôts. Chacun devrait donc y trouver son intérêt. Ce qui est finalement suggéré c’est que le « train de vie » de l’État est trop élevé et que cette gabegie résulte fondamentalement de la grande masse des fonctionnaires.
Or, l’analyse montre exactement l’inverse. L’évolution des déficits français a épousé l’évolution de la croissance économique. Alors qu’ils ont représenté 2 % du PIB jusqu’en 1990, période de croissance soutenue, ils s’aggravent par la suite en suivant le retournement de conjoncture. En réalité, les finances de l’État ont dû supporter une stagnation des rentrées fiscales, un fort accroissement de l’aide aux entreprises (pour qu’elles contribuent à réduire le chômage !) et une hausse de la charge d’endettement à cause des taux d’intérêts du marché.
Mais en structure, il y a eu fort peu d’évolution des dépenses de fonctionnement. En 1987, la part de celles-ci dans le PIB était d’environ 22 % ; elle était de 21,9 % en 1994. La part des salaires des fonctionnaires dans le total de ces dépenses était de 22,3 % en 1987 ; elle était de 22,4 % en 1994. Les déficits publics proviennent donc d’ailleurs et il n’y a pas eu d’« explosion » des dépenses publiques.
Le raisonnement tenu par les avocats de la politique gouvernementale sert, par contre, à cacher un certain nombre de choses. Tout d’abord, l’impôt sur les bénéfices des entreprises a diminué de 37 milliards de francs entre 1990 et 1994 alors que les bénéfices de celles-ci progressaient de 50 milliards. Au cours des cinq dernières années, la perte de recettes publiques, due au chômage, est évaluée à environ 100 milliards de francs. La fiscalité sur les revenus du capital et de l’épargne a été systématiquement allégée en comparaison avec ce qui était appliquée aux revenus du travail. La différence de pression fiscale a atteint, selon un rapport officiel, 10 % (Rapport Ducamin, 1994) 2
Le second tour de passe-passe concerne la dette. Les taux d’intérêts appliqués aux emprunts d’État sont évidemment ceux du marché. Mais dans la situation actuelle cela fait que les administrations payent environ 300 milliards de francs d’intérêts par an, c’est-à-dire deux-tiers du déficit total. En d’autres termes, la rente versée sur le marché obligataire nourrit grandement la dette. Mais il est très mal vu de rappeler cela, alors que les « marchés » sont censés jouer le rôle de grand arbitre vertueux.
Au tout début du conflit, le ministre du Travail et des Affaires sociales déclarait : « Nous ne louvoierons pas entre les lobbies (…) nous n’avons pas le droit de faire marche arrière (…), les marchés ne nous le permettraient pas ». 3
Il faut que l’époque soit bien étrange pour que l’on puisse dénoncer le « lobby » de plusieurs millions de salariés tout en consacrant l’objectivité des « marchés ». Mais c’est évidemment à cela que l’on reconnaît les authentiques porte-parole de la bourgeoisie.
Le troisième « oubli » du raisonnement officiel se rapporte aux propositions d’économie. Il n’est jamais question des militaires quand il faut évoquer les privilèges des fonctionnaires. Ils forment pourtant, par excellence, un corps non productif et sans obligation de productivité ! Rien n’est dit non plus sur le coût de l’arme nucléaire (avec les succès diplomatiques que l’on sait !). Si les crédits de défense augmentent peu dans l’actuel budget, tous les grands programmes militaires ont été préservés même si leur réalisation est échelonnée.
On voit donc, en définitive, ce qui a pu mettre le feu aux poudres quand le gouvernement a décidé de s’attaquer aux fonctionnaires et personnels des services publics, après des années d’attaques contre les travailleurs du privé. La décision d’allonger le temps de cotisation des fonctionnaires pour accéder à une indemnité de retraite pleine et entière a été justifiée au nom de l’alignement sur la situation des gens du privé. Mais la règle appliquée à ces derniers ne date que de deux années et avait été imposée sans réaction d’ampleur, notamment de la part des directions syndicales. C’est pourquoi la violente réaction du service public a pu prendre la forme d’une défense élargie à toutes les catégories de salariés. Mais cette question de l’unité face aux attaques est évidemment une toute autre affaire.
Le 6 décembre 1995