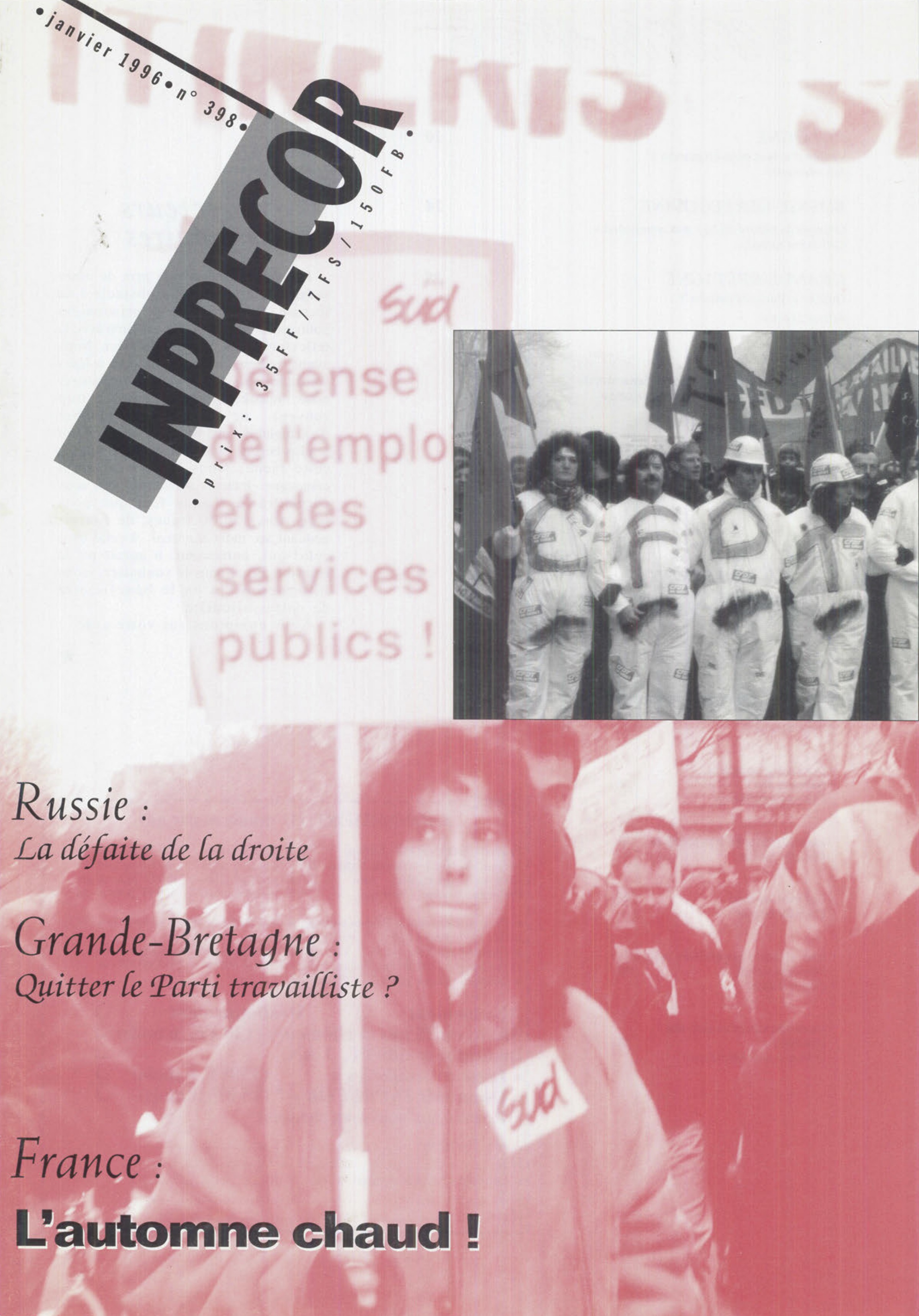Avant (!) la fin de ce siècle, l’UE aura une monnaie unique forte et stable (!). Ainsi l’ont voulu ses peuples (!) et ses dirigeants en signant puis en ratifiant le Traité de Maastricht sur l’UE » 1. Tout l’esprit de despotisme moderniste, de wishful thinking et de mépris qui caractérise les élites autoproclamées s’exprime à travers cette phrase introductive au Livre Vert de la Commission Européenne.
L’introduction d’une monnaie unique entre pays capitalistes développés qui ont une longue tradition de souveraineté nationale est un fait sans précédent dans l’Histoire 2. Elle se heurte à d’énormes difficultés qui sont écartées avec légèreté.
À première vue, la monnaie unique semble être le prolongement logique du marché unique : une monnaie unique facilite grandement la « mesure » et donc la circulation des marchandises et des services : elle aide les consommateurs à faire des choix rationnels et baisse le prix des voyages. Sans cela, on sait qu’un citoyen qui quitte la Belgique avec 100 F en poche et fait le tour de l’UE revient au pays avec 50 F seulement, sans avoir rien acheté : tout le reste a été dépensé dans les opérations de change. Mais cela n’est qu’une partie de la vérité.
Il faut savoir que l’argent est non seulement un moyen de circulation des marchandises mais qu’en plus il remplit deux autres fonctions fondamentales. Cela éclaire les choses sous un angle tout différent.
D’abord l’argent lui-même est une marchandise, qui est achetée et vendue au prix du marché (des changes). À l’échelle mondiale, le volume des échanges monétaires sur le marché dépasse de loin celui des échanges commerciaux : trois jours d’échanges sur le marché mondial des devises représentent l’équivalent du montant annuel des échanges commerciaux (1 200 milliards de dollars par jour) 3. Et comme les gouvernements ont décidé de libéraliser très largement la circulation de l’argent, les conglomérats internationaux sont en mesure de mettre les relations sociales dans un pays donné sens dessus-dessous en un trait de plume, par des opérations spéculatives. Ensuite, la gestion de la monnaie (nationale) est un des attributs de base des États (nationaux) et des gouvernements. Elle fait partie de la politique monétaire, qui à son tour fait partie de la politique générale des gouvernements sur le plan fiscal, des finances publiques, des services publics, de la sécurité sociale et, plus largement encore, de la gestion quotidienne de la lutte de classes qui s’appuie sur le partage du revenu national, la formation des salaires, la politique des prix, les relations paritaires, les conventions collectives, etc.
Introduire une monnaie unique, se substituant aux monnaies nationales en vigueur, est un acte d’un volontarisme extrême étant donné l’économie fort disparate et l’appareil d’État très cristallisé de chacun des pays impérialistes concernés.
Pour s’y préparer, le Traité de Maastricht a fixé des 4 critères de convergence, démarrant sur le plan monétaire et débouchant sur un rapprochement des politiques économiques et sociales. Il s’agit de rendre l’harmonisation de la politique monétaire mesurable à travers des ratios (des rapports) : déficit public inférieur à 3 % du Produit Intérieur Brut, dette publique inférieure à 60 % du PIB, normes en matière d’inflation, de taux d’intérêt à long terme et de stabilité entre monnaies.
Où en est-on de ce point de vue ? Les informations publiées par la Commission européenne elle-même sont claires 5. L’instabilité monétaire entre les États membres de l’Union, qui devrait être sur la voie de la résorption, n’a jamais été aussi grande que depuis 1992, c’est-à-dire depuis le traité de Maastricht. Le nombre de pays qui satisfont, aujourd’hui aux critères de convergence est extrêmement réduit. Sur base des cinq critères, ils ne sont que deux : l’Allemagne et le Grand Duché du Luxembourg. Si on ne prend en compte que le déficit, on peut y ajouter l’Irlande. Conclusion : au début de 1998, moment où il sera décidé officiellement qui peut participer à la monnaie unique, l’Euro ne sera en aucun cas une monnaie unique, mais seulement la monnaie de quelques pays de l’UE.
Instabilité croissante
Ce fait a des conséquences juridiques, économiques et politiques extrêmement importantes.
Premièrement, l’échec du traité de Maastricht est patent. Nous voulons dire par là que l’objectif central au nom duquel le patronat mène sa politique économique et sociale dans tous les pays d’Europe est un échec, et n’a plus de crédibilité.
Deuxièmement : les fameux avantages « dérivés » de l’Euro – en tant que monnaie unique de toute l’Union européenne – 6 tombent à l’eau. À savoir, constituer une monnaie de référence capable de concurrencer le dollar : fournir un instrument pour une politique socio-économique autonome en fonction du modèle européen, et créer une large zone de stabilité monétaire.
Troisièmement : au contraire, les tensions risquent d’augmenter au sein de l’Union entre ceux qui font partie du noyau dur et les autres, d’ici 1999 et après. La décision sur la participation à la monnaie unique ne sera pas « technique » mais politique. Comme lors de l’unification monétaire allemande, en 1990-1991. L’Allemagne, la France et les pays du Bénélux doivent au moins en être pour que l’opération ait un sens.
Mais que se passera-t-il si la Grande-Bretagne, l’Italie, l’Espagne, etc. restent en-dehors de l’Euro ? L’instabilité monétaire entre la monnaie unique d’une part, la lire, la peseta et la livre d’autre part va tendre à augmenter spontanément. Car pourquoi ces pays se priveraient-ils de la possibilité de faire usage de nouvelles « dévaluations compétitives » de leurs monnaies (comme ils l’ont fait depuis 1992), qui leur permettraient de gagner des parts de marché ? Pour prévenir ce risque, les participants au sommet de Madrid ont conclu un accord de principe pour un pacte de stabilité monétaire, un mécanisme semblable à l’actuel Système Monétaire Européen 7, avec pour but de contraindre les pays qui ne sont pas dans l’Euro à faire en sorte que leurs monnaies fluctuent dans des marges étroites par rapport à celui-ci, et avec l’obligation pour le pays qui en sort (sous la pression des marchés financiers, par exemple) de prendre les mesures qui s’imposent.
Tout cela pose deux questions considérables, du point de vue même de l’Union européenne.
Premièrement : l’UE restant par définition l’ensemble des pays ayant signé le Traité de Maastricht, quelle sera la valeur juridique « communautaire » (c’est-à-dire supranationale) des décisions prises (notamment par la fameuse et en principe puissante Banque centrale européenne) par les pays de « la zone euro » pour l’ensemble de l’UE ?
Deuxièmement : comment cette zone « euro » affectera-t-elle la dynamique globale des rapports socio-économiques concrets au sein du marché unique (embrassant l’UE), y compris sur la possibilité des « outsiders » de rattraper le noyau dur de l’euro ?
1999, « salto mortale »
Entre-temps, un nouvel élément a surgi avec force : la résistance sérieuse du monde de travail et des jeunes. La « fracture sociale » tant de fois annoncée est là ! Le mouvement français n’est pas le premier de la série. N’étant pas terminé lui-même, il ne sera pas le dernier. La résistance sociale en Italie, initiée en juillet 1992, était dans une certaine mesure plus large, plus forte et plus profonde que ce qui se passe aujourd’hui dans l’hexagone. La Belgique a connu un formidable mouvement gréviste, avec en point d’orgue la grève « totale » de 24 heures, le 26 novembre 1993. Mais, du fait de la situation géographique de la France, de son poids économique et politique, de son rôle-pivot dans l’unification européenne, des traditions spécifiques de la lutte de classes et, plus encore, parce que nous sommes entrés dans le sprint final vers la monnaie unique, la résistance sociale apparaît comme hautement emblématique : première grève générale européenne contre le Traité de Maastricht, en pointillé, contre l’UE. Cette résistance va se renforcer à l’échelle du sous-continent. Ce qui se passe en France offre un cadre socio-politique nouveau à des parties du secteur public, entrées en lutte actuellement dans plusieurs pays de l’Union (France, Italie, Belgique, Luxembourg) à partir de leurs propres forces. L’opposition acharnée contre la privatisation des chemins de fer britanniques (venant après les conséquences catastrophiques de la privatisation de l’eau) est un signe qui ne trompe pas.
Deux obstacles nouveaux se dressent sur la voie vers l’Union européenne.
L’application du dit « acte unique » (adopté en 1986), qui a créé le marché unique en 1993, est toujours en cours. C’est de là que découlent les attaques concordantes et synchronisées contre le secteur public dans leurs différents aspects (privatisation, dérégulation, statut du personnel), dans tous les pays de l’Union. La tentative de morceler le secteur public en autonomisant les entreprises publiques et en différenciant les statuts n’a pas pu empêcher l’unification dans l’action. Du coup, la lutte dans le secteur public sert de point de référence à l’ensemble de la résistance sociale. En second lieu, la possible introduction d’une zone euro-monétaire partielle est plus que jamais dépendante de la conjoncture économique en 1996-1997 qui servira de base pour mesurer l’avancement des pays de l’UE sur la voie des « critères de convergence ». Si cette conjoncture est bonne, alors il y aura des marges de manœuvre à différents niveaux. Mais si la morosité actuelle se poursuit, avec des taux de croissance oscillant autour de 2 %, ou si elle s’aggrave, notamment en France et en Allemagne 8 et débouche sur une (mini)récession, alors appliquer les critères de Maastricht équivaudra à éteindre le feu social par des flammes. Car les déficits augmenteront spontanément et cumulativement (par le jeu du marché) : le ralentissement de l’activité économique, signifiant plus de chômage, donc plus d’allocations de chômage, et moins de rentrées fiscales et de cotisations sociales. La consommation, dont le bas niveau est un grand sujet de préoccupation pour les responsables politiques aujourd’hui, ne peut dans ce cas que reculer sous l’impact de la contraction de la demande sociale. Dans ce contexte, maintenir comme priorité la réduction des déficits publics de la dette publique peut signifier un vrai « salto mortale », un saut de la mort. Les projections qui sont faites de ce que pourrait signifier, pays par pays, la politique pour ramener les déficits en-dessous de 3 % du PIB, débouche partout sur la même conclusion : une énorme attaque contre la classe ouvrière et une aggravation sérieuse de la récession économique (réduction du pouvoir d’achat social) !
La fameuse devise, des années 70, du social-démocrate allemand Helmut Schmidt, « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain » a cédé la place à une autre : « moins de déficits signifient des taux d’intérêt plus bas, donc plus d’investissements et plus d’emplois ». Mais cette nouvelle devise n’est pas plus juste que l’ancienne. Car, en réalité, les profits des entreprises servent seulement très partiellement à financer des investissements dans le secteur productif et encore moins à financer des investissements expansifs qui créent des emplois.
L’économie de marché et l’Europe ont fait faillite. C’est une conclusion qui est en train d’être assimilée massivement par de larges couches de la population. Cela explique pour une large part la résistance massive, avec sa force surprenante, qui réside non seulement dans l’acharnement de ceux qui font grève mais aussi – et cela est plus surprenant encore – dans la sympathie très grande des opinions publiques. Dans de telles conditions, la question se pose : la bourgeoisie est-elle prête à déclencher cette guerre sociale ?
Hésitations de la bourgeoisie
Les classes dominantes d’Europe hésitent, non pas sur l’opportunité, mais sur la faisabilité – dans ces conditions – de l’Euro. Bien sûr, cette hésitation n’est pas affirmée telle quelle publiquement. La lutte pour la monnaie unique – qu’on y arrive ou pas – ne sert-elle pas aussi à briser l’État-providence pays par pays. Et l’Europe « politique », dont cette union monétaire est censée être l’amorce, n’a-t-elle pour fonction, avec la béate collaboration de la social-démocratie, d’enterrer toute perspective socio-politique alternative. « Il n’y a pas d’alternative » titrait, en français (!) le Financial Times, qui est pourtant un adversaire notoire du scénario maastrichtien. Pas question de laisser s’entrouvrir la moindre brèche, faute de quoi toute la construction européenne risque de s’effondrer !
Mais certains secteurs patronaux sont nerveux.
Le secteur des banques craint de voir diminuer les profits qu’il tire de ses activités de change et qui, de plus, doit s’engager dans un gigantesque processus de restauration accéléré par dérégulation de l’union monétaire. Mais aussi des entreprises et des secteurs industriels de l’Euro-zone, dont les exportations vers les pays de l’UE-hors du noyau dur sont à la merci d’un « euro », monnaie de plus en plus chère, et de nouvelles dévaluations compétitives.
Toute une série de contradictions sociales, politiques et nationales au sein de l’UE et au sein des différents États membres sont ainsi activées.
Un rapprochement soudain et remarquable s’est produit entre la Grande-Bretagne et l’Italie, deux pays qui risquent de ne pas être dans le noyau dur pour des raisons différentes mais convergentes. Tous deux agitent le spectre d’une « Europe allemande ». Cette crainte vit aussi dans une partie de la classe dominante française, mais celle-ci s’accroche malgré tout à Maastricht et exige même une accélération de la marche, seule manière de peser sur la Bundesbank.
En Allemagne, précisément, le ministre des Finances Theo Waigel donne de lui l’image d’un fanatique de Maastricht. Mais cela pourrait s’avérer être un masque cachant un vrai eurosceptique. Le plan de stabilité, imaginé par Waigel et dont les principes ont été adoptés à Madrid, comporte les éléments suivants : 1- une interprétation très sévère des critères de Maastricht ; 2- un accord monétaire, analogue à l’accord du Système monétaire européen actuel, entre les pays de la zone-Euro et les autres ; 3 un pacte de stabilité entre les pays de la zone-Euro qui consiste essentiellement à remplacer la norme de 3 % de déficit par une norme de 1 % (avec des amendes pour les pays fautifs). En d’autres termes : un Maastricht II avant la mise en application de Maastricht I ! Un véritable aveu que les tentatives forcées et crispées de certains pays pour atteindre début 1998 les critères de Maastricht peuvent connaître un succès ponctuel. Mais elles ne garantissent nullement la stabilité monétaire et... sociale ultérieure. Et que la politique d’austérité continuera de plus belle ! À bon entendeur, salut ! Car l’union monétaire est bâtie sur une rigidité de fer : elle enlève à chaque gouvernement de l’Union sa politique monétaire et budgétaire (et au-delà), mais elle lui impose la gestion de la lutte de classes. Et gare à l’instabilité politique et sociale ! Mais toute contradiction d’ampleur risque de déboucher, plus qu’avant, sur une situation explosive. Car, les deux termes de la contradiction croissent : déficits budgétaires et résistances et luttes sociales. Le scénario, adopté à Madrid, avec ses échéances précises pousse chaque gouvernement à la confrontation.
Confrontation ou concertation, l’une et l’autre sont source d’instabilité, surtout si les « marchés financiers » mettent leur grain de sel. Si la bourgeoisie choisit la confrontation, elle doit pouvoir gagner la bataille, et le plus vite possible. Cela signifie un scénario à la Thatcher. Mais Thatcher a gagné avant que Maastricht ne soit engagé.
Inversement, des concessions sociales substantielles d’un gouvernement dans un pays feraient dérailler les critères de Maastricht et le scénario européen. Les classes dirigeantes iront-elles aveuglément à la confrontation ?
En France, Pasqua s’est ainsi profilé, comme alternative à Juppé, en relançant l’idée de « l’autre politique » : pas de mise en question explicite de Maastricht, mais révision du calendrier. Relance de l’économie, mesures sociales avancées et concertation avec les syndicats. Combinée à une politique sécuritaire et nationaliste, il postule également une solution populiste-bonapartiste à l’instabilité politique ambiante. Pour le moment, Juppé, et la bourgeoisie française derrière lui, ont tenu bon. Et pour cause : cette alternative est déchirante, et impliquerait un véritable tournant, aux conséquences imprévisibles en France et en Europe ! Mais si le mouvement social redémarre, elle refera surface.
La politique de Waigel est aux antipodes de celle de Pasqua : refus de toute concession sociale et priorité rigoureuse, voire renforcement, des critères de Maastricht. Mais constatant les mêmes difficultés que Pasqua (et n’étant pas confronté à une montée sociale « de gauche », mais à une opposition du « Mark-nationalisme ») il arrive à une même conclusion : mieux vaudrait reculer les échéances de l’Euro.
L’histoire se corse
Car l’union monétaire soulève la question des institutions européennes. Si les tensions sont fortes entre les principaux gouvernements de l’UE, les chemins du compromis se dessinent aussi. Le récent accord Kohl-Chirac, préparant les Sommets qui vont se succéder jusqu’en juin 1997 afin de refondre le traité de Maastricht, en donne le cadre : poids renforcé des « grands » de l’UE (en premier la RFA) dans les instances communautaires, réduction du pouvoir de la Commission européenne et du Parlement européen (qui n’en a presque pas) au profit du Conseil européen qui regroupe les gouvernements. Ce recul net de la supranationalité permet de préparer, en temps utile, un compromis avec la Grande-Bretagne. Comme celle-ci (avec à sa tête Blair et un gouvernement social-démocrate) semble tourner sur la question de l’union monétaire, tout en rejetant l’idée même d’un calendrier, elle pourrait (re)prendre sa place de plain-pied dans l’UE en courtisant la RFA sur la base d’une politique néolibérale à l’intérieur (dérégulation et privatisations en RFA) et vers l’extérieur. La présidence espagnole du semestre qui vient de se conclure, a « flatté » cette opinion en mettant l’UE au centre d’une série d’accords commerciaux préférentiels : avec l’Europe de l’Est et la Russie, d’une part, le Mercosur (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay), le pacte transatlantique (avec les USA), l’accord de la zone méditerranéenne, etc.
Mais la France et l’Allemagne auront besoin, chacune de son côté et pour des raisons particulières, d’une série d’institutions politiques de l’UE mieux charpentées qu’actuellement.
La voie vers la révision de Maastricht sera sinueuse et accidentée.
L’Europe sociale ne vient pas
Difficile de prévoir ce qui va se passer dans l’avenir proche. Les classes dominantes d’Europe pèsent le pour et le contre des diverses orientations. Elles laissent carte blanche à leurs « planificateurs ». Mais elles tiennent solidement les rênes de la politique antisociale. Il n’y a en fait que les directions réformistes du mouvement ouvrier qui continuent, comme des moutons, à digérer, tranche après tranche, les traités, les critères et les scénarios, qu’on leur présente. Mais ils ont de plus en plus de mal à justifier ce suivisme béat.
Il y a quatre faits incontournables qui doivent former le point de départ d’une stratégie socialiste alternative.
En premier lieu, il n’y a pas d’Europe sociale en vue, sur le plan juridique et institutionnel de l’Union européenne. Non seulement les commentateurs critiques mais aussi les thuriféraires de l’UE sont obligés de le reconnaître 9. L’État « social », ou l’État-providence, n’existe que dans les États nationaux. Mais il est en voie de démantèlement précisément parce qu’il n’existe pas de législation sociale convergente, institutionnalisée au niveau européen, susceptible de faire barrage, ne fût-ce que partiellement, à la concurrence au sein de l’UE en tant que marché unifié. Il existe la possibilité de mener une certaine politique sociale, basée sur les 14e et 15e protocoles (annexés au traité de Maastricht). Mais on a prouvé de façon convaincante que cette politique sociale n’a aucune valeur juridique pour l’Union européenne, et que par conséquent elle est un alibi et une impasse 10.
En deuxième lieu : la persistance d’un chômage de masse dresse le bilan social de la politique gouvernementale de l’UE (c’est-à-dire du Conseil européen). Les « livres » blancs et verts de la commission européenne et des sommets européens prétendent évidemment que la lutte contre le chômage est la priorité des priorités, mais le Conseil européen (la réunion des gouvernements des États membres), qui a le vrai pouvoir dans l’UE, pourrait prendre des décisions sociales, sans s’appuyer directement sur les règles de « l’Europe sociale ». Le Livre Blanc de Delors (1993) est d’ailleurs la version néolibérale d’un plan d’emploi, et c’est à ce titre qu’il est critiqué par des économistes de l’establishment comme Drèze et Malinvaud 11. Seul un changement radical dans les rapports de forces sociaux et politiques peut forcer ces messieurs à changer d’opinion.
En troisième lieu : il est clair aujourd’hui que l’union monétaire telle que prévue dans le traité de Maastricht et investie de tous les espoirs socio-démocrates ne verra pas le jour. Il est tout aussi clair que, malgré cela, la politique de régression qui allait de pair avec cet objectif continue bel et bien, c’est la seule certitude de la résolution du sommet de Madrid, ainsi que le seul point vraiment commun entre les gouvernements réunis.
En quatrième lieu : L’UE perd de plus en plus en légitimité et en popularité. La résistance se développe. Plus la lutte sociale occupe le devant de la scène et gagne, elle, en légitimité, plus il y a de l’espace pour une alternative de gauche, sociale.
Il est donc grand temps que le mouvement ouvrier reprenne son autonomie et son indépendance par rapport à la politique de l’UE.
Le point de départ est le rejet des critères de Maastricht et de l’euro-scénario décidé à Madrid. Aucun doute n’est en effet possible : le mouvement ouvrier existant (les dirigeants syndicaux nationaux et des centrales professionnelles, les dirigeants politiques de la social-démocratie et l’aile ouvrière de la démocratie chrétienne) sont en mesure, s’ils le veulent d’arrêter l’offensive néolibérale. Comment ? La réponse a été donnée par Raymonde Dury, europarlementaire du PS belge : il s’agit, « avant les négociations (au parlement européen) de provoquer la crise pour mettre les gouvernements au pied du mur » 12. L’ouverture d’une crise au sommet de l’UE, y compris par la voie parlementaire, est un moindre mal du point de vue du mouvement ouvrier. Elle signifierait un arrêt au projet du grand capital et ne ferait que répondre à ce que des millions de travailleurs et travailleuses ont exprimé et exprimeront sur le plan social, extraparlementaire dans les mois qui viennent. La crise en elle-même n’est pas une réponse programmatique. Au moins permettrait-elle d’ouvrir un débat étouffé depuis une décennie.
Bruxelles, 20 décembre 1995
- 1Livre Vert sur les modalités de passage à la monnaie unique (31 mai 1995), Commission européenne, p4.
- 2Armand Denis SCOR La monnaie unique, PUF ; Que sais·je ?, 1995, pp11·36.
- 3Étude récente de la Banque d’Angleterre, cité dans Olivier PlOT Finance et économie· la Fracture, Marabout,1995, p 11.
- 4The Economist, 9 décembre 1995, p 20.
- 5Profils économiques de I’UE (en néerlandais), Weekberichten·Kredietbank, vol 50, n°32, 24 novembre 1995.
- 6Les grands agrégats font rêver la Commission européenne, sur la base 1994, le PIB de I’UE, des USA et du Japon était respectivement : 6 184,1 Ecu, 5 576,0 Ecu et 38 899,0 Ecu.
- 7Le SME, fut instauré en 1979. Il faisait suite au « serpent » monétaire. Né en 1972, ce dernier reposait sur le principe d’une marge de fluctuation de 2,25 % entre monnaies européennes et tunnel de 4,5 %. A partir de 1973, les monnaies adoptaient le principe d’une parité fixe et flottaient conjointement dans un système monétaire international, instable après la disparition des Accords de Bretton-Woods (1971). À la monnaie la plus faible de défendre ses marges sur la base de ses propres réserves de change. Le SME est une solution « communautaire » : chaque monnaie repose sur un seuil de divergence maximale de chaque monnaie au sein de l’ECU. Dans ce cas, c’est le pays qui « diverge » (vers le bas ou vers le haut) qui est présumé devoir corriger l’écart.
- 8L’OCDE vient de-sortir ses prévisions « peintes en rose », pour les années concernées. La Commission européenne y a tout de suite trouvé un argument pour annoncer la quasi réussite d’un noyau dur France, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark. La Belgique serait à 0,5 % de la norme : encore un effort (Cf. Tableau dans The Economist, cit,). Elles sont contredites par les rapports de l’INSEE (France), une déclaration par plusieurs instituts bancaires allemands, Hans-Helmut Katz (Deutsche Girozentrale, Libération, 11 décembre 1995), le rapport de la FEB (organisation patronale belge).
- 9Daniel Lenoir, L’Europe sociale, La Découverte, 1994, pour la version critique, l’autre : Bruno Maliulo, L’Europe sociale, Nathan, 1991.
- 10E. Vogei-Polsky, Maastricht ou la voie étroite du social, in Marco Telo (éd) Quelle union sociale ?, ULB, 1994, pp 91-92.
- 11Publié dans : Jacques Dreze, Pour l’emploi, la croissance et l’Europe, De Boeck-Université, 1995, pp 58·98.
- 12Le Soir, (belge), 8 décembre 1995.