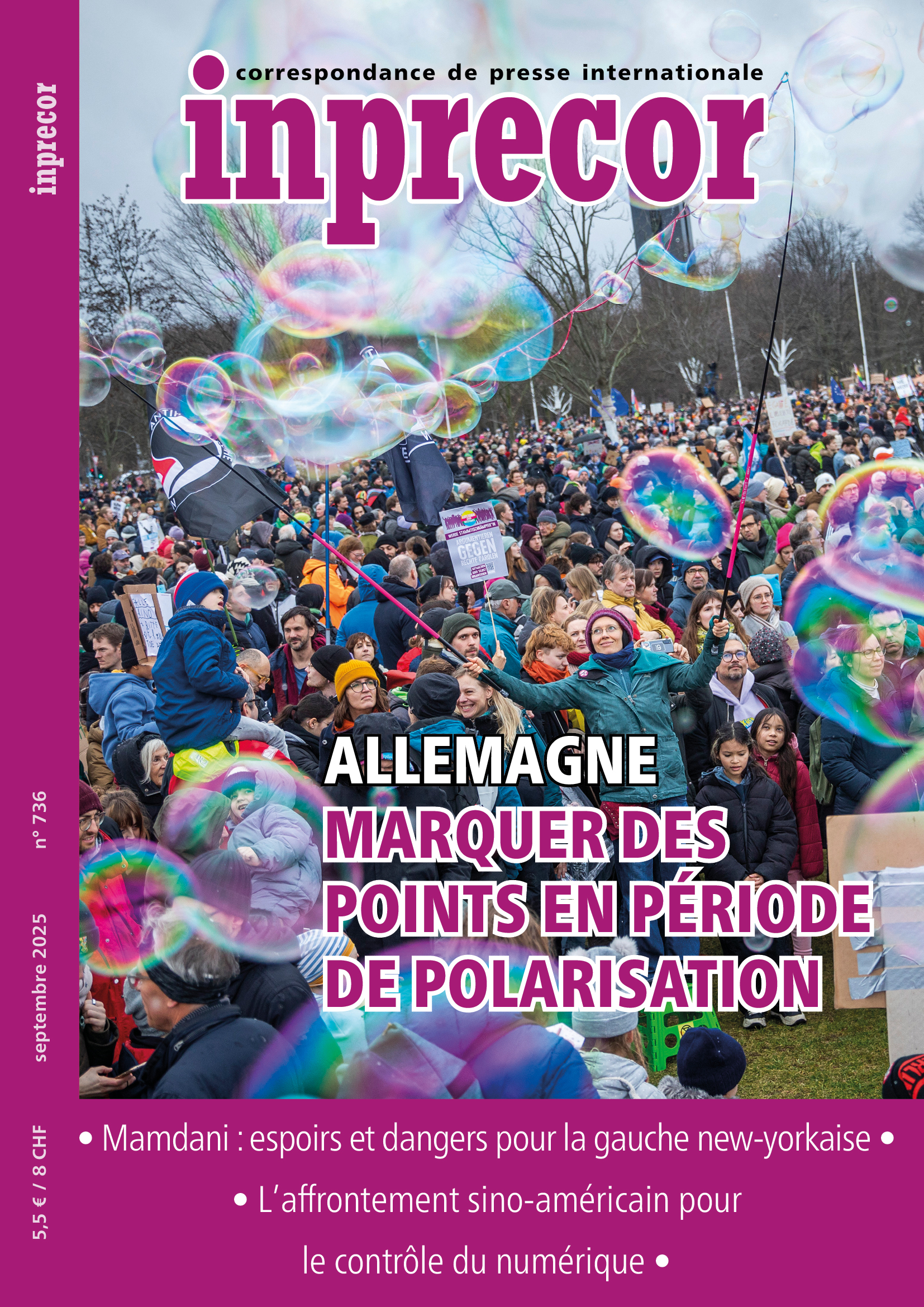Nous écrivons en tant que militant·es solidaires de l’Ukraine et membres de l’UCU (University and College Union). Cette expérience nous a amené·es à réfléchir à l’attitude que devraient adopter les socialistes et les syndicalistes face à la guerre, en particulier à la manière dont nous soutenons l’opposition aux guerres impérialistes, la critique de l’industrie de l’armement et la solidarité avec les guerres de libération nationale.
Le mouvement ouvrier en général, et les mouvements des opprimé·es, en particulier le mouvement des femmes, ont une longue et honorable tradition d’opposition aux guerres et à l’industrie de l’armement. Mais, à notre avis, cela ne signifie pas adopter une position complètement pacifiste. Nous pensons qu’il existe des circonstances dans lesquelles la résistance armée est nécessaire et doit être soutenue, en particulier lors des guerres de libération nationale, comme mentionné ci-dessus. Cela soulève une question importante pour la gauche : comment concilier notre critique de longue date du militarisme avec le soutien à ce type de luttes ?
Ces questions sont devenues de plus en plus pertinentes ces dernières années en raison de la guerre en Ukraine. Nous écrivons en tant que partisan·es de la résistance armée du peuple ukrainien contre l’agression russe. Dans ce contexte, nous avons vu des sections de la gauche, travaillant conjointement avec des groupes anti-guerre/pacifistes, adopter des positions pacifistes ou semi-pacifistes à l’égard de l’Ukraine. Ces personnes passent sans transition de l’appel à « la paix plutôt que la guerre » à l’appel à l’arrêt des livraisons d’armes à l’Ukraine, sans reconnaître les implications de cette position pour le peuple ukrainien et en ignorant le fait qu’elle est contraire à ce que réclament les syndicats ukrainiens.
Nous avons également assisté à des débats dans lesquels le soutien au droit des Ukrainien·nes à accéder à des armes pour se défendre était assimilé à un soutien à la guerre, à l’OTAN, à une inconscience des dangers d’une troisième guerre mondiale et d’une guerre nucléaire, et à un soutien aux gouvernements occidentaux. Nous estimons qu’il est tout à fait légitime de s’inquiéter d’une troisième guerre mondiale et des dangers d’une escalade des conflits, mais qu’il ne faut pas y répondre par une politique d’apaisement qui demande aux nations opprimées de renoncer à leur droit à l’autodétermination nationale ou d’accepter le partage forcé de leur territoire. Nous nous opposons également à l’idée que les nations opprimées doivent accepter des politiques (qu’elles soient intérieures ou extérieures) déterminées par les États puissants voisins, en restant dans leur sphère d’influence, quels que soient les souhaits de leur peuple.
Nous pensons également qu’il est important de reconnaître que, dans le monde contemporain, dans la mesure où les mouvements de libération nationale ou les pays qui luttent pour conserver leur autodétermination sont souvent relativement faibles sur le plan économique et militaire par rapport aux puissances impérialistes concurrentes, ces mouvements peuvent avoir besoin d’un soutien militaire, par exemple sous forme de livraisons d’armes, de la part d’une ou plusieurs de ces puissances. Cela soulève à nouveau des questions importantes pour les socialistes. Comment concilier cette nécessité avec nos luttes actuelles contre la domination impérialiste ?
Ces expériences nous ont amené·es à réfléchir à ce que signifie être antimilitariste et à la manière dont nous devrions définir l’antimilitarisme. Les notes qui suivent s’efforcent d’esquisser une position qui est antimilitariste sans être pacifiste et qui n’est pas en conflit avec la solidarité avec le peuple ukrainien. Nous ne prétendons pas qu’elles soient exhaustives.
Revendications
Les notes ci-dessous sont présentées sous forme de revendications ou d’exigences. Elles représentent les conditions qui, selon nous, doivent être remplies pour que le soutien militaire nécessaire aux mouvements progressistes évite de renforcer le militarisme. Nous les avons regroupées en trois catégories : celles qui s’adressent principalement à nous-mêmes, comme partie prenante du mouvement ouvrier ; celles qui s’adressent principalement aux gouvernements nationaux ; et celles qui s’adressent principalement aux organisations internationales.
En ce qui concerne le premier groupe, les exigences que nous estimons devoir être mises en avant par les socialistes sont les suivantes :
• Pas de romantisation ni de glorification de la guerre ; une approche critique des cérémonies militaires et des monuments commémoratifs.
• Reconnaissance du fait que la guerre nuit à l’environnement ; soutien aux opérations de déminage et à la reconstruction après la guerre, y compris la restauration de l’environnement en Ukraine et dans d’autres pays dévastés par la guerre.
• Opposition au racisme, au sexisme, à la misogynie et à d’autres préjugés pouvant être liés à la guerre ou exacerbés par celle-ci. Opposition aux atteintes aux droits reproductifs des femmes ou aux pressions exercées sur les femmes pour qu’elles produisent des enfants comme chair à canon. Soutien à l’égalité des droits dans l’armée.
• Reconnaissance du coût humain de la guerre et soutien aux ancien·nes combattant·es et aux personnes blessées ou handicapées à la guerre. Reconnaissance de la situation des réfugié·es et des autres personnes déplacées par la guerre. Reconnaissance de la situation des personnes qui ont vécu des situations de guerre.
• Préférence pour les négociations à chaque fois qu’elles peuvent être utilisées pour éviter la guerre et obtenir des règlements justes.
• Soutien aux organisations internationales et aux ONG dans la mesure où elles peuvent contribuer à la négociation de règlements justes.
• Opposition aux règlements de paix injustes, au colonialisme et aux annexions de territoires.
• Soutien à l’égalité des droits entre les nations et les pays, sans pression sur les petites nations pour qu’elles renoncent à leur indépendance ou acceptent d’être traitées comme l’arrière-cour d’un autre pays.
• Reconnaissance qu’il peut y avoir des guerres justes.
• Soutien aux droits à l’autodétermination et à la légitime défense.
Les exigences que nous adresserions aux gouvernements nationaux, en particulier dans nos pays d’origine, sont les suivantes :
• Reconnaissance des droits des objecteurs de conscience et soutien à la mise en place de formes alternatives de service civil pour ces derniers.
• Nationalisation de l’industrie de l’armement.
• Une fiscalité progressiste sur les entreprises et les riches pour financer les dépenses militaires. Le rejet de l’argument des gouvernements selon lequel les coupes dans les dépenses sociales sont nécessaires pour financer les guerres. La défense des prestations sociales en temps de guerre comme en temps de paix.
• Pas de ressources pour des projets militaires prestigieux destinés à favoriser le capital plutôt qu’à atteindre des objectifs concrets.
• Contrôle démocratique des dépenses militaires.
• Droit des membres des forces armées de former des syndicats et d’y adhérer.
• Soutien aux anciens combattant·es et aux civil·es blessé·es pendant les guerres, y compris en matière de soins de santé mentale et physique, d’éducation, d’emploi, de logement et de maintien des revenus. Prise en charge des réfugié·es et autres personnes déplacées par les guerres.
• Soutien militaire aux luttes de libération nationale et aux luttes pour l’autodétermination. Ce soutien doit être fourni sans restriction politique qui compromettrait la lutte pour la libération. Si ce soutien peut être inconditionnel, cela ne signifie pas pour autant qu’il doive être acritique.
• Désarmement nucléaire, interdiction des armes biologiques et chimiques. Une reconnaissance doit être accordée aux pays qui renoncent aux armes nucléaires, ainsi que des mesures visant à garantir qu’ils ne soient pas désavantagés.
Les revendications qui, selon nous, nécessitent une certaine coordination internationale pour être satisfaites, peut-être par le biais de traités internationaux, sont les suivantes :
• soutien aux « règles de la guerre » en termes d’opposition aux crimes de guerre et à la prolongation inutile des guerres. Il s’agit notamment des conventions visant à protéger les civil·es, les infrastructures civiles et l’environnement en temps de guerre, ainsi que des conventions relatives aux droits des prisonnier·es de guerre. Soutien aux tribunaux chargés de juger les crimes de guerre, ainsi qu’aux tribunaux internationaux de justice, à condition qu’ils s’appliquent à tous les pays.
• Soutien aux politiques économiques, sociales et environnementales qui favorisent un développement pacifique et éliminent au moins certaines des causes de la guerre.
Le 15 août 2025
Source : Labour Hub. Traduit par Catherine Samary.