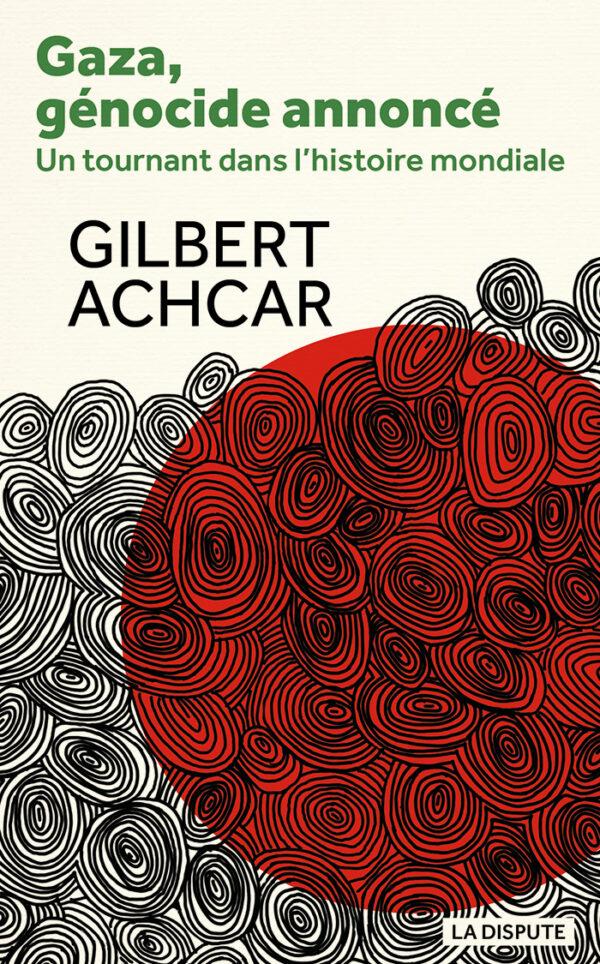
Le génocide à Gaza ne peut être compris correctement sans vous pousser à une action de solidarité. Simon Pearson chronique le livre de Gilbert Achcar, Gaza, génocide annoncé – un tournant dans l’histoire mondiale.
La Catastrophe de Gaza, de Gilbert Achcar, n’est pas un appel à la compassion. C’est une arme politique. Écrit en plein génocide, il dépouille le discours de ses euphémismes, de son théâtre diplomatique et de son brouillard moral. Cette guerre, affirme-t-il, est un projet colonialiste. Accélérée jusqu’à sa forme la plus brutale, elle bénéficie du soutien total des puissances occidentales qui prétendent défendre les droits humains. Achcar met le système en évidence, en retrace l’échafaudage historique et accuse non seulement Israël, mais aussi l’ordre mondial qui le rend possible. Ce n’est pas un livre de deuil. C’est un appel à l’action.
Le livre de Gilbert Achcar, Gaza, génocide annoncé, n’est pas un livre de plus sur Gaza. C’est un réquisitoire. Et pas seulement contre Israël, même si le nom de cet État apparaît dans presque toutes les pages. C’est un réquisitoire contre le système mondial qui a rendu le génocide possible, légal, acceptable, voire bureaucratiquement inévitable. Ce n’est pas un livre sur une tragédie. C’est un livre sur un crime. Et ce crime, insiste Achcar dès le début, n’est pas seulement l’acte de destruction, mais la logique qui a rendu cette destruction concevable.
Le titre est délibéré. Ce n’est pas une catastrophe (L’auteur fait référence au titre en anglais : Gaza Catastrophe: The Genocide in World-historical Perspective, NdT). C’est la catastrophe. Et ce n’est pas accidentel. C’était le but recherché.
La méthode d’Achcar : nommer le système
L’œuvre de Gilbert Achcar s’est toujours démarquée du genre des lamentations libérales. Marxiste de l’école anti-impérialiste, Achcar n’écrit pas pour diagnostiquer la tragédie, mais pour en exposer la structure. Ayant grandi au Liban et longtemps basé à la SOAS à Londres, il apporte à chaque crise non seulement une mémoire historique profonde, mais aussi une analyse acérée. Le choc des barbaries (2002) a disséqué l’ordre mondial post-11 Septembre bien avant que le centre libéral ne s’en empare. Les arabes et la Shoah (2010) a remis en cause à la fois l’instrumentalisation sioniste et l’amnésie historique arabe. Dans chaque cas, la méthode est la même : déconstruire l’échafaudage idéologique, révéler l’architecture géopolitique et réarmer la gauche avec une clarté conceptuelle.
Cette même clarté transparaît dans Israel’s War on Gaza, une brève et urgente polémique publiée par Resistance Books en décembre 2023, écrite alors que les bombes tombaient et que les euphémismes étaient forgés. Achcar y exposait ce que beaucoup refusaient de nommer : que le bombardement de Gaza par Israël n’était pas simplement une riposte, mais une extermination, « rien de moins qu’un génocide ». Il a averti très tôt qu’une deuxième Nakba n’était pas seulement un risque, mais un objectif stratégique. Et il a dénoncé la complicité des gouvernements occidentaux. En particulier celle des États-Unis et de l’Union européenne. Non pas comme une passivité diplomatique, mais comme une collaboration active. « Le refus des gouvernements occidentaux d’appeler à un cessez-le-feu », écrivait-il, « les rend complices de crimes contre l’humanité ».
Israel’s War on Gaza n’était pas seulement une chronique, c’était une intervention politique. Il esquissait les contours d’un argument plus long : ce à quoi nous assistions n’était pas un outrage isolé, mais l’éruption d’une contradiction historique mondiale. Il s’agissait de l’incapacité de l’État colonial à contenir la conscience nationale du peuple qu’il avait tenté d’effacer. Gaza, un génocide annoncé s’appuie sur ce texte, mais il est plus complet, mieux structuré et plus précis sur le plan polémique. En quatre parties, Achcar retrace le long arc qui va de la Nakba au génocide, de la complicité libérale au discrédit atlantiste, des fausses promesses d’Oslo à la politique brûlante du cabinet de guerre de Netanyahou. Si le livret était un signal d’alarme, cet ouvrage est le règlement de comptes politique.
Achcar est impitoyable dans son analyse, mais il ne succombe jamais au désespoir. Sa méthode est dialectique, non moraliste. Il ne demande pas ce qu’il faut ressentir, mais ce qu’il faut faire. Ce faisant, il va à contre-courant de l’indignation performative et nous entraîne sur le terrain de la stratégie politique. La catastrophe de Gaza n’est pas seulement le titre de ce livre (en anglais, NdT). C’est la réalité qui se déroule sous nos yeux. Et elle nous oblige non seulement à observer, mais aussi à agir.
i. Le génocide comme stratégie
Le livre s’ouvre sur des « Réflexions sur le génocide de Gaza et sa portée historique mondiale ». Achcar est précis : il s’agit d’un génocide, non pas au sens métaphorique, mais au sens littéral. Il établit un parallèle entre les actions d’Israël (bombardement de zones civiles, privation de nourriture, destruction des infrastructures) et la définition du génocide donnée par l’ONU. Il cite le langage déshumanisant de Gallant, la doctrine opérationnelle de l’armée israélienne et les déclarations de ministres israéliens. L’intention de détruire n’est pas cachée. Elle est déclarée.
L’une des idées les plus pertinentes d’Achcar apparaît dans sa critique de la stratégie militaire du Hamas : « Cette stratégie est irrationnelle car il est illogique d’attaquer ses ennemis sur le terrain même où ils détiennent une supériorité insurmontable. » Il condamne le choix du Hamas de recourir à la lutte armée, qu’il qualifie de mystique et contre-productif, écrivant que « rien ne justifie ce qui a été le mauvais calcul le plus catastrophique de l’histoire de la lutte anticoloniale ».
Mais l’argument plus profond est que Gaza révèle non seulement la nature de la politique israélienne, mais aussi l’épuisement de l’ordre mondial libéral. L’expression utilisée par Achcar (libéralisme atlantiste) résume bien le consensus qui a prévalu après 1945, à savoir la promotion de la démocratie par les États-Unis, le discours humanitaire et le multilatéralisme fondé sur des règles. Gaza, comme l’Irak avant elle, déchire ce masque. Le soutien inconditionnel de Biden à la campagne de Netanyahou, la paralysie de l’ONU et le silence de l’Union européenne ne sont pas des échecs diplomatiques. Ce sont des faits structurels. Le 18 octobre 2023, Biden a déclaré : « S’il n’y avait pas d’Israël, nous devrions en inventer un... Il n’est pas nécessaire d’être juif pour être sioniste. » Achcar relie cela à ce qu’il appelle la « compassion narcissique », la tendance occidentale à n’étendre l’empathie qu’à ceux qui sont perçus comme culturellement proches. Selon lui, « la définition de soi de Biden en tant que sioniste a été considérablement aiguisée » par les images traumatisantes du 7 Octobre, en particulier celles du festival de musique Nova. La campagne génocidaire qui a suivi, écrit Achcar, s’est déroulée sous le couvert politique de cet outrage.
Et à travers cet effondrement, Achcar voit autre chose : l’ascension d’une nouvelle configuration idéologique. L’ère du néofascisme n’est pas imminente. Elle est déjà là.
ii. D’Oslo à l’anéantissement
La partie II « Vers la catastrophe » revient au terrain qu’Achcar connaît le mieux : l’excavation historique. Mais il ne s’agit pas ici d’établir un contexte libéral. Il s’agit d’un diagnostic structurel. Il commence par interroger la manipulation de la mémoire de l’Holocauste par l’Europe. Loin de prévenir de futures atrocités, l’Holocauste a été instrumentalisé politiquement pour sanctifier l’État d’Israël et faire taire les critiques. Achcar montre que le sionisme est devenu un projet de « blanchiment », alignant la colonie juive sur le bloc civilisationnel occidental.
Il se tourne ensuite vers l’échec du processus de paix. Oslo, selon lui, n’a jamais été synonyme de paix. Il s’agissait d’un confinement contrôlé. Et il s’est effondré dès que les Palestiniens ont compris que les échanges de terres était en réalité une annexion et que la création d’un État équivalait à un asservissement permanent. Achcar détaille comment le Hamas s’est construit à la suite de l’effondrement d’Oslo, non pas comme une simple résistance, mais comme le renversement religieux de la défaite politique.
Sa critique du Hamas est sévère, mais politique. Il qualifie sa stratégie de « mystique », sa lutte armée de contre-productive, son idéologie de régressive. « Qui veut sérieusement affronter une superpuissance nucléaire avec quatre lance-pierres ? », citant Yahya Sinouar, l’homme qui a lancé l’attaque du 7 octobre.
Mais il ne se livre pas à un faux équilibre. La dévastation de Gaza n’est pas une réaction au Hamas. C’est un projet de longue date. « Le génocide de Gaza a été déclenché par une combinaison de facteurs », écrit Achcar, notamment « l’intention délibérée d’infliger un maximum de dégâts... sous la supervision d’une coalition de néofascistes et de néonazis... la fureur meurtrière de l’armée israélienne, associée à la déshumanisation des Palestiniens ».
iii. Un bilan en temps réel
Dans la troisième partie, « Gaza, Nakba, Génocide », Achcar rassemble ses interventions politiques écrites au fur et à mesure que la catastrophe se déroulait. Il ne s’agit pas d’essais universitaires, mais de polémiques urgentes, forgées en temps réel. Leur objectif est stratégique : nommer le génocide, briser les euphémismes et arracher le masque libéral de l’empire.
Achcar ne concède rien sur le terrain du langage. Sa critique est la plus acerbe lorsqu’elle vise « l’équivalence morale » colportée par les médias occidentaux et les dirigeants politiques : l’idée que l’attaque du Hamas du 7 octobre et la campagne militaire israélienne sont des actes de violence équivalents. « Assimiler le massacre du 7 octobre au génocide de Gaza, écrit-il, c’est nier l’asymétrie fondamentale entre colonisateur et colonisé. »
Il fustige les commentateurs libéraux et les ONG qui évitent le terme « génocide », soulignant que le vocabulaire humanitaire est utilisé non pas pour clarifier, mais pour obscurcir. Dans l’une de ses interventions les plus virulentes, il écrit : « L’obscénité ultime est l’équivalence morale entre le génocide de Gaza et le massacre du 7 octobre. »
Cette section est également remarquable pour son analyse des médias. Achcar dissèque sans pitié la manière dont des expressions telles que « boucliers humains », « tunnels de la terreur » et « frappes chirurgicales » servent à justifier l’injustifiable. Selon lui, ces euphémismes ne se contentent pas d’édulcorer la violence, ils la légitiment. Ils constituent un vocabulaire de la complicité.
Son objectif est de repolitiser le débat. Non pas pour faire ressentir les choses, mais pour faire réfléchir, puis agir.
iv. La convergence impériale
L’épilogue, intitulé « Entrée en scène de Trump », ne fonctionne pas comme un post-scriptum, mais comme une synthèse de l’argumentation structurelle d’Achcar : le génocide à Gaza n’est pas une aberration du libéralisme, mais un symptôme de son déclin. Le retour de Trump, affirme Achcar, n’est pas le début de quelque chose de nouveau, mais la consolidation d’une formation néofasciste en gestation depuis longtemps.
Achcar commence par dénoncer ce qu’il appelle une « épidémie généralisée d’illusions » dans la période qui a précédé la réélection de Trump en 2024. Il s’agissait d’un espoir irrationnel, partagé même par les observateurs libéraux ou de gauche, qu’un second mandat de Trump pourrait mettre Netanyahou au pas. Au lieu de cela, Achcar nous rappelle que Trump était déjà le président qui :
- a transféré l’ambassade des États-Unis à Jérusalem,
- a reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien,
- a réduit l’aide à l’UNRWA et à l’Autorité palestinienne,
- et a contribué à la conclusion des accords d’Abraham.
Aucune de ces mesures n’était une anomalie. Elles étaient au contraire le but recherché. Comme le dit Achcar, toute personne « dotée d’une lucidité normale » aurait dû s’attendre à une continuité, voire à une escalade.
Mais Achcar va plus loin. Il dévoile les coulisses de l’influence de Trump sur la politique guerrière de Netanyahou. Pendant la campagne de 2024, Netanyahou a semblé bloquer la proposition de cessez-le-feu négociée par les États-Unis, non seulement pour des raisons stratégiques internes, mais aussi pour courtiser Trump. Une citation révélatrice de Netanyahou en juillet 2024 – « nous y travaillons » – suit immédiatement sa rencontre avec Trump à Mar-a-Lago. Ce n’était pas un hasard. C’était un hommage.
Achcar détaille comment Netanyahou a collaboré avec l’envoyé de Trump, Steve Witkoff (un investisseur immobilier, et compagnon de golf), qui entretient des liens étroits avec Trump et le capital du Golfe, afin de faire coïncider la mise en œuvre du cessez-le-feu avec l’élection du président. Le génocide à Gaza devient ainsi non seulement une campagne stratégique, mais aussi une offrande électorale, alignant les intérêts de deux dirigeants autoritaires grâce à un théâtre de domination commun.
C’est l’aboutissement de la thèse d’Achcar : Gaza est le terrain d’essai d’un nouveau mode de gouvernance impériale, défini non pas par des règles ou des normes, mais par une coopération « enthousiaste » entre dirigeants suprémacistes. Le génocide devient un moyen de diplomatie, un instrument non pas de paix, mais d’alignement entre néofascistes.
L’utilisation de la satire par Achcar (des qualificatifs tels que « vieil ami du président, son partenaire de golf, son ex-avocat, et, comme lui, spéculateur immobilier en association avec les riches États pétroliers arabes ») renforce son propos : il ne s’agit pas d’une aberration, mais d’une mascarade qui constitue la structure même du système. Gaza n’est pas seulement le théâtre d’une tragédie, mais la scène sur laquelle s’affirme un nouvel ordre international.
Dans cette lecture, Trump n’est pas une déviation américaine, mais une cristallisation. Il représente la convergence impériale qu’Achcar a observée tout au long de son ouvrage : Washington, Tel Aviv et les monarchies du Golfe, qui ne se cachent plus derrière une rhétorique humanitaire, mais travaillent ouvertement comme un bloc de capitalisme racial et de coordination sécuritaire. C’est là que le libéralisme prend fin. Non pas dans la contradiction, mais dans la collusion.
Annexe : antisémitisme, sionisme et bataille autour de la définition
L’annexe de Gaza, génocide annoncé reproduit une déclaration importante, co-rédigée par Gilbert Achcar et Raef Zreik, publiée pour la première fois dans The Guardian en 2020 (et en français par Mediapart le 30 novembre 2020, NdT). Il ne s’agit pas d’une réflexion après coup. Il s’agit d’une intervention politique, conçue pour exposer le terrain idéologique sur lequel se déroule le conflit israélo-palestinien dans le discours occidental.
Le contexte est clair : des efforts croissants, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, pour confondre antisémitisme et antisionisme à travers la promotion et l’adoption de la définition de l’antisémitisme par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste. Cette manœuvre, affirment Achcar et Zreik, ne sert pas à protéger les juifs de la haine, mais à délégitimer la cause palestinienne et à réduire au silence les défenseurs des droits des Palestiniens.
« Face à la pression croissante des pro-israéliens pour [l’adoption d’] une définition de l’antisémitisme assimilant toute critique du sionisme et de l’État sioniste à une variante de l’antisémitisme, il était nécessaire que les intellectuels arabes se prononcent sur ce débat. »
La déclaration commence par affirmer la nécessité et l’urgence de lutter contre le véritable antisémitisme : la haine des juifs en tant que juifs, enracinée dans les stéréotypes, le complotisme, la négation de l’Holocauste et la haine raciale. Mais il doit s’agir d’une lutte fondée sur des principes, et non d’une lutte « détournée » pour servir les fins d’un État.
« L’antisémitisme doit être combattu et discrédité. La haine des Juifs en tant que Juifs ne saurait nulle part être tolérée, quel qu’en soit le prétexte ».
Mais cette lutte, poursuivent-ils, est instrumentalisée par le gouvernement israélien et ses alliés :
« La lutte contre l’antisémitisme a été de plus en plus instrumentalisée ces dernières années, [...] dans un effort systématique visant à délégitimer la cause palestinienne et à réduire au silence les défenseurs des droits des Palestiniens. »
Au cœur de cette critique se trouve l’amalgame entre judaïsme et sionisme, et entre l’État d’Israël et « l’autodétermination de tous les juifs ».
La définition de l’AIMH, tout en prétendant être neutre, efface cette distinction, laissant entendre que toute critique d’Israël est nécessairement antisémite. Selon Achcar et Zreik, cela est intellectuellement malhonnête et politiquement dangereux.
« Par certains “exemples” qu’elle fournit, la définition de l’AIMH présuppose que tout Juif est sioniste et que l’État d’Israël dans sa présente réalité incarne l’auto-détermination de tous les Juifs. Nous sommes en profond désaccord avec ce postulat. »
Ils vont plus loin en proposant un contre-principe : le soutien aux droits des Palestiniens n’est pas de l’antisémitisme, et le présenter comme tel nuit à la lutte contre l’antisémitisme réel.
« Le combat contre l’antisémitisme ne saurait être transformée en stratagème pour délégitimer la lutte contre l’oppression des Palestiniens, contre la négation de leurs droits et l’occupation continue de leur terre. »
La déclaration appelle au rejet de tout cadre qui « transformerait les victimes en bourreaux » et conclut en affirmant que les Palestiniens ont le droit de résister à leur oppression et d’exprimer leur réalité (politiquement, moralement et historiquement) sans être réduits au silence par l’instrumentalisation du traumatisme juif.
Dans le contexte de Gaza, génocide annoncé, l’annexe renforce la thèse plus large d’Achcar : les structures idéologiques qui permettent le génocide ne se limitent pas à la doctrine militaire ou à la logique des colons. Elles sont intégrées dans le langage même utilisé pour définir la haine. En résistant à l’amalgame entre antisémitisme et critique d’Israël, Achcar remet en cause un pilier discursif central du sionisme libéral et défend le droit (voire la nécessité) de nommer le génocide lorsqu’il se produit.
Néofascisme : la banalité du génocide
L’analyse d’Achcar est particulièrement percutante lorsqu’il nomme la logique idéologique qui anime le gouvernement israélien : il ne s’agit pas seulement de l’extrême droite, mais d’un néofascisme en phase avec un courant mondial.
Dans Gaza, génocide annoncé, Achcar n’hésite pas à employer ce terme. Il décrit la coalition au pouvoir en Israël comme « composée des forces les plus extrêmes de la droite, des sionistes religieux et des ultra-orthodoxes du pays », affirmant que le génocide à Gaza n’est pas simplement le produit du militarisme ou du colonialisme, mais l’expression d’un projet politique néofasciste opérant derrière une façade démocratique.
Comme il l’écrit dans « L’ère du néofascisme et ses particularités » (5 février 2025) :
« Le néofascisme prétend respecter les règles fondamentales de la démocratie au lieu d’établir une dictature pure et simple comme l’a fait son prédécesseur, même s’il vide la démocratie de son contenu en érodant les libertés politiques réelles... »
En d’autres termes, les élections peuvent se poursuivre, mais le système devient vide, dépourvu de toute représentation pour les Palestiniens comme pour les Israéliens dissidents. Dans The Gaza Catastrophe, Achcar intègre cette analyse dans son analyse historique mondiale du génocide, soulignant que les conditions idéologiques préalables à la guerre contre Gaza n’étaient pas rhétoriques mais structurelles : la normalisation du sionisme suprémaciste, les attaques judiciaires contre les démocrates israéliens et l’ancrage d’acteurs ouvertement génocidaires au sein du gouvernement.
Achcar situe clairement le cabinet israélien dans cette logique néofasciste : des partis politiques autrefois considérés comme terroristes sont aujourd’hui au gouvernement ; des idéologues du nettoyage ethnique sont élevés à des postes ministériels. Il s’agit d’un apartheid contrôlé par l’État, avec l’électoralisme pour couverture et et l’occupation comme politique. L’appareil colonial ne se contente pas de perdurer. Il s’intensifie considérablement dans les conditions du néofascisme.
Il élargit son champ de vision au-delà de Jérusalem. Dans « Paix entre néofascistes et la guerre contre les peuples opprimés » (18 février 2025), Achcar observe :
« Nous assistons aujourd’hui à une convergence entre les néofascistes aux dépens des peuples opprimés... »
Cette convergence est structurelle. Dans Gaza, génocide annoncé comme dans ses essais, Achcar montre comment Washington, Moscou et Tel-Aviv opèrent désormais non pas en dépit du libéralisme, mais grâce à l’ascendant du néofascisme. Il ajoute : « Les États-Unis sont pleinement complices de la guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien à Gaza... »
Pour Achcar, la logique génocidaire à Gaza n’est pas fortuite, mais coproduite par l’alliance impériale, médiatisée par les transferts d’armes, la couverture diplomatique et le cadrage racialisé de la résistance palestinienne.
Son article « Néofascisme et changement climatique » explique plus en détail comment ce mode de gouvernance est biopolitique, niant la réalité environnementale, ciblant les migrants et utilisant la crise écologique comme couverture pour l’exclusion raciale :
« Le néofascisme pousse le monde vers l’abîme avec [une] hostilité flagrante [...] aux mesures écologiques indispensables », en renforçant la « souveraineté d’exclusion »1.
L’analyse d’Achcar montre ainsi que les régimes colonialistes héritent non seulement d’une logique raciale, mais aussi d’un déni écologique. Il s’agit là d’une fusion dangereuse dans l’avenir de la zone assiégée de Gaza. Un lieu où la guerre, les déplacements et l’effondrement climatique convergent sous la logique de la règle exclusive.
Dans le contexte de Gaza, génocide annoncé, la théorie du néofascisme d’Achcar clarifie la continuité entre l’extrême droite israélienne et l’extrême droite mondiale, entre Smotrich et Trump, Ben-Gvir et Poutine. Ce n’est pas une métaphore, c’est une logique de développement.
Il écrit :
« Nous sommes entrés dans l’ère du néofascisme... qui est pire parce que la puissance impérialiste la plus importante est à la tête de la coalition néofasciste. »2
La position politique d’Achcar est donc double : internationale sur la plan analytique, locale sur le plan matériel et concret. Le génocide israélien n’est pas unique dans son horreur, mais il est unique par sa façade démocratique. La machine de destruction du Hamas est en parfaite cohérence avec l’ère du néofascisme : IA ciblée, doctrine du zéro blessé, rhétorique raciste et soutien mondial en matière d’armement.
Ce diagnostic n’est ni une exagération rhétorique ni une panique historique. C’est une acuité structurelle. Le néofascisme, selon Achcar, n’est pas un signe d’extrémisme. C’est une technique d’État, un écosystème idéologique dans lequel le génocide devient politique.
Conclusion : contre l’euphémisme, contre l’empire
Gaza, génocide annoncé est un livre peu réconfortant. Il ne se termine pas sur une note optimiste et n’offre aucune confiance dans le droit international. Sa force réside dans sa clarté. Achcar ne se lamente pas. Il nomme les choses, et à un moment où nommer est en soi subversif, ce n’est pas un mince exploit.
La catastrophe n’était pas une erreur politique. C’était une décision stratégique. Les décombres de Gaza ne sont pas un avertissement de l’histoire. Ils sont une révélation du présent.
C’est le système. Il faut s’y opposer. Pas seulement avec l’indignation. Mais avec la politique, en combinant le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté, nourris par l’espoir.