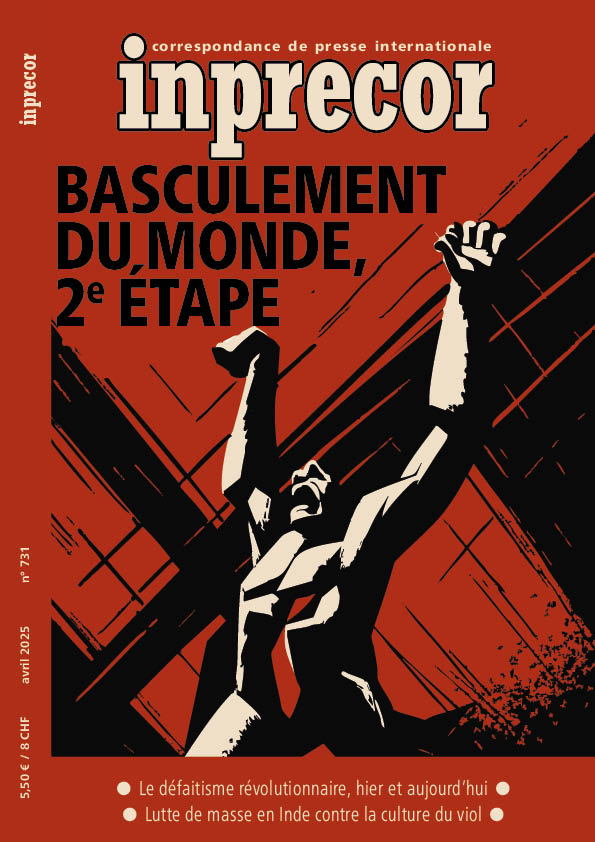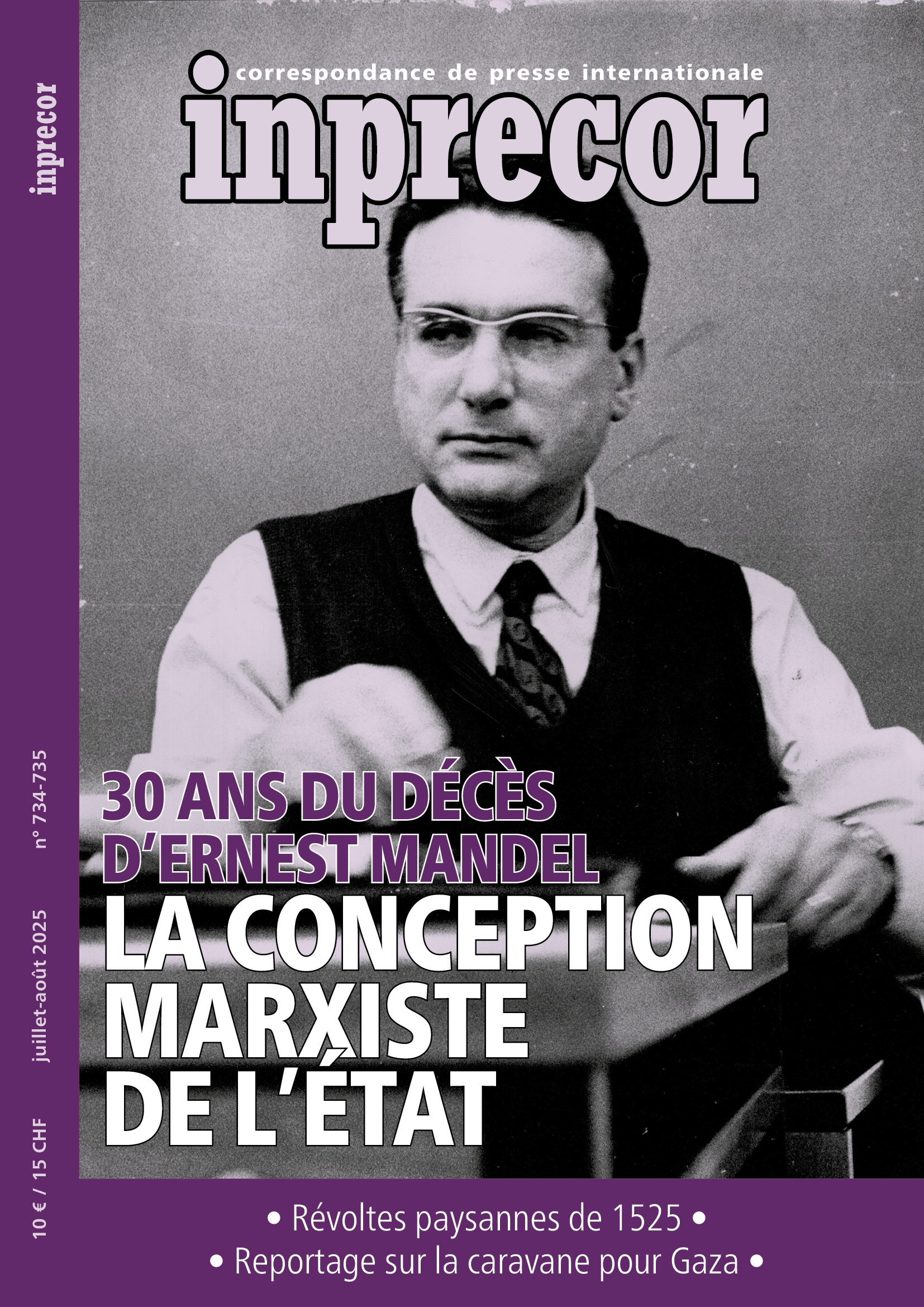L’hiver politique russe s’est installé avant même le déclenchement du conflit armé avec l’Ukraine, que les documents officiels qualifient par euphémisme d’« opération militaire spéciale » (OMS). La pandémie de Covid-19 de 2020 avait déjà servi de prétexte à une forte restriction de la liberté de réunion. Des amendements constitutionnels ont ensuite prolongé le mandat du président russe Vladimir Poutine, déjà en exercice depuis 20 ans, de 12 années supplémentaires, le rendant de fait président à vie.
La pandémie a également justifié la modification des lois électorales, rendant la surveillance des votes et le décompte des voix quasiment impossibles. Néanmoins, à l’automne 2021, lors des élections à la Douma d’État, les électeurs moscovites ont tenté d’élire des candidats d’opposition dans la plupart des circonscriptions. Un tel scandale dans la capitale était inacceptable. Le problème a été résolu grâce au vote électronique à distance (VED). Dès que les résultats du VED ont été ajoutés au décompte général, les candidats de l’opposition (qui avaient souvent mené avec une avance impressionnante) ont été soudainement dépassés par ceux du parti au pouvoir. L’opposition parlementaire, officiellement sanctionnée, s’est résignée à ce résultat et elle a perdu toute importance politique. Ces partis n’étaient même plus perçus comme un canal par lequel les citoyens pouvaient exprimer leur mécontentement à l’égard des politiques gouvernementales.
La répression systématique
Il ne restait plus que l’opposition hors système, dont le représentant le plus influent était Alexeï Navalny. Cependant, une nouvelle législation répressive a rapidement détruit le réseau national de bureaux qu’il avait construit. Leurs dirigeants ont été arrêtés ou contraints à l’exil. Navalny lui-même, de retour d’Allemagne où il avait été soigné après une tentative d’empoisonnement (présumée), a été arrêté à l’aéroport et est décédé en détention le 16 février 2024. Récemment, un tribunal russe a statué que la simple mention du nom « Alexeï » pouvait être considérée comme un signe d’extrémisme.
Dans le cadre de la répression plus large de la dissidence, la tristement célèbre loi sur les « agents étrangers » a été promulguée. En vertu de cette loi, tout citoyen russe considéré comme sous influence étrangère peut être qualifié d’agent étranger sans aucun contrôle judiciaire. Les personnes désignées comme telles se voient interdire d’enseigner dans les universités publiques, de participer aux campagnes électorales et sont même soumises à des restrictions concernant les revenus issus d’activités créatives ou la location de biens immobiliers. La loi continue d’être étendue avec de nouvelles interdictions et restrictions.
Les autorités ont exercé une pression active sur les « agents étrangers » désignés pour qu’ils émigrent, tandis que ceux qui sont restés en Russie ont dû se conformer à de nombreuses exigences bureaucratiques humiliantes sous peine d’amendes et, à terme, d’emprisonnement. De plus, un registre des terroristes et des extrémistes a été créé, où tout citoyen peut être inscrit sur simple décision administrative. Une fois inscrit, l’individu perd non seulement l’accès à ses comptes bancaires, mais il lui est également interdit d’effectuer des transactions bancaires, même en espèces, sans autorisation spéciale.
Avec la guerre, les purges systématiques
Ainsi, avant même l’arrivée des chars russes à Kiev le 24 février 2022, un vaste système de mesures répressives avait déjà été mis en place, gelant de fait la vie politique du pays. Le conflit armé a simplement servi de prétexte pour serrer encore davantage la vis. Des dizaines de lois répressives supplémentaires ont été promulguées ou durcies. On estime que le nombre de prisonniers politiques se situe entre 1 000 et 3 000, bien que certains éléments portent à croire que ces chiffres sont largement sous-estimés.
Tous les partis de la Douma ont unanimement soutenu la politique du gouvernement. Néanmoins, ils ont eux aussi subi des purges systématiques. Les militants et les politiciens jugés peu fiables ont été qualifiés d’agents étrangers (comme Oleg Shein d’Une Russie juste et Ievgueni Stoupine du Parti communiste de la Fédération de Russie). Ils ont été démis de leurs fonctions au sein du parti, exclus des listes électorales et contraints de quitter le pays. Nombre d’entre eux se sont tus par peur, mais même cela ne garantissait pas toujours leur sécurité.
Une vague de purges a déferlé sur les universités, entraînant le renvoi de professeurs soupçonnés d’être des dissident·es. Journaux, revues et sites web ont été fermés. Plusieurs tentatives infructueuses de blocage des réseaux sociaux ont été menées, mais l’État s’est heurté à des obstacles technologiques. L’exode massif de personnes mécontentes de la situation, ainsi que la fuite des jeunes hommes fuyant la mobilisation à l’automne 2022, semblaient avoir mis fin à l’activité civique indépendante, transformant le pays en un désert politique. C’est du moins l’impression que l’on pourrait avoir à première vue, mais on peut voir des processus plus profonds qui échappent souvent à l’attention des observateurs occasionnels.
La résistance clandestine
La réalité de l’accès des Russes aux ressources en ligne de l’opposition révèle un tableau plus complexe. Les critiques du régime ne se contentent pas de pouvoir diffuser depuis l’étranger, à l’instar des « voix ennemies » qui infiltraient autrefois les foyers soviétiques par ondes radio. La lutte permanente autour d’internet témoigne d’une résistance populaire généralisée. Chaque fois que YouTube est ralenti, ou qu’un autre service ou réseau social est bloqué en Russie, d’innombrables experts en technologie développent des accélérateurs et des logiciels pour contourner les restrictions, dont beaucoup sont entièrement gratuits.
Le nombre croissant de prisonniers politiques témoigne également d’une montée de la contestation. De plus, leur profil social et culturel a radicalement changé. Autrefois, le prisonnier politique type était un jeune membre de l’intelligentsia, mais aujourd’hui, de plus en plus de détenus sont d’âge moyen, souvent moins instruits et engagés dans un travail physique. Leurs opinions politiques diffèrent sensiblement de celles de l’opposition libérale urbaine. Par exemple, ils ont tendance à considérer le passé soviétique sous un jour beaucoup plus positif, notamment ses politiques sociales. En ce sens, le mouvement de protestation devient plus populaire, plus axé sur les questions sociales et plus ancré à gauche.
La campagne de Nadejdine
Un indicateur important de la volonté de changement de la société est apparu en janvier 2024, avec la campagne pour la désignation de Boris Nadejdine1 comme candidat à la présidence. Le simple fait qu’il ait été autorisé à recueillir des signatures suggérait qu’une faction au sein de l’élite dirigeante se souciait au moins de préserver l’apparence de procédures démocratiques. Nadejdine, malgré ses positions politiques modérées, se présentait comme un « candidat antiguerre ». La croissance rapide et nationale de ses bureaux de campagne a constitué une très grande surprise. Ils ont poussé « comme des champignons après la pluie », avec la participation significative de divers groupes de gauche. Lorsque la campagne de Nadejdine a recueilli 300 000 signatures – bien plus que les 100 000 requises –, il a été, comme prévu, disqualifié de la course. Cependant, cet épisode a clairement démontré l’existence d’un potentiel protestataire important dans le pays.
Alors que les exilé·es de l’opposition libérale ont accueilli la campagne de Nadejdine avec, au mieux, un certain scepticisme, les militant·es de gauche resté·es en Russie l’ont largement soutenue, quoique de manière critique. Il est également remarquable que les plateformes en ligne de gauche, malgré tous les risques et les défis, s’efforcent de continuer à opérer depuis la Russie. Cela les oblige souvent à se montrer plus prudentes dans leurs critiques, mais leur permet de rester connectées à leur public. Même les rares médias libéraux encore présents en Russie ont été contraints de s’appuyer sur des journalistes et commentateurs de gauche.
La solidarité avec les prisonniers russes
Après la mort de Navalny, l’opposition en exil a été en proie à de nombreux scandales et conflits. Bien sûr, tous les membres de l’émigration libérale n’ont pas pris part à ces conflits. Par exemple, Vladimir Kara-Murza, qui avait passé beaucoup de temps en prison et avait été libéré en août 2024 dans le cadre d’un échange de prisonniers entre la Russie et l’Occident, a concentré tous ses efforts sur le soutien aux prisonniers politiques encore en Russie. Cependant, le climat général au sein de la communauté en exil n’a guère contribué à renforcer sa crédibilité.
En revanche, les militant·es resté·es en Russie, ainsi que les groupes à l’étranger qui entretenaient des liens avec eux, ont favorisé un climat de solidarité et d’entraide. Le soutien aux prisonniers politiques est devenu un axe central de leurs activités2. Les gens collectent des fonds, envoient des colis et écrivent des milliers de lettres pour exprimer leur solidarité avec ceux qui sont derrière les barreaux. L’expérience de la collecte de fonds pour les prisonniers a démontré l’émergence d’une culture autonome, fonctionnant sans subventions étrangères, sans subventions des oligarques ni soutien de l’État.
La fonte des glaces
En guise de première conclusion, nous pouvons observer que des processus sous-jacents remodèlent l’équilibre des pouvoirs au sein de la société. Lorsque le prochain printemps politique s’amorcera, le paysage révélé sous la fonte des glaces sera sensiblement différent de celui d’avant.
Mais avons-nous des raisons d’espérer un printemps, et encore plus de l’espérer bientôt ? Il semble que oui.
La montée de l’autoritarisme dans les années 2020 n’était ni accidentelle ni le résultat de la volonté de vétérans des services de sécurité qui s’étaient emparés de postes clés au sein de l’État. Au contraire, l’escalade du conflit avec l’Ukraine et la marche sur Kiev en 2022 ont été largement motivées non seulement par des tensions internationales, mais aussi par des contradictions internes. On espérait qu’une « petite guerre victorieuse » consoliderait la société, à l’instar de l’annexion de la Crimée en 2014. Mais si cette victoire avait été rapide et sans effusion de sang, les événements se sont déroulés cette fois-ci tout autrement. Non seulement la guerre n’a résolu aucun des problèmes existants de la Russie, mais elle en a créé de nouveaux. Le conflit a permis au gouvernement de reporter indéfiniment des réformes attendues depuis longtemps, mais les contradictions et les tensions n’ont fait que s’accumuler, y compris au sein de l’élite dirigeante.
Les limites de l’économie de guerre
Bien sûr, nombreux sont ceux qui ont profité de la guerre en Ukraine et des contrats militaires, mais les secteurs civils de l’économie en ont souffert. Parallèlement, la perspective d’un accord de paix imminent pose de nouveaux défis majeurs. L’économie russe ne s’est pas effondrée sous l’effet des sanctions et affiche même une croissance notable, mais elle est devenue de plus en plus contradictoire. La réduction des liens avec l’Occident n’a pas conduit à une réorientation cohérente vers les partenaires commerciaux des BRICS (Brésil-Russie-Inde-Chine-Afrique du Sud). Cela est devenu particulièrement évident lorsque la Chine et l’Inde ont réduit leurs achats de pétrole russe, soulignant ainsi qu’au-delà des exportations de matières premières, les entreprises russes ont peu à offrir aux marchés mondiaux.
Parallèlement, les secteurs socialement importants se contractent rapidement et les dépenses militaires sont devenues le principal moteur de la croissance économique. Cependant, maintenir ce niveau de dépenses de défense après un cessez-le-feu sera difficile, non seulement financièrement, mais aussi politiquement. La lutte contre l’inflation repose sur la hausse du taux directeur de la Banque centrale, rendant le crédit inaccessible à une grande partie du secteur des entreprises et étouffant la demande non militaire. Il apparaît de plus en plus clairement qu’une transition vers un développement pacifique nécessitera une redistribution massive des ressources et un changement de priorités et d’approches, ce qui est impossible sans une transformation radicale des processus décisionnels. Un changement politique est donc inévitable.
Même une partie importante de l’élite dirigeante commence à saisir cette réalité. La majorité de la société et la classe dominante rêvent peut-être d’un retour aux jours « heureux » de 2019, mais malheureusement, c’est impossible – en raison de l’évolution du paysage géopolitique sous l’ère Trump, des difficultés économiques et de la profonde lassitude accumulée dans toutes les couches de la société après le « long règne » de Poutine. Pris ensemble, ces facteurs rendent le changement non seulement attendu depuis longtemps, mais inévitable.
L’avenir émergera des prisons
Si les accords de paix peuvent apaiser les tensions mondiales, ils ne résolvent pas les problèmes internes de la Russie ; au contraire, ils les exacerbent (ce qui explique en partie pourquoi le processus de paix lui-même est si semé d’embûches). Le changement est en marche ; la seule question est de savoir quels intérêts le façonneront et sur quels principes les nouvelles priorités seront formulées.
Les contradictions sociales et économiques exigent des solutions politiques. La campagne répressive de 2020-2024 n’a réussi qu’à geler temporairement la situation, mais elle a également créé de nouvelles conditions qui influenceront inévitablement l’évolution future. Comme l’a fait remarquer le célèbre blogueur de gauche Konstantin Syomin en 2023, les demandes de participation à la vie politique passent désormais par le système pénitentiaire. Ni les exilés libéraux ni les bureaucrates actuels ne seront capables de formuler de nouvelles idées pour le développement du pays ; ils restent prisonniers du passé.
Si le changement s’amorce, la société elle-même proposera de nouveaux dirigeants. Certains d’entre eux sont actuellement dans les tranchées en Ukraine, d’autres s’efforcent de soutenir des initiatives locales ou de préserver les vestiges de médias indépendants. Les prisonniers politiques d’aujourd’hui pourraient se retrouver en première ligne des efforts visant à bâtir de nouvelles institutions sociales et à débarrasser les écuries d’Augias des problèmes accumulés. Ils sont prêts à œuvrer à la transformation de leur pays et du monde.
Mais pour l’instant, ils ont avant tout besoin de soutien et de solidarité. Ensuite, les événements suivront leur cours naturel.
La manière dont cela se déroule est bien connue de l’histoire russe.
Le 18 février 2025