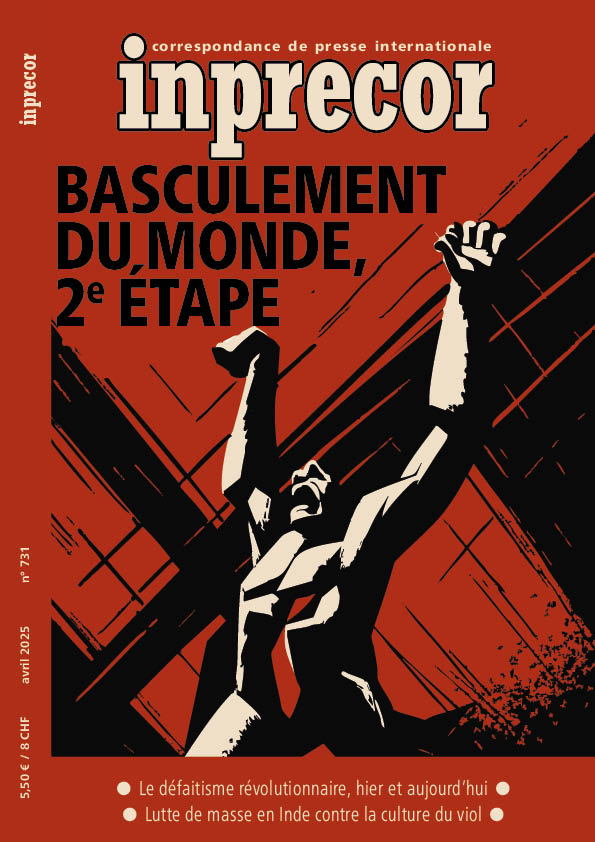La soumission des dirigeants syndicaux allemands au fascisme a culminé le 1er Mai 1933 avec l’appel de la Confédération générale des syndicats allemands (ADGB) à participer à la « journée du travail national ». Les défilés forcés sous les « drapeaux de l’oppression la plus éhontée et la plus sanglante » devaient, selon sa publication Unser Wort, « marteler la défaite dans les têtes du prolétariat ».
Une arme importante – probablement la plus déterminante – dans la lutte contre le fascisme aurait été la grève politique de masse et finalement la grève générale contre les violations de la Constitution par le « général de fer » Hindenburg. Mais, d’une part, les dirigeants syndicaux, dans le sillage de l’aile droite de la social-démocratie, avaient contribué à faire monter ce président sur le pavois, et, d’autre part, ils espéraient qu’on ne pourrait pas gouverner l’Allemagne sans eux, et encore moins contre eux.
Cette dernière hypothèse aurait été correcte si les syndicats avaient utilisé la force des travailleur·ses organisé·es pour défendre les droits démocratiques. Mais la direction ne plaçait pas ses espoirs dans la force de l’action syndicale, mais dans une plus grande « lucidité » des forces politiques représentées par le « général social » Schleicher. Cette « porte de sortie » devait permettre de prévenir les manifestations les plus graves du fascisme, de rétablir le calme dans le pays et de barrer à Hitler la route de la chancellerie du Reich.
Tout comme le comité directeur du SPD, les dirigeants syndicaux – toutes tendances confondues – se sont bercés de l’illusion qu’il était possible de sauver les organisations en maintenant un cap de légalité absolue et de neutralité politique. Ils avaient été incapables de retenir la leçon que le régime fasciste italien de 1925-1927 avait donnée en matière d’élimination des syndicats.
En se suicidant politiquement, ils ont tenté désespérément d’échapper à la mise à mort de leurs organisations.
Par leurs hésitations depuis le 30 janvier, les syndicats libres, les piliers les plus solides de la Confédération syndicale internationale, avaient gâché non seulement leurs propres atouts, mais aussi de nombreuses autres potentialités au niveau international. Le 19 avril, après que l’Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund (ADGB, ancêtre du DGB) eut annoncé publiquement qu’elle appelait au 1er Mai, la rupture entre l’ADGB et la Confédération syndicale internationale est devenue définitive.
Une répression planifiée
Fin 1932, au sein du NSDAP, le parti nazi, tout le monde était d’accord pour dire que les syndicats existants devaient disparaître en tant qu’« organisations de lutte des classes » pour être remplacés par des organes d’un État coopératif. Les opinions ne divergeaient que sur comment et quand y procéder. Ainsi, dans un premier temps, la politique d’Hitler visait à contourner le plus prudemment possible le corps des travailleurs organisés, à préserver la motivation au travail de l’ouvrier et à éviter de donner l’impression de vouloir lui enlever quelque chose.
Comme, dans la première phase de la « révolution nationale » hitlérienne, les syndicats bénéficiaient de marges de manœuvre, les dirigeants syndicaux avaient de plus en plus tendance à penser que s’ils s’adaptaient suffisamment au nouveau pouvoir, ils seraient reconnus comme membres du nouvel « État coopératif ».
Les premiers résultats des élections aux comités d’entreprise, qui avaient débuté en mars, avaient montré une fois de plus à Hitler qu’il ne parviendrait jamais à mettre la main sur ses conseils d’entreprise par le biais de la NSBO (organisation nationale-socialiste des cellules d’entreprise). Malgré les pressions les plus fortes exercées sur les ouvriers, malgré les alliances de listes avec des associations d’employés nationalistes et avec d’insignifiantes associations locales de travailleurs réactionnaires, la NSBO n’obtint que 25 % de tous les mandats, et encore, seulement là où les travailleurs hautement qualifiés et les employés constituaient la majeure partie du personnel. Par crainte que les élections dans les grandes entreprises ne soient détournées en manifestations contre le NSDAP, les élections y furent retardées en raison de prétextes à chaque fois différents, jusqu’à ce que la loi sur le régime des comités d’entreprise du 4 avril permette de reporter toutes les élections jusqu’à la fin de l’année et d’exclure ainsi les « travailleurs dont l’attitude était hostile à l’État » des comités d’entreprise qui existaient encore, de sorte que des nazis puissent y être intégrés.
Cette loi était une étape dans le plan de long terme visant à prendre le contrôle des syndicats par une action soudaine au niveau du Reich. Et c’est dans le cadre de ce plan d’action que la ruse la plus raffinée a été mise en place : la promotion du 1er Mai au rang de « journée fériée de célébration du travail national » par la loi du 10 avril 1933.
Un « comité d’action » pour la « protection du travail », dont l’existence était tenue strictement secrète, même au sein du parti, et dont Ley avait été nommé chef, avait jusqu’au 13 avril préparé en détail le programme de la prise de contrôle, tandis que Goebbels, spécialiste de la mise en scène de manifestations de masse, se consacrait à la préparation des festivités du 1er Mai.
Goebbels écrivit dans son journal « Nous ferons du 1er Mai une démonstration grandiose de la volonté populaire allemande. Le 2 mai, les sièges des syndicats seront occupés. Mise au pas et alignement dans ce domaine également. Cela fera peut-être du raffut pendant quelques jours, mais ensuite, ils seront à nous. Pas question ici de prendre des gants ».
Les courbettes de l’ADGB
Le président de l’ADGB, Leiphart, envoya une lettre « ouverte » à Hitler, dans laquelle il déclarait que les missions sociales des syndicats devaient être remplies, « indépendamment de la nature des dirigeants de l’État […] en demandant la médiation publique et en la reconnaissant, les syndicats ont montré qu’ils reconnaissent le droit de l’État d’intervenir dans les conflits entre les travailleurs organisés et les chefs d’entreprise. Les syndicats ne demandent pas à s’immiscer dans la politique de l’État ».
Lors d’une réunion des hommes de confiance syndicaux de l’union locale du Grand Hambourg, son secrétaire, John Ehrenteit, a déclaré : « Nous sommes disposés et à même d’aider le dirigeant du nouvel État à répondre aux souhaits et aux attentes des ouvriers dans les domaines social et économique… Même dans ces circonstances, les organisations syndicales ne doivent pas négliger leurs tâches économiques et sociales. Le gouvernement actuel du Reich s’est fixé le même objectif que nous. Ce fait permet aux syndicats de trouver sans difficulté leur place au sein de la programmation gouvernementale ».
Par cette capitulation indigne, les dirigeants syndicaux ne firent que démontrer leur impuissance face aux nazis, et, plus tard, après la prise de contrôle des syndicats par Robert Ley et ses acolytes, Hitler les raillera publiquement pour ces tentatives d’accommodement.
La transformation de la traditionnelle journée internationale de lutte du mouvement ouvrier socialiste en une grande foire nationale était une provocation à grande échelle. On aurait pu s’attendre à ce que les dirigeants syndicaux s’opposent à ce viol du 1er Mai. Cependant, l’organe officiel de l’ADGB publia un article de Walter Pohl à la veille du 1er Mai, dans lequel on pouvait lire : « Nous n’avons certainement pas besoin d’abaisser notre drapeau pour reconnaître la victoire du national-socialisme. Bien que remportée en combattant un parti que nous avions également pour habitude de considérer comme porteur de l’idée socialiste, c’est aussi notre victoire, car aujourd’hui, la tâche de construire le socialisme est posée devant la nation tout entière ».
Dans un appel de l’ADGB reprenant la phraséologie nationale-socialiste, on peut lire : « C’est avec grand plaisir que nous saluons le fait que le gouvernement du Reich ait déclaré notre journée comme étant la fête du travail national, une fête populaire allemande. Ce jour-là, comme le disent les déclarations officielles, le travailleur allemand doit être au cœur de la fête. Le 1er Mai, l’ouvrier allemand doit manifester, conscient de son statut, qu’il est un membre à part entière de la communauté nationale ».
À la suite de cette manifestation de soumission, on ne pouvait plus s’attendre à ce que la masse des membres des organisations ouvrières s’oppose spontanément aux provocations, elle qui, malgré la terreur exercée par les fascistes, prouvait encore le 5 mars sa fidélité au mouvement ouvrier socialiste par ses votes en faveur des partis ouvriers (776 000 pour les sociaux-démocrates et presque 5 millions (4 485 000) pour les communistes).
L’occupation des bourses du travail
Le 2 mai, les locaux des syndicats ont été investis dans toute l’Allemagne par les SS, les SA et la police. Les dirigeants syndicaux les plus en vue furent arrêtés malgré leurs tentatives d’accommodement. Par leurs écœurantes propositions de capitulation, ils voulaient « sauver leur organisation ». Beaucoup n’ont même pas sauvé leur tête.
Toutefois, la masse des ouvriers éduqués par le syndicalisme indépendant ne pouvait pas être aveuglée. Leur opposition s’est exprimée par la passivité. Seules 30 % des entreprises berlinoises participèrent à la manifestation centrale sur le terrain d’aviation de Tempelhof.
C’est avec la précision d’une horloge que les manœuvres nationales-socialistes du 2 mai se sont déroulées. À 10 h du matin, des commandos de SS et de SA occupent en qualité de « police auxiliaire » les maisons des syndicats, la Banque des travailleurs, des employés et des fonctionnaires à Berlin et ses filiales dans le Reich, tous les centres de paiement et les rédactions de la presse syndicale.
Outre Leiphart, Graßmann et Wissell, les présidents de toutes les fédérations, les directeurs de la Banque des travailleurs, les directeurs et les principaux responsables de toute la bureaucratie syndicale ainsi que les rédacteurs de la presse syndicale furent placés en « détention préventive ». Tous les biens des syndicats libres ont été confisqués et les comptes bloqués. À l’exception de quelques cas (quatre assassinats à Duisbourg), ces actions ont pu être menées à bien en une heure sans rencontrer de résistance. Le même jour, une pression fut exercée sur les autres fédérations syndicales (chrétiens, etc.) afin qu’elles se « soumettent volontairement » et, le 5 mai, Ley put annoncer à Hitler que toutes les principales fédérations d’ouvriers et d’employés, regroupant plus de 8 millions de membres, s’étaient « soumises de la même manière et sans condition ».
Le 2 mai 1933 a constitué une manifestation de la faillite du mouvement ouvrier allemand, qui était jusqu’alors le mouvement de masse organisé le plus important et le plus riche de traditions au monde. Son incapacité à réagir a rendu possible la victoire du fascisme. Cette victoire a mis fin à toute une période historique.
La défaite finale du national-socialisme a ouvert une nouvelle période de l’histoire allemande. Il semble cependant que la grande majorité des dirigeants actuels n’ont jusqu’à présent tiré aucune leçon du destin tragique du mouvement ouvrier allemand dans les années 1923-1933.
Avril 1970
L’article reprend un exposé de Georg Jungclas réalisé en avril 1970. Traduit par Pierre Vandevoorde.