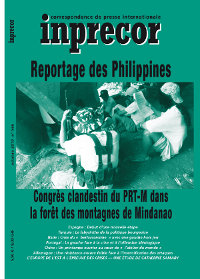Cet article étant écrit à quelques jours de la grève générale du 29 septembre, il serait superflu de spéculer sur son déroulement. Mais quels que puissent être son succès ou ses limites, une chose est certaine : cet appel syndical met fin au long cycle de relations sociales relativement pacifiques dans l'État espagnol et nous fait entrer dans une nouvelle étape, agitée et incertaine. Une étape qui va mettre en question les modèles économiques, les institutions politiques et les formes organisationnelles du mouvement ouvrier hérités de la " transition démocratique ».
Un modèle qui a fait faillite
Il faut dire, cependant, que tous les ressorts du modèle néolibéral contenaient les germes de cet échec. A l'initiative des gouvernements " progressistes » de Felipe González (PSOE), l'Espagne a adapté sa réalité économique aux exigences de la construction européenne. Les industries lourdes du secteur public — construction navale, sidérurgie, une partie de l'industrie minière… — ont été démantelées dès la décennie 1980-1989. Le pays s'est transformé en une piste d'atterrissage pour les grandes entreprises multinationales, dont l'installation a été favorisée par toute sorte de facilités administratives. Autour d'elles, un dense réseau d'entreprises auxiliaires, toujours dépendantes des grandes corporations. Au cours de la décennie 1990-1999, en pleine apogée des politiques néolibérales qui ont eu une forte impulsion des gouvernements conservateurs de José María Aznar, les secteurs stratégiques de l'énergie et des communications ont été privatisés. La nouvelle loi du sol a rendu aménageable l'ensemble du territoire, déchaînant une expansion du marché immobilier, qui paraissait ne pas avoir de limites. Au cours des vingt ans qui ont précédé la crise, les constructions en Catalogne ont été aussi nombreuses que depuis l'époque romaine jusqu'aux années soixante-dix. L'Espagne a construit autant de logements que la France et l'Allemagne réunies.
Cette dérive du modèle productif, combinée avec un pari sur le tourisme et plus généralement sur le secteur de services, a profondément transformé le pays, se faisant sentir dans tous les domaines. Les villes sont devenues diffuses. Le territoire a été maltraité par des urbanisations insoutenables. La pression de ce modèle de croissance, l'irruption des grandes multinationales de la distribution et l'expansion du négoce agricole (encouragé par les politiques communautaires) ont radicalement modifié la campagne, favorisant un déplacement de sa population vers les villes. Aujourd'hui, en Catalogne, seulement 1 % de la population se consacre à l'agriculture ; dans l'ensemble de l'État espagnol ce pourcentage n'atteint pas 5 %. La démographie ainsi que la composition nationale et culturelle des populations ont été également modifiées. A titre d'exemple, en moins d'une décennie, la Catalogne est passée de 6 millions à 7,5 millions d'habitants, grâce à l'immigration.
Ces années de la transformation de la réalité économique et sociale ont produit aussi des changements non moins significatifs en ce qui concerne le monde du travail. Les gouvernements successifs ont mis en œuvre des mesures de libéralisation qui ont miné les conquêtes sociales et les droits acquis par le mouvement ouvrier. Si la puissante grève générale du 14 décembre 1988, convoquée par les CCOO et l'UGT, a forcé le gouvernement " socialiste » de Felipe González à retirer sa réforme du code du travail et l'a obligé durant une période à augmenter les dépenses sociales (très inférieures à la moyenne européenne), à partir de la décennie suivante les politiques libérales ont érodé de manière constante la protection du travail et les salaires. Après la grève générale de 1994, qui eu un impact plus faible, les syndicats se sont totalement alignés sur la dynamique de concertation sociale et de négociations à froid (qui, mis à part quelques écarts, a été une constante depuis 1977, sous des gouvernements de droite comme de gauche). Une seule grève générale, en juin 2002, contre une réforme régressive des prestations aux chômeurs, promue par l'exécutif d'Aznar, déjà fort impopulaire à cette époque-là, a interrompu cette paix sociale.
Ces dernières quinze années ont été décisives, parce qu'elles ont combiné un processus de précarisation généralisée des relations contractuelles et des conditions salariales dans les entreprises privées et dans le secteur public avec ce qui a été appelé " l'effet richesse ». L'économie espagnole maintenait un niveau très élevé de chômage structurel, toujours supérieur à deux millions de demandeurs d'emploi ; mais son caractère était fluctuant. Certes, les emplois étaient devenus instables et la menace du chômage était toujours présente. Mais, grâce au bâtiment et aux services, la demande de main d'œuvre demeurait soutenue. Les caractéristiques de ces secteurs expliquent le caractère de l'immigration, aussi maltraitée au niveau administratif qu'elle était indispensable pour l'économie de croissance. Si le pouvoir d'achat des salaires régressait, le crédit était bon marché — stimulé par les établissements bancaires et par les pouvoirs publics — permettant de maintenir un niveau de consommation des familles sans rapport avec leurs revenus. L'Espagne a ainsi connu un phénomène semblable à celui du marché immobilier états-unien. Il n'y a rien de semblable à un parc de logements locatifs sociaux. Bien au contraire, les gouvernements successifs ont promu le négoce des banques et des constructeurs en stimulant l'achat de logements à travers les prêts hypothécaires, dont la demande était encouragée par des dégrèvements fiscaux. Parallèlement, malgré la croissance du PIB, les dépenses publiques pour l'éducation, la santé et la protection sociale ont continué à être inférieures de neuf points à la moyenne de l'Union européenne des 15. Ainsi la réalité détériorée du cadre social était dissimulée par une façade de prospérité.
Impact de la crise
La dégradation du marché du travail et la fragilité de l'échafaudage économique espagnol expliquent les effets fulgurants de la crise. En automne et en hiver 2008 on a assisté à une véritable lame de fond de fermetures d'entreprises et de licenciements, dont les multinationales comme Pirelli ou Nissan furent les références. Les syndicats ont répondu en négociant cas par cas tout en réclamant impuissamment un " dialogue social » au niveau national avec le gouvernement et le patronat. Toutefois l'explosion du chômage n'était pas due essentiellement à ces licenciements, mais au non renouvellement des contrats précaires et à l'asphyxie des travailleurs " indépendants » fort nombreux. Le bâtiment a été paralysé du jour au lendemain, laissant plus d'un million de logements nouveaux invendus. Le crédit a été restreint, précipitant la faillite de milliers de petites entreprises et de commerces. Il faut dire que le système bancaire espagnol représente un cas à part, tant par son influence déterminante sur le pouvoir politique que par les exorbitants privilèges dont il jouit. Il suffit de mentionner, par exemple, qu'en cas d'impayés, les entités créancières obtiennent non seulement l'expulsion des familles, mais ils bénéficient d'une adjudication truquée de l'appartement, se l'attribuant à moitié prix… tout en continuant à réclamer aux gens expulsés le reste de la dette hypothécaire.
Le déficit de la balance de paiements (les importations sont supérieures aux exportations) a conduit les organismes de crédit à se procurer sur le marché interbancaire européen les liquidités nécessaires pour pouvoir offrir des crédits et faire des affaires sur le territoire, essentiellement en finançant l'immobilier et en réalisant des hypothèques. Le gouvernement Zapatero a mobilisé une énorme quantité de fonds publics (260 milliards d'euros) pour éviter une crise financière aux conséquences imprévisibles. Les banques ont utilisé ces aides et garanties pour assainir leurs comptes et, dans un second temps, pour spéculer sur le déficit de l'État en achetant une partie de la dette publique, émise justement pour les sauver de la faillite (à peu près la moitié de cette dette est dans les mains des grandes entités européennes : la Deutsche Bank à elle seule possède plus de 45 milliards d'euros de dette publique espagnole). L'économie nationale s'est installée dans la récession. Les banques, devenues propriétaires de milliers d'appartements, lotissements et terrains poursuivent leurs activité avec des bilans manifestement faux, car leurs actifs sont surévalués et maintenus artificiellement : selon les experts le prix des logements devrait être déprécié d'au moins 30 % pour promouvoir la réactivation du marché immobilier. Cela va sans dire, de nouveaux sursauts sont prévisibles dans un proche avenir…
Ajoutons pour compléter ce tableau, que le système fiscal espagnol est le plus régressif d'Europe. Les cadeaux fiscaux aux entreprises et aux propriétaires des biens patrimoniaux ont encore été multipliés en pleine crise. Les sociétés d'investissements boursiers ne payent que 1 % de leur capital. L'économie parallèle pour sa part est estimée, par l'inspection fiscale elle même, à 23 % du PIB.
Tous ces éléments — auxquels il faudrait ajouter la corruption endémique du modèle néolibéral et l'agressivité des classes dominantes — aident à saisir la fragilité de la situation espagnole. Le virage antisocial du gouvernement Zapatero a profondément atteint les grands syndicats, qui se sont lourdement trompés en pariant sur la conciliation avec un " gouvernement ami ». La réaction à laquelle les directions syndicales ont été contraintes a mis en évidence l'inadéquation du mouvement ouvrier à la situation actuelle du marché du travail. Si les CCOO et l'UGT revendiquent chacun un peu plus d'un million d'affiliés, ces chiffres rendent compte plus d'une influence que d'une organisation. En réalité la structure des syndicats se fonde sur une charpente de délégués élus dans les entreprises, mais généralement dépourvus d'une organisation militante sur le terrain. La fragmentation de la classe travailleuse, du fait de la filialisation des entreprises et de la diversité des contrats de travail, a laissé les organisations syndicales conçues pour l'époque " fordiste » comme suspendues en l'air. Par ailleurs, les syndicats ont pris l'habitude depuis les lointaines années de la " transition » de gérer les conflits dans le cadre des entreprises et des branches, alors que la politique néolibérale et la mondialisation ont bousculé ce cadre. Les réalités contractuelles sont aujourd'hui diversifiées au sein même de chaque entreprise et les circuits de valorisation du capital ne correspondent plus aux réseaux industriels traditionnels. Les années de réussite économique ont à la fois fait croître l'individualisme et ont affaibli la culture de la défense collective de la force du travail. Toute une génération de syndicalistes n'a pratiquement pas connu d'autres actions que le recours devant les tribunaux. Les grèves les plus combatives n'ont eu d'autre horizon que celui de la négociation des indemnités de licenciement selon l'ancienneté… Enfin, le bureaucratisme et la dépendance des subventions minent la crédibilité des syndicats et leur relation avec la masse des travailleurs, effrayés par la gravité de la crise et tentés par " le sauve-qui-peut ». Ce ne sont pas les meilleures conditions pour faire face au tournant qui approche. Mais il faut regarder la réalité en face.
L'imminence d'un tournant
Nous allons entrer dans une nouvelle étape de la lutte des classes et il s'agit d'un tournant de portée historique. La classe ouvrière n'a pas encore pris la mesure des attaques que le gouvernement met en œuvre à l'instigation des " marchés ». En juin, le gouvernement a décrété : des réductions de salaires dans la fonction publique (qui ont eu immédiatement un effet de " boule de neige » dans les entreprises privées), le gel des retraites et des prestations sociales, des coupures radicales dans les dépenses budgétaires qui affectent gravement les infrastructures, les équipements et les services publics. Cette détérioration ouvre la porte à une nouvelle vague de privatisations. La réforme du code du travail, qui a épuisé la patience des syndicats, réduit les indemnités des licenciements, augmente les marges de manœuvre des patrons et accroît le champ d'activité des sociétés d'intérim - y compris dans le domaine de l'administration publique. Elle autorise aussi les entreprises à ne pas respecter les conventions collectives de leurs branches en fonction de leurs besoins particuliers, ce qui constitue une concession au patronat réellement cruciale. Il s'agit d'une véritable torpille envoyée sous la ligne de flottaison du syndicalisme. Les conventions collectives sont fondamentales pour l'existence même des syndicats, sans elles la classe ouvrière sera atomisée et transformée en une masse d'individus sans défense qui s'affronteront entre eux de manière inévitable…
Sur le point d'être débattue au Parlement, le réforme des retraites qui prétend, comme dans tant d'autres pays européens, de repousser l'âge de départ à la retraite à 67 ans, de réduire le montant des pensions et de promouvoir de cette manière les fonds de pension privés, constitue le couronnement de cette offensive du grand capital contre l'État providence. Les relations entre les classes sociales établies après la seconde guerre mondiale dans toute l'Europe sont ainsi remises en question. Dans l'État espagnol, avec ses caractéristiques particulières, cela prend des aspects particulièrement dramatiques. Les années du néolibéralisme triomphant ont préparé le terrain. A travers une nouvelle application de la " doctrine du choc » chère aux tenants du libéralisme, le capitalisme essaye aujourd'hui d'imposer un saut qualitatif.
La grève du 29 septembre montrera à quel point le mouvement ouvrier est prêt à relever ce défi. Les directions conciliatrices des syndicats majoritaires sont soumises à des pressions contradictoires. Elles voient leurs propres organisations menacées… mais elles rêvent de revenir aux temps de la " concertation ». Certes, leurs proclamations dénoncent avec lucidité la gravité des réformes gouvernementales. Certaines prises de position des mouvements de voisins liés aux syndicats proposent même des mesures radicales pour une sortie de gauche de la crise : banques publiques, fiscalité progressive, nationalisations, défense des services publics, réduction des dépenses militaires, reconversion écologique de la production, mesures d'égalité entre les genresw (les femmes représentent 80 % des salariés à temps partiel, souffrent de la discrimination salariale et sont les premières victimes de toute nouvelle dégradation du marché du travail, des prestations sociales ou des services publics)… Cependant de telles proclamations se concluent généralement par un appel à la " reprise du dialogue social ». Il faudra voir quelle sera la capacité de mobilisation d'un corps de délégués qui, dans de nombreux cas, ont une faible présence et peu d'autorité dans leurs entreprises. Car pour leur part, les syndicats de gauche — la CGT libertaire, le Syndicat ferroviaire, le Cobas, l'Intersyndicale alternative de Catalogne ou le Syndicat andalous des travailleurs — sont minoritaires et, indépendamment de la qualité de leurs équipes militantes et de leur poids dans tel ou tel secteur, ne peuvent compenser la défaillance des grandes centrales. Il faut encore préciser que l'engagement de chacune des grandes centrales n'est pas le même : alors que l'on voit les CCOO pleinement actives dans la convocation du 29 septembre, l'UGT se montre ici et là vacillante, soumise à de fortes tensions internes du fait des pressions exercées par le PSOE auquel ce syndicat est étroitement lié historiquement.
Signalons enfin la particularité basque, qui complique encore le panorama syndical. La majorité du mouvement syndical au Pays Basque, représentée par ELA, LAB, STES… est de tradition nationaliste et s'est fréquemment heurté au syndicalisme structuré à l'échelle étatique. La majorité syndicale basque a déjà organisé deux grèves générales — une l'an dernier et la seconde en juin 2010, avec cette fois-ci l'appui des CCOO. Les deux grèves ont été très suivies et ont donné lieu à d'importantes manifestations. Mais pour ce 29 septembre, la majorité des syndicats basques a refusé de soutenir l'appel des CCOO et de l'UGT, en alléguant des griefs et son propre calendrier de mobilisation. La question nationale, que la crise tend une nouvelle fois, pèse ainsi sur l'unité d'action du mouvement ouvrier.
Il ne s'agit pas là, évidemment, de la seule distorsion d'origine politique. La grève met aussi en lumière l'incontournable crise des gauches. Le PSOE paraît décidé au harakiri pour servir les riches. Sa politique gouvernementale prépare le retour de la droite. Les élections autonomes catalanes de cet automne verront très probablement le triomphe de la droite nationaliste et la fin d'un cycle de gouvernements de la gauche social-libérale.
Izquierda Unida (la Gauche Unie) se déchire entre l'idée de " refonder » son projet avec une tournure anticapitaliste… et ses engagements de gouvernabilité locale et régionale sous la houlette du PSOE. Avec ses modestes forces militantes en construction, Izquierda Anticapitalista (Gauche anticapitaliste) s'est fermement engagée dans la préparation de la grève générale, consciente de l'importance de cette grève et de la nécessité d'en faire le début d'un cycle de luttes, ouvrant une issue à la crise systémique, favorable aux intérêts des classes populaires. ■
Barcelone, le 23 septembre 2010
* Lluís Rabell est membre de la direction de Izquierda Anticapitalista (Gauche anticapitaliste), section de la IVe Internationale dans l'État espagnol.