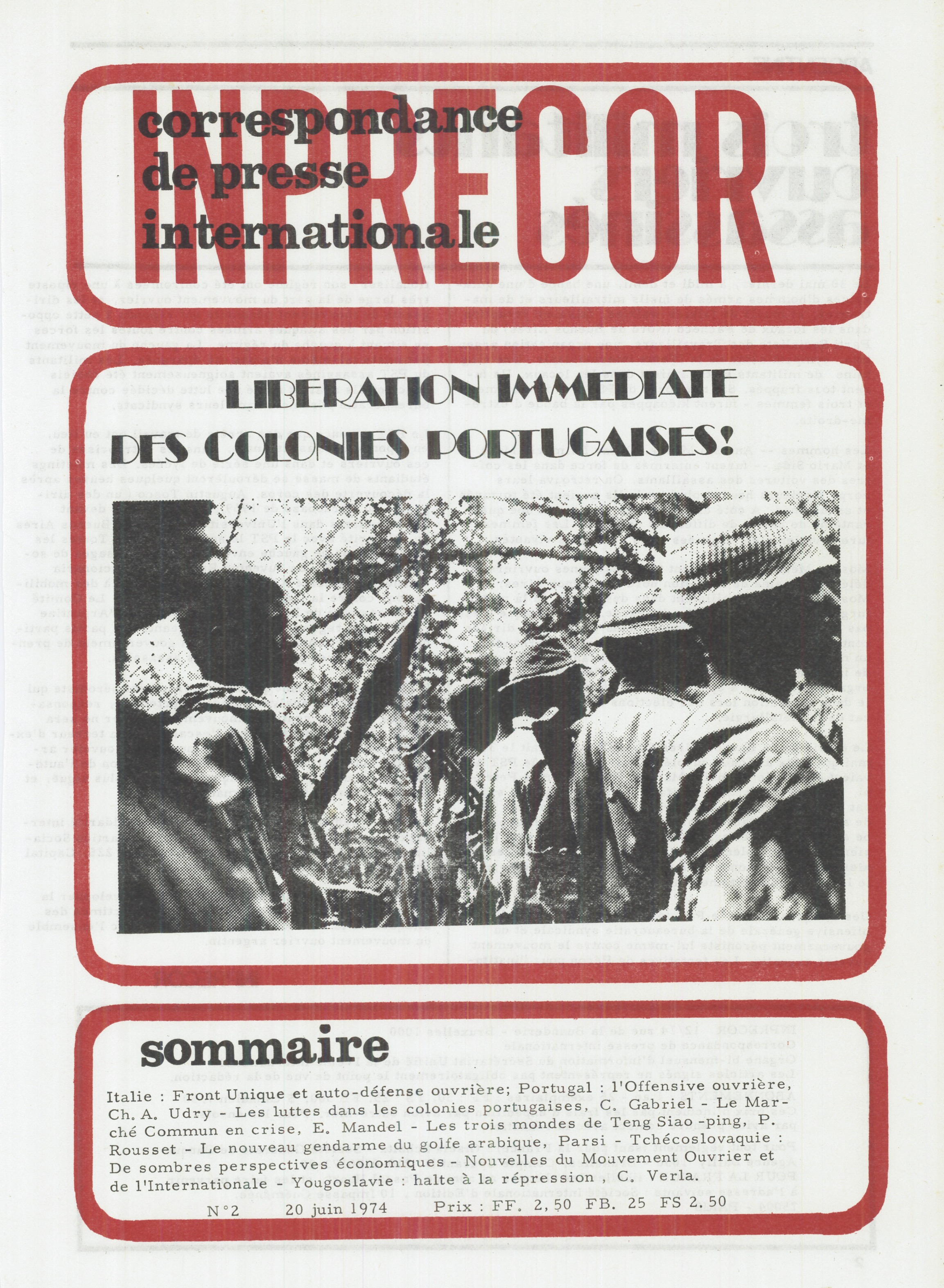La plupart des analyses sur la lutte dans les colonies portugaises se contentent, y compris dans un but de soutien, de placer les mouvements de libérations au centre du triangle : métropole-armée coloniale-impérialisme. Tout est fait comme si les trois colonies africaines du Portugal étaient hors de l’histoire du continent africain. Pour notre part, parce que notre soutien au MPLA (Mouvement Populaire de Libération de l’Angola), au FRELIMO (Front de Libération du Mozambique) et au PAIGC (Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap Vert) veut s’accompagner d’une analyse de leur trajectoire politique, il est nécessaire de replacer ces luttes dans le cadre du continent et de la révolution africaine. Le putsch au Portugal ouvre une période décisive ; les mouvements de libération sont aujourd’hui confrontés aux jeux complexes des négociations qui réclament un dépassement de l’empirisme pour saisir précisément le rôle du réformisme au Portugal ou encore la nature du « soutien » intéressé et combinard des régimes néo-coloniaux africains.
La bourgeoisie portugaise et l’impérialisme sont à la recherche d’une solution néo-coloniale. Mais celle-ci est-elle possible ? Peut-on, dans ces conditions historiques différentes, reproduire la politique d’un de Gaulle et obtenir le même résultat ? Mario Soarez a beau répéter que « tout ce qui nous rapproche est beaucoup plus fort que ce qui nous divise », il ne fera pas reculer l’histoire de quinze ans.
Le piège néo-colonial ne sera pas le résultat d’une séduction brutale des mouvements de libération par les déclarations moralisantes du secrétaire général du Parti socialiste portugais. Mais le danger néo-colonial ne se résume pas à une affaire de bonne ou de mauvaise morale. Il peut trouver une brèche dans les illusions d’un « État démocratique et national », ou tout simplement se développer sur la base de certains investissements multinationaux qui, depuis une décennie, pillent l’Angola et le Mozambique, et pour lesquels les réformistes portugais deviennent soudain silencieux. Silencieux sur l’armée privée de la Gulf Oil à Cabinda. Silencieux sur les prochaines fournitures d’énergie de Cabora Bassa à l’Afrique du Sud...
La politique actuelle de Lisbonne vise à minoriser les mouvements de libération en faisant apparaître une série de « 3èmes forces », susceptibles de briser l’intransigeance du PAIGC ou du FRELIMO.
Le Parti Socialiste et le Parti Communiste portugais pour qui le gouvernement d’union nationale est un but en soi ne ménagent pas le chantage : « pour que les négociations se mènent il faut que le gouvernement actuel se maintienne et pour qu’il se maintienne il faut qu’on obtienne un minimum de concessions de la part de vous autres, les mouvements de libération ! »
La période qui s’ouvre va donc révéler la profondeur ou les limites de l’élaboration politique des mouvements de libération. Elle va aussi éprouver leur cohésion. La crise qui se dessine dans le MPLA favorisera-t-elle les manœuvres de l’impérialisme ? Le front uni avec le FNLA (Front National de Libération de l’Angola -- voir encart) envisagé par une fraction du MPLA est d’ores et déjà le Front de N’Gouabi, Mobutu, Kaunda et Nyerere (respectivement chef d’État du Congo Brazzaville, du Zaïre, de la Zambie et de la Tanzanie), c’est-à-dire un front du néo-colonialisme. C’est bien sur un programme authentiquement anti-capitaliste que l’avant-garde angolaise, ainsi que celle du Mozambique et de la Guinée, pourra faire échouer le plan néo-colonialiste de l’impérialisme.
- Soutien au PAIGC, FRELIMO et MPLA !
- Indépendance immédiate et sans condition !
- Contre toute solution néo-coloniale !
- La lutte continue, le soutien aussi
- C. G. –
Lorsque la lutte contre le colonialisme portugais prend un essor décisif à la fin des années 50, la situation politique dans le continent noir est marquée par un profond reflux des luttes de masse et par l’intégration d’une partie importante du mouvement nationaliste dans le cadre d’une solution néo-colonialiste. Un peu partout, en l’espace de 5 à 6 ans, les partis nationalistes acceptent avec enthousiasme les postes de larbins de l’impérialisme. La petite-bourgeoisie urbaine qui s’était largement développée dans les sphères de l’administration coloniale, se hisse au rang de classe dirigeante après avoir utilisé le mouvement de masse comme force de pression sur les gouvernements impérialistes. Le contenu contradictoire des indépendances formelles a été la conséquence d’un double processus. D’une part, pour la bourgeoisie européenne, rompre avec l’économie coloniale classique pour passer à un stade supérieur de pillage en accord avec l’évolution du capitalisme contemporain constituait aussi une réponse politique empirique face à la montée de la révolution coloniale. D’autre part, pour les masses africaines, il s’agissait de la première offensive généralisée contre la barbarie impérialiste dans un cadre social modelé par le colonialisme, c’est-à-dire sous la direction politique de la petite-bourgeoisie « bureaucratique ». L’économie néo-coloniale n’a rien d’un stade « suprême » de la domination impérialiste, comme le prétend Nkrumah. La reconversion n’ouvrait pas une ère nouvelle de la domination bourgeoise, mais correspondait plus à un pis aller permettant un saut qualitatif du pillage tout en désamorçant provisoirement les poussées révolutionnaires. À la lumière de cela il apparaît que le néo-colonialisme n’était pas une évolution objectivement déterminée du système de domination mais, essentiellement, une défaite du mouvement nationaliste incapable, par nature, de faire transcroître la lutte pour l’indépendance en lutte anti-capitaliste.
G. Althabe dans son livre « Les fleurs du Congo » explique précisément le jeu idéologique du nationalisme africain « Le parti nationaliste tel qu’il est édifié durant cette période est, pour une fraction de l’élite bureaucratique, à la fois instrument de lutte contre les dominants étrangers et cadre dans lequel s’établit un rapport avec la masse de la population, un lieu où elle réussit à la mobiliser autour d’elle. » (p. 238) « Le parti nationaliste est donc construit comme une contre-institution dont le mode d’existence est entièrement déterminé par l’adversaire face auquel il est dressé. » (p. 240) « L’enjeu de la lutte est d’arracher la population de l’institution bureaucratique qu’est l’administration contrôlée par les administrateurs belges, de l’introduire dans une nouvelle institution bureaucratique, le parti, contrôlé par les politiciens dits nationalistes. » (p. 241) « L’épilogue de la confrontation est simple : le parti nationaliste devient l’administration, la dualité entre les deux institutions bureaucratiques est effacée. » (p. 241)
Ajoutons, de notre côté, que l’effacement de la dualité s’effectue soit par l’intégration du mouvement nationaliste au cadre néo-colonial, soit par la répression de ces éléments les plus radicaux (U.P.C. « Union des Populations Camerounaises » au Kamerun, Sawaba au Niger, M.N.C. « Mouvement Nationaliste Congolais » au Congo...).
C’est donc notamment par ces facteurs que le néo-colonialisme a pu devenir une politique possible des bourgeoisies coloniales. Estimer les possibilités de néo-colonialisme dans les colonies portugaises implique donc la mise en évidence de facteurs tels que ceux-ci, intégrés à une situation politique continentale et internationale, qui, pour leur part et de toute manière, sont différentes de celles des années 60.
L’analyse du nationalisme dans les colonies portugaises doit donc intégrer deux réponses :
- les conséquences de la période politique continentale sur la formation des mouvements nationalistes en Angola, au Mozambique et en Guinée Bissau à la fin des années 50 ;
- l’importance et les limites de leur rupture avec le nationalisme traditionnel de cette période et leurs bilans des indépendances octroyées.
La formation des mouvements nationalistes
Le Parti Africain pour l’Indépendance de la Guinée Bissau et du Cap-Vert (PAIGC) est fondé en septembre 1956. Un peu plus de 6 ans après, en 1963, la lutte armée est déclenchée après un processus de préparation politique et militaire. Mais de 1956 à 1963, cette région de l’Afrique est marquée par un reflux important des luttes de masse et par la stabilisation d’un rapport de forces favorable à l’impérialisme. Au Sénégal, c’est l’arrivée au pouvoir de Senghor et après l’emprisonnement de Mamadou DIA, l’instauration d’un régime fort qui va pendant plusieurs années inquiéter les arrières du PAIGC sur la frontière nord de la Guinée, et qui va soutenir un groupuscule droitier, le FLING. Au Sénégal ce sera aussi la répression contre le PAI, c’est-à-dire pour le PAIGC, la disparition, de fait, d’un point potentiel d’appui, au cœur de la néo-colonie. En Guinée Conakry, l’échec du premier plan va opérer une première réaction droitière du régime Touréen. Certes cet épisode ne modifie guère l’attitude de Conakry vis à vis du PAIGC naissant ; certes d’un point de vue quantitatif l’aide restera forte au fil des années. Mais du point de vue de la naissance d’une direction révolutionnaire en Guinée Bissau, la trajectoire politique du régime guinéen joue un rôle non négligeable, tant au niveau du rapport de forces régional que de l’influence politique directe sur les jeunes cadres du PAIGC. L’impasse du nationalisme guinéen ne peut bien sûr, à elle seule, bloquer un processus de radicalisation au sein du PAIGC ; mais elle n’a pas permis, encore, en tant que contre-exemple, son dépassement théorisé, comme l’attestent les déclarations de Vasco Cabral sur le « Parti-État ». En fait, le jeu complexe d’influences politiques s’instaure dont l’épilogue dépendra des capacités du PAIGC à théoriser son propre combat et à lui donner un contenu de classe.
Le MPLA est créé en décembre 1956 par la fusion de divers petits groupes urbains. Le 4 février 1961 éclate la révolte de Luanda, suivie par une insurrection paysanne dans le Nord. Nous sommes en pleine crise congolaise. L’impérialisme américain s’acharne à faire du Congo la plaque tournante de la contre-révolution en Afrique centrale. La bourgeoisie américaine a toujours adopté une politique ambiguë vis à vis du nationalisme africain. Il lui fallait à la fois briser la révolution montante et exploiter la crise du colonialisme européen afin de gagner de nouveaux marchés, inaccessibles dans le cadre de l’économie coloniale. Pour ce faire, l’aide aux éléments les plus droitiers du nationalisme africain deviendra une pratique courante de la part de Washington, notamment à travers les syndicats affiliés à la CISL1. Pour l’Angola, l’apparition du mouvement des « Populations du Nord » (UPNA) à dominante ethno-centriste est une aubaine. (Son apparition était, d’ailleurs, indépendante de l’action américaine). Cristallisation d’un mouvement nationaliste droitier, éventuel interlocuteur valable avec Lisbonne, possible « armée des frontières » et liens politico-ethniques (bakongo) avec le régime de Kinshasa, ne pouvait de toute manière se traduire que par une rencontre entre ce mouvement et la politique américaine, même si leurs rapports passent par des hauts et des bas. Pour le MPLA, la contre-révolution victorieuse au Congo se solde par son expulsion de Kinshasa et par la reconnaissance du GRAE (Gouvernement Révolutionnaire Angolais en Exil) à l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine). Cependant en 1963, les « trois glorieuses » de Brazzaville constituent une poussée révolutionnaire conjoncturelle que le MPLA va exploiter. Si le nouveau régime Massembat Debat au verbiage nationaliste accorde asile au MPLA après l’éviction de F. Youlou, ce n’est pas uniquement par conviction révolutionnaire d’une partie des protagonistes, mais aussi par réaction d’éléments droitiers (M. Debat) aux menaces d’un rassemblement bakongo sous la direction de Kinshasa2. Sur cette base, le MPLA peut en 1964 ouvrir un front dans l’enclave de Cabinda. Il sort très affaibli de cette période, coincé entre la répression portugaise et le soutien de Kinshasa au FNLA basé sur la frontière nord. Les rapports entre le MPLA et le nationalisme congolais ne sont pas faciles à établir. Du lumumbisme à la Défense Civile de Brazzaville, il est probable que les cadres du MPLA ont eu largement l’occasion de tirer un bilan. Mais celui-ci, qui n’est pas explicite, a-t-il été prolongé jusqu’au régime N’Gouabi, à la lutte de Diawara et de la gauche du PCT ? La question est d’importance. Car, si l’influence politique du nationalisme congolais semble faible, il n’en reste pas moins que la situation politique sur la frontière nord de l’Angola joue un rôle décisif pour les perspectives militaires dans les régions économiquement développées. En mai 66 le MPLA sort de la crise en ouvrant un nouveau front sur la frontière zambienne. Là encore, le « socialisme » de Kaunda3 n’influence guère les rangs du MPLA. Mais les jeux politiques au sein du MPLA peuvent rentrer en résonnance avec ceux du régime de Lusaka. On a vu dernièrement la rencontre qu’il pouvait y avoir entre la tendance Chipenda et une fraction du régime Zambien. S’il n’y a pas d’influence idéologique directe, du moins y a-t-il une intervention politique au travers des structures bureaucratiques de l’appareil organisationnel, notamment dans les Représentations extérieures.
Le FRELIMO (Front de Libération du Mozambique) se constitue pour sa part en 1962 par le regroupement du MANU, de l’UDENAMO et de l’UNAMI. Il rassemble aussi des petits groupes d’émigrés nationalistes en Tanzanie, en Zambie et au Malawi. Le mouvement nationaliste dans l’est africain est marqué avant tout par la personnalité de Nyerere et le FRELIMO reste faible. Constitué plus tard que le MPLA et que le PAIGC, le FRELIMO a été beaucoup moins confronté aux luttes précédant les indépendances. Il semble aussi que l’intégration plus importante du Mozambique au bloc austral, comparativement à l’Angola, ait plutôt polarisé les attentions et les relations militantes avec les mouvements de Rhodésie et d’Afrique du Sud. En définitive, il semble donc que le FRELIMO soit, des trois mouvements celui dont les premiers pas ont été les moins sensibles à la crise du nationalisme dans les pays environnants.
Cependant pour les trois mouvements la lutte s’amorce dans une situation de reflux généralisé à l’échelle continentale. Les premières années seront ainsi marquées par un profond isolement. ISOLEMENT QUI N’EST PAS SANS IMPORTANCE POUR COMPRENDRE LES DIFFICULTÉS DE CLARIFICATION POLITIQUE ET L’ABSENCE D’UNE RÉELLE THÉORISATION DU PROCESSUS RÉVOLUTIONNAIRE.
Les limites d’une évolution politique
Les trois mouvements se constituent au départ par le regroupement de jeunes nationalistes, membres de la petite-bourgeoisie urbaine. Ils ont été plus ou moins influencés par les luttes dans les colonies françaises ou britanniques. Ils ont, pour certains, découvert à travers le PC portugais l’existence du mouvement ouvrier occidental, en le percevant, malgré eux, à travers le prisme stalinien et social-chauvin. Hétérogènes, sans passé politique, ces jeunes directions se contentent dans un premier temps d’un corps de mots d’ordre réduits à la revendication d’indépendance. Le contenu de la lutte, sa stratégie et ses perspectives historiques ne sont guère détaillés. Mais aujourd’hui disposons-nous d’une production écrite plus copieuse ? Certes nous connaissons « The Struggle for Mozambique » (La lutte pour le Mozambique) de Mondlane, ainsi que les écrits de Cabral, notamment entre 1961 et 1969, qui, pour leur part, sont déjà en rupture avec les analyses traditionnelles d’un Nkrumah ou d’un S. Touré. En fait, c’est surtout au détour d’une interview ou au cours d’un discours que l’observateur perçoit un progrès dans l’analyse, une évolution, une précision. La production théorique dont la fonction éducatrice et propagandiste est décisive pour s’adresser au mouvement anti-impérialiste mondial, est très faible de la part de ces directions. La comparaison avec la direction vietnamienne est révélatrice. D’un côté des militants dont la production importante d’analyses politiques révèle leurs liens historiques avec le mouvement ouvrier international ; de l’autre des mouvements de libération, qui, constitués dans le cadre étouffant de la domination portugaise, ont mille difficultés à rompre avec l’empirisme, à découvrir l’instrument marxiste pour formuler une théorisation de leur combat. Encore faut-il ajouter ici que ces efforts peuvent être avortés s’ils se font avec le support stérilisant des concepts staliniens.
Cabral lui-même, reconnaît l’empirisme qui prévalut au début de la lutte4. Dos Santos, de son côté reconnaît l’importance du pragmatisme et le poids de l’hétérogénéité. Dans une interview à The African Communist (N°55), il déclare notamment « Ainsi, dès le début, en 1962, différentes idéologies se reflétaient dans la direction. Mais les tâches auxquelles nous étions confrontés à cette époque exigeaient que nous formions un collectif capable d’intégrer tous ceux qui étaient prêts à travailler ensemble afin de faire démarrer les luttes. Ainsi, la nature de la réalité politique, sociale et économique telle qu’elle existait, exigeait une attitude pragmatique. » (p. 47)
L’empirisme se révèle tout d’abord sur la question des formes de lutte en rapport avec l’analyse des formes de domination coloniale. Confrontés à un adversaire qui, contrairement au colonialisme français et britannique, n’a pas les moyens politiques et économiques de transformer sa forme de domination à la fin des années 50, les mouvements de libération perçoivent la nécessité de la lutte armée au travers des expériences de mobilisations légalistes de masse et de la répression inouïe qui bloque toute possibilité de leur transcroissance en mouvement national pour l’indépendance. Ainsi Cabral à l’ONU (27ème session) « Le massacre de Pidjiguiti, perpétré par les colonialistes portugais le 3 août 1959, contre des dockers de Bissau et les travailleurs des bateaux de transport fluvial en grève, avait été, aux dépens de 50 morts et de plus d’une centaine de grèvistes blessés, une douloureuse leçon pour notre peuple. Nous avons appris que, contre les colonialistes portugais, il n’était pas question de choisir entre la lutte pacifique et la lutte armée... Nous décidons alors de... suspendre toutes les actions revendicatives en ville et de nous préparer à la lutte armée. » Au Mozambique en 1956 et 1962 ont lieu à Lourenço Marques des manifestations anti-portugaises sauvagement réprimées. En 1960 à Mueda et en 1962 dans les plantations de canne à sucre de Xinavane, les revendications paysannes se soldent par des centaines de morts. C’est par de tels évènements ainsi que par l’exemple de la Guinée en lutte depuis plusieurs années que le FRELIMO fait peu à peu sa revendication de « négociations » pour préparer la lutte armée qui sera proclamée le 25 septembre 1964.
Empirisme aussi pour gagner les sympathies d’un village au cœur de la brousse ; empirisme pour résoudre les conflits entre deux groupes ethniques parmi lesquels il faut s’implanter ; empirisme encore pour structurer la guérilla. Nulle part ailleurs en Afrique de telles questions ne s’étaient posées jusqu’alors. Les réponses apportées, même partielles, constituent un apport fondamental pour les développements ultérieurs de la Révolution africaine5.
La question ethnique
Mais certaines questions ne se situent pas seulement dans le domaine subjectif. Au contraire la question ethnique, par exemple, a des fondements historiques, économiques et sociaux que la bonne volonté pragmatique ne suffit pas à résoudre. Certes, le PAIGC, intervenant dans un cadre géographique restreint, a pu, au travers d’une lente préparation et d’une approche différente des groupes ethniques, modeler une conscience nationale. Le FRELIMO, de son côté, a connu des épreuves sur ce terrain, notamment avec le groupe Makonde au nord. Mais c’est au MPLA qu’échoient les plus mauvaises conditions en la matière... La situation géographique de l’Angola, son histoire écartelée entre le pool congolais et l’Ovamboland rendent les conditions d’une « conscience nationale dans la lutte » très difficiles. Le groupe bakongo au nord, dont la cohésion et la « légitimité » proviennent de l’ancien royaume du Congo, est aujourd’hui partagé entre les frontières du Congo, du Zaïre et de l’Angola6. C’est ainsi qu’en 1954 se crée à Léopoldville l’union des peuples du nord de l’Angola (UPNA) sur la base du nationalisme bakongo. Les leaders en sont Barros Nekaka et Holden Roberto. En 1957 ce dernier avait écrit à l’ONU pour réclamer la reconstitution du royaume du Congo. Plus tard, l’UPNA, devenue UPA, soutiendra, y compris militairement, la fraction tchombiste du Congo. Aujourd’hui, devenue une véritable armée des frontières sous l’aile protectrice de Mobutu, cette fraction droitière du nationalisme peut jouer un rôle d’interlocuteur privilégié. L’accord entre le MPLA et le FNLA-UPA signé en 1972 représentait certes un intérêt tactique pour le MPLA afin de débloquer la situation de son front N° 1 dans le nord. Mais au-delà de ses conséquences conjoncturelles l’accord représenta une reconnaissance de fait du FNLA comme co-représentant de la lutte. Le FNLA fut aussitôt réintégré dans le soutien public de l’OUA. Il est reconnu aujourd’hui par Pékin, Sofia7. Les conséquences mystificatrices de l’accord furent telles que le MPLA dut publier un communiqué dans lequel il signalait à la presse internationale : « Le MPLA maintient toutes ses structures aussi bien que le FNLA. Comme c’est clair, les actuelles conversations n’autorisent personne à se référer au MPLA comme s’il n’existait pas. » Dans « Afrique en Lutte » de mars 1973 nous écrivions : « conséquences des projets tactiques du MPLA et contradictoirement des espoirs de l’impérialisme, l’accord réalisé sous la tutelle de N’Gouabi, Mobutu, Nyerere, Kaunda n’est pas exempt de contradictions. Il faut se féliciter pour les nouvelles perspectives militaires qu’il offre au MPLA. Mais il faut encore s’interroger sur la manière dont les différentes composantes du MPLA vont envisager l’application des clauses. » Effectivement quelques mois après la tendance Chipenda expliquait que cet évènement constituait un accord des peuples du nord contre les peuples du sud, dont, bien sûr, elle se dit la représentante.
L’existence de groupes ethniques, à cheval sur les frontières, favorise les moyens de pression et d’intervention des régimes néo-coloniaux qui ont le contrôle d’une partie de cette population8. Une fraction régionaliste, au gouvernement ou pas, peut alors se lier d’intérêt avec des leaders locaux du mouvement de libération. Ce fut le cas dans l’affaire Chipenda avec une fraction du gouvernement zambien. Une telle situation est d’autant plus favorisée que le mouvement de libération n’est pas muni d’une direction homogène, qu’il connaît une certaine bureaucratisation sur la base d’un « willayisme ». Des trois mouvements, le MPLA est certainement le plus vulnérable sur ces questions. Chipenda était responsable de la logistique. Il a été dénoncé comme traître, ce qui mériterait tout de même une explication politique. Non seulement celle-ci n’est jamais arrivée, mais il semble bien qu’un compromis soit intervenu entre le « traître » et le reste de la direction. Un tel fonctionnement, une telle hétérogénéité, ne peuvent pas ne pas avoir de conséquences sur la ligne politique générale. La situation en Angola permet toutes les manœuvres possibles de la part de l’impérialisme pour minoriser les tendances les plus radicales. Il est donc particulièrement inquiétant de lire la déclaration de A. Neto à Dar Es Salaam le 12 mai 1974, dans laquelle il se félicite des progrès réalisés par le FNLA et il exprime l’espoir que le MPLA et le FNLA coopéreraient en vue d’extirper d’Afrique le colonialisme portugais. Un tel compromis se fera sur quel programme et dans quel but ?
À propos de la question régionale et ethnique, le FRELIMO a dû, lui aussi, prendre position. Dos Santos dans l’interview à The African Communist, déclare : « Au niveau de l’économie régionale de subsistance, au niveau d’une économie basée principalement sur l’agriculture à son niveau le plus élémentaire, il est difficile pour des gens d’avoir des rapports dans un sens vraiment national, dans le sens d’un partage égal de la même économie et tous les liens sociaux que cela crée. Je dirais donc que le développement économique national est une partie essentielle du processus continu de construction d’une nation. Bien sûr une nation est le produit de l’histoire, et sa formation passe par différentes phases. Dans ce sens le travail de réalisation finale d’une nation continuera encore après l’indépendance, bien que les éléments fondamentaux de la nation existent déjà et vont se développer ultérieurement au Mozambique. » (p. 42)
La lutte armée et la volonté d’unification nationale dans le combat contre l’oppresseur portugais ont été deux facteurs permettant une rupture décisive avec les éléments capitulards ethnocentristes qui dans la veine du nationalisme des colonies françaises et britanniques optent pour une politique de pression diplomatique et de guerre des frontières. Ce n’est pas un hasard si le FLING pour la Guinée a été soutenu pendant plusieurs années par le régime Senghor. Pas plus étonnant le soutien de Mobutu pour le FNLA. Cette rupture ne peut cependant être absolue du fait de l’hétérogénéité des mouvements, particulièrement du MPLA. C’est pourquoi nous ne saurions sous-estimer les risques de déviations induits par des compromis entre différentes tendances. Dans le contexte africain ces risques subsistent tant que la rupture définitive avec l’idéologie nationaliste n’est pas accomplie.
Certes des mouvements autonomes se sont créés dès le début cristallisant sans ambiguïté les secteurs les plus droitiers du nationalisme. Le FLING et le FNLA en sont les meilleurs exemples. Mais l’histoire n’a pas toujours été si simple. En Angola des « passages » se sont faits entre le MPLA et FNLA bien après le déclenchement de la lutte. C’est aussi une scission du FNLA, dirigée par Savimbi qui créera l’UNITA. Au Mozambique où le FRELIMO était, déjà au départ, un rassemblement de groupes divers, l’« épuration » s’est faite dans le cours même de la lutte. Ce fut le cas des deux principaux départs : celui de Lazare Kavandamé et celui de Uria Simango.
Samora Machel (dirigeant du FRELIMO) explique ainsi ces évènements : « La contradiction essentielle concernait la ligne générale : d’un côté une position purement nationaliste qui réduisait la libération à un seul de ses aspects, chasser les portugais ; de l’autre, une position largement majoritaire, qui liait le mouvement de libération à celui de transformation des structures coloniales autochtones et tribales ». Les deux exclus visaient en définitive la stabilisation de fiefs où pouvait s’exercer leur pouvoir dans le cadre des structures traditionnelles. S. MACHEL continue ainsi : « Mais c’est quand les vastes territoires du Mozambique ont été libérés et que se posa le problème de savoir comment les organiser pour en faire des éléments moteurs de développement de la lutte de libération que la contradiction a éclaté au grand jour... Si l’on combat pour chasser les portugais et qu’ensuite on met à leur place des africains qui utilisent le même système économique que les portugais, donc qui exploitent les autres africains, alors la lutte s’enlise. Mais si, après avoir chassé les portugais, on fait en sorte que la lutte du peuple devienne permanente... » (interview à Rinascita - hebdomadaire du Parti Communiste Italien - 9 juillet 1971).
C’est donc des Simango, des Kavandamé qu’il faudrait aujourd’hui à Spinola pour réussir son opération.
Une rupture décisive s’est donc opérée avec les traditions du nationalisme réformiste qui sévissaient majoritairement dans les mouvements d’émancipation des colonies françaises et britanniques.
Avant la nouvelle situation au Portugal et les propositions du gouvernement d’Union nationale, une capitulation immédiate sous l’effet de la séduction néo-coloniale est donc improbable. Il y a certes au sein du MPLA des tendances authentiquement droitières qui pourraient trouver des points d’appui à l’extérieur du mouvement. Mais globalement la dynamique engendrée par les spécificités du colonialisme portugais et les années de lutte ont, sans conteste, séparé ce NATIONALISME RÉVOLUTIONNAIRE de ce marais droitier et réformiste.
Mais si le néo-colonialisme ne vient pas d’une capitulation brutale sous l’effet du coup d’État militaire il reste qu’il peut être fécondé par le mythe de l’État national et démocratique. Sur la question de la finalité sociale de la lutte les mouvements de libération adoptent une position floue et volontairement imprécise. Certes, l’absence de théorisation du processus révolutionnaire explique cette insuffisance. Mais cela ne suffit pas à rendre compte d’un tel « refus » à préciser les objectifs historiques. Cette attitude a pour cause principale l’hétérogénéité des directions. Certes, chacun refuse catégoriquement le « néo-colonialisme » tel qu’un Senghor ou un Mobutu s’en font les représentants. Mais il ne faut pas oublier que de Sékou Touré aux marxistes révolutionnaires, il existe en Afrique un « choix » « impressionnant » d’« anti-colonialistes » !
C’est donc sur cette question qu’il faut débattre avec les camarades du PAIGC, du MPLA et du FRELIMO. Pour l’Angola et le Mozambique une première remarque s’impose alors que se précise l’horizon des négociations. Les zones de guérilla, notamment en Angola ont très peu mordu sur les régions économiquement riches. Dans ces régions les investissements impérialistes sont particulièrement importants et impliquent d’ores et déjà pour la bourgeoisie portugaise un siège de seconde catégorie dans un cadre néo-colonial ouvert à toutes les fractions impérialistes. La première carte que va tenter de jouer la bourgeoisie portugaise sera de mettre à la table de négociations des groupes représentant des secteurs de la petite-bourgeoisie urbaine métisse, africaine et des secteurs démocratiques de la population portugaise. Ainsi apparaissent soudain le Mouvement Démocratique de Guinée ou même le GUMO multiracial du Mozambique. Ajoutons à cela le FLING dont la presse internationale se met à reparler copieusement alors que tout le monde s’accordait à en signaler la disparition il y a quelques semaines. Il s’agira donc de minoriser les mouvements de libération au nom d’une représentativité nationale, autour de la table de négociation. Une réponse urgente s’impose donc de leur part sur l’avenir des capitaux de KRUPP et des mines de BENGUELA ou encore ceux de la GULF OIL et autres compagnies pétrolières, etc. Si les négociations devaient aboutir à un gel de la situation actuelle n’attribuant au MPLA et au FRELIMO qu’une autorité partielle il serait impossible de contrecarrer les tendances néo-colonialistes soutenues par une économie largement dépendante des investissements impérialistes. Il n’y a donc pas d’autres solutions dans le cas du Mozambique et de l’Angola que la poursuite des combats afin de prendre pied solidement dans les régions économiquement développées. Or chacun sait qu’une telle situation entraînerait aussitôt une épreuve de force entre le gouvernement portugais et les ultras. Attentistes aujourd’hui, ils ne tarderaient pas à devenir hégémoniques parmi une population blanche dont le vœu le plus cher est de rester. (Le parti FICO vient de se créer au Mozambique, FICO signifie « Je reste »). Une situation à la rhodésienne est une constante dans les débats au sein du colonat blanc. Au Mozambique une telle tendance s’appuie sur des secteurs économiques non négligeables : le groupe de Champalimaud, industriel, et de Jardin.
La terreur des réformistes du PS et du PC est donc ce risque de rupture qui par la crise meurtrière qu’elle engendrerait en Afrique australe compromettrait définitivement leur gouvernement d’Union nationale. Il est donc évident que ces partis vont multiplier les pressions pour que le FRELIMO et le MPLA acceptent le compromis que nous analysions plus haut. A. Almeida Santos, représentant des démocrates blancs au Mozambique et proche du PS vient d’être nommé Ministre de la coordination inter-territoriale. Il déclarait voilà quelques jours : « Le dialogue avec le FRELIMO devrait être aisé pour nous... Mais nous devons faire vite parce que tous les africains ayant un minimum de conscience politique sont ou seront du FRELIMO. »
(à suivre)
Juin 1974
- 1
Nixon déclarait en 1957 : « Les futurs intérêts des États-Unis en Afrique sont si vastes qu’ils nous donnent le droit de ne pas hésiter même à aider le départ des puissances coloniales en Afrique ».
- 2
Fulbert Youlou était un Lari, c'est-à-dire un groupe apparenté Bakongo. Au sein du régime Massembat Débat une aile favorisa réellement, pour des raisons internationalistes, le soutien et l'aide au MPLA. Mais la direction, notamment M. Débat, s'avéra très rapidement être une nouvelle fraction régionaliste et tribaliste. La répression ne tarda pas à s'abattre sur les éléments les plus radicalisés qui avaient cru trouver la clé de la « Révolution démocratique et nationale ».
- 3
Comme Senghor et d'autres, Kaunda développa la phraséologie du « socialisme africain » dont l'essence et les objectifs sont bien évidemment réactionnaires.
- 4
Cabral ne semble pas penser que cet empirisme se prolonge au-delà de la période de stabilisation de la lutte armée.
- 5
Des risques de déviation militaristes se font jour au sein du PAIGC en 1964, avec l'apparition de petits potentats locaux. Le congrès règlera cette question en épurant certaines directions militaires et en redéfinissant les rapports entre le politique et le militaire. À nouveau le PAIGC résolvait un problème à chaud.
- 6
Dans les deux pays apparaissent régulièrement des appels à la réunification du peuple Kongo, à l'initiative de politiciens véreux qui cherchent par là une assise régionale. Rappelons que durant la crise congolaise Kasavubu, un des hommes de paille, fondait sa crédibilité sur sa « représentativité » des kongos majoritaires dans le pool.
- 7
Le 1er juin 1974, 112 instructeurs chinois sont arrivés à Kinshasa pour le FNLA suite à une clause de l'accord sino-zaïrois.
- 8
En Guinée, chez les Balantes, la terre est la propriété du village, les instruments de production appartiennent à la famille ou à l'individu. Toujours en Guinée, les Foulas connaissent aussi la propriété collective de la terre mais doivent une certaine quantité de travail à la chefferie. Seuls dans ce pays les Mandjaks connaissaient à l'arrivée des portugais une société de type féodale induite par l'islamisation.