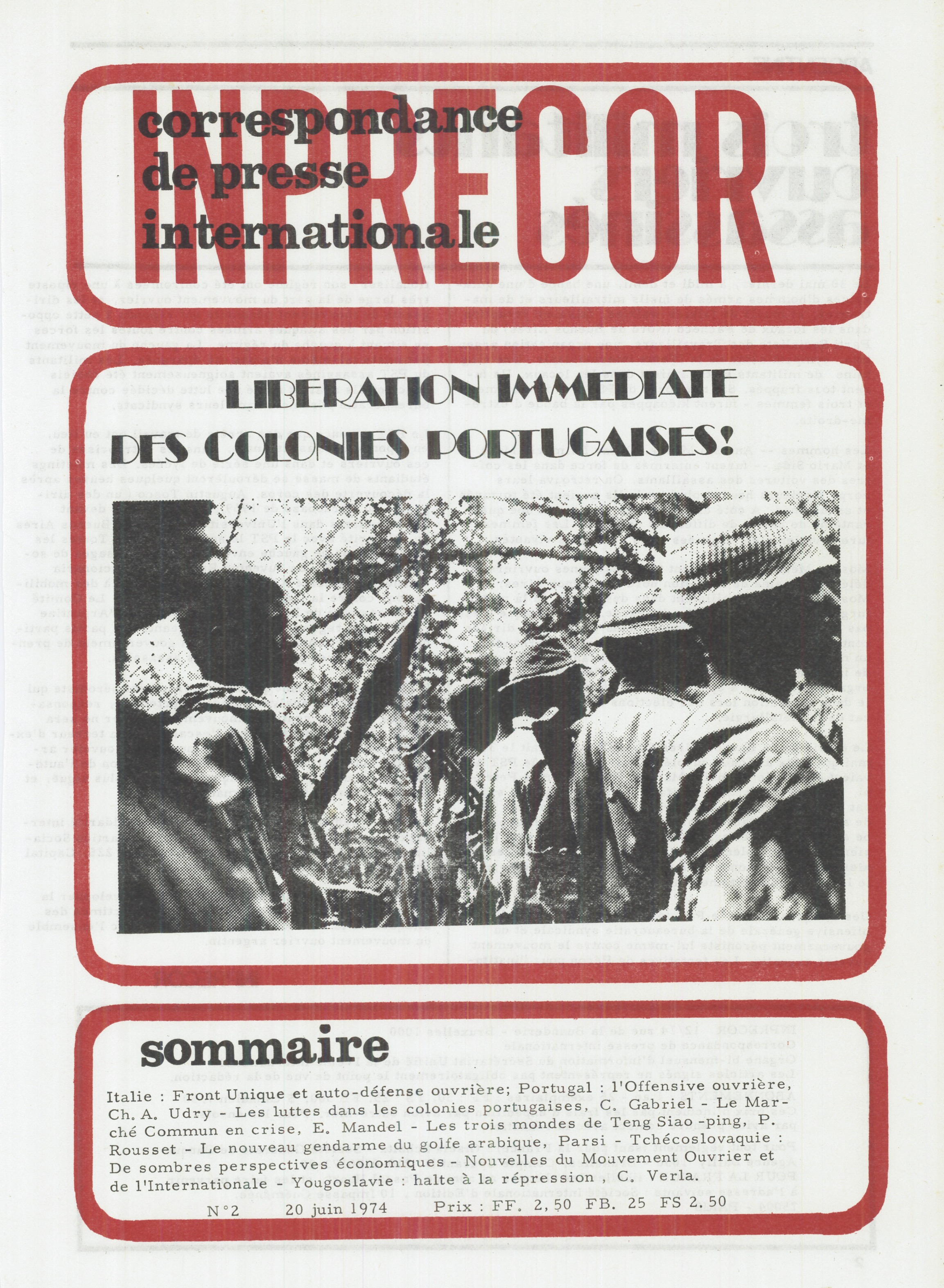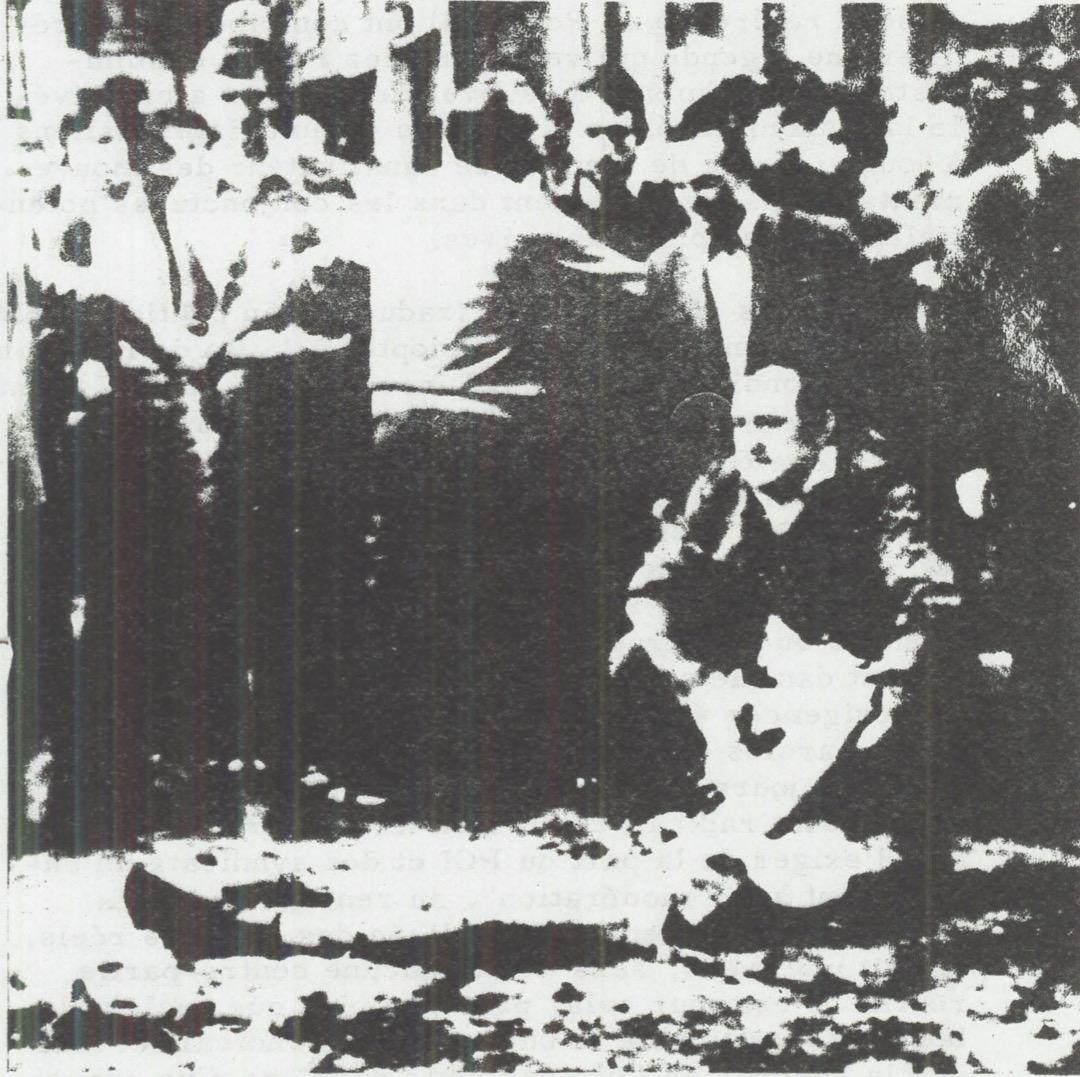
Le 28 mai dernier une bombe éclatait au cours d'une réunion syndicale à Brescia, tuant sept personnes et en blessant plusieurs dizaines. Il s'agit d'un attentat de caractère clairement fasciste qui prolonge la série d'attentats et de provocations ouverte en décembre 1969 par l'explosion de la bombe à la Banque de l'Agriculture, place Fontana, à Milan.
Le massacre de Brescia provoqua une riposte de masse de grande ampleur. Le 29, une grève générale de 4 heures paralysa le pays tout entier et donna lieu à des manifestations gigantesques (plus de 200 000 personnes à Rome). Dans différentes villes de nombreux locaux du MSI (Mouvement Social Italien - mouvement néo-fasciste) furent attaqués et détruits.
L'aggravation de la situation économique (augmentation du taux de l'inflation, énorme déficit de la balance des paiements) soulignée dans le rapport du directeur de la Banque d'Italie, Carli, est un autre facteur qui accélère la crise politique du pays. La polémique s'est de nouveau ouverte publiquement sur la solution à adopter. Le président de la FIAT et du Syndicat des Industriels, Agnelli, parlait d'un nouveau "pacte social", faisant explicitement référence à l'unité nationale établie à la fin de la seconde guerre mondiale. Cette nouvelle crise ouverte devait amener à la démission du gouvernement Rumor le 10 juin.
De son côté le Parti Communiste Italien relançait le "compromis historique" (c'est-à-dire la collaboration entre communistes, socialistes et démocrates-chrétiens).
Nous publions ci-dessous l'éditorial sur la situation en Italie après Brescia, paru dans le numéro du 5 juin 1974 de Bandiera Rossa (bi-mensuel des Gruppi Comunisti Rivoluzionari).
Deux semaines après le referendum qui avait représenté une défaite cuisante pour l'aile la plus conservatrice de la bourgeoisie et avait montré que la crise de direction politique restait plus que jamais ouverte, le massacre de Brescia a mis à nu, une fois de plus, le caractère conflictuel de la situation actuelle en Italie, et a stimulé à nouveau la recherche frénétique de solutions "nouvelles". Les perspectives économiques très négatives ont contribué à dramatiser encore plus la situation, et ont suggéré à certains membres parmi les plus représentatifs de la classe dominante la perspective d'un tournant qui pourrait se concrétiser par un "pacte social" analogue à celui qui avait été réalisé à la fin de la seconde guerre mondiale.
Les conséquences de la "stratégie de tension"
La tragédie de Brescia a, avant tout, montré une fois de plus l'existence de secteurs disposés à jouer jusqu'à ses conséquences les plus aberrantes la "stratégie de tension". L'échec de la politique "modérée" de recherche d'un bloc entre la Démocratie-Chrétienne (DC) et la droite, a provoqué, comme il était facile de l'imaginer, une tentative de la part des ultras de droite de faire éclater la crise du régime par la terreur. Tout ce qui est apparu après l'attentat de Brescia, au sujet des responsabilités de groupes bien identifiés, a, d'autre part, clarifié même aux yeux des plus myopes, ce que la gauche révolutionnaire avait dénoncé dès le lendemain de l'attentat de la Place Fontana de Milan : à savoir que les extrêmes fascistes pouvaient compter sur des connivences importantes dans les secteurs les plus variés de l'appareil d'État et que leur force résidait justement en cela en plus des subventions économiques dont ils disposaient.
La riposte au massacre de Brescia -- qui, même dans son contenu émotionnel a revêtu une ampleur énorme -- a fourni une autre indication non moins claire : au niveau de masse, le fascisme est encore extrêmement faible et toute tentative d'instaurer une dictature fasciste ou fascisante se heurterait inévitablement à une riposte impétueuse de la classe ouvrière et de larges couches de la petite-bourgeoisie et pourrait stimuler une dynamique de guerre civile à l'issue incertaine. C'est cette constatation même – et sûrement pas son attachement aux "institutions démocratiques" – qui a amené la grande majorité de la classe dominante à s'associer à la condamnation de l'action de Brescia et à chercher à créer, par l'intermédiaire de ses porte-paroles et de ses organes de presse les plus connus, une atmosphère d'unanimité anti-fasciste, reprenant les thèmes de l'unité nationale d'il y a trente ans. La question politique centrale qui se pose aujourd'hui, est, en dernière analyse la suivante : la bourgeoisie italienne considère-t-elle qu'elle est arrivée à la limite ultime et, dans l'impossibilité d'imposer une solution de force, une dictature fasciste ou militaire, est-elle prête à opérer un tournant du type de celui de 1944/45, c'est-à-dire à rechercher une alliance avec toutes les composantes du mouvement ouvrier ? L'heure du nouveau "pacte social" ou, pour utiliser les termes de Berlinguer (dirigeant du Parti Communiste Italien) d'un nouveau "compromis historique" est-elle sur le point de sonner ?
Vers un nouveau "pacte social" ?
Nous n'avons, pour notre part, jamais exclu l'apparition d'une telle hypothèse. Au contraire, nous avons affirmé à plusieurs reprises que des tendances significatives œuvraient dans cette direction. La dégradation de la démocratie parlementaire, la menace croissante d'une crise de régime sans issue et les nuages menaçants qui s'accumulaient sur la situation économique, dans le cadre des rapports de forces politiques qui ont été révélés – pour se limiter aux événements les plus récents – par le referendum et les mobilisations après Brescia, ont renforcé ces tendances de façon notable. Le discours fait par Agnelli devant la Confindustria (Syndicat des patrons de l'Industrie Italienne) en a été la manifestation la plus significative. (Voir l'introduction – INPRECOR). De leur côté, les dirigeants du P.C.I. ont cherché à utiliser le résultat du referendum et la riposte à Brescia exactement dans la même direction. Leur pouvoir de discussion s'est incontestablement renforcé, et certaines expériences internationales de ces dernières semaines (nous faisons référence au Portugal) ont contribué à discréditer une légende qui veut faire des Partis communistes des éléments de subversion, et ont ainsi révélé la disponibilité des dirigeants communistes italiens à jouer un rôle de frein et de canalisateur des mouvements de masse justement dans les conjonctures potentiellement les plus explosives.
Toutefois les obstacles à la traduction en pratique d'une orientation analogue à celle adoptée à la fin de la seconde guerre mondiale, et donc à l'insertion du Parti Communiste dans le gouvernement ou dans la majorité, restent encore très importants. Au niveau des forces politiques de la bourgeoisie, la Démocratie-Chrétienne et ses alliés de droite ont encore récemment réaffirmé leur volonté de poursuivre sur la voie du centrisme, réservant au PCI le rôle d'une opposition avec laquelle on peut travailler, mais sans l'insérer réellement dans le système gouvernemental. Au niveau des exigences économiques et sociales, ces mêmes porte-paroles de la bourgeoisie qui ont, au cours des derniers jours, parlé d'une ouverture explicite vers un tournant radical, n'ont rien fait d'autre, ensuite, que d'exiger de la part du PCI et des syndicats un engagement à la "modération", au renoncement à la lutte pour une défense généralisée des salaires réels, en fait une trève, sans offrir aucune contre-partie réelle. C'est pour cela, par exemple, que, malgré la bonne disposition de la bureaucratie syndicale et malgré la concession faite par cette dernière d'un renvoi de la relance généralisée des luttes, les discussions entre les syndicats et le gouvernement n'ont encore apporté aucun résultat concret et les syndicats n'ont pas pu ne pas exprimer – même de façon modérée – leur insatisfaction.
Au-delà des affrontements épisodiques, la contradiction de fond – qui continue à faire obstacle à la réalisation du "compromis historique" – est la suivante : la bourgeoisie ne peut sortir, ou mieux, tenter de sortir de la situation économique actuelle, que par une nouvelle compression du niveau de vie des grandes masses, que par de profondes restructurations qui impliqueront, en dernière analyse, une augmentation du taux d'exploitation et un maintien ou une réduction du niveau de l'emploi. Et c'est justement cela que les bureaucraties politiques et syndicales du mouvement ouvrier peuvent difficilement accepter, dans une situation où la classe ouvrière fait toujours preuve d'un haut niveau de combativité et où de larges couches de la petite bourgeoisie continuent à se radicaliser. Sur le terrain plus directement politique, on voit mal par quoi pourrait se concrétiser le tournant "démocratique" tant souhaité, comment pourrait se traduire concrètement les proclamations verbales : à moins que l'on croie qu'il soit possible de "renouveler" tous les appareils, de la police à la magistrature, simplement parce que l'on affirme vouloir un tel "renouveau", et parce que, à la limite, la composition du gouvernement change ?
Quoi qu'il en soit, les révolutionnaires doivent être extrêmement clairs sur l'orientation de fond pour la lutte du mouvement ouvrier dans cette phase et sur leurs tâches impératives.
Les travailleurs ne feront pas les frais de la crise
Avant tout, la classe ouvrière ne doit pas sortir vaincue de la bataille contre la bourgeoisie, bataille sans arrêt relancée pour lui faire payer le prix de la crise économique. Sur ce terrain, tous les discours sur le "sens des responsabilités", sur les "sacrifices nécessaires" doivent être rejetés. Cela signifie que toute trève doit être rejetée, que l'on doit créer, à brève échéance, les conditions pour une mobilisation générale sur les objectifs qui unifient toutes les couches de la population travailleuse exploitée. Les patrons et le gouvernement voudraient attaquer le système déjà insuffisant de réajustement des salaires au coût de la vie. La classe ouvrière doit opposer à cette tentative une mobilisation pour une véritable échelle mobile des salaires, qui compense, totalement et immédiatement, la réduction du pouvoir d'achat due à la hausse des prix, et qui soit sous contrôle ouvrier à tous les niveaux (du relevé de l'indice au contrôle des prix dans les magasins). Les patrons et le gouvernement se préparent à attaquer le niveau de l'emploi : la classe ouvrière doit opposer à cette tentative la lutte contre toute suspension et tout licenciement, pour que le travail existant soit réparti entre tous les travailleurs sans réduction de salaire. S'il doit y avoir des réductions, que ce soit pour les heures de travail, sans réduction de salaire. Enfin, la classe ouvrière doit se préoccuper des différenciations qui apparaissent en son sein. Les catégories les moins favorisées et les moins organisées perdent du terrain par rapport aux secteurs les plus combatifs et elles ont, de fait, des rétributions toujours plus basses. Pour combattre cette tendance, il est nécessaire d'exiger un salaire minimum garanti. Ce mouvement d'ensemble de la classe ouvrière doit préparer une grève générale nationale, qui ne soit pas une simple répétition des manifestations symboliques du passé, mais prenne l'aspect d'une épreuve de force. Pour cela, il faudra, si cela s'avère nécessaire, la prolonger jusqu'à ce que l'ennemi de classe ait été contraint à céder. Personne ne doit s'illusionner sur la difficulté d'une telle lutte. Mais il n'y a pas de choix possible : ou l'on arrache la victoire sur ce terrain, avec ces méthodes, ou il faut se résigner à payer le prix, le prix très élevé de la crise et donc à subir une défaite grave.
En ce qui concerne la bataille politique, dont les événements de Brescia ont montré l'urgence, les révolutionnaires devront refuser la solution de l'unité "démocratique et anti-fasciste" sans discriminant. Leur ligne doit se baser sur la nécessité du front unique, mais du front unique ouvrier, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'unité de la classe ouvrière et de toutes les couches de la population travailleuse.
Ceci ne concerne pas seulement le contenu d'un tel front unique, mais aussi la méthode. La politique d'unité anti-fasciste tend inévitablement à jouer sur les mécanismes constitutionnels (par exemple en demandant la mise hors-la-loi du MSI), et à faire pression sur les appareils d'État (police, magistrature, gouvernement) pour qu'ils défendent la "démocratie". La politique de front unique ouvrier implique la mobilisation de la classe ouvrière pour rejeter les attaques fascistes et pour défendre les droits et les libertés que le mouvement ouvrier a conquis par des dizaines d'années de lutte. Cela implique la nécessité de former des détachements ouvriers d'auto-défense, organisés dans les usines, dans les quartiers, ayant des liens au niveau national. Cela implique l'auto-défense des locaux, des piquets et des manifestations. Cela implique fondamentalement que la classe ouvrière ne se mette pas sous la tutelle des appareils de l'ennemi de classe qui n'ont pas voulu frapper les bandits noirs et qui ont laissé la voie libre aux dynamiteurs criminels, mais ne compte que sur ses propres forces et sur son organisation propre.
La tâche première des révolutionnaires est de se battre pour que des couches toujours plus importantes de la classe ouvrière comprennent la nécessité de cette orientation et deviennent les protagonistes directs des batailles anti-fascistes et anti-capitalistes qui sont à l'ordre du jour.
Cela signifie que l'on doit éviter toute confusion opportuniste sur la nature de classe de la lutte contre le fascisme. Cela signifie que toute position sectaire doit être bannie : les initiatives de l'avant-garde ne doivent pas être des fins en soi, mais elles doivent tendre constamment à mobiliser des couches plus larges de la classe ouvrière. Telle est le moyen concret de mener la lutte contre l'hégémonie de la bureaucratie.
Publié le 20 juin 1974