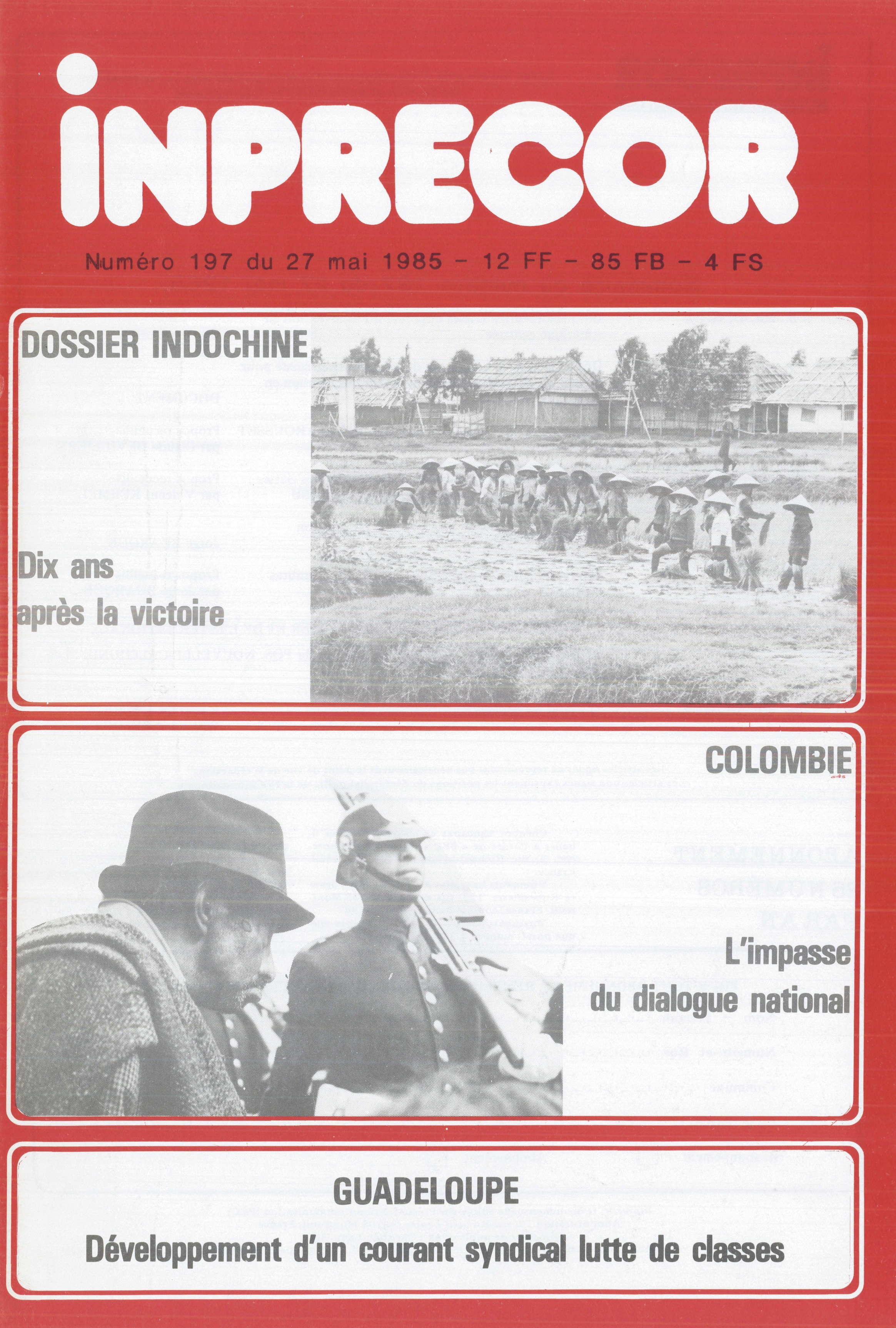Nous publions ci-dessous les deux dernières parties de l’interview que nous avons demandée à notre camarade Pierre Rousset, à l’occasion du 10e anniversaire de la victoire des révolutions indochinoises. Nous avons voulu à la fois tirer les leçons de cette victoire et analyser la situation des pays indochinois aujourd’hui. Rappelons que dans les deux premières parties de cette interview, publiées dans notre dernier numéro, nous avons discuté de la nature de la guerre impérialiste et de ses conséquences durables pour l’Indochine, ainsi que du drame cambodgien.
La troisième partie de l’interview traite de l’évolution de la situation dans toute la région de l’Asie du Sud-Est, partant de la défaite américaine en 1975 pour aboutir à l’impact de la crise sino-indochinoise, qui a éclaté en 1978-1979. La quatrième partie analyse la situation au Vietnam, le bilan des dix dernières années et les problèmes qui demeurent aujourd’hui.
« INPRECOR » : – Essayons maintenant d’analyser l’impact des victoires de 1975 sur l’évolution des rapports de forces au niveau régional. Nous espérions, voilà 10 ans, que la victoire des révolutions indochinoises ouvrirait, en Asie du Sud-Est et dans le monde, une période de montée rapide de nouvelles luttes révolutionnaires. Quant au gouvernement américain, il avait longuement développé la théorie dite des dominos. Si le Sud-Vietnam tombait, le Cambodge et le Laos devaient tomber à leur tour. Si l’Indochine tombait, toute la péninsule sud-est asiatique tomberait à court terme. Et ainsi de suite. La situation actuelle ne correspond pas à ces prévisions. Pourquoi ?
Pierre ROUSSET : – Il y a là deux questions différentes qu’il ne faut pas confondre. L’impact des révolutions indochinoises est une chose, la théorie des dominos, longtemps brandie comme un épouvantail anticommuniste par Washington, en est une autre. Nous n’avons jamais défendu cette théorie des dominos, car elle était viciée dès le départ. En effet, derrière cette théorie, il y avait l’idée que les révolutions sont avant tout le produit de la « subversion », de la « subversion extérieure » s’entend.
Bien qu’en admettant que les communistes vietnamiens se soient habilement servis des erreurs et des faiblesses du régime de Saïgon, Washington expliquait l’existence d’une lutte révolutionnaire au Vietnam par l’action subversive de Moscou et, à l’époque, de Pékin. Céder à la pression subversive au Vietnam, c’était favoriser l’action subversive partout. Encore aujourd’hui, les stratèges de la guerre froide utilisent des arguments semblables pour justifier le soutien à la contra au Nicaragua. D’après ces idéologues, la révolution sandiniste ne serait qu’une composante d’un plan de subversion visant à assurer la domination russo-cubaine sur toute l’Amérique centrale.
Cette thèse ne tient pas debout et les experts américains eux-mêmes le savent bien. Une véritable lutte révolutionnaire dans un pays se développe à partir d’une crise de société, d’un conflit de classe combiné ou non avec un conflit national, et dont les racines se trouvent à l’intérieur du pays. Si une société n’est pas profondément ébranlée par une telle crise, aucune « subversion internationale » ne permettra à une véritable lutte révolutionnaire de s’engager. C’est d’ailleurs pourquoi il est vain de vouloir artificiellement exporter la révolution.
Pourtant, les facteurs internationaux jouent un rôle.
Bien sûr. Mais pour que des facteurs internationaux pèsent dans le mûrissement d’une lutte révolutionnaire, il faut que la crise de société existe, que les forces sociales soient en mouvement, que les forces politiques nationales soient à même d’agir directement.
De plus, le principal facteur d’ordre international qui a opéré en Indochine n’est pas la « subversion communiste ». Toute l’histoire des révolutions indochinoises montre que l’aide soviétique et chinoise n’a pas précédé mais suivi, et souvent très tardivement, le développement des luttes dans ces pays mêmes. Le principal facteur international qui a favorisé l’extension de la révolution, du Vietnam au Laos, puis au Cambodge, a été l’intervention impérialiste elle-même. Il est vrai que le Cambodge a ressenti l’impact des luttes au Vietnam. Mais c’est l’obligation de prendre position dans la guerre du Vietnam, et les pressions américaines, qui ont constitué le facteur clef de déséquilibre pour le régime paternaliste de Sihanouk avant 1970. Et c’est le coup d’État de 1970, organisé par les Américains pour les besoins de leur action au Vietnam, et l’intervention militaire US qui l’a suivi, qui ont brutalement brisé les équilibres instables de la société cambodgienne et précipité le cours des luttes révolutionnaires (1). L’action impérialiste a lourdement et brutalement pesé sur la société cambodgienne. Il n’y a rien de comparable entre cela et la soi-disant action subversive des agents de Moscou ou de Pékin.
Dans la situation concrète qui existait dans la région et dans chaque pays en 1975, il était impensable que la « rangée de dominos » – la succession des pays, du Vietnam à Singapour, voire à l’Indonésie – tombe, entraînant un pays après l’autre.
Pourtant, la victoire des révolutions indochinoises a bel et bien eu un impact régional et international profond.
En effet, cette victoire a créé un « moment favorable » pour les luttes de libération nationale et sociale à l’échelle internationale. Le caractère exemplaire des combats révolutionnaires en Indochine montrait que la victoire était possible, même contre toute la puissance des États-Unis. Par ailleurs, la capacité d’intervention américaine directe était limitée par la crise politique aux États-Unis et dans les autres pays impérialistes. Le gouvernement américain ne pouvait plus se permettre un engagement militaire direct, et aucune autre puissance impérialiste n’était en position de le remplacer à l’échelle internationale.
Dans cette situation, les États-Unis ont dû démanteler le gros de leurs bases en Thaïlande, alors que ce pays était secoué par une profonde vague de luttes nationales et sociales. Washington n’a pas pu intervenir en force face au renversement spectaculaire d’un régime aussi important pour lui que celui du chah d’Iran. Il n’a pas pu remplacer le Portugal en Afrique australe quand les luttes anticoloniales en Angola et au Mozambique, après celle de Guinée-Bissau, l’ont emporté. Et il n’a pas pu engager les moyens nécessaires pour tenter de sauver le régime somoziste ou pour tuer dans l’œuf le régime sandiniste au Nicaragua.
Depuis la fin de la guerre d’Indochine, Washington cherche à répartir plus « égalitairement » la responsabilité du maintien de l’ordre impérialiste dans le monde. C’est notamment le sens des pressions exercées sur le Japon pour que Tokyo accroisse qualitativement ses forces militaires. Le gouvernement américain cherche aussi à rétablir sa propre capacité d’intervention directe, d’où l’importance qu’il accorde à la question de l’engagement auprès des contras au Nicaragua. Il a marqué des points politiques sur ce terrain, mais il est loin d’avoir encore gagné l’opinion publique à l’idée d’un nouvel engagement direct et majeur dans un conflit contre-révolutionnaire.
Comment comprendre, dans ce contexte, le retournement de la politique américaine vis-à-vis de la Chine, isolée hier sur le plan international et accueillie aujourd’hui à bras ouverts ?
Je crois que ce retournement exprime deux choses à la fois, dont l’une est positive et l’autre très négative.
L’échec de la politique indochinoise de Washington dans les années 1960 impliquait aussi un échec de sa politique chinoise. Car la guerre d’Indochine n’était que la pointe avancée d’une orientation générale visant à « endiguer » et « refouler », d’après les termes utilisés par les stratèges américains eux-mêmes, la vague révolutionnaire asiatique qui avait pris son essor après la Seconde Guerre mondiale. Remplaçant les impérialismes défaits, comme le Japon, ou affaiblis, comme l’Angleterre et la France, les États-Unis ont établi un cordon sanitaire autour de la Chine. Le prix en a été assez élevé, comprenant l’engagement dans la guerre de Corée, l’aide aux régimes de Séoul, de Tokyo et de Taïwan, le déploiement d’une force militaire considérable sous la forme de la 7e flotte, l’établissement de bases en Corée, au Japon, à Okinawa et aux Mariannes, en Thaïlande et aux Philippines.
Finalement, ils ont engagé l’épreuve de force directe au Vietnam. Cette politique visait aussi la Chine elle-même et, au-delà des aléas de la détente, c’était en dernière analyse le « bloc socialiste » et le mouvement de libération nationale tout entier qui étaient menacés.
Le gouvernement américain était d’autant plus décidé à porter un coup d’arrêt au processus révolutionnaire au Vietnam que la victoire de la révolution cubaine en 1959 manifestait l’actualité de la révolution socialiste sur le continent latino-américain même. La guerre du Vietnam – qui s’est étendue pour devenir la seconde guerre d’Indochine – faisait donc partie d’une politique contre-révolutionnaire d’ensemble à l’échelle mondiale, mise en œuvre par les États-Unis agissant bel et bien en chef de file du monde impérialiste. Durant les années 1950 et 1960, la contre-révolution a porté des coups redoutables, dont on paye encore aujourd’hui le prix, depuis l’écrasement du mouvement populaire et communiste en Indonésie et du soulèvement de Saint-Domingue en 1965-1966, jusqu’au coup d’État de Pinochet au Chili en 1973.
Il y a eu beaucoup de défaites pour quelques victoires. Et certaines de ces défaites nous ont coûté – nous, toutes les composantes du mouvement révolutionnaire mondial – très cher. C’est avant tout au Vietnam et à Cuba que cette contre-offensive impérialiste a été bloquée et s’est épuisée. Et c’est en Indochine que le bras de fer entre révolution et contre-révolution à l’échelle mondiale a été de très loin le plus violent, le plus éprouvant. L’Indochine était bel et bien, selon l’expression alors consacrée des Vietnamiens, la « pointe avancée » du combat international contre l’impérialisme.
Tu parles exactement de la même façon qu’il y a 10 ans…
C’est vrai, et je ne m’en excuse pas. Je sais que ce vocabulaire n’est plus de mode dans des secteurs désabusés du mouvement de solidarité d’hier. Mais ce que je dis n’en reste pas moins vrai. Le Vietnam n’était pas une guerre locale, mais le principal lieu de cristallisation d’une très violente contre-offensive impérialiste. Si Washington l’avait emporté là, comme il l’a emporté en d’autres lieux, il aurait été libre de poursuivre sa politique de « refoulement ». Les peuples d’Indochine ont effectivement combattu pour nous tous et nous ne devons pas l’oublier. Oui, la barbarie guerrière, c’était Washington, n’en déplaise à ceux qui chantent aujourd’hui les bienfaits du libéralisme américain.
Enlisé et défait en Indochine, Washington a dû passer des compromis ailleurs, et d’abord vis-à-vis de la Chine. Pendant 20 ans, le gouvernement américain a refusé de reconnaître sur le plan international l’existence de la Chine. En attendant le retour à l’ordre impérialiste des choses, la seule Chine représentée à l’ONU, par exemple, était Taïwan, territoire où s’était réfugié ce qui restait des armées du Kuomintang. En 1970, Washington espérait encore gagner la guerre en Indochine, mais il savait qu’il lui fallait déjà reculer en ce qui concernait la Chine. C’était une très bonne chose. Le drame, c’est que faisant de nécessité vertu, le gouvernement américain réussira à retourner largement en sa faveur l’abandon de la politique antérieure.
C’est là le deuxième aspect essentiel de l’évolution de la politique chinoise de Washington. Les États-Unis vont dorénavant utiliser une politique de « coexistence pacifique » et de réintégration de la Chine dans les organismes internationaux, afin d’isoler les mouvements révolutionnaires en Asie, comme ils avaient déjà utilisé une politique de coexistence pacifique avec l’URSS pour isoler dans le passé la Chine.
Et la bureaucratie chinoise, profondément ébranlée par la crise ouverte à l’occasion de la Révolution culturelle de 1966-1969, confrontée à des problèmes économiques majeurs, inquiète de la dynamique autonome des révolutions indochinoises, va accepter de jouer ce jeu. C’est cela qui se négociait au moment des contacts secrets qui débouchèrent sur le voyage de Kissinger en Chine, en 1971, et sur le voyage de Nixon à Pékin en 1972, juste avant celui qu’il fit à Moscou la même année.
Les effets du « rapprochement » sino-américain se sont faits immédiatement sentir en Indochine. Les négociations se sont déroulées dans le dos des Vietnamiens, qui étaient pourtant concernés au premier chef. La guerre devenait en effet de plus en plus dure au Vietnam et dans toute l’Indochine. Or, le gouvernement américain put se prévaloir des négociations en cours avec la Chine pour se présenter, face à son opinion publique, comme recherchant sérieusement la paix. Cela a affaibli la mobilisation antiguerre aux États-Unis même. C’était particulièrement clair en 1972, quand les voyages de Nixon à Pékin et à Moscou ne furent pas annulés par la Chine et l’URSS, alors que la flotte aérienne américaine bombardait à une échelle sans précédent Hanoï et le port stratégique de Haïphong.
La désorientation du mouvement antiguerre aux États-Unis a eu des effets négatifs sur la lutte en Indochine même. Par ailleurs, les pressions se multipliaient sur les Vietnamiens pour qu’ils ne se montrent pas trop « ambitieux ». La riposte vietnamienne fut double. Sur le plan politique, ils rendirent publics leurs désaccords, en dénonçant, dans des éditoriaux enflammés, les « opportunistes » qui, dans le mouvement communiste mondial, se laissaient tenter par la politique nixonienne qui consistait à isoler la pointe avancée de la lutte, à savoir l’Indochine, en passant un compromis avec la Chine. En même temps, sur le terrain, ils déclenchèrent une très importante offensive militaire, de façon à se mettre en position de négocier. Les Vietnamiens avaient en effet compris que le temps ne jouait plus comme avant en leur faveur, du fait de la fatigue de la guerre au Vietnam et de l’évolution de la politique chinoise. Il leur fallait conclure rapidement des accords qui assureraient le désengagement des forces américaines, quitte à accepter le maintien temporaire des forces saïgonnaises. C’était le sens des Accords de Paris de 1973, qui ont ouvert la dernière phase de la lutte de libération.
Quelle a été la portée durable de ce conflit politique entre Chinois et Vietnamiens ?
Elle a été très importante. Le tournant de la diplomatie chinoise n’était pas conjoncturel. Pour la première fois, cette bureaucratie, après la formidable décantation sociale et politique provoquée par la crise des années 1966-1969, s’installait durablement dans la défense du statu quo régional et international, à l’instar de ce que faisait la bureaucratie soviétique depuis des décennies. Le rapport des forces régional fut bouleversé par l’évolution conjointe de la politique chinoise des États-Unis et de la politique internationale de Pékin.
Je crois donc qu’il faut dater de 1971 la rupture politique radicale entre le PC vietnamien et le PC chinois. Avant, il y avait de nombreux désaccords, mais sur un fonds idéologique souvent proche. À partir de ce moment, les stratégies internationales et régionales vont s’opposer de plus en plus frontalement. L’URSS était devenue l’ennemi principal pour Pékin, alors que le lien avec Moscou restait au cœur de la politique d’alliances de Hanoï. Pour les Vietnamiens, la diplomatie chinoise mettait en danger leur combat de libération. Pour Pékin, la révolution vietnamienne représentait un facteur incontrôlable, qui mettait en cause sa politique d’intégration au statu quo régional et mondial. Je crois que les États-Unis espéraient encore, en 1972, grâce justement à l’évolution de la diplomatie chinoise, obtenir le gel des rapports de forces en Indochine, en conservant le contrôle de la « ligne du Mékong », au moins au Cambodge.
De plus, le schisme sino-vietnamien allait avoir de profondes répercussions dans le mouvement révolutionnaire régional. La grande majorité des organisations révolutionnaires de la région étaient en effet maoïstes et souvent très liées à Pékin. Or, dans les années 1970, ce n’était plus de Chine mais du Vietnam que venait l’impulsion révolutionnaire. Les tensions politiques sino-vietnamiennes allaient diviser le mouvement régional, et quand les conflits militaires de 1979 éclatèrent, les alliances se brisèrent brutalement, des partis communistes soutenus par Hanoï, comme le PC thaïlandais, prenant fait et cause pour les Khmers rouges (2). À l’heure où l’unité devait permettre de profiter du « moment favorable » ouvert par la victoire en Indochine, c’est la division qui l’emporta.
Comment expliquer que les mouvements révolutionnaires de la région soient presque tous maoïstes, et que l’influence politique propre du Vietnam soit si faible ?
D’abord, il faut préciser que si tel était le cas dans les années 1970, depuis lors, la crise du maoïsme s’est approfondie et s’est manifestée, y compris en Asie du Sud-Est. Mais c’est vrai que la prépondérance absolue du maoïsme dans la région, jusqu’à tout récemment, peut sembler surprenante. On trouve pourtant aisément des éléments d’explication.
Parmi ces éléments, il faut d’abord constater l’antériorité de la victoire de la révolution chinoise, en 1949, qui représentait une voie alternative face aux échecs graves subis, après 1945, par de nombreux partis liés à Moscou, par exemple aux Philippines. Le Vietnam ne semblait alors que reprendre la voie chinoise, mais, en fait, la stratégie vietnamienne prolongeait et dépassait sur bien des questions essentielles celle du PC chinois. Elle exprimait une expérience objectivement plus avancée et plus dialectique, ne serait-ce que parce qu’elle était confrontée à une agression impérialiste plus longue et d’une plus grande ampleur. Mais les cadres révolutionnaires de la région ne s’en sont rendus compte que très tardivement.
Il faut aussi tenir compte du fait que le mouvement communiste s’était souvent implanté dans la région, dès les années 1930, au sein des communautés chinoises. À l’origine, le mouvement communiste en Thaïlande et en Malaisie-Singapour était d’ailleurs organiquement lié au PCC, dont il constituait la branche « outre-mer ».
Avec la rupture sino-soviétique de 1960, le PCC offrait une ligne globalement et explicitement alternative à celle de Moscou. Les Vietnamiens s’en gardaient bien, pour des raisons de conviction et d’opportunité, de faire pareil. Pékin répondait ainsi plus frontalement aux préoccupations des nouvelles générations militantes. C’est particulièrement évident dans le cas des Philippines, où le « nouveau parti » se constitua en 1968, avec comme référence le maoïsme de la révolution culturelle (3). Donc, les premières générations communistes d’Asie du Sud-Est étaient souvent composées de Chinois, liées par bien des aspects à Pékin, alors que les nouvelles voyaient dans la Chine la patrie de la « révolution continue » et une réponse globale au « révisionnisme moderne » des Soviétiques.
Mais est-ce que la faiblesse de l’influence propre des Vietnamiens ne reflète pas tout simplement leur manque de perspectives internationalistes ?
Je ne crois pas que ce soit là une bonne explication. Le PC vietnamien a en effet une vision régionale, voire internationale, et surtout un projet régional. C’est particulièrement net en ce qui concerne la période 1975-1979.
Le PC vietnamien avait analysé la portée mondiale de la défaite de l’impérialisme en Indochine. Il savait qu’un « moment favorable » s’ouvrait. Il misait sur le renforcement global du « camp socialiste » dont il espérait peut-être encore la réunification. Il appelait de ses vœux une extension des luttes révolutionnaires dans la région, sachant d’ailleurs que c’était dans son intérêt. Il proposa à la direction nationale du PC de Thaïlande, puis à la direction régionale de ce parti pour le nord-est thaïlandais, un appui massif pour donner une impulsion nouvelle aux luttes révolutionnaires dans le royaume, qui connaissaient un développement rapide depuis le renversement de la dictature militaire en 1973 et le coup d’État sanglant de 1976. Mais le PC de Thaïlande s’était rangé du côté sino-khmer rouge en 1979, entraînant une rupture brutale avec Hanoï.
Il est possible que le PC vietnamien ait été longtemps très prudent dans ses contacts politiques avec les PC maoïstes de la région, parce qu’il ne voulait pas ouvrir à ce sujet un conflit avec Pékin, dont l’aide lui était indispensable. Des règles strictes ont été mises en avant par les partis concernés. Par exemple, le PC de Thaïlande envoyait des cadres se former à Hanoï, dans les domaines militaire et médical, mais ils ne devaient pas discuter de politique avec les Vietnamiens. Pour l’éducation politique, les cadres étaient envoyés en Chine et formés par des Chinois, qui étaient d’ailleurs souvent formellement membres du PCT. Mais il est clair qu’en 1975 le PC vietnamien considérait l’Asie du Sud-Est comme une zone où il devait consolider des liens directs, aux dépens de l’influence de la Chine, ce qui, évidemment, ne plaisait pas du tout à Pékin.
Et aujourd’hui ?
Aujourd’hui, la dynamique enclenchée par la victoire a été brisée, sauf aux Philippines (4). C’est particulièrement le cas en Thaïlande, où le PCT est entré en crise profonde, où le mouvement de guérilla s’est largement désintégré, où l’extrême gauche révolutionnaire est divisée, très affaiblie et sur la défensive (5).
Les Vietnamiens, eux aussi, sont aujourd’hui sur la défensive. Ils ne croient plus à une extension rapide des luttes révolutionnaires dans les pays frontaliers. Ils sont plus dépendants de l’appui soviétique. Ils cherchent à diviser le front diplomatique présenté, sur la question du Cambodge, par les pays membres de l’ASEAN (6). La méfiance réciproque qui sépare maintenant le PC vietnamien des autres formations révolutionnaires de la région sera difficile à surmonter.
Pourtant, des contacts sont maintenus ou se renouent. Un noyau de militants thaïs est resté lié au Laos, où le PCT a eu, jusqu’en 1979, d’importants camps d’entraînement, et on parle d’un nouveau parti qu’ils auraient constitué, mais dont il est bien difficile de mesurer l’importance réelle. Par ailleurs, le PCT lui-même, en tout cas les derniers éléments « jeunes » de la génération des années 1970 qui sont restés dans ce parti malgré la crise et qui se trouvent maintenant au comité central, ont proposé de reprendre contact. Un diplomate vietnamien en poste à Bangkok a d’ailleurs été expulsé de Thaïlande, l’année dernière, pour avoir accepté de rencontrer l’un d’entre eux.
Enfin, il faut signaler que les Vietnamiens ont apporté un appui discret, sous la forme de formation militaire, politique, technique ou médicale, à de nombreux mouvements en Afrique et en Amérique latine. Mais il est difficile de savoir l’importance de ce type d’aide aujourd’hui.
Pour conclure cette partie de notre interview, deux questions. Tout d’abord, quelle est ton appréciation globale de la situation régionale aujourd’hui ?
Je crois que dans l’ensemble, la situation régionale reflète l’héritage contradictoire de la victoire de 1975 et de la crise de 1979. Durant les années 1970, les luttes populaires et de guérilla se sont spécialement développées dans deux pays, la Thaïlande et les Philippines. La dynamique révolutionnaire a été brisée en Thaïlande, alors qu’elle est plus vivante que jamais aux Philippines. Cela exprime l’impact contradictoire des développements régionaux, mais aussi, bien sûr, l’importance des facteurs politiques nationaux, où la rigidité bureaucratique de la direction du PCT contraste avec la souplesse tactique du PC philippin. Il faut aussi prendre en compte des facteurs économiques, et notamment le fait que les Philippines traversent sur ce plan une crise sans précédent.
Par ailleurs, la crise cambodgienne a donné vie à l’ASEAN, qui auparavant n’existait en fait que sur le papier. Les projets économiques de l’ASEAN ne sont toujours pas très substantiels, mais cette coalition de six pays joue maintenant un rôle international notable. Des divisions internes se manifestent évidemment au sein de l’ASEAN, y compris en ce qui concerne le Cambodge, le Vietnam et la Chine. Mais il existe maintenant un bloc de régimes pro-impérialistes qui fait face au bloc indochinois et qui bénéficie d’un système d’alliances efficace qui englobe aussi bien les États-Unis que la Chine. De plus, plusieurs des pays membres ont connu un développement économique effectif.
Peux-tu préciser, enfin, quels sont à ton avis les principaux enseignements qui peuvent être tirés de ce dont nous venons de discuter ?
Je voudrais insister sur quatre questions.
Premièrement, il est de plus en plus évident que chaque organisation révolutionnaire nationale doit savoir gagner une indépendance réelle de décision et d’action vis-à-vis des gouvernements « frères » susceptibles de la soutenir. Le PC chinois lui-même avait dû lutter contre la volonté de la direction stalinienne de l’URSS de se le soumettre : c’est le sens profond de la lutte de fractions au sein du PCC, qui a longtemps opposé Mao à Wang Ming, ce dernier exprimant les positions de Moscou. Le PC vietnamien a, lui aussi, dû gagner son indépendance de décision, sur le plan national d’abord, notamment après l’expérience difficile du front démocratique en 1937-1939, et encore en 1945-1946, quand Moscou refusait de reconnaître la nouvelle République démocratique du Vietnam, indépendante. Ensuite, il a dû gagner son indépendance sur le plan international aussi.
Lors des accords de Yalta de 1945, Staline accorda aux Occidentaux les « zones d’influence » chinoise et vietnamienne, sans même consulter les intéressés. En 1954, les Vietnamiens siégeaient eux-mêmes à la table de conférence, à Genève. Mais ce sont encore Molotov avant tout, pour l’URSS, et Zhou Enlai ensuite, pour la Chine, qui imposèrent aux Indochinois des compromis très graves. En 1968, après l’offensive du Têt, le PCV se sentait assez fort pour exiger que les négociations de Paris se déroulent entre les parties directement concernées, c’est-à-dire les Vietnamiens et les Américains, sans la participation des puissances extérieures, qu’elles soient membres du bloc occidental ou du « camp socialiste ». C’est alors qu’ils se sont trouvés en position de négocier les accords de 1973, compromis délicat mais qui leur était fondamentalement favorable.
Plus récemment, des partis comme le PC thaïlandais ont payé cher leur subordination à la diplomatie chinoise. La leçon vaut évidemment pour tous. Il est normal et inévitable que des partis révolutionnaires en Asie du Sud-Est cherchent un jour ou l’autre à obtenir l’aide du Vietnam. Dans toute lutte révolutionnaire prolongée, l’aide de pays comme le Vietnam, Cuba, l’URSS ou la Chine est un des facteurs qui rendent possible la victoire. Mais il ne faut pas que ces partis se trouvent pour autant dépendants matériellement et politiquement de Hanoï, comme certains d’entre eux l’ont été hier de Moscou ou de Pékin. Le régime vietnamien accordera peut-être des aides, bien que la conjoncture actuelle ne soit pas favorable sur ce plan, mais il développera aussi une diplomatie d’État qui peut entrer en conflit effectif avec les intérêts d’une lutte révolutionnaire nationale. Il serait dangereux de l’oublier.
Deuxièmement, il faut comprendre la dynamique profondément contre-révolutionnaire du conflit inter-bureaucratique qui oppose l’URSS et la Chine. La responsabilité historique de ce conflit incombe, j’en suis convaincu, à la bureaucratie stalinienne de Moscou. Mais depuis, la bureaucratie chinoise est entrée elle aussi dans le jeu de la coexistence pacifique et elle a fait au Vietnam ce que Moscou avait fait à la Chine en 1960, en le sacrifiant sur l’autel de ses manœuvres avec l’impérialisme.
Encore une fois, s’il faut tenter de gagner l’aide de pays comme l’URSS ou la Chine, il faut se garder d’entrer dans la logique du conflit sino-soviétique. C’est ce conflit lui-même qu’il faut combattre. Ses conséquences ont été et continuent d’être trop graves en Asie du Sud-Est. Il ne faut pas remplacer un alignement avec Pékin contre Moscou, donc avec les Khmers rouges contre le Vietnam, par un autre alignement, avec l’URSS contre Pékin, donc pour l’intervention soviétique en Afghanistan. Il faut définir une position indépendante pour le mouvement révolutionnaire.
Troisièmement, il faut mener la bataille pour un nouvel internationalisme. La crise du « camp socialiste », la crise sino-indochinoise et bien d’autres déchirements et reniements ont profondément ébranlé les convictions internationalistes de beaucoup de militants. Pourtant, toute l’histoire des guerres et des révolutions indochinoises montre que l’internationalisme concret est un facteur indispensable de la victoire. Ce n’est pas combattre pour une utopie que de lutter pour l’internationalisme, c’est combattre pour quelque chose d’essentiel, pour un élément clef de toute lutte révolutionnaire. Les organisations révolutionnaires ont une très grande responsabilité en ce domaine. La seule manière de réhabiliter l’internationalisme, c’est de montrer dans la pratique ce qu’est une politique véritablement internationaliste, c’est-à-dire qui correspond vraiment aux intérêts objectifs de la lutte des peuples et non aux intérêts particuliers de telle ou telle organisation, de tel ou tel courant, de tel ou tel État.
Le dernier point, c’est qu’il y a des tâches de solidarité immédiates qui doivent être assumées. C’est vrai pour l’Amérique centrale, mais aussi pour l’Asie du Sud-Est, où il faut organiser par exemple la solidarité à l’égard des luttes engagées actuellement aux Philippines, et aussi envers les forces révolutionnaires thaïlandaises qui tentent de tirer les leçons de la crise et du recul subi, et d’établir de nouveaux rapports unitaires. Là encore, c’est en poursuivant des tâches concrètes de solidarité que l’on contribuera à réveiller les espoirs internationalistes.
Propos recueillis par Claude DEVILLIERS le 7 mai 1985.