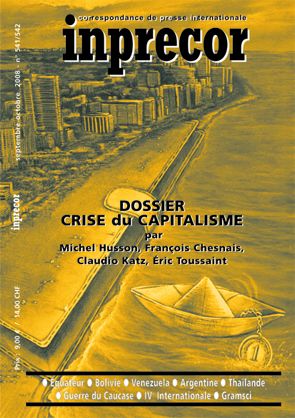Avant le début du conflit entre la Russie et la Géorgie, la Confédération des syndicats de Géorgie avait prévu d’organiser le 4 octobre des actions de protestation d’ampleur nationale. J’ai écrit cet article pour annoncer l’événement. Maintenant cet article a une autre résonance, il me semble pourtant avoir encore plus d’actualité. Au cours du mois d’août les cercles de la gauche en Russie ont fait mine de rivaliser d’adresse pour se « positionner » sur la question géorgienne. Malheureusement, nombreux furent ceux qui se sont intéressés moins à une alternative sociale dans la région et plus à la recherche de fondements théoriques justifiant leurs « solutions ». Beaucoup ont cru répondre à la question géorgienne en faisant appel à des formules abstraites, en proposant par exemple une « confédération socialiste des peuples de la Transcaucasie ». Les véritables antagonismes de classes sont ainsi relégués à la marge, ils n’intéressent personne : à quoi bon se fatiguer à se pencher sur les questions sociales des Géorgiens lorsqu’on peut discourir sur la nouvelle donne à l’œuvre dans l’ordre mondial ? Le but de cet article est de fournir quelques éléments sur la question sociale dans la région en vue de pouvoir y envisager une alternative.
Le coup porté aux syndicats
En mai 2006, le parlement géorgien a adopté un nouveau code du travail, après avoir ignoré de nombreuses protestations de la part des organisations syndicales, des organisations non gouvernementales et internationales, parmi lesquelles la Confédération internationale du travail et l’Organisation internationale du travail. Ce document constitue un objet de fierté pour le gouvernement de Saakashvili, car, à en croire le point de vue officiel, ce serait une mesure « favorisant le développement du business » adaptée aux normes juridiques du travail en vigueur dans le monde. En fait, la Géorgie est aujourd’hui le seul pays en Europe (et il s’en faut de peu pour qu’il ne soit pas le seul au monde) qui se dote d’un code du travail ne mentionnant pas une seule fois le mot « syndicat ». D’ailleurs, il ne s’agit pas du seul « mérite » de cette législation. Il faut reconnaître que les auteurs du code du travail semblent cultiver l’humour noir. Un nouvel article remplace l’article 37 du code du travail. L’ancien était inspiré « du modèle soviétique » : il rendait impossible le licenciement d’un travailleur sans l’accord du syndicat. L’article qui le remplace permet dorénavant à l’employeur d’annuler ( sic !) le contrat de travail qui le lie à son salarié en l’espace d’un seul jour et sans devoir fournir de motifs. Il doit seulement dédommager le salarié à hauteur d’un mois de salaire. En appliquant la nouvelle norme, en juillet 2008, la Banque centrale de Géorgie a licencié 150 employés : le samedi soir, elle leur a fait savoir par téléphone qu’ils n’avaient pas à « s’inquiéter » pour venir travailler le lundi, parce que le bâtiment, dans lequel ils travaillaient, avait été vendu et qu’en outre, la direction avait jugé superflu de se préoccuper de trouver des nouveaux locaux pour ses employés. Une maladie ou une grossesse peuvent également motiver un licenciement. Et le contrat de travail est automatiquement annulé lorsque le travailleur est appelé à effectuer son service militaire. Il est évident que ce droit absolu de jeter à la rue un travailleur n’est que la réplique du système d’embauche à l’américaine « à la demande » (« at will »). Ce droit permet en effet à chacune des parties la liberté de rompre le contrat « pour des motifs suffisants, partiellement suffisants, ou sans aucun motif ». Mais dans la législation américaine une série de lois viennent compléter cette formulation. Elles protègent les travailleurs de l’injustice du licenciement et leur donnent le droit, sinon de réintégrer leur poste, de recevoir une compensation. Droit qui n’était pas du goût de la législation géorgienne. « Nous avons eu des cas de licenciement de femmes qui avaient protesté contre le harcèlement sexuel dont elles étaient victimes sur leur lieu de travail… Et bien sûr, les licenciements de militants syndicaux sont monnaie courante », raconte Iraklij Petriashvili, président de la Confédération des syndicats de Géorgie (KPG). « Le code du travail entre en contradiction avec les lois sur les libertés syndicales qui interdisent le licenciement des leaders élus par les syndicats sans l’accord de ces derniers — dit Gocha Aleksandriya, vice-président de la KPG — mais les juges se fondent en réalité sur les règlements du code travail. Les membres du syndicat ne sont pas protégés, dans une situation pareille, nous ne pouvons rien faire pour eux. Aussi, naturellement les gens s’en vont. » Le nouveau code du travail se prête à une large marge d’interprétations quant aux conditions de licenciement prévues par la loi en cause. De plus, l’absence de protection contre les pressions et des discriminations s’ajoute à ce flou juridique. Cela a coûté la perte de 20 000 membres aux syndicats. « Pour la seule usine métallurgique de Zestafoni, on a perdu par exemple 5 000 personnes. Là-bas, le conflit — provoqué par la tentative par l’administration de créer un syndicat jaune — a duré quelques années. Une partie des travailleurs sont entrés dans le nouveau syndicat mais plus de la moitié est restée avec nous. Cependant, après l’adoption de la nouvelle législation, l’employeur a déclaré que maintenant il pouvait licencier facilement tous les membres de la KPG… Notre section syndicale n’a pas fait long feu : après sept mois, il n’en restait plus rien. Les gens ont eu peur de perdre leur travail », raconte Petriashvili. Dans le port de Poti, en 2006 le syndicat des dockers rassemblait 12 000 des 13 000 travailleurs. Aujourd’hui, après le licenciement des militants, après les procès perdus par le syndicat et cinq jours de grève de la faim menée par les leaders de l’organisation, il ne reste plus que 20 personnes à la KPG.
Cadences infernales et économie souterraine
Cependant, dans les rares endroits où les syndicats conservent une certaine activité et disposent encore de militants, ils sont privés de tous les droits, et donc il leur est difficile de protéger les droits des salariés. L’employeur n’est pas obligé de mener des négociations avec le syndicat ni de tenir ses engagements suite aux accords conclus avec lui. La seule présence de deux salariés de l’entreprise suffisent pour la signature d’une convention collective. En même temps le nouveau code du travail donne le feu vert à des arrangements verbaux. L’employeur peut ne pas stipuler les conditions de travail. Ainsi, en Géorgie, l’industrie agroalimentaire et l’industrie légère ont imposé un régime de cadences infernales. « Dans notre fabrique, l’administration enferme ses salariés jusqu’à ce que la chaîne de travail ait achevé sa tâche conformément aux normes de rendement. Les toilettes sont ouvertes deux fois par jour seulement pendant les pauses de cinq minutes, vous vous imaginez les longues files d’attente ? Et si tu n’as pas le temps, tu n’as qu’à patienter jusqu’à la prochaine pause », dit une ouvrière de la fabrique de Georgia-Karsa qui appartient à une compagnie turque. « Et nous travaillons en général sur deux équipes à la suite. La semaine dernière, je suis rentrée à 18 heures une fois. Mais d’habitude, je rentre à 21 heures, ou à 22 heures. Nous n’avons pas le temps de préparer le dîner pour les enfants. Bien sûr, les heures supplémentaires sont payées 50 % de plus, mais je ne veux plus de cet argent, je veux une vie normale ! ». « Je travaille de 9 heures du matin à 22 heures du soir », raconte une des employées de l’usine Betumex à Batumi, qui produit des vêtements de la marque Marx & Spencer. « Toute la journée debout, avec dans les bras un fer à repasser de trois kilos. Pour un salaire de 260 lari (120 euro) Est-ce que cela vaut la peine de se ruiner la santé ? L’été dans les locaux de repassage, la chaleur est insupportable. L’usine a reçu récemment des nouvelles commandes : Marx & Spencer a arrêté sa production en Turquie et maintenant les ouvrières géorgiennes doivent assurer un rendement doublement supérieur. Bien sûr, il est plus avantageux de nous forcer à faire des heures supplémentaire, qui atteignent plus de 20 heures par jour, que de mettre en place une nouvelle équipe pour la relève. En effet, rien ne garantit qu’à l’avenir, l’usine recevra autant de commandes. Si les gens ne respectent pas la norme du rendement, l’administration les menace de ne pas payer les heures supplémentaires. Le plus dur arrive, quand on a des nouveaux modèles et qu’il faut apprendre d’urgence une nouvelle technologie », raconte l’adjoint du représentant du comité syndical de Batumex, Manoni Djaparidzé. « Le syndicat, qui organise presque tous les 1 040 travailleurs de la fabrique, a conclu un accord avec l’administration qui prévoit l’octroi de 4 jours de congé par mois au minimum, cependant cet accord est constamment violé. Récemment, on a réussi à obtenir la permission pour les ouvrières affectées aux postes de repassage et de contrôle de qualité de travailler en position assise… » Pour chaque robe confectionnée, Marx & Spencer paye un lari (0,43 euro) à ses fournisseurs géorgiens. L’entreprise multinationale vend cette robe au prix de 40 euros. Les contrôleurs de la compagnie n’ont jamais inspecté les conditions de travail du centre de production de Batumi. « Si ici, on pouvait trouver un autre travail, j’aurais quitté la fabrique depuis longtemps — dit une autre ouvrière Batumex. — Mais à Batumi, il n’y nulle part où aller travailler. Nous nous sommes, bien sûr, battues pour nos droits, pour que la situation s’améliore, mais nous avons besoin des commandes de Marx & Spencer. Si la fabrique ferme, qu’allons-nous faire ? » Selon les données officielles, 50 000 chômeurs sont recensés. Cependant, les syndicats sont convaincus qu’il y en dix fois plus. Près de 60 % de la population active serait impliquée dans l’économie souterraine. Au sein de la KPG a été créé un nouveau syndicat en 2007, pour ceux qui sont « auto-employés », c’est à dire qui n’obtiennent pas un contrat de travail mais sont des prestataires extérieurs, travaillant à leur propre compte, comme le font aussi les vendeurs des marchés. Il regroupe déjà trois mille personnes. Le leader de ce nouveau syndicat, Zaza Agladzé, dit à ce propos : « Après l’éclatement de l’U.R.S.S., et en particulier après la guerre qui a suivi, beaucoup de grandes entreprises ont fermé. Des milliers de personnes se sont trouvées à la rue et, pour s’en sortir, se sont mis à créer des entreprises individuelles ou des petits commerces. Car le gouvernement n’a rien fait pour venir en aide aux chômeurs. En 2007, on pouvait dénombrer environs 1,4 million de ces “auto-employés”, dont 100 000 qui travaillent pour le secteur public. Les impôts qu’ils payent constituent 25 % des ressources de l’État, mais ces gens ne reçoivent rien en échange. Nous nous battons par exemple pour que les années de travail de ces « auto-employés » comptent pour leur retraite. Nous voulons obtenir une diminution des taxes qu’ils payent, des amendes qui leur sont infligées et des tracasseries administratives. Un autre problème majeur : nous voulons que les gens n’aient plus à payer leur place dans les marchés, si, par exemple, ils sont absents ».
Les syndicats et la politique
La constante dégradation de la situation des travailleurs et le durcissement du code du travail ont contraint les syndicats géorgiens à sortir de leur stupeur. Après une lutte difficile pour la direction, une nouvelle génération de dirigeants s’est affirmée. Elle a une véritable expérience du travail et des luttes et elle veut faire renaître la tradition de la démocratie syndicale et des luttes actives et sans compromis dans les entreprises. En 2007, les rassemblements syndicaux contre le nouveau code du travail ont rassemblé jusqu’à 50 000 personnes. Néanmoins, la KPG n’a pas osé se joindre aux affrontements contre le gouvernement de Saakashvili en automne dernier et, durant un moment, la lutte contre le code du travail s’est moins fait entendre. « Nous ne voulons pas entrer dans la politique » explique Iraklij Petriashvili, ancien leader du syndicat Telasi de la compagnie d’électricité de Tbilissi, qui en son temps avait obtenu la satisfaction des revendications ouvrières en recourant à la grève de la faim. Il estime que le nouvel esclavage au travail est l’une des sources de mécontentement à l’égard du régime. Il est possible qu’à l’automne dernier, les syndicats aient commis une erreur. Il y a un an, à la demande de l’Organisation internationale du travail (OIT), la Commission européenne a demandé à la Géorgie de réviser son code du travail (qui viole les normes fondamentales du travail — le droit d’association et de négociation collective) en menaçant de l’exclure du système des préférences commerciales. Pour la première fois la Commission européenne a appliqué de telles sanctions, pour le même motif, contre la Biélorussie. Mais la Géorgie, dont les échanges avec l’Union européenne sont beaucoup plus importants que pour la Biélorussie, aura plus de mal à ignorer les recommandations de Bruxelles. On verra bientôt si l’ultimatum, que l’Union Européenne a fixé pour 2009, sera ou non appliqué. La nouvelle guerre ne peut que nuire aux travailleurs. Et tout porte à croire que la pression sur les syndicats ira en s’accentuant. Aujourd’hui, les syndicats sont non seulement les seules organisations de classe du pays mais ils constituent en réalité (bien qu’ils craignent d’assumer un tel rôle) l’opposition au régime néolibéral. Établir des contacts avec les syndicats géorgiens — seule voie réelle aujourd’hui pour entrer en contact avec la classe ouvrière géorgienne — constitue pour la gauche de Russie un défi non moins important que celui d’échafauder sans cesse la « position » correcte.
Macha Kurzina, syndicaliste de Moscou, est militante du Mouvement socialiste « Vpieriod » (« En avant »), qu'elle avait dirigé avant de céder la place « aux nouveaux » lors du Congrès de février 2008. Nous reproduisons cet article du site web du mouvement. (Traduit du russe par Arthur Clech).