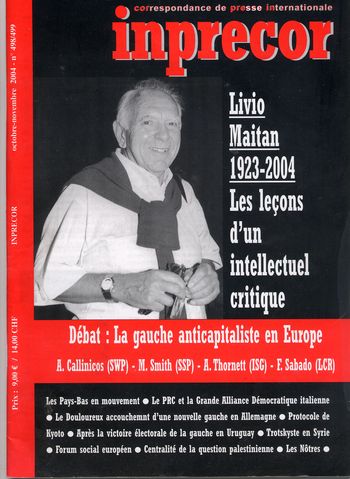Il est facile de dire, après ce qui est arrivé, qu'il y a un temps pour les mouvements et un autre pour la politique. En Italie, nous sommes en plein dans le moment de la politique, après celui des mouvements, au cours de la première phase du gouvernement de centre-droite de Silvio Berlusconi.
Le temps des mouvements
Il a fallu le mouvement des mouvements et, en Italie, la défaite du centre-gauche à la tête du pays durant cinq ans, pour qu'on recommence à comprendre que le marché, le libéralisme effréné, le système capitaliste, la mondialisation, l'entreprise n'étaient pas des tabous, des données définitives d'une société enfin " normale ". Cette vague fut assez puissante et convaincante pour que le président de la Commission européenne, Romano Prodi, ancien président du conseil italien, dise que c'était " la fin de la pensée unique ". Selon celle-ci, il fallait — au nom du réalisme, de la maturité, du bon sens, de la fin des illusions — accepter le monde tel qu'il était. Il fallait encore se conformer à l'idéologie dominante qui qualifiait toute prétention de pensée et de proposition critique d'attitude idéologique. Le climat d'euphorie néolibérale et d'enthousiasme boursier avait disparu en même temps que la certitude d'une " croissance à long terme ", de la soi-disant supériorité totale et globale de l'entreprise et du marché sur la politique, c'est-à-dire sur les tentatives d'interprétation critique du monde. Ce " n'était pas le meilleur des mondes possible " et, concluait-il avec emphase, " les politiques gouvernementales des pays européens au cours de la dernière décennie ", assumées surtout par les forces de centre-gauche, étaient fondées sur des " sottises " du genre " l'entreprise a toujours raison " (1)
Même l'ancien secrétaire de la CGIL, Sergio Cofferati, dans une interview à La Stampa deux jours plus tard (2), n'hésitait pas à rompre avec les atermoiements et les attitudes tactiques — typiques de la lune de miel avec le gouvernement ami de centre-gauche — en affirmant que les manifestations du " mouvement des mouvements " (autre nom du mouvement altermondialiste) marquaient la " fin de la foi en ce modèle économique comme modèle de développement ".
Le développement du " mouvement des mouvements " révélait " un vide préoccupant sur le plan politique, un grave déficit démocratique " ; il était " l'autre face de la médaille de la désaffectation politique, depuis longtemps tellement répandue et croissante dans les pays occidentaux ". Cette désaffection serait due à l'incapacité de maîtriser les processus globaux et locaux et à l'impossibilité, pour la démocratie représentative, de contrôler le mouvement du capital par le biais des accords internationaux hors de toute logique — même strictement formelle — de participation et de consentement. Par conséquent " l'action des mouvements sociaux comblait le vide qui existait depuis longtemps entre l'économie et la politique, entre les mouvements incontrôlés du capital et le déficit du projet politique, avec la désaffection connexe des citoyens " (3).
En Italie, l'action du " mouvement des mouvements " s'est insérée dans un cycle " antipolitique " qui a duré plus d'une décennie et qui était marqué " par un affrontement sans précédent au sein de la classe politique et par la méfiance croissante des citoyens vis-à-vis de la politique au sein de l'opinion publique " (4). La valeur éthique, encore plus que politique, de la rébellion des participants au " mouvement des mouvements ", avait été soulignée à de nombreuses reprises. Cela concernait en particulier la jeune génération, reflétant également, dans ce cas, la précarité de sa condition sociale, car la condition matérielle de ces jeunes est indéfinie, fondée sur un travail instable, des contrats de courte durée et précaires. Ce n'est pas un hasard si le premier sursaut éthique de ces jeunes les a confronté à la guerre impériale états-unienne, devenue un moteur de l'affrontement avec le monde politique et le monde des politiciens. L'attitude irréductible éthique et sociale face au libéralisme contient un refus latent du capitalisme, qui peut éventuellement se transformer en conscience politique et sociale. Toutefois, ce processus n'est pas forcément linéaire et inévitable. Au contraire, il rencontre de nouvelles difficultés, a du mal à se transformer en combat politique, et ne réussit pas à trouver un nouveau paradigme de référence (5). L'option claire de Refondation communiste de rester dans le mouvement, de participer à son processus de croissance et de mûrissement, s'est révélée un choix correct à long terme. Par contre, ce parti est moins en mesure de profiter de positions électorales et d'une croissance significative du nombre de ses membres et de ses cadres dans l'immédiat.
Dans l'ensemble, la redéfinition des frontières de la politique a provoqué la fragmentation du système politique italien, déjà en difficulté par rapport à un mouvement né hors des mécanismes de la politique institutionnelle et composé de sujets étrangers aux modes traditionnels de l'action politique. Les partis, notamment, se sont sentis non représentés, ou si mal par un mouvement qui recueille partiellement et met en activité un malaise social et un malaise diffus envers la politique et sa faillite, qui avaient commencé à se répandre au cours des années 1980.
Le temps de la politique
Tous les partis de l'opposition au gouvernement ont vécu un tourment critique qui les a mis en difficulté, dans la foulée de l'affirmation électorale du centre-droite lors des élections de 2001. Leurs dirigeants, Piero Fassino et Massimo D'Alema, respectivement secrétaire et président des Démocrates de gauche ou Francesco Rutelli, secrétaire du parti de la Marguerite, ont souvent fait l'objet de critiques et se sont fait huer pendant les manifestations. Nanni Moretti, un réalisateur italien un peu triste et déprimé, avait lancé une accusation très lourde à leur encontre : celle de n'être pas capables de mener l'opposition contre Berlusconi. " Avec ces dirigeants ", a-t-il dit en présence de Fassino et Rutelli, " nous n'irons nulle part ". Il a ainsi lancé un mouvement typiquement italien, celui des " girotondi " (rondes) en défense de l'État de droit, menacé par certaines mesures du nouveau gouvernement qui ont fait sortir dans la rue les " classes moyennes réfléchies ", selon la définition de l'historien Paul Ginsborg. Les " girotondi " avaient peu à voir avec le conflit social tant par la composition sociale du mouvement, que parce qu'ils ont mis la seule question de la justice au centre de leur action. Plus encore qu'une opposition directe au gouvernement, le mouvement des " girotondi " cherchait dès le début une contestation critique de la direction du centre-gauche afin de modifier son orientation et sa stratégie d'opposition par une pression massive d'en bas ; mais sans pour autant dépasser l'horizon de l'Olivier, c'est-à-dire de la coalition de centre-gauche défaite aux élections. Les rapports avec le " mouvement des mouvements " furent donc difficiles, même avec celui suscité par la CGIL et son ex-secrétaire, Sergio Cofferati.
Par beaucoup d'aspects, les girotondi présentaient une image opposée à celle du mouvement syndical. D'une part une extériorité presque physiologique au conflit social, sinon ses aspects antigouvernementaux, de l'autre une attention à ce même conflit social loin de toute visée politique, orientée vers le centre-gauche, avec la volonté explicite de ne pas s'introduire dans ce qui se produisait au sein des organismes dirigeants des partis d'opposition.
Un scénario possible s'est effondré très rapidement au cours de ces mois. Sergio Cofferati, un dirigeant venant du secrétariat de la CGIL, jouissant d'un appui large et charismatique au sein de la de gauche, semblait prédestiné pour devenir le nouveau porte-parole d'un centre-gauche renouvelé, capable de s'imposer à la vieille garde politique des sommets partidaires. Il serait devenu " le chef ", aurait guidé vers le salut, peut-être en binôme avec Romano Prodi. Une telle perspective poserait un défi même au PRC, à son rôle et à celui du secrétaire Fausto Bertinotti, en impliquant sa base dans un amalgame flou de réformisme radical contre Berlusconi. Pourtant quelque chose a mis en pièces ce mécanisme si parfait, quelque chose que ni les historiens ni les analystes politiques n'ont découvert ou expliqué jusqu'à maintenant : contre toute attente Sergio Cofferati a accepté de devenir maire de Bologne, en arrachant la ville au centre-droite, et de se reléguer ainsi à un rôle marginal en vue d'un éventuel renouvellement de la direction du centre-gauche. La guerre contre l'Irak, l'évolution, après de multiples difficultés, du centre-gauche vers une position contre la guerre, puis pour le retrait immédiat des troupes, les mêmes contradictions, l'incapacité, l'ingénuité et les intérêts privés éhontés de Berlusconi, évidents dans beaucoup de lois approuvées par le Parlement, ont contribué de manière importante à la formation d'une opposition au gouvernement, toujours plus vaste et articulée qui a tout mis en jeu au nom de l'antiberlusconisme.
La politique a repris son souffle, trouvé un consentement et ressuscité l'intérêt dans les rangs de l'opposition, même si celle-ci n'était pas encore en mesure de peser sur la masse croissante des abstentionnistes. Ceux qui s'étaient retirés de la politique depuis peu, déçus ou critiques, y sont revenus, mais pas les désenchantés de longue date. Là où une synthèse imposée par le mouvement a tardé à apparaître, la synthèse mise en œuvre par les politiciens, composée de nuances, de médiations, de longues réunions, de déclarations conjointes ou disjointes, s'est imposée, sous l'impulsion de l'unité contre le gouvernement. À la fin, la reprise de la politique a accouché de sa synthèse philosophique : Romano Prodi, propulsé par tous à la tête d'une coalition renouvelée de centre-gauche en mesure de battre le centre-droite sur le plan électoral. De manière unanime — en dehors de quelques réserves de la part des " cousins " Communistes italiens de Cossutta et de Diliberto (6) — tous ont reconnu le caractère indispensable de la contribution du Parti de la refondation communiste (PRC) à la nouvelle coalition, sans les voix de laquelle il lui serait impossible de remporter les élections.
Pour sa part le PRC a pris un tournant radical en remettant l'accent sur le rapport politique au sommet avec les forces de l'Olivier dans la perspective déclarée de constituer une véritable alliance programmatique de gouvernement. Il l'a fait quelques jours après avoir animé et organisé la grande bataille référendaire pour l'extension de l'article 18 du Statut des travailleurs qui protège les travailleurs et travailleuses des licenciements arbitraires, au lieu de tenter de donner des perspectives politiques alternatives aux onze millions de citoyens qui avaient répondu positivement à la question référendaire (défaite seulement par l'abstention massive organisée par les forces de centre-droite et de centre-gauche).
La difficile deuxième montée de Prodi
Prodi est vite apparu plus préoccupé de ne pas faire cavalier seul et de mettre en valeur les divers partis de la coalition, que de l'alliance avec Refondation communiste. Sa faiblesse se situait toujours et se situe encore dans le manque d'un véritable parti qui le soutienne au sein de la coalition, contrairement à son adversaire, Silvio Berlusconi, dont le grand parti le situe au centre de son déploiement. Prodi demeure préoccupé par son " indépendance " vis-vis de tous les partis ce qui le rend " dépendant " de chacun d'entre eux. À l'occasion des élections européennes il a fait des pressions pour une " grande liste ", " Unis dans l'Olivier " sous le symbole unique duquel se présenteraient les partis de la coalition. Seuls trois et la moitié d'un ont répondu a l'appel (d'où le terme " tricycle ") : les Démocrates de gauche (DS), ses partisans les plus enthousiastes, les Catholiques populaires de la Marguerite, les Socialistes démocrates et un morceau du petit Parti républicain. Les autres, des centristes aux Verts, des Communistes italiens au PRC, ont préféré agir seuls.
Même si la forte abstention en atténue la portée, les résultats des élections européennes ont marqué lourdement la défaite du grand parti de la coalition de centre-droite, Forza Italia de Silvio Berlusconi. En revanche, l'Alliance nationale a maintenu ses suffrages et l'on observe une croissance significative des catholiques et, dans une certaine mesure, de la Ligue du nord. D'autre part, il était évident que la grande liste ne décollait pas ; la liste que voulait Prodi n'a pas réalisé de plus-value par rapport au total accordé aux trois partis qui la composaient. Au contraire, la redistribution interne des sièges a vu une croissance de la DS et une perte de suffrages chez les Catholiques populaires. Cela a freiné les illusions sur la construction rapide d'un grand parti réformiste au sein de la coalition. Francesco Rutelli et les Catholiques populaires, notamment, voulaient retrouver une autonomie et une identité, pour reconquérir les espaces électoraux qu'ils perdaient. L'idée a connu un déclin et avec elle celle de présenter la grande liste de nouveau en vue des élections régionales de 2005. À la lumière des faits et des négociations en cours, cette éventualité n'est pas du tout certaine. Il semble de plus en plus probable que chacun fera ce qu'il veut, et que la tendance dominante sera de se présenter seuls.
Comme Prodi se sent à nouveau menacé par l'excès " d'indépendance " des partis, il a cherché une légitimation : il a demandé l'organisation des élections primaires à l'américaine à l'intérieur du centre-gauche pour son investissement officiel en tant que leader. Devant l'accord de tous, à quelques nuances près,. Bertinotti, le secrétaire du PRC, a vite proposé sa candidature, pour qu'au moins les apparences démocratiques soient sauves et pour souligner la différence programmatique de Refondation sur quelques éléments de l'éventuel programme électoral. Bertinotti avançait même l'idée de " primaires sur programme ", par lesquelles on s'engagerait à respecter les décisions majoritaires au sein de l'alliance de gouvernement, y compris sur la question très délicate de la guerre en Irak. Cette proposition a suscité des polémiques très vives au sein du PRC, mais a recueilli les louanges des forces politiques de centre-gauche qui ont saisi l'essence du problème : dans une future coalition gouvernementale, le PRC serait ainsi loyal et ne pourrait pas provoquer une rupture comme celle qui a fait tomber le premier gouvernement Prodi en 1998. Naturellement personne n'a plus parlé des primaires sur le programme, parce qu'au sein du centre-gauche on discute de tout (des règles, des organigrammes, des procédures, de qui décide et de qui décide qui décide) sauf du programme, des contenus sociaux et des politiques à mettre en œuvre contre le centre-droite. Ceci n'est pas dû au hasard ou à l'incapacité, ni même au fait que c'est un point litigieux, à cause des différences possibles de projet et de perspective, mais parce que tous savent que le pôle de référence sera toujours la politique néolibérale dictée par les organismes de l'Union européenne, que sanctionne la constitution à laquelle on vient de donner l'aval.
Dans ce cadre, il faut également remarquer que les importantes luttes ouvrières, qui se sont développées au cours du printemps et ont produit des victoires partielles des travailleurs, ont marqué un temps d'arrêt. Le contexte négatif pèse encore lourd et beaucoup de contrats de travail renouvelés portent encore la marque de la subordination aux exigences de l'entreprise. Les organisations syndicales n'ont pas organisé de mobilisation contre la énième contre-réforme des retraites et les autres mesures sociales du gouvernement. Celui-ci a donc surmonté la période la plus difficile, lorsqu'une mobilisation sociale menaçait de le chasser. La stagnation de la mobilisation s'est poursuivie en septembre et octobre pendant que les travailleurs d'Alitalia subissaient une lourde défaite. Les projets patronaux de restructuration et de licenciements ont passé avec l'aval de la majorité des syndicats et sans riposte. Le syndicat des ouvriers métallurgistes de la CGIL, la FIOM, qui a mis en avant des initiatives de mobilisation et de contenu plus avancés, est resté isolé et seul au cours de ces jours. Mais face à un budget de " larmes et de sang ", les trois organisations syndicales majoritaires ont finalement déclaré une grève générale pour le 30 novembre.
Le PRC dans le gouffre de la " GAD-politique "
Fort de sa remontée électorale (plus en pourcentage qu'en termes de votes absolus), le PRC, par la voix de son secrétaire, s'est mis sur le devant de la scène par une révision de la ligne politique adoptée lors de son dernier congrès. Ce tournant a été annoncé par des méthodes que son secrétaire avait déjà expérimentées à d'autres occasions — interviews, déclarations publiques — dans le dos des organismes dirigeants élus au congrès. Bertinotti a ainsi fait des ouvertures à une alliance avec le centre-gauche, en prenant pour acquis une convergence programmatique. Il est allé jusqu'à postuler la participation de ministres du PRC au futur gouvernement, qui, à ce qu'il semble, prendrait la relève de celui de Berlusconi, qui ne fait plus consensus.
Alors que l'hypothèse d'une fédération unitaire des partis de la " grande liste" a fait long feu, la GAD, sigle de la Grande alliance démocratique, l'a remplacé. La GAD est composée de tous les partis qui soutiennent Prodi, y compris Refondation communiste — ce qui est la grande nouveauté. Naturellement, personne ne met en question la nécessité d'une alliance électorale, que la loi électorale majoritaire actuelle impose, pour battre Berlusconi aux prochaines élections. Mais c'est autre chose d'envisager un gouvernement avec des forces aussi distantes sur le terrain programmatique et présidé par le président de la Commission européenne, c'est-à-dire par celui qui s'est porté garant des politiques libérales de l'Union.
La manière traditionnelle de construire les alliances politiques et gouvernementales a été mise pieds par dessus tête, tout comme l'est toujours davantage le rapport entre la politique et la société. La GAD — énième sigle dont la politique a accouché — est une première entente réalisée en prévision d'un accord programmatique, politique, électoral, encore à venir. C'est la pire synthèse politique qui s'affirme. C'est un récipient où l'on peut tout introduire, avec des positions divergentes, avec des intérêts et des intentions différents, au nom d'une unité floue, indépendamment des contenus et des programmes. Au moment de décider que faire, c'est le chantage habituel mais très utile et efficace qui prévaudra : veux-tu rompre l'unité reconstituée à grand peine ? Veux-tu faire vaincre Berlusconi ? Ou bien, si on va au gouvernement : veux-tu le retour de Silvio au pouvoir ? En somme, nous sommes devant une politique où l'on discute peu de politique, de programmes, de choses à faire et de comment faire dans le cas de victoire électorale. Ce qui divise ou provoque des débats sérieux et passionnés est tout simplement caché et n'est jamais mis à l'ordre du jour.
Le choix du PRC de faire partie de la GAD sera sans doute payant dans l'immédiat sur le plan de l'image et de la reconnaissance, celle qu'on gagne surtout par les apparitions télévisées en contact direct avec les électeurs, toujours davantage par-dessus la structure militante du parti. Mais à la longue on court le risque de devoir " rendre des comptes ", quand le parti devra expliquer des choix " impopulaires " de ses alliés, devant son électorat et sa base. Pour le moment, ce problème ne semble pas troubler la majorité du parti, convaincue qu'il faut avancer sans trop se préoccuper de ce qui pourrait arriver, selon une conception stratégique typique de la pratique des politiciens de cette période, qui semblent avoir embrassé une philosophie minimaliste, désenchantée, empirique, basée sur la thèse suivante : " je ne vois pas au-delà de ce que je fais ". L'écart entre les proclamations du dernier congrès du PRC, qui a mis au centre la construction du conflit social et du projet d'alternative anticapitaliste, et les choix politiques quotidiens de la majorité de sa direction, atteint son paroxysme. Le prochain congrès du Parti de la refondation communiste devra discuter de tout cela, entre autres ...
1. La Stampa du 10 novembre 2002.
2. La Stampa du 12 novembre 2002.
3. P. Ceri, Movimenti globali. La protesta nel XXI secolo, Bari, Laterza, 2002, p. 32 et p. 117.
4. C. Marletti, Il ciclo dell'antipolitica e i risultati delle elezioni del 13 maggio in Italia, in Comunicazione politica, n° 1/2002.
5. S. Cannavo, Impressioni di Firenze, Liberazione du 14 novembre 2002.
6. Armando Cossuta a rompu avec le PRC lorsque ce dernier a décidé à la majorité de sortir du précédent gouvernement Prodi, en 1998, formant peu après un nouveau parti : les Communistes italiens.