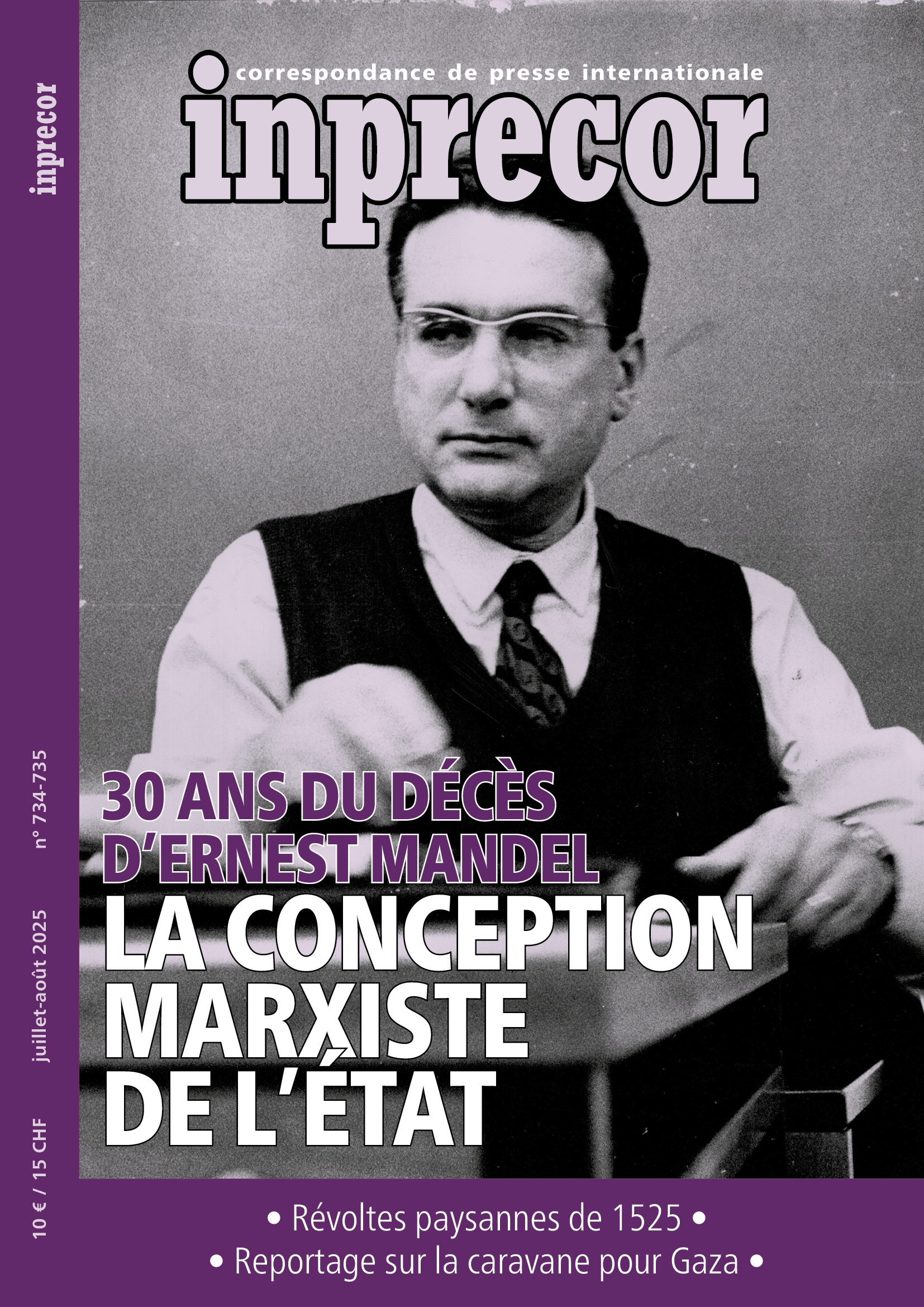Pour que le pays puisse renaître après des années de guerre, il sera nécessaire d’inclure la population et d’instaurer la démocratie pendant la période de transition, sans quoi la cohésion nationale risque d’être compromise.
La chute du régime d’Assad le 8 décembre 2024 a suscité des espoirs d’un avenir meilleur pour la Syrie. Cependant, l’optimisme initial a été remplacé par des difficultés croissantes, notamment la fragmentation territoriale et politique, l’influence étrangère et l’occupation, ainsi que les tensions confessionnelles. Cela a eu un impact négatif sur la reprise économique potentielle et le processus de reconstruction dont le pays a désespérément besoin. Le coût de la reconstruction est estimé entre 250 et 400 milliards de dollars. Plus de la moitié de la population reste déplacée, 90 % vit sous le seuil de pauvreté et, en 2024, 16,7 millions de personnes en Syrie (soit 75 % de la population) avaient besoin d’une aide humanitaire, selon les Nations unies.
Un nouveau vent d’espoir s’est levé en Syrie en mai, après une série de décisions importantes prises par les États-Unis, l’Union européenne et le Japon pour assouplir les sanctions économiques imposées au pays. Ces annonces ont été accueillies par des célébrations publiques dans plusieurs villes syriennes, notamment après la déclaration du président américain annonçant l’allègement des sanctions. Ces décisions ont déjà produit des résultats politiques tangibles, ouvrant la voie à de nouveaux engagements régionaux et internationaux. Parallèlement, ces mesures permettent la réintégration de l’économie syrienne aux marchés régionaux et mondiaux. Elles facilitent les transactions financières, revitalisent les flux commerciaux et ouvrent la voie aux investissements directs étrangers (IDE), ainsi qu’à la participation de la diaspora syrienne. Dans ce contexte, Damas a intensifié ses efforts pour attirer les entreprises régionales et internationales afin qu’elles investissent dans la modernisation des infrastructures et les secteurs générateurs de revenus. Fin mai, Damas a par exemple signé un protocole d’accord avec un consortium d’entreprises (dont des entreprises américaines, qataries et turques) dirigé par la société qatarie UCC Concession Investments, pour accroître les investissements dans le secteur de l’énergie, d’une valeur pouvant atteindre 7 milliards de dollars américains.
Des possibilités de reprise économique
En d’autres termes, la levée des sanctions américaines représente un grand espoir pour la population syrienne, car un obstacle majeur à l’amélioration de l’économie a été levé. Cependant, des obstacles subsistent pour que l’économie syrienne connaisse une reprise économique réussie.
Premièrement, la levée des sanctions doit être confirmée par un processus clair, ce qui pourrait prendre du temps. Alors que la Syrie est sous sanctions américaines depuis 1979, après son inscription sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme, c’est la loi César votée en décembre 2019 qui a gravement affecté l’économie syrienne et sanctionné toute tentative d’aide à l’ancien régime syrien et de contribution à la reconstruction du pays. La loi César, ainsi que la désignation de la Syrie comme État soutenant le terrorisme, nécessitent l’approbation officielle du Congrès. Cela étant dit, une dérogation du président américain Trump aux sanctions, voire leur levée informelle, pourrait également être envisagé.
Concernant les sanctions de l’ONU, celles-ci sont décidées par le Conseil de sécurité, et non par les seuls États-Unis. Cependant, un accord sera très probablement conclu suite à la décision de Washington, la légitimation régionale et internationale de la Syrie progressant rapidement.
Cela dit, ce relatif flou dans le processus de levée des sanctions ralentira probablement un retour rapide des institutions financières et des hommes d’affaires en Syrie. Mais surtout, même en l’absence de sanctions, il existe de profonds problèmes économiques structurels.
La stabilisation de la livre syrienne est encore loin d’être achevée, ce qui décourage les investisseurs en quête de rendements rapides et à moyen terme. La destruction des secteurs productifs de l’économie, notamment l’industrie manufacturière et l’agriculture, ainsi que le déficit persistant de la balance commerciale, exercent une pression sur la livre syrienne. Parallèlement, la monnaie nationale syrienne est toujours confrontée à la concurrence de la livre turque dans certaines régions du nord-ouest, tandis que le dollar américain continue de circuler largement dans le pays.
Des limites structurelles importantes
Par ailleurs, les infrastructures et les réseaux de transport syriens restent endommagés. Les coûts de production sont élevés, notamment en ce qui concerne l’électricité, et le pays continue de faire face à de graves pénuries de matières premières et de ressources énergétiques essentielles, pénuries qui pourraient être diminuées par la levée des sanctions. Par ailleurs, l’approvisionnement en pétrole, bien qu’encore insuffisant, s’est récemment amélioré grâce à l’augmentation des flux d’approvisionnement en provenance de Russie depuis le début de l’année.
On observe également une pénurie importante de main-d’œuvre qualifiée, sans indication d’un retour massif de cette main-d’œuvre dans un avenir proche. Le secteur privé, principalement composé de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) aux capacités limitées, nécessite encore une modernisation et une reconstruction importantes après plus de 13 ans de guerre et de destructions.
Les ressources de l’État sont également sévèrement restreintes, ce qui limite encore davantage les investissements dans l’économie, tandis que l’orientation politico-économique des nouvelles autorités au pouvoir privilégie un modèle économique commercial, caractérisé par des investissements axés sur le profit à court terme, au détriment des secteurs productifs.
Dans ce contexte, des discussions sur la reprise économique et le développement ont déjà commencé entre les acteurs sociaux et politiques syriens et les représentants internationaux. Cependant, trois facteurs majeurs sont nécessaires pour une réhabilitation et une reconstruction nationales réussies et durables.
• Premièrement, une transition politique inclusive créant les conditions d’une participation des différents secteurs de la société.
• Deuxièmement, la mise en place d’un contrepoids au pouvoir en place afin d’approfondir la démocratisation de l’espace politique syrien.
• Enfin, une amélioration des conditions socio-économiques afin d’accroître la participation des classes les plus vulnérables de la société, qui sont confrontées à des conditions de vie difficiles.
En l’absence de ces conditions, la reprise économique de la Syrie sera compromise et le risque d’instabilité augmentera, car divers acteurs politiques et sociaux seront laissés-pour-compte. Pire encore, si les nouvelles autorités continuent d’imposer leur volonté, cela pourrait conduire à un conflit armé. De même, le fait de ne pas associer plus activement des secteurs plus larges de la population à la phase de transition pourrait nuire à la légitimité de cette dernière. Un manque d’inclusivité pourrait également alimenter les tensions sectaires et ethniques, sapant encore davantage la cohésion nationale.
Le contexte politique après la chute d’Assad
Après l’effondrement du régime d’Assad, Hayat Tahrir al-Cham (HTC), qui avait mené l’offensive contre les forces gouvernementales syriennes, a concentré le pouvoir entre ses mains. Peu après sa prise de pouvoir, le chef du groupe, Ahmed al-Charaa, a choisi Mohammed al-Bachir pour diriger un gouvernement intérimaire. Bashir était auparavant à la tête du gouvernement de salut syrien (1) à Idlib. Son gouvernement était composé exclusivement de membres de Hayat Tahrir al-Cham ou de personnes proches du groupe. En janvier 2025, al-Charaa est allé plus loin en se nommant président par intérim, avant de nommer, le 29 mars, un gouvernement de transition sous son autorité, chargé de diriger le pays jusqu’aux élections.
Une fois au pouvoir, al-Charaa a formé un « conseil législatif intérimaire » après avoir dissous le Parlement et gelé la Constitution. Il a également nommé des ministres, des responsables de la sécurité et des gouverneurs régionaux affiliés à Hayat Tahrir al-Cham ou à des groupes armés de l’Armée nationale syrienne qui en sont proches. Par exemple, Anas Khattab a d’abord été nommé chef des services de renseignement jusqu’à son remplacement par Hussein al-Salama en mai. Khattab est un membre fondateur de Jabhat al-Nusra, un prédécesseur de Hayat Tahrir al-Cham, et il en était la principale figure de proue en matière de sécurité. Depuis 2017, il gérait les affaires intérieures et la politique de sécurité de Hayat Tahrir al-Cham. Khattab a annoncé une restructuration des services de renseignement, alors même que les autorités mettaient en place une nouvelle armée syrienne. Elles ont nommé des commandants de Hayat Tahrir al-Cham aux postes les plus élevés et ont choisi Mourhaf Abou Qasra comme ministre de la Défense, le promouvant au grade de général. En relançant l’armée, le nouveau régime cherchait à consolider son contrôle sur les groupes armés fragmentés de Syrie et à donner à l’État le monopole des armes.
De même, les postes clés du nouveau gouvernement de transition sont occupés par des personnalités proches de Sharaa. Par exemple, Assad Al-Chibani et Abou Qasra ont conservé leurs fonctions de ministre des Affaires étrangères et de ministre de la Défense, respectivement, tandis que Khattab a été nommé ministre de l’Intérieur. Cependant, les pouvoirs réels du gouvernement sont remis en question, d’autant plus que le Conseil national de sécurité syrien, dirigé par Sharaa et composé de ses proches collaborateurs (le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, le ministre de l’Intérieur et le directeur des services de renseignement généraux), a été créé au même moment dans le but de gérer la sécurité et la politique. Dans le même ordre d’idées, le ministère des Affaires étrangères a créé fin mars le Secrétariat général aux affaires politiques chargé de superviser les activités politiques intérieures, de formuler les politiques générales en matière politique et de gérer les actifs du parti Baas dissous.
Le pouvoir a toutes les clés
Les nouvelles autorités syriennes ont également pris des mesures pour consolider leur pouvoir sur les acteurs économiques et sociaux. Elles ont par exemple restructuré les chambres de commerce du pays en remplaçant la majorité de leurs membres par des personnes nommées, notamment dans les gouvernorats de Damas, de la campagne de Damas, d’Alep et de Homs. Plusieurs des nouveaux membres du conseil d’administration sont connus pour leurs liens étroits avec Hayat Tahrir al-Cham. C’est le cas notamment du nouveau président de la Fédération des chambres de commerce syriennes, Alaa Al-Ali, ancien directeur de la Chambre de commerce et d’industrie d’Idlib, affiliée à Hayat Tahrir al-Cham. En outre, à la mi-avril, le frère d’Ahmed al-Charaa, Maher Al-Sharaa, a été nommé secrétaire général de la présidence, chargé de gérer l’administration présidentielle et d’assurer la liaison entre la présidence et les organes de l’État.
Les autorités ont également fait appel à de nouvelles personnalités proches du régime pour diriger les syndicats et les associations professionnelles. Elles ont notamment sélectionné un conseil syndical pour le barreau syrien, composé de membres du Conseil du barreau libre opérant à Idlib. Les avocats syriens ont réagi en organisant une pétition appelant à des élections démocratiques au barreau.
Le manque d’inclusivité démocratique du nouveau régime s’est également reflété dans les initiatives, les conférences et les comités chargés de façonner l’avenir de la Syrie. Par exemple, après avoir initialement reporté la Conférence de dialogue national syrien, les autorités l’ont finalement organisée en février 2025 avec environ 600 participant·es. Cependant, le processus a été vivement critiqué. Tout d’abord, le comité préparatoire a été créé moins de deux semaines avant la conférence et les invitations n’ont généralement été envoyées que deux jours avant, empêchant ainsi la participation de nombreuses personnes invitées provenant de l’étranger. Le temps alloué aux discussions lors des sessions de travail – sur la justice transitionnelle, l’économie, les libertés individuelles et la Constitution – a été limité à quatre heures, ce qui a empêché des échanges approfondis. Certains participants, notamment ceux issus de régions telles que le sud de la Syrie et les zones côtières, étaient absents ou sous-représentés, et les principaux acteurs politiques kurdes, l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (AANES) et le Conseil national kurde, ont dénoncé le fait qu’ils n’aient pas été invités à participer à la conférence.
Des politiques capitalistes…
La Constitution provisoire signée par Ahmed al-Charaa en mars a également été critiquée par les acteurs politiques et sociaux, en raison de son contenu et du manque de transparence des critères de sélection de la commission de rédaction. Le document maintient des dispositions de la Constitution précédente. Le nom officiel du pays reste la République arabe syrienne, l’arabe reste la seule langue officielle et il est toujours stipulé que le président doit être un homme musulman. Et la jurisprudence islamique est désormais « la principale source de législation » et non plus « une source majeure de législation ». Tout en proclamant la séparation des pouvoirs, la Constitution provisoire entrave celle-ci en conférant un large éventail de pouvoirs à la présidence. Le président peut soumettre des lois, promulguer des décrets et mettre son veto aux décisions du Parlement. Il est également chargé de nommer les juges de la Cour constitutionnelle, ce qui renforce encore les pouvoirs de l’exécutif.
Sur le plan économique, l’orientation du gouvernement n’a pas été discutée ni partagée en dehors d’un cercle restreint de responsables, dont l’objectif premier est de s’assurer le pouvoir. Les décisions prises par les nouvelles autorités visent à imposer leur vision économique, fondée sur l’approfondissement du néolibéralisme et des mesures d’austérité. Ces politiques favorisent généralement la classe bourgeoise. Ahmed al-Charaa et ses ministres ont tenu de nombreuses réunions avec des représentants des chambres de commerce et d’industrie du pays, ainsi qu’avec des hommes d’affaires syriens à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie, afin d’écouter leurs griefs et d’expliquer leur propre vision économique.
…au détriment des classes populaires
Certains signes indiquent que Hayat Tahrir al-Cham souhaite encourager la privatisation et imposer des mesures d’austérité. Avant sa présence en janvier au Forum économique mondial de Davos, qui incarne les intérêts des élites néolibérales et capitalistes mondiales, Shaibani a déclaré au Financial Times que les autorités syriennes prévoyaient de privatiser les ports et les usines publics, d’inviter les investissements étrangers et de stimuler le commerce international. Il a ajouté que le gouvernement « explorerait des partenariats public-privé pour encourager les investissements dans les aéroports, les chemins de fer et les routes ». Damas a également réduit les droits de douane sur plus de 260 produits turcs, ce qui nuit à la production nationale, en particulier dans les secteurs manufacturier et agricole, qui peinent à concurrencer les importations turques. Les exportations turques vers la Syrie au premier trimestre de cette année ont totalisé environ 508 millions de dollars, soit une augmentation de 31,2 % par rapport à la même période en 2024, selon le ministère turc du Commerce.
Le gouvernement a également mis en œuvre des mesures d’austérité. Depuis décembre, il a augmenté le prix du pain subventionné standard de 1 100 grammes de 400 livres syriennes à 4 000 livres syriennes, alors que le poids standard était initialement de 1 500 grammes. La fin des subventions sur le pain a été annoncée pour les mois suivants, mais sans date précise. En janvier 2025, le ministre de l’Électricité, Omar Chaqrouq, a déclaré que le gouvernement réduirait, voire supprimerait, les subventions sur les prix de l’électricité, car « les prix [actuels] sont très bas, bien en dessous de leurs coûts, mais seulement de manière progressive et à condition que les revenus moyens augmentent ». Actuellement, l’État ne fournit pas plus de deux heures d’électricité par jour aux principales villes syriennes. Par ailleurs, en janvier, le prix d’une bouteille de gaz utilisée pour la cuisine est passé de 25 000 livres syriennes à 150 000 livres syriennes, ce qui a considérablement affecté les familles syriennes.
De même, la réduction ou la cessation des subventions aux dérivés du pétrole, notamment le carburant, le diesel et l’essence, aura également un impact négatif sur l’économie dans son ensemble, ainsi que sur la population. La suspension des subventions au carburant en décembre 2024, par exemple, a augmenté les coûts de production pour les agriculteurs et limité les semis pour la récolte de blé de 2025.
Entre décembre et janvier, le ministère de l’Économie et du Commerce extérieur a annoncé le licenciement d’un quart à un tiers des fonctionnaires, correspondant aux employé·es qui, selon les nouvelles autorités, percevaient un salaire sans travailler. Le ministre du Développement administratif, Mohammed al-Skaff, qui supervise les effectifs du secteur public, est allé encore plus loin en déclarant que les institutions publiques avaient besoin de 550 000 à 600 000 travailleurs, soit moins de la moitié du nombre actuel. Depuis lors, aucun chiffre officiel n’a été communiqué concernant les employé·es licencié·es, tandis que certain·es ont été mis en congé payé pendant trois mois jusqu’à ce que leur situation soit clarifiée. À la suite de cette décision, des manifestations de fonctionnaires licencié·es ou suspendu·es ont éclaté dans tout le pays.
Dans le même temps, les autorités syriennes ont réitéré depuis le début de l’année leurs promesses d’augmenter les salaires des fonctionnaires de 400 % et de fixer le salaire minimum à 1,12 million de livres syriennes (environ 102 dollars). Bien que ces mesures aillent dans le bon sens, elles n’ont toujours pas été mises en œuvre et les montants des salaires ne permettent pas de couvrir les frais de subsistance dans un contexte de crise économique persistante. Fin mars, les dépenses mensuelles minimales pour une famille de cinq personnes à Damas étaient estimées à 8 millions de livres syriennes (soit 727 dollars).
Parallèlement, dans le secteur privé, le ministère de l’Économie et de l’Industrie a publié fin mai une décision supprimant l’obligation pour les hommes d’affaires et chefs d’entreprise d’inscrire leurs salariés à la sécurité sociale, sous prétexte de faciliter les démarches et d’encourager l’investissement. Suite aux critiques concernant cette décision, jugée contraire aux droits des travailleurs, le ministère a publié le lendemain une clarification précisant que cette mesure ne dispense pas les entrepreneurs de l’obligation d’inscrire leurs salarié·es à la sécurité sociale, mais suspend simplement cette obligation jusqu’à la fin de l’année, à titre temporaire pour encourager l’adhésion aux chambres de commerce. Cette explication n’a cependant pas atténué les craintes d’une nouvelle exploitation des travailleurs.
Dans le même temps, alors que la Syrie est confrontée à l’une des crises alimentaires les plus graves des dernières décennies, alors qu’une sécheresse aiguë en 2025 menace de décimer la récolte nationale de blé, des rumeurs circulent sur l’abandon du soutien à la culture du blé, traditionnellement un pilier de la production agricole du pays, selon une source au ministère de l’Agriculture, comme le rapporte le site The Syria Report, selon lequel le ministère envisage d’abandonner le soutien à la culture du blé. Déjà avant la chute du régime d’Assad, les coûts des intrants étaient constamment élevés, avec des prix des engrais triplant depuis 2023 – augmentant les dépenses de production, limitant l’accès des agriculteurs aux intrants et affectant négativement la production agricole.
Face aux massacres confessionnels
Une société civile forte, capable de faire contrepoids au pouvoir, est une condition préalable à la réussite du processus de relance et de reconstruction de la Syrie. La société civile ne se limite pas aux organisations non gouvernementales locales et internationales, mais comprend également les partis politiques, les syndicats, les associations professionnelles, les organisations féministes et environnementales, les associations locales, etc. L’objectif serait de s’opposer à la nouvelle dynamique autoritaire dans le pays et à la consolidation du pouvoir de Hayat Tahrir al-Cham à travers les institutions étatiques et son orientation économique. Un espace politique démocratique est essentiel pour encourager la participation de larges secteurs de la société à la reconstruction économique et politique. L’implication de la majorité de la population, en particulier des classes pauvres et travailleuses, dans la renaissance du pays est cruciale, car celle-ci ne doit pas se limiter aux élites politiques et économiques et aux couches les plus riches de la société. Pour promouvoir une telle approche, deux conditions préalables sont nécessaires : garantir la paix civile et la sécurité, et améliorer l’environnement socio-économique de la Syrie.
La paix civile reste aujourd’hui difficile à atteindre en Syrie. Dans certaines régions, notamment à Homs et dans les zones côtières, l’insécurité règne, comme en témoignent les violents incidents sectaires commis par les nouveaux services de sécurité et les groupes armés qui leur sont associés, notamment des exécutions et des assassinats. En mars, Hayat Tahrir al-Cham et l’Armée nationale syrienne se sont livrés à des massacres confessionnels de civil·es alaouites dans les régions côtières, faisant des centaines de morts. Si les violences ont été provoquées par des vestiges du régime d’Assad qui ont organisé des attaques coordonnées contre des membres des services de sécurité et des civil·es, la contre-réaction a englobé tous les Alaouites, selon une logique de haine confessionnelle et de vengeance. En avril et mai, des groupes armés liés aux autorités ou qui les soutiennent ont mené des attaques contre la population druze, tandis que les violences et assassinats contre des civil·es alaouites se poursuivaient.
La responsabilité des massacres de mars et des meurtres continus de civils alaouites, et maintenant de Druzes, incombe principalement aux nouvelles autorités syriennes. Elles n’ont pas réussi à les empêcher et ont même été directement impliquées et ont créé les conditions politiques qui les ont rendues possibles. Les autorités n’ont pas non plus mis en place un mécanisme favorisant un processus global de justice transitionnelle visant à punir toutes les personnes et tous les groupes impliqués dans des crimes de guerre pendant le conflit syrien. Cela aurait pu jouer un rôle crucial dans la prévention des actes de vengeance et dans l’apaisement des tensions sectaires croissantes. Cependant, Ahmed al-Charaa et ses alliés n’ont aucun intérêt à la justice transitionnelle, craignant très certainement d’être jugés pour leurs propres crimes et les exactions commises contre les civils. D’ailleurs, le 17 mai, les autorités syriennes de transition ont annoncé des décrets présidentiels portant création de deux nouveaux organes gouvernementaux : la Commission de justice transitionnelle et la Commission nationale pour les disparus. Cependant, le mandat de la Commission de justice transitionnelle, tel que défini dans le décret, est restreint et exclut de nombreuses victimes, notamment celles de Hayat Tahrir al-Cham et de ses groupes armés alliés. Cette justice sélective est donc très problématique et risque de provoquer de nouvelles tensions politiques et confessionnelles dans le pays.
La justice transitionnelle comporte également une dimension socio-économique, dans la mesure où elle comprend des mesures visant à récupérer les biens publics et à poursuivre les crimes financiers. Celles-ci concernent la privatisation de ces biens et la distribution de terres publiques à des hommes d’affaires affiliés à l’ancien régime, au détriment de la population et de son droit à bénéficier des ressources publiques de manière plus générale. Cependant, les préférences économiques des nouvelles autorités, qui consistent à conclure des accords de réconciliation avec certaines personnalités du monde des affaires associées au régime d’Assad et à approfondir les politiques néolibérales et la privatisation des biens publics, vont à l’encontre de la dynamique propre à un processus complet de justice de transition.
Début mars, le gouvernement a signé un protocole d’accord avec l’AANES et cherché à se rapprocher de certains secteurs de la population druze à Souweïda. Ces initiatives ont démontré la nécessité de renforcer sa légitimité aux niveaux national, régional et international, fortement ébranlée par les massacres dans les zones côtières. Toutefois, la mise en œuvre de ces initiatives doit encore être évaluée, car les communautés locales du nord-est de la Syrie et de Souweïda s’y opposent. Des secteurs importants de ces communautés ont organisé des manifestations contre la constitution provisoire et les politiques des autorités au pouvoir, notamment leur refus de punir les groupes armés qui ont participé aux massacres dans les communautés côtières. De plus, les combats confessionnels ont repris en avril dans certaines régions du pays, visant les populations druzes. Afin d’apaiser les tensions et d’empêcher toute ingérence extérieure dans les affaires nationales, en particulier de la part d’Israël, le gouvernement syrien et les représentants druzes ont conclu début mai un accord sur les questions de sécurité.
Outre le risque de fragmentation de la Syrie, certains pays étrangers, notamment l’Iran et Israël, ont intérêt à attiser les violences confessionnelles et ethniques. Ils peuvent ainsi se présenter comme les défenseurs d’une secte particulière et générer davantage d’instabilité. À titre d’exemple, des responsables israéliens ont déclaré être prêts à protéger les Druzes de Syrie par des moyens militaires. Ils ont récemment mené des frappes aériennes d’avertissement après des combats près de Damas, dans les villes de Jaramana et Sahnaya, où vivent de nombreux Druzes. Les principaux acteurs sociaux et politiques druzes ont largement rejeté ces appels et réaffirmé leur loyauté envers la Syrie et l’unité du pays. Dans le même temps, l’armée turque n’a pas complètement cessé ses menaces contre la population kurde du nord-est, malgré l’accord conclu entre Damas et l’AANES.
Construire un contrepoids au pouvoir
Une deuxième condition essentielle pour élargir l’espace politique en Syrie est l’amélioration de l’environnement socio-économique du pays. Cela est particulièrement nécessaire compte tenu des destructions massives causées par la guerre et du fait que 90 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. L’incapacité de larges secteurs de la population à subvenir à leurs besoins essentiels, à payer leur loyer, leur électricité, leurs frais de scolarité, etc., empêche leur inclusion et leur participation à un processus de reconstruction dans lequel ils ont un intérêt direct et objectif.
Les décisions économiques des nouvelles autorités appauvrissent encore davantage de larges pans de la population et aggravent le sous-développement des secteurs économiques productifs de la Syrie. C’est pourquoi les autorités ne peuvent pas limiter leurs discussions aux hommes d’affaires et aux acteurs étrangers. Elles doivent les élargir à d’autres acteurs sociaux et politiques locaux, notamment les syndicats et les associations paysannes et professionnelles. Il convient donc de donner la priorité à la dynamisation de ces organisations, ce qui peut se faire par le biais d’élections libres mobilisant leurs électorats, ainsi que par la mobilisation de la main-d’œuvre nationale.
La renaissance des organisations démocratiques de masse de travailleurs est essentielle pour améliorer les conditions de vie et de travail de la population et élargir l’espace de représentation politique et de classe dans la reconstruction. À cet égard, les manifestations organisées en janvier et février 2025 dans différentes provinces par des fonctionnaires licenciés étaient prometteuses, tout comme les tentatives de création de syndicats alternatifs ou, à tout le moins, de structures de coordination. Ces nouvelles entités, outre leur opposition aux licenciements massifs, ont également exigé une augmentation des salaires et rejeté les projets du gouvernement visant à privatiser les biens publics. Cependant, les massacres confessionnels dans les zones côtières ont considérablement réduit la puissance du mouvement de protestation, en raison des craintes que des groupes armés proches du régime ne réagissent par la violence.
Le risque d’un processus de reconstruction exclusif et dirigé par l’élite ne fera que reproduire les inégalités sociales, l’appauvrissement, la concentration des richesses entre les mains d’une minorité et l’absence de développement productif. Il convient de rappeler que tous ces éléments étaient à l’origine du soulèvement populaire contre le régime d’Assad en 2011. Par conséquent, construire une transition post-Assad sur de telles bases ne peut que se retourner contre elle.
Quel avenir pour la Syrie ?
Tout successeur du régime de Bachar al-Assad aurait été confronté à d’énormes défis politiques et socio-économiques. Cela ne doit pas être sous-estimé. Cependant, les prédispositions politiques et économiques de Hayat Tahrir al-Cham n’ont fait que rendre plus difficile la mise en place des conditions préalables à un processus de reconstruction réussi et durable pendant la phase de transition en Syrie. Il en résulte une société plus pauvre et plus fragmentée sur le plan social et politique, ce qui pourrait entraîner de nouveaux cycles de violence et de tensions confessionnelles. Par conséquent, aucune reprise économique, et encore moins une reconstruction réussie, n’est susceptible de se produire. La Syrie se trouve à la croisée des chemins. Si aucune mesure n’est prise pour s’engager sur une voie plus inclusive et plus démocratique sur le plan social, l’agonie du pays se poursuivra et pourrait conduire à l’établissement d’un nouveau régime autoritaire et de nouvelles formes d’exclusion. C’est la recette d’une nouvelle catastrophe.
Le 9 juin 2025