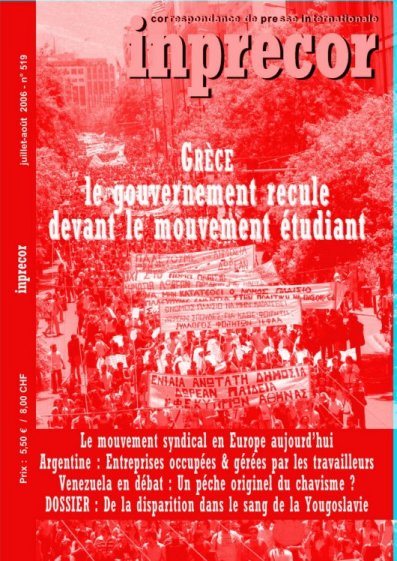La politique néolibérale des vingt dernières années a eu des conséquences importantes sur le mouvement syndical. Il faut cependant faire la distinction entre les effets objectifs, pour ainsi dire intériorisés de cette politique sur le mouvement syndical en raison de la transformation du monde du travail et des formes d'emploi, et les mesures prises par la classe possédante et ses fondés de pouvoir dans les parlements au moyen de modifications législatives dirigées explicitement contre les syndicats.
1. Préambule
Dans ce qui suit, nous éviterons d'utiliser les termes à la mode comme " politique néolibérale » et " mondialisation ». Et ce pour les raisons suivantes :
Premièrement, ils prêtent à confusion parce qu'ils reviennent à affirmer implicitement qu'on assiste à l'heure actuelle à une nouvelle phase de développement du système capitaliste. Ce qui n'est pas le cas, nous nous trouvons toujours dans la période que Mandel avait désignée du nom de " Capitalisme tardif » ou " Troisième âge du capitalisme » et toutes les caractéristiques de cette période qu'il avait définies, correspondent au développement actuel de la politique du capital. Ce qui a changé c'est uniquement la vitesse à laquelle le capitalisme s'est imposé partout dans le monde. Cette formidable accélération remonte à l'écroulement du bloc de l'Est.
Deuxièmement le terme " mondialisation » n'est qu'une autre dénomination pour désigner une tendance inhérente au capitalisme, son expansion dans le monde entier - ce qui n'est donc en rien un changement qualitatif.
Troisièmement le concept de " néolibéralisme » est un terme imprécis, en effet il y a plusieurs écoles néolibérales, dont certaines très éloignées de l'actuelle politique économique reposant sur l'offre (ainsi le néolibéralisme allemand classique de l'école de Eucken, Röpke etc. préconise une intervention de l'État dans la vie économique).
Et quatrièmement ces deux concepts sont souvent utilisés dans un sens laissant entendre qu'il existe un " autre » capitalisme — dans le même ordre d'idées apparaissent également des classifications zoologiques comme " capitalisme carnassier » par exemple. Il faut absolument objecter que, aujourd'hui comme hier, nous avons affaire au capitalisme au sens commun du terme et que la question de savoir s'il est plus ou moins " rapace » dépend uniquement des rapports de forces dans la société.
Et là est le sujet, car ce qui est décisif pour évaluer ces rapports de forces c'est l'état des organisations des salariés.
2. Politique économique libérale et ses conséquences sur le mouvement syndical
Sur le plan mondial et européen, nous nous trouvons toujours dans une phase d'onde longue à dominante dépressive. L'objectif de la classe au pouvoir ces vingt dernières années a été de trouver une solution pour sortir de la crise économique qui perdure, solution permettant tout simplement de relever les taux de profit grâce à un faisceau de mesures.
En substance, il s'agit des points suivants, que nous aborderons de façon plus approfondie par la suite :
— Précarisation des conditions de travail. Comme nous pouvons le voir par exemple en Allemagne, on assiste à une diminution drastique des prétendues " conditions normales de travail » c'est-à-dire un emploi à temps plein et à durée illimitée .
— Tentative d'importation de main-d'œuvre bon marché ; dans ce domaine la directive Bolkestein devrait être une avancée décisive pour le capital.
— Diminution des coûts dans le domaine social (baisse des retraites et diminution de la protection maladie etc.) et cela grâce à la privatisation et à la réduction des subventions.
— Internationalisation de la production (à l'intérieur et hors d'Europe). C'est ce qu'on appelle aujourd'hui " mondialisation » ce qui d'un point de vue qualitatif n'est pas nouveau. La différence est qu'aujourd'hui, d'une part la vitesse de ce processus a augmenté considérablement et que d'autre part, en raison de la révolution technologique, le transfert d'unités de production est plus aisé et plus rapide que jamais, ce qui signifie que la production se localise prioritairement là où les coûts salariaux sont les plus faibles.
— Diminution des impôts pour les possédants.
— Utilisation maximale des possibilités de la révolution technologique : rationalisation, automatisation, production à flux tendu.
Toutes ces mesures furent plus ou moins appliquées dans tous les pays européens, mais pas l'ensemble de ces mesures dans tous les pays à la fois, au même moment et au même degré. C'est ce qui explique en partie le développement inégal de chacune des économies nationales considérées au sein de l'Union européenne. Dans ce processus, une partie des mesures citées, en particulier l'internationalisation de la production, est utilisée comme une menace à l'encontre de la classe ouvrière du pays et de ses organisations. Les possédants poursuivent avec cette politique globale deux objectifs importants :
— faire de l'Union européenne le bloc économique le plus puissant et le plus dynamique au monde. C'est là l'enjeu du " processus de Lisbonne » ;
— surmonter la crise de la baisse du taux de profit.
3. Une politique directement dirigée contre le mouvement syndical
Ici, nous ne devons pas ignorer que des stratégies différentes dans les différents pays existent et qu'il est donc très difficile de procéder à une généralisation .
L'explication en est qu'il subsiste dans les différents pays des règles juridiques différentes définissant les droits des syndicats. En conséquence, la façon d'agir ouvertement contre eux, dans le but de mettre en place les conditions d'une politique décrite dans le point 2, sera différente dans chaque pays
En Allemagne par exemple, les droits des syndicats, le droit de grève particulièrement, est depuis toujours, très encadré. La grève n'est autorisée qu'en cas de négociations portant sur les salaires ou les termes du contrat de travail, les grèves politiques sont en général illégales et il y a certaines règles qui restreignent les activités syndicales. En outre, en Allemagne la social-démocratie a exercé et exerce toujours une forte influence directe sur le DGB (la confédération générale des syndicats), influence nullement contestée de façon significative dans le pays. C'est pourquoi le besoin de changer la législation concernant les syndicats ne s'est pas fait sentir en Allemagne, même si quelques décisions judiciaires ont apporté certaines restrictions.
Dans la plupart des autres pays de l'UE il y a plusieurs confédérations syndicales, liées à différents courants ou partis politiques, mais principalement à des partis, qui défendent l'idéologie politique et économique dominante ( à l'exception de l'Espagne)
Le pays, qui a subi les attaques les plus dures contre les droits syndicaux est la Grande- Bretagne, où, dans les années quatre-vingts sous le gouvernement Thatcher, les syndicats ont considérablement perdu en importance et en influence, en raison des modifications significatives de la législation.
Nous ne pensons pas que ce soient les mesures prises contre le mouvement syndical, y compris les mesures législatives, qui expliquent le mieux la situation syndicale. C'est bien l'offensive libérale de ces 25 dernières années qui a joué un rôle essentiel, mais les directions syndicales ont totalement capitulé devant elle en se laissant entraîner par la logique inhérente de la politique économique libérale.
4. Les effets de la politique économique libérale dans le détail
A l'aide de quelques chiffres et statistiques, nous allons tenter d'esquisser quelques éléments de cette évolution et ses arrière-plans. Cette description ne peut être exhaustive, mais elle contribuera à faire comprendre les ressemblances mais également les différences d'évolution des mouvements syndicaux dans les différents pays européens.
4.1. les transformations du marché du travail
Le graphique suivant est construit à partir des chiffres de la R.F.A., mais l'évolution générale ici perceptible est observée dans l'Europe entière. Comme nous pouvons le voir, les conditions d'emploi des salariés se sont transformées de façon dramatique. En 1980 nous avions en Allemagne encore 80% des salariés qui bénéficiaient de conditions normales d'emploi, c'est-à-dire de contrat à temps plein et illimité, alors que toutes les autres formes d'emploi, comme le temps partiel, les contrats à durée limité, les petits boulots, occupaient une place négligeable - l'intérim n'existait pratiquement pas. Aujourd'hui, les conditions normales d'emploi représentent moins de 50% et la tendance est encore à la baisse, l'augmentation la plus importante, on la rencontre chez les salariés à temps partiel et pour les minijobs et les CDD. L'intérim a également augmenté de façon exponentielle. Il est particulièrement intéressant d'observer l'augmentation du nombre de travailleurs indépendants, qui travaillent en sous-traitance. Ces travailleurs, qui auparavant effectuaient le même travail en tant que salariés, le font maintenant en tant qu' indépendants. En général, ils travaillent pour la même entreprise qu'avant, mais assument eux-mêmes les risques et très souvent avec des revenus nettement inférieurs. Cela a naturellement des effets non négligeables sur la capacité de lutte des syndicats dans certaines branches, puisque ces travailleurs prétendument indépendants ne font plus partie du champ de syndicalisation et peuvent encore moins être mobilisés.
Il en est de même pour les salariés, employés en contrat à durée limitée, les précaires ainsi que les intérimaires. Ces personnes sont pour des raisons presque identiques difficilement mobilisables pour des actions syndicales.
Il serait bien sûr erroné de présenter cette évolution comme l'aboutissement d'un complot contre le mouvement ouvrier consciemment élaboré. Il s'agit ici en substance d'une conséquence de la stratégie capitaliste évoquée plus haut, en vue de reconstituer les taux de profit. Il n'est pas nécessaire de développer ici que la flexibilisation des conditions d'emploi a de substantiels avantages de coûts pour le patronat. Le changement de l'organisation des emplois a des conséquences qui rendent la résistance de la classe ouvrière et de ses organisations syndicales difficile, voire même dans certains secteurs impossible, et ceci a évidemment un effet secondaire positif pour les patrons. Les répercussions sur la conscience des travailleurs de cette transformation de la réalité du monde du travail, particulièrement la montée croissante de l'individualisme, très sensible chez les travailleurs indépendants, ainsi que la perte concomitante de la conscience syndicale, prennent une importance que l'on a du mal à estimer à sa juste valeur.
Nous pouvons constater ici (Tableau 1), qu'en raison de cette dramatique transformation de la structure des emplois, les capacités de luttes des organisations syndicales ont été considérablement réduites d'une part, et d'autre part que pour un grande nombre de travailleurs, elle a eu des conséquences négatives sur la conscience syndicale.
4.2. L'évolution en adhérents des syndicats
A première vue, on pourrait penser que le tableau 2 qui suit contredit en partie l'évolution décrite dans le paragraphe précédent. Comme nous pouvons le voir, le nombre d'adhérents des syndicats en Europe continentale, c'est-à-dire en Autriche , Italie, Allemagne, Pays-Bas, et France mais également en Irlande et Grande-Bretagne a baissé continuellement depuis 1980 au moins (ceci est également vrai pour le Japon et pour les États-Unis).
Dans les pays scandinaves et en Belgique, c'est tout à fait différent. Nous avons dans ces deux cas une croissance régulière du nombre d'adhérents, ou pour le moins une stabilisation du nombre d'adhérents dans la même période.
Mais cette évolution à première vue très divergente entre la Scandinavie et le reste de l'Europe s'explique par d'autres raisons. Des changements comme ceux qui sont advenus dans la structure des emplois n'agissent pas de manière linéaire sur le degré d'organisation dans les syndicats. D'autres facteurs jouent également un rôle : nous reviendrons par la suite sur les plus importants. Le taux de syndicalisation ne permet pas de tirer de conclusion sur la vigueur des luttes dans les pays concernés.
Mais il ne faut pas oublier que, non seulement en Europe, mais également dans les pays industriels hors d'Europe, l'offensive économique libérale des 25 dernières années a considérablement fait reculer le taux de syndicalisation. L'une des raisons principales en est sans aucun doute la modification décrite plus haut des conditions d'emploi.
4.3. Le développement des luttes dans le monde du travail
Il est intéressant de considérer l'évolution du nombre et de la durée des grèves au cours des 15 dernières années (Tableau 3). Deux choses sautent aux yeux : tout d'abord, on constate qu'il n'y a pas de corrélation automatique entre le degré d'organisation syndicale et le nombre de jours de grève. Il est vrai que dans une série de pays, particulièrement en Allemagne, le nombre de jours perdus pour fait de grève par des milliers de salariés a reculé parallèlement à la baisse continue du taux de syndicalisation. Cependant il y a ailleurs des pays, comme par exemple la France, où au début de la phase, le degré faible de syndicalisation et la baisse continue de la syndicalisation n'empêchent pas un maintien relativement élevé du nombre de grèves en comparaison aux autres pays.
Pour expliquer cela, il ne faut pas oublier que le droit de grève a un statut légal différent selon les pays. Ainsi en Allemagne, il est encadré de manière très restrictive, les grèves politiques sont en général interdites. Les grèves de solidarité ne sont autorisées que dans un cadre bien limité. Mais si on considère l'Union Européenne ou la zone Euro, il nous faut constater qu'en moyenne, on observe une baisse régulière du nombre de grèves depuis 1990.
Le graphique suivant (Tableau 4) montre la moyenne du nombre annuel de jours de grève pour 1000 salariés pendant la période 1995-2003. On peut faire deux observations : tout d'abord les pays qui ont de loin le plus petit nombre de jours de grève sont les pays de l'Europe de l'Est, qui, après la dissolution du Comecon, ont connu un processus de désindustrialisation dramatique et qui par la même ont perdu " les plus gros bataillons » de syndiqués. Il est intéressant d'observer également que l'Allemagne a connu durant cette période un faible nombre de grèves. Deux raisons à cela : d'une part, en Allemagne de l'Est après la chute du mur, le même processus de désindustrialisation s'est produit, avec les mêmes conséquences (chômage élevé et disparition d'emplois stables) et d'autre part la croissance économique en Allemagne depuis 1990 est nettement plus faible que dans les autres pays occidentaux de l'Union Européenne.
Et c'est là le deuxième point intéressant : nous pouvons constater que l'importance du nombre de jours de grève est en corrélation avec la croissance économique à quelques restrictions près. C'est au Danemark que l'on observe depuis 1990 en moyenne le plus de jours de grève, c'est également au Danemark comme en Finlande que la croissance économique est la plus importante
Cependant, il faut noter que des facteurs historiques entrent également en compte; dans des pays comme l'Espagne, la France , l'Italie, l'habitude de lutter est fortement ancrée et, de ce fait indépendante du taux de syndicalisation. Ceci a des raisons multiples, que nous n'aborderons pas ici.
4.4. Degré d'organisation et système contractuel
Dans le graphique qui suit (Tableau 5), un économiste bourgeois a tenté en 2002 de montrer la relation entre le taux de syndicalisation — le pourcentage de salariés organisés — et la manière dont le système de convention collective est réglé, le degré d'extension de la convention collective c'est-à-dire dans quelle mesure la convention collective négociée par les syndicats s'appliquera à tous les salariés. Dans le graphique, on remarque que l'on peut procéder à différents regroupements selon le système économique et le mode d'organisation syndicale qui prédomine dans les groupes de pays. Bien sûr, il n'y pas ici non plus de formes idéales, mais certaines transitions. L'auteur différencie pour l'essentiel trois types ; l'économie décentralisée et dérégulée, ce qu'il appelle l'économie libre de marché ; ensuite le capitalisme rhénan, dans lequel il y a une puissance de régulation des syndicats avec une intervention de l'État et de puissantes organisations de travailleurs et enfin, le coopérativisme avec des syndicats fortement centralisés, qui ont une capacité de régulation.
Ici, nous trouvons la solution au problème évoqué au paragraphe 4,1 c'est-à-dire que les syndicats scandinaves, en particulier en Suède, ont un taux de syndicalisation de plus de 80%, mais que d'un autre côté la fréquence des luttes n'est en rien comparable. Ceci résulte du fait que, dans un système de coopération, les syndicats assument une part des fonctions assurées par l'État dans un autre système. L'appartenance syndicale joue un rôle de garantie sociale.
En résumé, ce graphique montre que, dans un système de coopération, le taux de syndicalisation atteint son maximum , alors que dans le système appelé capitalisme rhénan, le degré d'organisation est plutôt faible à taux de couverture par des conventions collectives identique voire supérieure. Le système décentralisé et dérégulé, qui prévaut dans l'économie libérale de marché présente avec un taux de syndicalisme moyen, un faible taux de couverture par conventions collectives.
Si l'on compare ceci maintenant avec les chiffres présentés plus haut concernant le nombre de grèves, on constate grosso modo que les systèmes économiques les plus libéraux ont également le plus petit nombre de jours de grève.
4.5. Les femmes dans les syndicats
Un changement important dans le mouvement syndical de ces dernières 30 années est le changement du taux de syndicalisation des femmes. Nous présentons ici les chiffres comparés entre 1970 et 2001 pour trois pays. En général, le nombre de femmes syndiquées a crû de 100% pendant la période. Les raisons en sont pour une part la croissance exponentielle de l'activité féminine et d'autre part également la chute du nombre d'hommes syndiqués. Cependant, il faut noter que ces importants changements structurels se sont fort peu fait sentir aux niveaux supérieurs de la hiérarchie des syndicats dans la plupart des pays.
5. Conclusions
Nous avions ces vingt-cinq dernières années une situation :
— de crise économique
— de recul de l'activité de lutte de classe avec des défaites symboliques ( les mineurs en Grande-Bretagne dans les années 1980)
— de politique d'accommodation et de capitulation des principales organisations syndicales dans les pays capitalistes d'Europe face à l'offensive libérale du Capital.
— de recul général du taux de syndicalisation.
Dans les trois dernières années, il semble d'après les chiffres récents qu'un revirement soit en train de se produire, le nombre de jours de grève (et par endroits le taux de syndicalisation) sont en augmentation, et nous avons une succession de luttes économiques et politiques menées par les syndicats mais :
— Presque toutes ces luttes (et leur nombre croît) sont de nature défensive, elles sont dirigées par exemple en Allemagne contre la tentative de rallonger le temps de travail, de diminuer les salaires et de rendre les conditions de travail encore plus dures.
— Face au patronat européen ,qui a développé une stratégie commune contre la classe ouvrière, il n'existe pas de stratégie visible commune des organisations syndicales (à l'exception des fédérations des transports qui ont impulsé avec succès une action contre la directive sur les transports dans l'Union européenne) et il n'y a que très peu d'actions communes.
— Les syndicats sont encore toujours trop nationaux.
— Une grande partie des directions syndicales est étroitement liée aux partis qui défendent une ligne de politique libérale de marché, et /ou est purement et simplement corrompue.
La tâche essentielle du mouvement syndical européen dans les prochaines années est de s'opposer à la stratégie européenne du patronat, qui se manifeste au plan économique de façon visible par une aggravation de la flexibilité et de la mobilité. Sur le plan politique, ce sont des projets comme l'Agenda de Lisbonne, avec la tentative de le mettre en place grâce à une batterie de mesures particulières, aux nombre desquelles la directive sur les transports, la directive Bolkestein ou le projet de Constitution. Il s'agit d'y opposer une stratégie syndicale unitaire européenne transfrontières qui organise réellement l'action, ce qui nécessite de dépasser le cadre des organisations internationales syndicales purement bureaucratiques actuelles.