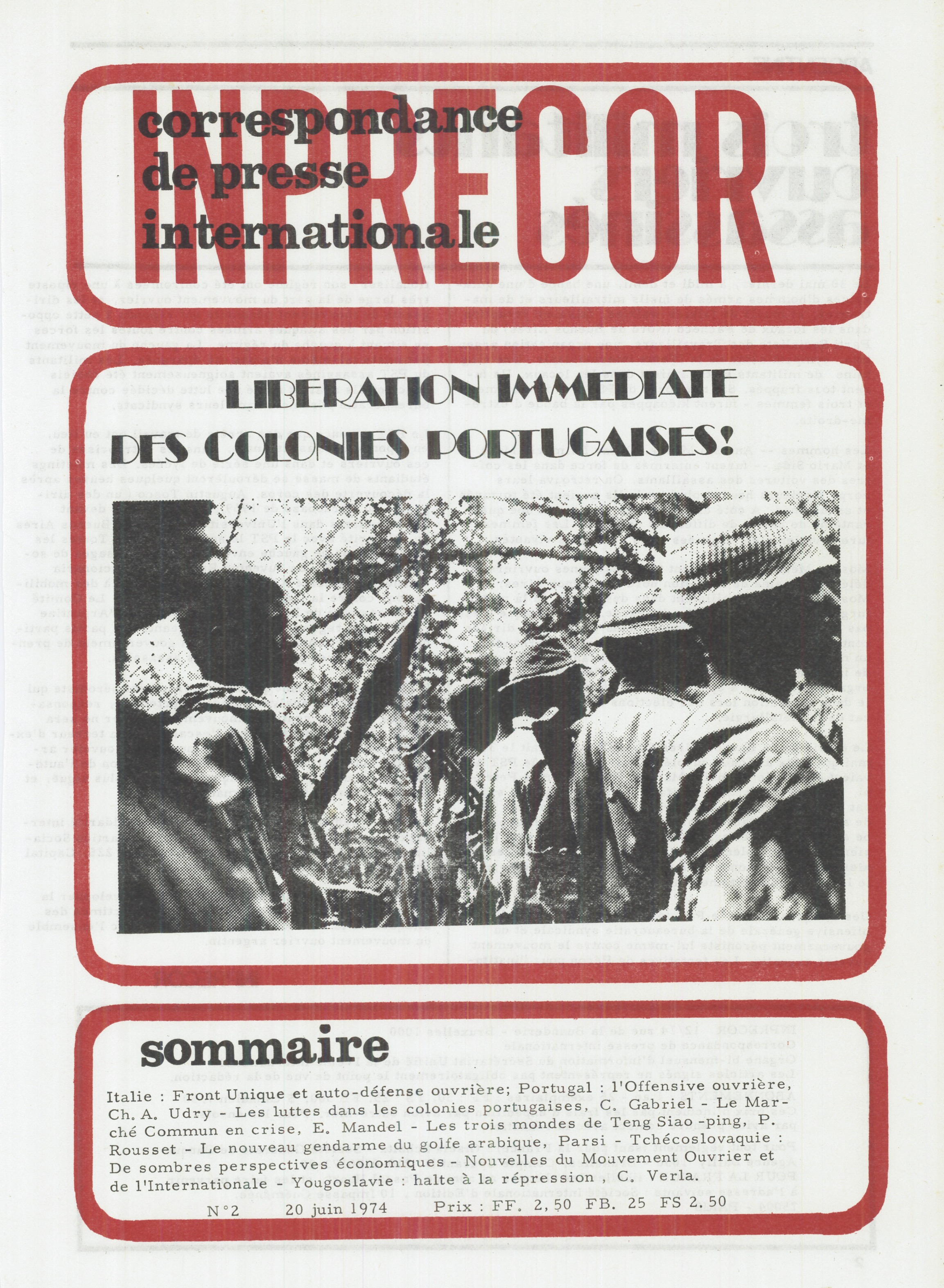Avril 1974. Teng Siao-ping dirige la délégation chinoise à la 6ème session extraordinaire de l'ONU. C'est un événement en soi. Teng Siao-ping, secrétaire général du Parti Communiste chinois en 1965, fut en effet l'un des principaux limogés de la Révolution Culturelle avec Liu Shao-chi et Peng-chen. On l'appelait alors, à Pékin, le « second Khrouchtchev chinois ». Après 7 ans d'éclipse, il réapparaissait discrètement un an avant son envoi triomphal à l'ONU. Il s'affirme, aujourd'hui et à nouveau, comme l'un des dirigeants les plus importants de la République Populaire de Chine. Cette réhabilitation silencieuse — exempte de toute autocritique de sa part ou de la part de ses contradicteurs d'antan, et opérée en pleine campagne anti-Confucius-anti-Lin Piao — en dit long sur le maintien d'une couche bureaucratique installée au pouvoir et susceptible de régler bien des problèmes politiques de fond hors de tout contrôle de masse. La Révolution Culturelle, malgré les mobilisations de masse qu'elle a suscitées, n'aura pas renversé cette bureaucratie. Elle aura modifié les rapports de force en son sein et entre elle et les masses. Mais le plus significatif est probablement le discours-programme que Teng Siao-ping a prononcé à l'ONU lors de cette session consacrée au débat sur les matières premières et qui a vu les pays semi-coloniaux producteurs de matières premières tenter de faire bloc face aux pays impérialistes.
Trois mondes
Il y a peu, le Parti Communiste Chinois (PCC) découpait l'arène internationale en quatre grands ensembles : les deux super-puissances, les USA et l'URSS, le « camp socialiste » et les deux « zones intermédiaires » : les puissances impérialistes « secondaires » (hors les USA) et les pays capitalistes dominés et sous-développés. L'intervention de la délégation chinoise en avril, à l'ONU, est évidemment empreinte des soucis tactiques de s'intégrer au bloc du « tiers-monde ». Mais Teng Siao-ping va, dans son discours, plus loin : il formule une appréciation de la situation mondiale qui révise sur plusieurs points les thèses antérieures et tend à offrir à la diplomatie chinoise une cohérence nouvelle. En un paragraphe lapidaire il définit l'existence de « trois mondes » distincts en fonction desquels doit s'orienter la politique étrangère de la République Populaire de Chine.
« Dans cette situation (internationale), déclare-t-il, caractérisée par de "grands bouleversements sous le ciel", les diverses forces politiques dans le monde, par suite d'un affrontement et d'une lutte de longue haleine, ont connu des divisions et des regroupements intenses. Une série de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine ont successivement accédé à l'indépendance, ils jouent un rôle grandissant dans les affaires internationales. Le camp socialiste, qui avait existé pendant un temps après la seconde guerre mondiale, a déjà cessé d'être, avec l'apparition du social-impérialisme. Sous l'effet de la loi de l'inégalité du développement du capitalisme, le bloc impérialiste occidental s'est également désagrégé. À en juger par les changements survenus dans les relations internationales, notre globe comporte maintenant, en fait, trois parties, trois mondes qui sont à la fois liés mutuellement et contradictoires entre eux. Les États-Unis et l'Union Soviétique forment le premier monde ; les pays en voie de développement d'Asie, d'Afrique, d'Amérique Latine et des autres régions, le tiers-monde ; et les pays développés se trouvent entre les deux, le second monde. » (je souligne – P. R.) (1)
Le plus remarquable, dans les thèses développées par Teng Siao-ping est la marginalisation ultime du rôle des luttes de classes proprement dites. C'est la lutte des « pays pauvres » contre les « riches », des « petits pays » contre les « grands » qui domine l'arène internationale.
Le tiers-monde « force motrice » révolutionnaire
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les dirigeants chinois assignent au tiers-monde une place déterminante dans la dialectique de la révolution mondiale. La théorie de la « zone des tempêtes », chère à Lin Piao, illustrait déjà le scepticisme relatif dont le PCC faisait preuve à l'égard de la capacité de la classe ouvrière occidentale de renverser le régime capitaliste. La période de la « révolution culturelle » avait produit l'élargissement de l'horizon et de l'intérêt porté aux luttes ouvrières. Les thèses défendues actuellement ne sanctionnent pas, on le verra, un « repli » nouveau sur le tiers-monde. Au contraire. Mais elles opèrent un triple glissement qui tend à systématiser plus, théoriser mieux et généraliser ce qui était déjà présent dans la pratique et les conceptions du PCC quant à sa politique à l'égard du monde néo-colonial.
La tâche historique assignée aux luttes du tiers monde est réduite à la recherche de l'indépendance effective face à l'impérialisme et l'« hégémonisme » :
« Les nombreux pays en voie de développement... se trouvent confrontés, sans exception, à la tâche historique de liquider les forces résiduelles du colonialisme, de développer l'économie nationale et de consolider l'indépendance nationale... Ils constituent la force motrice révolutionnaire qui fait avancer la roue de l'histoire universelle, de même que la force principale dans la lutte contre le colonialisme, l'impérialisme et, en particulier, contre les super-puissances. » (2)
Les termes utilisés ici par Teng Siao-ping montrent qu'il ne s'agit pas là d'une déclaration visant seulement à commenter un événement ponctuel, mais bien tendant à présenter une stratégie pour la période. C'est là l'un des éléments qui explique l'analyse fort unilatérale faite par le PCC de la « bataille du pétrole », qui « oublie » que cette hausse du prix du pétrole profite essentiellement aux multinationales et... aux bourgeoisies indigènes des pays producteurs et non aux peuples du tiers-monde, sans compter les « problèmes » auxquels se trouvent confrontés des pays comme l'Inde, l'Éthiopie, et les pays africains déshérités.
L'étude des conditions de réalisation de cette tâche historique qui est l'indépendance des pays coloniaux ou semi-coloniaux fait en effet totalement abstraction de la structure sociale des États considérés. C'est Huang Hua, chef adjoint de la délégation chinoise, qui le souligne avec le plus de clarté dans son allocution du 1er Mai en session plénière où il déclare que « les conditions nécessaires... pour assurer l'indépendance politique et économique (des pays en voie de développement) et pour développer leur économie nationale dans l'indépendance, c'est de se débarrasser sur le plan économique du monopole colonialiste, néo-colonialiste et impérialiste, de mettre fin au pillage et balayer tous les obstacles ; ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour défendre leurs ressources économiques et leurs droits et intérêts. » (je souligne) (3) Nulle part la révolution socialiste n'est présentée comme la condition indispensable à l'indépendance réelle par rapport à l'impérialisme et au marché capitaliste mondial.
Le plus grave est peut-être l'assimilation complète opérée entre les peuples et « leurs » gouvernements quelle qu'en soit la nature. Teng Siao-ping déclare sans ambages que « les peuples des pays en voie de développement ont le droit d'opter pour le système social et économique de leur choix, et d'en décider eux-mêmes. » (4) Notion nouvelle du choix pour les marxistes ! Si la majorité des « peuples » anti-impérialistes du tiers monde a « choisi » le régime capitaliste, on conçoit que la bureaucratie chinoise accorde le label d'anti-impérialisme à des gouvernements et des chefs d'État ultra-réactionnaires et répressifs tels le Shah d'Iran et Hailé Sélassié d'Éthiopie. Ou, par exemple, au président du Sénégal qui a été reçu dernièrement par Chou En-lai et Mao Tsé-toung à Pékin, Léopold Senghor. L'un des produits les plus achevés du néo-colonialisme dans l'Afrique francophone. Le premier ministre chinois, dans son allocution de bienvenue, n'a néanmoins pas hésité à féliciter le gouvernement sénégalais qui... « dans les affaires internationales..., a appliqué une politique de non alignement, combattu l'impérialisme, le colonialisme et l'hégémonisme... » (5) On se demande pourtant pourquoi le raisonnement assimilant les peuples à « leurs » gouvernements ne vaudrait pas pour les peuples soviétique et nord-américain ! À moins que dans la conception de Teng Siao-ping, ce soit les peuples de ces deux super-puissances qui exploitent le tiers-monde...
La diplomatie chinoise ne souffre qu'une exception à cette règle, dans le cas de « gouvernements fantoches » ou des administrations coloniales confrontés à des gouvernements ou fronts révolutionnaires développés (GRP, GRUNK, Guinée Bissau...). Encore ce cas s'avère-t-il bien restrictif : la Chine de Mao Tsé-toung n'a pas jugé bon de rompre les relations diplomatiques avec la junte chilienne et n'a pas craint d'accueillir dernièrement un nouvel ambassadeur la représentant à Pékin. Le voyage de Nixon à Pékin avait montré, de même, que si la reconnaissance du GRP par la République Populaire de Chine n'a jamais été remise en cause, la bureaucratie chinoise n'hésitait plus à définir sa stratégie internationale sans grand souci des très graves difficultés qu'elle occasionnait aux peuples d'Indochine « frères ». Aujourd'hui la politique maoïste à l'égard de l'Angola manifeste de cette même priorité accordée à la défense des intérêts et des relations d'États. Le soutien de la Chine s'est en effet tourné vers le Front de Libération Nationale de l'Angola de Holden Roberto, aile droite du mouvement national angolais, beaucoup moins représentatif que le MPLA (6). Cent douze instructeurs chinois viennent même d'arriver à Kinshasa (7) pour aider à l'encadrement de l'« armée » de Holden. Derrière cet appui au FNLA, ce sont les rapports entre la République Populaire de Chine et le Zaïre de Mobutu, assassin du révolutionnaire africain Patrice Lumumba, et la politique maoïste à l'égard du centre-Afrique, qui sont fondamentalement en cause.
Lutter contre l'« hégémonisme »
La priorité, ouvertement proclamée, de la stratégie maoïste à l'égard du tiers monde ne vise donc pas à stimuler les mouvements de libération armés et révolutionnaires, mais à tenter de former un « bloc » de l'ensemble des États tels qu'ils sont aujourd'hui constitués. L'objet de ce « bloc » est la lutte contre la politique d'« impérialisme » et d'« hégémonisme » des deux super-puissances. Son axe en est une défense commune de la « souveraineté d'État ».
Dans cette mesure la politique extérieure de la Chine, même si elle est motivée elle aussi par une conception bureaucratique des intérêts d'État, diffère nettement de celle de l'URSS. L'ouverture vers les États-Unis était ressentie comme une nécessité, pour permettre la réinsertion de la République Populaire de Chine dans l'arène diplomatique internationale (entrée à l'ONU...) comme pour mettre définitivement fin au blocus économique qui tendait à priver l'économie chinoise de biens d'équipements dont elle avait besoin. Lors du voyage de Nixon à Pékin, ces considérations ont primé sur toutes les autres (Indochine). Cette politique de « coexistence pacifique à trois » dans laquelle la direction maoïste a accepté d'entrer, a porté un coup sévère à bien des mouvements révolutionnaires. Elle n'a cependant pas donné naissance à une politique de « détente » concertée et durable analogue à celle préconisée par Moscou. Les relations USA-RPC marquent le pas. Surtout la recherche d'un « bloc » avec les pays en voie de développement implique la dénonciation conjointe des deux « grands ». Et si l'accent semble plutôt mis sur le danger, particulièrement pernicieux, que représente pour le tiers monde le « social-impérialisme » soviétique, un dosage savant équilibre les critiques portées à l'URSS ou aux USA.
La « détente » est constamment qualifiée d'illusoire. Au contraire la lutte pour l'« hégémonie » que se livrent les deux super-puissances implique pour la Chine un danger constant de nouvelle guerre mondiale. Il est difficile de savoir ce qui, dans la politique maoïste, tient de l'analyse et de la propagande en ce qui concerne le danger de guerre, que ce soit entre l'URSS et les USA (le conflit armé entre eux est parfois présenté comme « inévitable ») ou entre l'URSS et la République Populaire de Chine. Depuis le conflit qui avait opposé les troupes soviétiques et chinoises en 1969 sur l'Oussouri, la tension a notablement crû. Le prétexte en est la délimitation exacte du tracé frontalier. Après l'arrestation, en mars, de l'équipage d'un hélicoptère soviétique qui s'était aventuré au-dessus du territoire chinois, l'URSS a brusquement augmenté la mise. Elle revendique maintenant l'administration d'une partie de la province de Heilongjiang et notamment le contrôle sur des voies d'eau importantes de cette région où confluent l'Amour (Heilong en chinois) et l'Oussouri (Wusuli). Cette tension sino-soviétique très probablement s'explique partiellement par des raisons de politique intérieure. Le « danger chinois » est notamment un des rares thèmes sur lequel la « direction soviétique » peut s'assurer d'un large écho populaire. Mais l'URSS s'inquiéterait aussi de la naissance d'une nouvelle puissance nucléaire sur sa frontière asiatique. Selon Neville Maxwell des contacts auraient même été pris avec l'administration Kennedy pour envisager une attaque atomique « préventive » contre les sites nucléaires chinois. (8) Quarante-cinq divisions soviétiques stationnaient en 1973 le long de la frontière contre seulement quinze en 1967. Elles seraient insuffisantes, cependant, selon l'« Institut d'Étude Stratégique » de Londres pour permettre la réalisation, aujourd'hui, d'une telle attaque. Surtout, le contexte international marqué par la fin de l'isolement chinois et la crainte de conflits nucléaires, la rend politiquement très difficile et excessivement coûteuse.
La lutte contre un danger éventuel de guerre et l'« hégémonisme » domine néanmoins la diplomatie chinoise : condamnation du projet de « sécurité collective » préconisé en Asie par l'URSS pour isoler la Chine ; dénonciation, lors du voyage du chypriote Makarios à Pékin, de la concurrence en Méditerranée des deux « super-grands », etc. C'est dans ce domaine que la politique étrangère chinoise vient d'enregistrer son échec le plus grave. La République Populaire de Chine est le seul État, avec l'Irak, à s'être abstenu au Conseil de Sécurité de l'ONU sur l'envoi d'une force des Nations Unies sur le Golan pour séparer les troupes israéliennes et syriennes. La crise du Moyen-Orient et la question palestinienne était pour la Chine l'un des axes fondamentaux de sa diplomatie. Elle n'aura réussi à détacher, effectivement, des « grands » aucun des États arabes, ni à s'assurer un écho sérieux parmi les directions des organisations palestiniennes, davantage tributaires de l'URSS.
L'Europe, cas « complexe »
« La rivalité entre les super-puissances s'étend partout dans le monde » déclare Teng Siao-ping, mais sur le « plan stratégique, le point clé de leur rivalité, c'est l'Europe ». (9) Puisque le bloc impérialiste s'est « désagrégé », le « second monde » des pays industrialisés doit être rallié en partie à la cause du tiers monde. En effet, l'« hégémonisme et la politique du plus fort pratiquée par les deux super puissances ont suscité... un vif mécontentement des pays développés du "second monde". » (10)
Bien sûr le problème n'est pas simple : « les pays développés situés entre les super puissances et les pays en voie de développement présentent des cas complexes. Certains d'entre eux maintiennent jusqu'à ce jour des rapports colonialistes sous diverses formes avec des pays du tiers monde ; le Portugal » (le discours de Teng Siao-ping est prononcé avant le coup d'État de Spinola) « par exemple, continue même d'exercer sa domination coloniale barbare. Cet état de chose doit être redressé (sic). » Mais « tous ces pays demandent, à tel ou tel degré, à s'affranchir de l'asservissement ou du contrôle des super puissances et à préserver leur indépendance nationale et l'intégrité de leur souveraineté ». (11)
Cette analyse maoïste de l'évolution de la situation du « second monde » et les tâches qui en découlent est particulièrement grave. Cette puissance capitaliste européenne unifiée que le PCC appelle de ses vœux donnerait naissance à un nouveau « super grand » impérialiste aux côtés des USA. Cette intégration européenne est souhaitée par une partie des bourgeoisies de ce continent. Elle leur permettrait en effet de faire mieux face et à la concurrence américaine et à la montée actuelle de la classe ouvrière occidentale. Pire, cet État bourgeois européen unique, avec son gouvernement, son armée, sa diplomatie, ne pourrait se construire que sur la base de l'écrasement de la classe ouvrière, pour permettre la réorganisation industrielle nécessaire et les investissements de réorganisation de la production, et l'échec de cette montée. De même, l'émergence de cette nouvelle puissance ne mettrait pas un terme à la « tension » internationale d'aujourd'hui. Au contraire, elle provoquerait (et naîtrait de) une accumulation de la concurrence inter-impérialiste mondiale... pour le pillage du tiers-monde et la pénétration des États ouvriers comme des marchés capitalistes développés. Les révolutionnaires ne peuvent être pour ou contre l'« Europe » en général — ou le Marché Commun en particulier. Ils ne peuvent qu'être contre l'Europe des trusts, pour l'Europe des travailleurs. Le rôle contre-révolutionnaire du Japon, confirmé par le renforcement même de cet impérialisme face aux USA est lui aussi occulté. Il ne s'agit pas là d'« erreur » d'analyse. Il s'agit d'une vision du monde déterminée par le point de vue étroit d'une bureaucratie d'État qui cherche, au travers de la « théorie » des contradictions secondaires et principales à comptabiliser les aspects « positifs » qui peuvent, dans la politique de chaque gouvernement, asseoir sa position internationale ou intérieure.
Pékin Information relate (parfois) les luttes ouvrières européennes. Mais l'essentiel de la politique étrangère de la Chine tend à découvrir les « aspects positifs » de la politique des gouvernements en place... ou des prétendants au pouvoir. Lors des dernières élections françaises, Pékin n'a pas fait mystère de ses préférences : Chaban-Delmas était censé représenter la poursuite d'une politique d'indépendance gaulliste. Mais, en désespoir de cause, Valéry Giscard d'Estaing valait mieux que Mitterrand qui cumulait un double désavantage, représenter l'atlantisme des socialistes et permettre l'arrivée au gouvernement de ministres « révisionnistes » du PCF. Mais c'est probablement le cas anglais qui est le plus « étonnant », quand bien même il est surprenant de voir Pékin Information relater avec satisfaction les discours de l'aile la plus réactionnaire de l'État-Major helvétique réclamant un « renforcement de la défense nationale » ! (12)
Fin mai, E. Heath, dirigeant du Parti conservateur, battu aux élections, était reçu comme un chef d'État — réception triomphale, il a même bénéficié d'une heure et demie d'entretien avec Mao Tsé-toung. Le protocole chinois est précis et ce n'est pas par hasard que de tels honneurs ont été rendus au... chef de l'opposition anglaise. Dans son discours, Teng Siao-ping fit sans vergogne l'éloge de la politique étrangère des conservateurs et « oublia » le malheureux Wilson dans ses toasts lors du banquet. Heath en profita pour prononcer un véritable discours électoral s'attardant sur l'Europe, l'OTAN et la situation des « moyennes puissances ». La direction maoïste tente parfois de justifier son opportunisme par son refus de « s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre pays » (un des cinq principes de la coexistence pacifique). Il semble que ce qui vaut pour le Chili de la junte ne vaut pas pour l'Angleterre du Parti travailliste ! La raison en est simple : Heath s'affirme pour l'Europe (capitaliste), Wilson, sous la pression de larges couches de travailleurs anglais, lui fait la moue.
Quant aux « démocraties populaires » (puisqu'elles font partie du « second monde » selon Teng Siao-ping) la direction maoïste marque ses préférences pour la Roumanie — parce qu'elle manifeste de l'indépendance à l'égard de l'URSS —, Roumanie qui a le triste privilège d'être le premier État ouvrier bureaucratisé à avoir décidé d'importants investissements au Chili de Pinochet.
L'évolution du communisme asiatique
Malgré l'échec qu'elle a enregistré au Moyen-Orient, la poursuite de l'intervention américaine en Indochine et l'importance de la présence soviétique en Asie, la diplomatie chinoise peut se targuer d'importants succès. Les échanges économiques avec les pays capitalistes avancés se développent rapidement et comprennent des biens d'équipement ultra-modernes (la France, 8ème fournisseur de la Chine et son 4ème client vient de tenir à Pékin la plus importante exposition industrielle qu'elle ait jamais organisée à l'étranger). C'est ce besoin d'échanges économiques qui explique l'absence de revendications concrètes de la Chine sur Macao, « province asiatique » du Portugal avec Timor. Macao, comme Hong Kong, est considéré comme partie de la Chine de Pékin. Mais Macao, comme Hong Kong, est un centre de transit essentiel et d'opérations financières entre le monde capitaliste et la République Populaire de Chine. Ce qui a poussé le porte-parole multi-millionnaire du PCC à Macao, Ho Yin, à déclarer que le renversement du régime de Caetano au Portugal, ne devait rien changer au statut et aux structures de Macao. (13)
Pour la direction maoïste cette augmentation en quantité et qualité des échanges commerciaux avec le monde capitaliste est essentielle pour permettre à l'économie chinoise de faire un nouveau bond. Il n'y a rien à redire quant à la nécessité de tels échanges. Il y a beaucoup à redire sur les choix politiques que la bureaucratie chinoise a déterminés pour les favoriser. (14)
Une offensive diplomatique se poursuit en direction de l'Afrique (centrale notamment). (Quatre chefs d'État africains sont venus en Chine depuis janvier : Kaunda, président de Zambie, Boumediene pour l'Algérie ; Nyerere, président de Tanzanie et Léopold Senghor du Sénégal). La « bataille des matières premières » a permis à la République Populaire de Chine de s'intégrer au « front » du tiers monde. Surtout la situation évolue maintenant très vite en Asie du Sud-Est et extrême-orientale.
Pékin a obtenu, en avril 1974, la signature d'un accord sino-japonais avec Tanaka sur les transports aériens qui a provoqué la fureur de Taïwan. Pour ce faire, Tokyo a accepté la rupture des relations aériennes avec la Chine nationaliste, point de transit important, ce qui coûtera cher à son économie. Le « lobby » japonais favorable à Taïwan semble bel et bien en perte de vitesse. La Malaisie, à son tour, vient d'établir des relations diplomatiques avec la Chine lors d'un voyage de son premier ministre, Abdul Razak. C'est le premier pays non communiste de l'Asie du Sud-Est à le faire. Les relations se détendent rapidement avec la Thaïlande — qui a envoyé une mission à Pékin en décembre 73 — et avec les Philippines du très pro-américain Marcos. Même l'Indonésie de Suharto semble prête à réviser (progressivement) son attitude. Mais tout ceci ne peut être sans conséquences importantes sur l'avenir des différents Partis communistes d'Asie.
Le voyage du dirigeant « Khmer Rouge » Khieu Samphan au Vietnam et en Chine a probablement permis le resserrement des liens entre la République Populaire de Chine et le FUNK (15). Mais l'annonce du voyage de Nixon à Pékin avait provoqué une première rupture publique grave avec le P.C. Vietnamien — rupture qui n'a pu que s'accentuer depuis et doit affecter tout le mouvement communiste indochinois. Le Japon est aujourd'hui la seconde puissance impérialiste, après les USA, à intervenir en Asie du Sud-Est, et a été la cible des mobilisations qui se sont produites lors du récent voyage de Tanaka en Corée du Sud, en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Dans l'ensemble de ces pays existent des mouvements de guérilla, plus ou moins développés, dirigés par des Partis communistes d'obédience maoïste. Ces derniers vont être à nouveau placés devant l'alternative suivante : prendre leur distance à l'égard de Pékin ou « modérer » leurs actions. Lors de son discours de bienvenue à Abdul Razak, Chou En-lai a fait allusion — positivement — à la « neutralisation » du Sud-Est asiatique, ce qui ressemble fort aux projets des très anti-communistes États de l'« Association des Nations du Sud-Est asiatique » (ASEAN). Il n'a pas répété ses allusions lors du départ du premier ministre malais. Le fait reste néanmoins inquiétant.
Après le renversement, en octobre 1973, par le mouvement étudiant et populaire du régime militaire de Bangkok, le PC thaïlandais et le PC vietnamien ont mis en lumière le caractère réactionnaire du nouveau gouvernement et appelé à la poursuite de la lutte. Pékin Information s'est tu sur les déclarations et les activités militaires (d'importantes zones de guérilla existent en Thaïlande) du Parti Communiste thaïlandais. L'agence « Chine Nouvelle » a seulement publié un tardif compte-rendu récapitulatif des principales actions menées dans le bulletin quotidien. (16) De prises de position du PCC, point ! La direction maoïste vient récemment d'apporter son appui aux PC de la fédération malaise en diffusant la déclaration publiée après le ralliement de nombreux insurgés (dont des dirigeants) au gouvernement dans la province insulaire du Kalimantan septentrional (17). Mais il semble bien que l'évolution de la diplomatie chinoise ait déjà d'ores et déjà provoqué de durs débats au sein du PC malais. (18) Plus à l'ouest, les courants maoïstes indiens n'ont toujours pas réussi à sortir de leur crise, tandis que la politique de la Chine à l'égard du Pakistan et du Bangladesh a tué les possibilités de développement de partis communistes pro-chinois à l'activité révolutionnaire dans ces deux pays.
La politique étrangère de la Chine a d’ores et déjà été un des facteurs qui ont provoqué la désagrégation du mouvement maoïste mondial dans les pays capitalistes développés, aidée par son inconsistance sur les questions de stratégie ouvrière. Le courant mao-spontanéiste a à peu près abandonné la référence stricte à la Chine. Les organisations mao-staliniennes, dans la majeure partie des cas, se sont réduites à l’état de sectes, relais des tournants de la diplomatie chinoise. Et les organisations mao-centristes n’arrivent plus à déterminer une orientation cohérente sur ces questions, se réfugiant souvent dans le silence. Aujourd’hui, l’évolution de la situation régionale va probablement accélérer un processus d’éclatement–recomposition du mouvement communiste asiatique. Et cela, dans un continent où les luttes de classes sont particulièrement développées et où l’influence maoïste était la plus profonde, sera peut-être demain l’une des conséquences majeures de l’évolution de la diplomatie chinoise.
Pour la direction maoïste, « le vent souffle de l’Est » et « la situation mondiale est excellente ». Force est de reconnaître que la cohérence de cette analyse apparaît mal. La disparition des États ouvriers (avec l’émergence du « social-impérialisme ») et la désintégration du « camp socialiste » selon Pékin indiqueraient plutôt le contraire. Surtout, les tâches internationales que s’assigne le PCC s’accordent mal avec le soutien nécessaire aux luttes ouvrières et révolutionnaires dans le monde. Luttes qui pourtant se développent effectivement avec, notamment, la relance possible de la révolution coloniale dans plusieurs secteurs (Afrique, Asie du Sud-Est et du Sud…) et — fait capital — l’approfondissement des luttes de classes en Europe occidentale. Les conditions objectives de la révolution socialiste mondiale manifestent une nouvelle fois leur maturité. La faiblesse essentielle de l’actuelle montée révolutionnaire internationale reste la désorganisation et la confusion de son avant-garde. La tâche essentielle d’une direction internationaliste à la tête d’un État ouvrier tel que la Chine serait d’aider à la recomposition d’un véritable mouvement communiste mondial. La direction maoïste favorise, elle, son éclatement.
Publié le 20 juin 1974
—
1. Pékin Information du 15 avril 1974, p. 7 et 8
2. Idem, p. 8
3. Pékin Information du 13 mai 1974, p. 10. Houang Hua marque bien quelques « réserves » à l’égard du document présenté à l’ONU par les pays du tiers-monde. Mais il ne s’agit là que de regretter l’utilisation des termes « indépendance économique » et « division mondiale du travail » qui pourraient être récupérés par les grandes puissances.
4. Pékin Information du 15 avril 1974, p. 12
5. Pékin Information du 13 mai 1974, p. 14
6. Mouvement Populaire de Libération de l’Angola. À ce sujet, voir dans ce numéro l’article sur les mouvements de libération dans les colonies portugaises.
7. Capitale du Zaïre, ancien Congo.
8. Voir Le Monde diplomatique de mars 1974, « Le conflit frontalier entre la République populaire de Chine et l’URSS ».
9. Pékin Information du 15 avril 1974, p. 8
10. Idem, p. 9
11. Idem, p. 8
12. Pékin Information du 26 novembre 1973
13. Voir Far Eastern Economic Review du 6 et du 13 mai
14. Le problème n’est pas seulement de politique internationale. Il renvoie aussi aux choix de développement intérieur opérés. INPRECOR y reviendra dans un numéro ultérieur.
15. Le Cambodge reste, semble-t-il, le seul thème qui suscite encore de véritables mobilisations de masse anti-impérialistes en Chine.
16. Cahiers de la Chine nouvelle, du vendredi 22 mars. Par contre, on trouvera nombre de dépêches relatant les attaques de la presse de Bangkok contre l’URSS… et même le compte rendu d’un tournoi de badminton qui s’est tenu en Thaïlande. Rappelons que le PCT est peut-être le principal parti communiste de la région, hors ceux d’Indochine, et qu’il est d’obédience maoïste.
17. Pékin Information des 19 et 29 avril 1974
18. Voir Far Eastern Economic Review du 24 décembre et du 14 janvier. Ces informations doivent cependant être prises avec prudence, notamment en ce qui concerne la forme extrême du conflit. Ce qui est certain, c’est que le PC au Kalimantan septentrional vient de subir une scission très grave. Mais si son lien avec l’évolution de la diplomatie chinoise est possible, il n’est pas démontré.