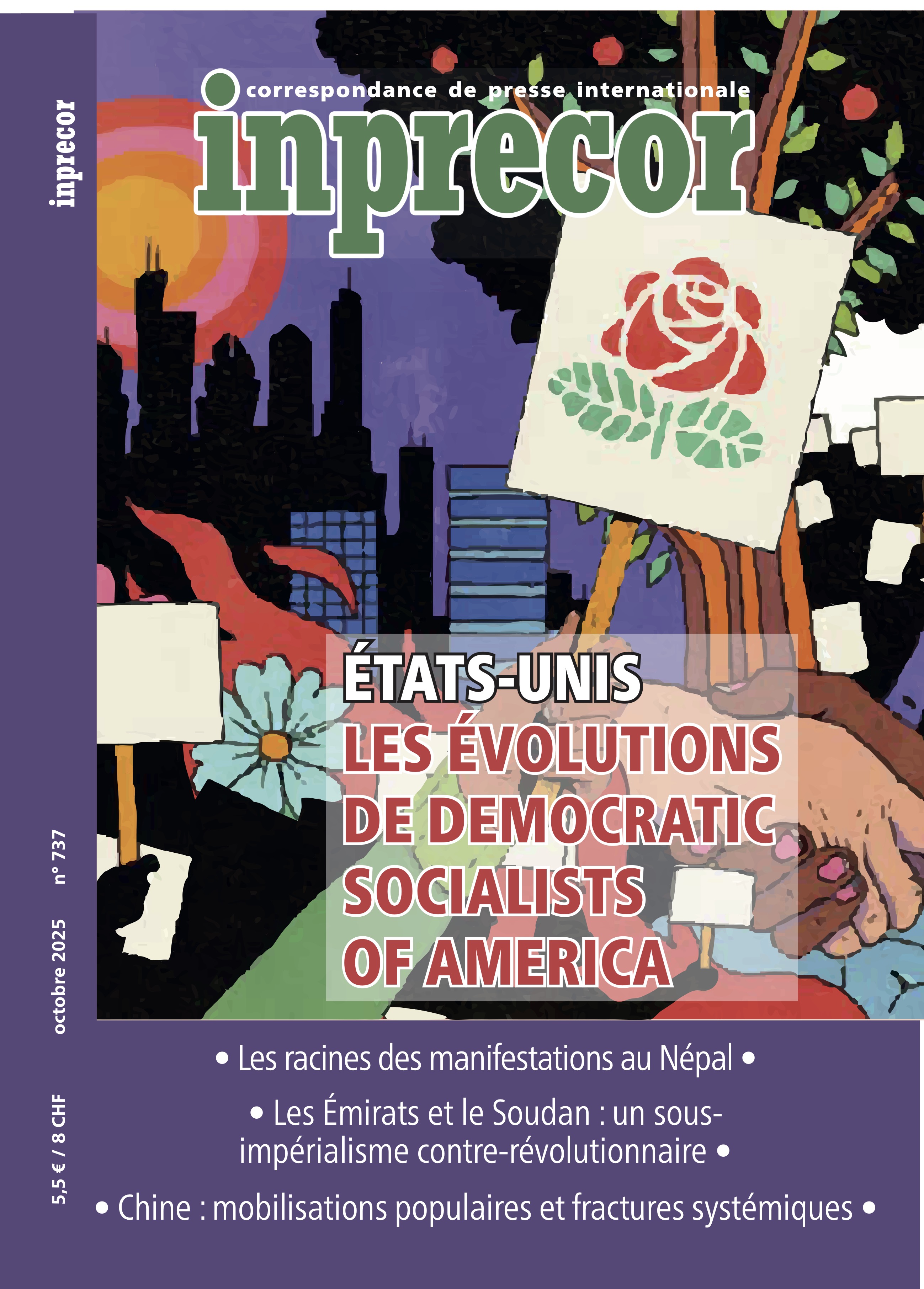Les manifestations qui ont traversé la Chine entre mai et début juin 2025 mettent en lumière des tensions profondes et une dynamique d’instabilité croissante dans le tissu social du pays.
L’analyse des épisodes de mobilisation sociale enregistrés en Chine entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2025 fait apparaître des tensions systémiques qui traversent l’ensemble du pays. Loin d’être des phénomènes isolés, ces événements mettent en évidence des fractures profondes dans la situation sociale actuelle du pays, où les difficultés économiques se mêlent à des problèmes structurels de nature politique et à des violations croissantes des libertés fondamentales.
La période considérée, qui culmine symboliquement avec le 36e anniversaire de la répression de Tiananmen le 4 juin 1989, présente une concentration extraordinaire de protestations qui, en un peu plus d’une semaine, ont investi avec intensité différents secteurs de la société : la production industrielle, la construction, l’éducation, la santé, et même le système pénitentiaire. Cette succession rapide de mobilisations transversales montre que les causes des protestations ne peuvent être attribuées à des problèmes sectoriels précis, mais plutôt à des dynamiques systémiques plus profondes qui évoluent simultanément.
Les huit journées « échantillons » analysées en détail – du 26 mai au 3 juin – révèlent en outre une répartition géographique couvrant l’ensemble du pays, de la province industrielle de Guangdong aux régions du nord-est, soulignant ainsi que le phénomène n’est pas limité à certaines zones économiques, mais représente une manifestation généralisée des fractures du tissu social chinois contemporain.
Le phénomène des arriérés de salaires : dimensions et caractéristiques
Les arriérés de salaires apparaissent comme le dénominateur commun de la grande majorité des protestations documentées. Selon les données du China Labour Bulletin, pas moins de 88 % des protestations collectives en 2024 étaient liés au non-paiement des salaires, soulignant la façon dont ce problème est devenu endémique dans l’économie chinoise. L’organisation note que « les arriérés de salaires représentent 76 % des événements sur la carte des grèves depuis 2011 », ce qui indique une persistance du phénomène sur une décennie.
La manifestation des travailleur·ses de Yunda Express à Chengdu illustre la complexité de ces dynamiques et la manière dont les conflits se développent et, parfois, sont résolus. Le conflit, qui a duré du 30 mai au 2 juin, est né non seulement de questions salariales, mais aussi de la décision unilatérale de l’entreprise de délocaliser le centre de distribution dans la ville de Ziyang, dans le comté de Lezhi, sans offrir de compensation ou d’emploi alternatif aux employé·es en contrepartie de la délocalisation. Les travailleur·ses ont bloqué l’entrée du centre de distribution pour empêcher les véhicules d’entrer et de sortir, paralysant ainsi les activités de l’entreprise.
Le déroulement de la manifestation révèle l’escalade des tensions : dans la nuit du 31 mai, la police a tenté de disperser les manifestant·es par la force et, selon les témoignages des travailleur·ses, certain·es employé·es ont été tabassé·es au cours de l’intervention. Après des jours de résistance et de négociations serrées, l’entreprise a finalement accepté, le 2 juin, d’indemniser les employé·es selon une formule mathématique précise : le salaire moyen, plus 6 000 yuans, multipliés par les années de service. Cette issue montre qu’une pression collective soutenue peut encore obtenir, bien que rarement, des résultats concrets dans le contexte chinois, malgré le contexte répressif.
Le secteur productif a connu de nombreux troubles reflétant les difficultés économiques structurelles de l’économie chinoise. Par exemple, à Ningbo, dans le Zhejiang, les travailleur·ses de Rockmoway Clothing se sont mobilisé·es pendant deux jours, les 2 et 3 juin, pour protester contre la décision de l’entreprise de retenir arbitrairement 40 % de leurs salaires. De même, plusieurs usines ont connu des grèves prolongées en raison d’arriérés de salaires, comme sur les chantiers de BASF à Donghai, dans le Guangdong, où les ouvrier·es du bâtiment sont resté·es les bras croisés le 2 juin pour protester contre le non-paiement de leurs salaires.
La géographie des protestations dans l’industrie montre une concentration particulière dans la province de Guangdong, le « moteur » de l’économie chinoise, qui avait enregistré 37 cas en avril 2025, de loin le nombre le plus élevé de toutes les régions. Cette concentration reflète la pression croissante exercée sur les industries orientées vers l’exportation dans une province qui représente le cœur manufacturier de la Chine.
L’impact de la guerre commerciale et les transformations du travail industriel
L’escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a eu des effets directs et mesurables sur la condition des travailleur·ses. L’augmentation des droits de douane américains, qui visent également les biens produits par des entreprises chinoises dans des pays tiers, a amplifié les incertitudes et exacerbé la crise à laquelle sont confronté·es les travailleur·ses. Les données montrent que le secteur manufacturier a connu une augmentation significative des mobilisations, passant de 25 cas en mars 2025 à 39 en avril suivant, ce qui reflète les pressions croissantes exercées sur les industries orientées vers l’exportation.
Les manifestations se sont étendues géographiquement « de la province de Guangdong, dans le sud-ouest de la Chine, où se trouvent de nombreuses usines, à Tongliao, dans la province de Jilin, dans le nord-est », mettant en évidence une répartition nationale du phénomène. Comme le note Workers’ Solidarity, « cela reflète également le fait que les problèmes du système économique chinois s’étendent aussi aux activités internationales », les travailleurs chinois·es employé·es dans des projets à l’étranger ayant fait grève en Arabie saoudite et à Oman le 29 mai pour réclamer leurs salaires.
Les protestations dans les usines Foxconn, l’un des plus grands fabricants au monde, qui fournit des iPhones à Apple, sont particulièrement significatives. À l’usine de Hengyang, les travailleurs se sont mis en grève pour protester contre la réduction des aides sociales et des heures supplémentaires, tandis qu’à l’usine de Taiyuan, ils et elles ont protesté contre les projets de transfert des installations de production de Taiyuan à Jincheng, à trois heures de route. Lors des manifestations de rue, les travailleur·ses ont crié « Nous voulons que nos droits soient respectés ».
BYD, le principal constructeur chinois de voitures électriques, a également été confronté à d’importants troubles. Le 28 mars, plus de 1 000 travailleur·ses de l’usine de Wuxi se sont mis en grève pour protester contre les baisses de salaire, la fin des primes d’anniversaire et d’autres réductions d’allocations. Quelques jours plus tard, les travailleur·ses de l’usine de Chengdu ont également manifesté pour réclamer la sécurité de l’emploi, la transparence sur les processus de délocalisations et des compensations équitables.
Parmi les différents secteurs, l’industrie de l’habillement et de la chaussure a été particulièrement touchée par la crise, ses travailleur·ses ayant souvent souffert du non-paiement des salaires. Ces industries sont souvent petites et concentrées dans la même région, de sorte que le non-paiement des salaires ou la suspension de l’activité en raison de la baisse de la rentabilité se produisent souvent dans des endroits proches et au même moment. Parmi les grèves dans l’industrie manufacturière en 2024, le secteur de l’habillement arrive en deuxième position (90 cas) après le secteur de l’électricité et de l’électronique (109 cas).
L’affaire « Brother 800 » : symbole du désespoir systémique
Le 20 mai 2025, l’incendie de l’usine textile de la Sichuan Jinyu Textile Company dans le district de Pingshan a acquis une résonance symbolique qui dépasse largement la dimension locale de l’événement. Wen, un ouvrier de 27 ans, a mis le feu à son lieu de travail après avoir été privé des salaires qui lui étaient dus pour un montant total de 5 370 yuans, et non pas 800 yuans comme cela a été initialement rapporté par les médias et plus tard démenti par la police.
La reconstitution des faits révèle la complexité des dynamiques qui ont conduit à ce geste extrême. Wen avait présenté sa démission le 30 avril et, conformément à l’article 9 des dispositions provisoires sur le paiement des salaires, il aurait dû recevoir tous les arriérés de salaire immédiatement après la cessation d’emploi. Lorsqu’il a finalisé les procédures de démission le 15 mai, l’usine lui devait 5 370 yuans (environ 760 dollars). Wen a demandé un paiement immédiat, mais le service financier a refusé, invoquant des procédures internes de validation. Après avoir à nouveau demandé, sans succès, le paiement à son supérieur, Wen a développé ce que le rapport de police appelle un « désir de vengeance ».
L’incendie a causé des dommages économiques estimés à des dizaines de millions de yuans et a conduit à l’arrestation de l’auteur, mais l’histoire est devenue virale sur les médias sociaux chinois avec le hashtag « Brother 800 ». L’écart entre les 800 yuans initialement médiatisés et les 5 370 yuans réellement dus a alimenté les débats sur les rénaux sociaux, sur lesquels de nombreux utilisateurs ont exprimé leur solidarité avec Wen, le considérant comme un « héros désespéré » plutôt que comme un criminel.
Ce cas met en évidence l’inefficacité structurelle des mécanismes de protection juridique. Comme l’observe ironiquement un témoin, « lorsque les personnes à qui l’on devait des salaires ont demandé une aide juridique, les juges ont disparu et le personnel du département du travail s’est également éclipsé. Mais lorsque Wen a mis le feu à l’usine, la police est immédiatement arrivée et les magistrats sont réapparus ». Cette critique souligne que le système réagit rapidement aux violations de l’ordre public, mais reste inerte face aux violations systématiques des droits des travailleur·ses.
La description de la situation familiale de Wen – pauvreté, mère malade, besoin urgent d’argent – illustre la façon dont les difficultés économiques individuelles sont liées à l’absence de protection sociale adéquate. Le China Labour Bulletin souligne que l’incident représente « une rupture dans les systèmes juridiques et institutionnels conçus pour soutenir les travailleur·ses », mettant en évidence l’inadéquation des structures syndicales existantes qui sont « restées silencieuses » tout au long de l’affaire.
La réaction du public reflète une frustration généralisée à l’égard de ces failles systémiques. En ligne, un commentaire viral demandait : « Pourquoi un homme en serait-il réduit à incendier une usine pour 800 yuans ? Cela signifie qu’il était littéralement affamé ». D’autres ont dénoncé le double standard : les travailleur·ses qui protestent sont qualifié·es de fauteurs de troubles, tandis que les employeurs qui retiennent les salaires sont tolérés par les autorités.

La crise dans la construction et l’immobilier : une spirale descendante
Le secteur de la construction représentait 54,48 % de toutes les protestations collectives en avril 2025, un chiffre qui reflète la crise persistante du marché immobilier chinois. Cette concentration dans le secteur de la construction montre que la crise immobilière, qui a commencé avec l’affaire Evergrande en 2021 et s’est propagée à l’ensemble du secteur ainsi qu’à l’économie en général, continue d’avoir des effets dévastateurs sur les conditions de travail.
Les projets inachevés sont une source particulière de tensions sociales, car ils concernent non seulement les travailleur·ses du secteur, mais aussi les citoyen·nes qui ont investi leurs économies dans l’achat de logement. Par exemple, à Xianyang, dans le Shaanxi, le 30 mai, des propriétaires de bâtiments inachevés du projet Sunac Shiguang Chenyue ont manifesté devant le centre de réclamation local, accusant le gouvernement d’avoir détourné des fonds destinés à la construction, ce qui a entraîné plusieurs arrestations par la police. À Qingdao, Shandong, des centaines de propriétaires du projet immobilier inachevé Heda Xingfucheng ont organisé une manifestation collective dans le district de Chengyang le 31 mai, bloquant la circulation et entrant de force sur le site de construction. Plusieurs propriétaires ont subi des violences de la part de la police.
Ces épisodes montrent que la crise immobilière ne concerne pas seulement les opérateurs du secteur, mais s’étend aux citoyen·nes de la classe dite moyenne qui ont investi leurs économies dans l’achat d’un logement, créant ainsi une base sociale plus large au mécontentement. La convergence de la crise économique et des attentes sociales déçues est un élément particulièrement déstabilisant.
L’extension des manifestations au secteur public : enseignants, médecins et travailleur·ses de la santé
Les autorités sont particulièrement préoccupées par l’extension des manifestations au secteur public, traditionnellement considéré comme plus stable et fidèle au système. Dans la province de Shandong, les enseignant·es contractuel·les n’ont pas reçu de salaire depuis six mois. Un enseignant d’école primaire a déclaré : « Notre salaire mensuel n’est que d’environ 3 000 yuans (un peu plus de 400 dollars) et, depuis six mois, nous vivons avec de l’argent emprunté ».
Un enseignant de la région de Shanxi a signalé que son école exigeait la restitution des primes de fin d’année versées au personnel depuis 2021, ainsi qu’une partie de la rémunération perçue pour les activités extrascolaires. Ces mesures ont provoqué un mécontentement généralisé sur le site, comme en témoignent les messages publiés sur le réseau social Xiaohongshu (RedNote).
Les travailleur·ses de la santé sont confronté·es à des problèmes similaires. Une infirmière d’un hôpital public de la province de Gansu, dans le nord-ouest du pays, a déclaré que son salaire mensuel n’était que de 1 300 yuans (moins de 200 USD) et que sa prime de rendement n’avait pas été versée depuis quatre mois. À Fuzhou, dans la province de Jiangxi, des médecins et des infirmier·es de l’hôpital Dongxin n° 6 se sont rassemblé·es devant le bâtiment du gouvernement municipal de Fuzhou le 7 avril, pour réclamer le paiement d’une prime bloquée depuis sept mois.
Comme l’observe Zhang, un enseignant retraité de l’université de Guizhou : « Dans le passé, ce sont les travailleur·ses migrant·es et les ouvrier·es qui réclamaient des salaires, mais aujourd’hui, les enseignant·es, les médecins et les éboueur·ses sont eux aussi concerné·es. Cela montre que la “structure stable” de la Chine commence à se fragiliser ». Cette observation rend compte d’un changement qualitatif fondamental : l’extension du mécontentement social à des catégories traditionnellement privilégiées du secteur public indique une crise de légitimité qui va au-delà des difficultés économiques conjoncturelles.
Violations des droits de l’homme dans le système carcéral : le témoignage de Liu Xijie
Le système judiciaire et carcéral a fait l’objet de violences particulièrement sérieuses qui ont mis en lumière des abus systématiques. Liu Xijie, originaire de Bozhou dans l’Anhui et détenu de 2011 à 2024 à la prison n° 1 de Fushun dans le Liaoning, a trouvé le courage de dénoncer publiquement et nominalement les violences systématiques de la police pénitentiaire, en donnant les noms précis des agents accusés.
Selon son témoignage détaillé, aux alentours de février 2022, plus de 200 prisonniers ont été soumis à des sévices de degrés divers, notamment des tortures électriques à l’aide de matraques électriques, des insultes et des coups pour des infractions mineures telles que des réponses non conformes aux règlements, des postures inappropriées ou un pliage incorrect des couvertures. Les témoignages décrivent de manière particulièrement glaçante comment certains agents pénitentiaires auraient trouvé du plaisir à faire subir des mauvais traitements, piétinant des personnes âgées, introduisant des matraques dans la bouche des détenus, électrocutant des prisonniers au point de provoquer des incontinences fécales.
Le cas le plus grave concerne Fan Hongyu, un prisonnier décédé le 19 février 2022 à la suite de tortures répétées pour le punir de ne pas avoir mémorisé le règlement de la prison. Ce témoignage, rendu public à un moment de tension sociale particulière, met en lumière la façon dont le système répressif utilise des méthodes qui violent systématiquement les droits humains fondamentaux, contribuant au climat général d’oppression qui alimente le mécontentement social.
Épisodes de protestation étudiante : le cas de Xuchang et la mémoire de Tiananmen
L’analyse des mouvements étudiants révèle des dynamiques particulièrement significatives. Le 3 juin à Changning, dans la province du Hunan, des centaines de lycéen·nes de l’école Shangyu ont organisé une manifestation spontanée sur le campus pour évacuer le stress des examens d’entrée à l’université. L’événement, d’abord pacifique et caractérisé par des cris libérateurs, a rapidement pris une connotation politique lorsque l’école a alerté les autorités sur l’enthousiasme excessif manifesté par les jeunes.
Lorsque la police est intervenue et a arrêté trois organisateurs présumés, la situation a rapidement dégénéré : les étudiant·es ont formé un mur humain pour empêcher les voitures de police de partir, en criant des slogans tels que « retirons-nous de l’école, rendez l’argent » et en exigeant la libération des camarades arrêtés. Malgré la détermination affichée, les policiers ont réussi à briser le cordon d’étudiant·es par la force, emmenant trois jeunes hommes sous le regard impuissant de leurs camarades.
Cet épisode est particulièrement sensible compte tenu de sa proximité temporelle avec l’anniversaire du 4 juin 1989, une date qui continue de représenter un moment extrêmement sensible pour les autorités chinoises. Dans le cas du collège n° 6 de Xuchang, dans le Henan, où une élève s’est vraisemblablement suicidée à cause du harcèlement pratiqué par un professeur, des milliers d’élèves et de citoyen·nes ont manifesté devant l’école, pénétrant dans le campus et endommageant des bureaux avant que la police intervienne. Wu Jianzhong, secrétaire général de la Taiwan Strategy Association, note que l’incident s’étant produit à proximité d’une date sensible comme le 4 juin, les autorités ont réagi avec une extrême prudence, craignant qu’il ne déclenche des troubles sociaux et ne se propage rapidement, comme un incendie.
Contrôle social et répression : l’anniversaire de Tiananmen
Dans le cadre du 36e anniversaire de Tiananmen, les autorités ont mis en œuvre des mesures de contrôle sans précédent à l’encontre du groupe des « mères de Tiananmen ». Pour la première fois dans l’histoire du groupe, toute communication avec le monde extérieur a été coupée, les téléphones portables et les appareils photo étant interdits lors de la commémoration au cimetière de Wan’an à Haidian.
Le 31 mai, les Mères de Tiananmen ont publié une lettre ouverte signée par 108 parents de victimes, commémorant les membres décédé·es au cours de l’année écoulée et réitérant leurs demandes : enquête impartiale sur l’événement, publication des noms des mort·es, indemnisation des familles et punition des coupables. Zhang Xianling, 87 ans, s’est ému dans une vidéo il y a quelques jours : « Depuis 36 ans, nous n’avons cessé de chercher le dialogue avec les autorités, mais nous n’avons été que mis sous contrôle et réprimés ».
Cette escalade du contrôle met en évidence le fait que les autorités sont particulièrement sensibles à toute forme de mémoire collective liée aux événements de 1989, suggérant un sentiment de vulnérabilité du régime aux liens potentiels entre les protestations contemporaines et les précédents historiques de mobilisation sociale.
Censure numérique et contrôle de l’information
La gestion de l’information sur les incidents de protestation révèle des stratégies sophistiquées pour contrôler le discours public. Dans le cas de l’incident du collège Xuchang n° 6, les autorités ont rapidement supprimé tous les contenus publiés sur les médias sociaux, et le fil de discussion sur le collège Xuchang n° 6 sur le site Weibo a disparu. Lorsque les élèves ont réalisé que leurs messages n’étaient pas diffusés, ils n’ont eu d’autre choix que de retourner leur frustration contre l’école elle-même, ce qui a fini en confrontation ouverte.
Dans le même temps, le cyberespace chinois a montré des réactions anormales. Début juin, dans le jeu de Tencent « Golden Spatula Wars », tous les avatars des utilisateurs de WeChat ont été uniformément remplacés par des pingouins verts et ne pouvaient être modifiés, ce qui a attiré l’attention de tous les joueurs. Un internaute s’est plaint sur X : « Les pingouins étaient à l’origine un symbole de divertissement, mais ils sont maintenant devenus un symbole de la censure ».
En outre, comme chaque année autour du 4 juin, les plateformes de médias sociaux chinoises bloquent des mots-clés tels que « place », « chars », « 8964 » [Note : Pour 4 juin 1989], et le contenu correspondant est immédiatement supprimé, tandis que les comptes qui les ont publiés risquent d’être interdits. Le 4 juin, l’avocat des droits de l’homme Pu Zhiqiang a été sommé par la police de supprimer son discours commémoratif publié sur X.
Dynamique de la résistance effective : le cas de Dongguan
Malgré le contrôle autoritaire, plusieurs épisodes montrent que la mobilisation sociale conserve une capacité à influencer les décisions des autorités locales lorsqu’elle atteint des dimensions significatives et formule des demandes économiques concrètes. Le cas de Dongguan est un exemple emblématique de mobilisation spontanée et réussie des travailleur·ses.
Le 2 juin, des centaines de travailleur·ses migrant·es vivant dans le village de Yangyong, dans la ville de Dalang, se sont opposé·es à l’introduction d’un système de péage qu’ils et elles considèrent comme économiquement insupportable. Leur action collective, qui a débuté vers 18 heures par le blocage des barrières de péage, s’est progressivement étendue à plusieurs centaines de personnes criant des slogans tels que « enlevez les barrières ».
Sous la pression soutenue des manifestant·es, la police en charge de la stabilité sociale a dû céder vers 22 h, envoyant des personnels retirer tous les équipements du péage. La politique de taxation, mise en œuvre la veille, a été déclarée nulle et non avenue, mettant en évidence le fait que les difficultés économiques poussent les classes populaires à des formes de résistance de plus en plus organisées et efficaces.
Évolution des stratégies de protestation et de l’organisation sociale
L’analyse révèle une évolution dans la manière dont les manifestations sont organisées, reflétant l’adaptation des mouvements sociaux au cadre technologique et répressif contemporain. Dans le cas des étudiant·es de Xuchang, l’utilisation des téléphones portables et d’internet a permis une connexion et la constitution rapide de rassemblements, soulignant comment les technologies numériques peuvent agir comme des multiplicateurs d’action collective, en dépit des contrôles gouvernementaux.
Zeng Jianyuan, directeur de l’Association Académique Démocratique chinoise à Taïwan, note que « dans le climat actuel de gouvernance répressive et de purges politiques en Chine, seules les questions apolitiques peuvent obtenir la légitimité permettant l’organisation de formes de rassemblement collectif à grande échelle ». Toutefois, il ajoute que « le Parti communiste chinois perçoit clairement que ce tumulte n’est pas seulement un geste de soutien à une école ou à un incident isolé, mais qu’il reflète également deux problèmes plus profonds ».
Le premier, selon Zeng, est que « sous l’administration de Xi Jinping, la société chinoise connaît une vague de détresse émotionnelle collective, et beaucoup cherchent un exutoire ». Le second est que « l’incident de Xuchang révèle un relâchement du contrôle social par les autorités locales : les étudiant·es ont pu se coordonner et se rassembler rapidement grâce aux téléphones portables et à Internet, ce qui montre l’échec des mécanismes de maintien de la stabilité ».
Il est clair que les manifestations les plus récentes ne peuvent pas être interprétées comme de simples réactions spontanées à des injustices spécifiques, mais représentent plutôt des manifestations d’un « vague de détresse émotionnelle collective » plus large qui cherche des canaux d’expression à travers des questions apparemment non politiques.
Crise de légitimité des autorités locales
Les protestations documentées mettent en évidence une crise de légitimité croissante des autorités locales, incapables de concilier efficacement les pressions économiques centrales et les besoins sociaux locaux. L’imposition arbitraire de taxes au niveau local est un parfait exemple de cette dynamique.
Dans le cas du village de Pingtang, dans la ville de Gushan, province de Zhejiang, le comité du village a publié un avis annonçant qu’à partir du 10 mai, des « frais de gestion sanitaire » et des « frais de stationnement » seraient prélevés sur toustes les résident·es permanent·es et les travailleur·ses du village : 80 yuans par an pour les adultes, 40 yuans pour les enfants et 500 yuans pour les voitures et les tricycles. L’avis indiquait également que ceux qui ne paieraient pas à temps seraient « mis sous contrôle » à partir du 1er juin, et devraient payer un supplément de 100 à 200 yuans, que leur véhicule serait verrouillé, et que ceux qui forceraient les serrures seraient « traités comme des auteurs d’actes de vandalisme contre des biens publics ».
Li, un résident du village, a déclaré que « cette taxe n’a jamais été convenue avec les villageois·es et n’a jamais fait l’objet d’une réunion publique. Je vis ici et je n’ai jamais entendu parler d’une réunion du village approuvant cette taxe ». Certain·es villageois·es ont critiqué la décision du comité du village, la qualifiant d’« extorsion éhontée ». Un autre villageois, Zhang Shun (pseudonyme), a déclaré : « Ma famille compte cinq personnes et nous devons payer 400 yuans par an. Nous ne pouvons absolument pas nous le permettre. Est-ce encore un pays dirigé par le Parti communiste ? » Jia Lingmin, une militante, a souligné que le comité du village est une organisation populaire autonome et que toutes les redevances doivent obtenir un « permis de redevance », faute de quoi elles sont illégales.
Cet épisode illustre la façon dont les gouvernements locaux, sous la pression des difficultés fiscales, ont recours à des mesures de plus en plus désespérées et illégales pour lever des fonds, ce qui érode encore plus leur légitimité aux yeux de la population. Comme l’observe Zhang, un enseignant retraité de l’université de Guizhou : « Le niveau élevé de la dette locale et le durcissement des politiques centrales ont fortement affecté la gestion fiscale locale. Les victimes les plus directes sont les travailleur·ses permanent·es et contractuel·les ».
Transformations du tissu social chinois
Tang Gang, un universitaire du Sichuan, propose une analyse particulièrement perspicace des transformations sociales en cours, notant que la société chinoise évolue « d’une société traditionnelle où il était possible de trouver des compromis, de se tolérer mutuellement et de coexister, à une société marquée par de rudes conflits, où les positions sont irréconciliables et où la coexistence devient impossible ». Cette transformation, qu’il attribue aux changements survenus au cours des dix dernières années sous la direction de Xi Jinping, suggère une détérioration qualitative des relations sociales qui transcende les questions économiques spécifiques.
Xue, chercheur en relations du travail à Guizhou, identifie plusieurs facteurs qui contribuent à l’accentuation des conflits entre travailleur·ses et patrons. « Tout d’abord, dans certaines entreprises, les dirigeant·es des syndicats sont directement nommés par les patrons, ce qui empêche le syndicat de représenter véritablement les intérêts des travailleur·ses. Cela entrave la défense des droits des salarié·es et alimente les tensions. Deuxièmement, la relation entre le capital et le travail est fortement orientée vers le marché, mais il n’y a pas de répartition équitable des revenus. De plus, dans de nombreuses usines, l’opacité prévaut dans la gestion des questions concernant les travailleur·ses, ce qui exacerbe encore les contradictions ».
L’analyse de Xue montre que les problèmes ne sont pas simplement économiques, mais qu’ils reflètent des déficiences structurelles dans le système de relations industrielles de la Chine. L’absence de syndicats indépendants et représentatifs prive les travailleur·ses de canaux efficaces pour la résolution des conflits, ce qui les oblige à recourir à des formes de protestation de plus en plus directes et parfois extrêmes.
Vers des scénarios d’instabilité croissante
L’accumulation des tensions documentées au cours de la période fin mai-début juin 2025 indique à elle seule que la Chine d’aujourd’hui est confrontée à des défis sociaux de nature systémique qui ne peuvent être résolus par les seuls mécanismes répressifs traditionnellement employés par le régime. La transversalité sectorielle des protestations, l’extension géographique nationale des phénomènes et l’implication de catégories traditionnellement stables telles que les enseignant·es et les travailleur·ses de la santé montrent que les difficultés actuelles ne sont pas des fluctuations conjoncturelles mais plutôt des manifestations de contradictions structurelles plus profondes.
La capacité limitée des autorités locales à répondre efficacement aux demandes populaires, combinée au désespoir économique croissant de larges pans de la population, crée des conditions potentiellement explosives. Comme l’a montré l’affaire « Brother 800 », lorsque les voies légales de résolution des conflits s’avèrent inefficaces, les citoyen·nes peuvent recourir à des formes de protestation de plus en plus extrêmes et destructrices.
L’intensification des mesures répressives, visible dans l’isolement des Mères de Tiananmen et la censure rapide des épisodes de protestation, indique une compréhension de sa vulnérabilité de la part du régime, qui pourrait paradoxalement alimenter de nouvelles tensions. La stratégie de contrôle de l’information, bien qu’efficace à court terme, risque d’alimenter la frustration et la radicalisation lorsque les citoyen·nes découvriront l’impossibilité de communiquer leurs revendications par les canaux institutionnels.
Les autorités chinoises semblent se trouver dans une position de plus en plus difficile, obligées de trouver un équilibre entre les exigences du contrôle social et la nécessité de maintenir la stabilité économique. L’expérience de la courte période analysée ici suggère que cette tension atteint des seuils critiques, avec des implications qui pourraient s’étendre bien au-delà des frontières de l’épisode ou du secteur concerné.
Le 5 juin 2025
Cet article a collecté des informations dans les médias Yesterday, Radio Free Asia, China Labour Bulletin, AsiaNews, Workers’ Solidarity. Il a été traduit de l’italien par Pierre Vandevoorde et Pierre Rousset pour ESSF, et revu par nos soins (Agatha).