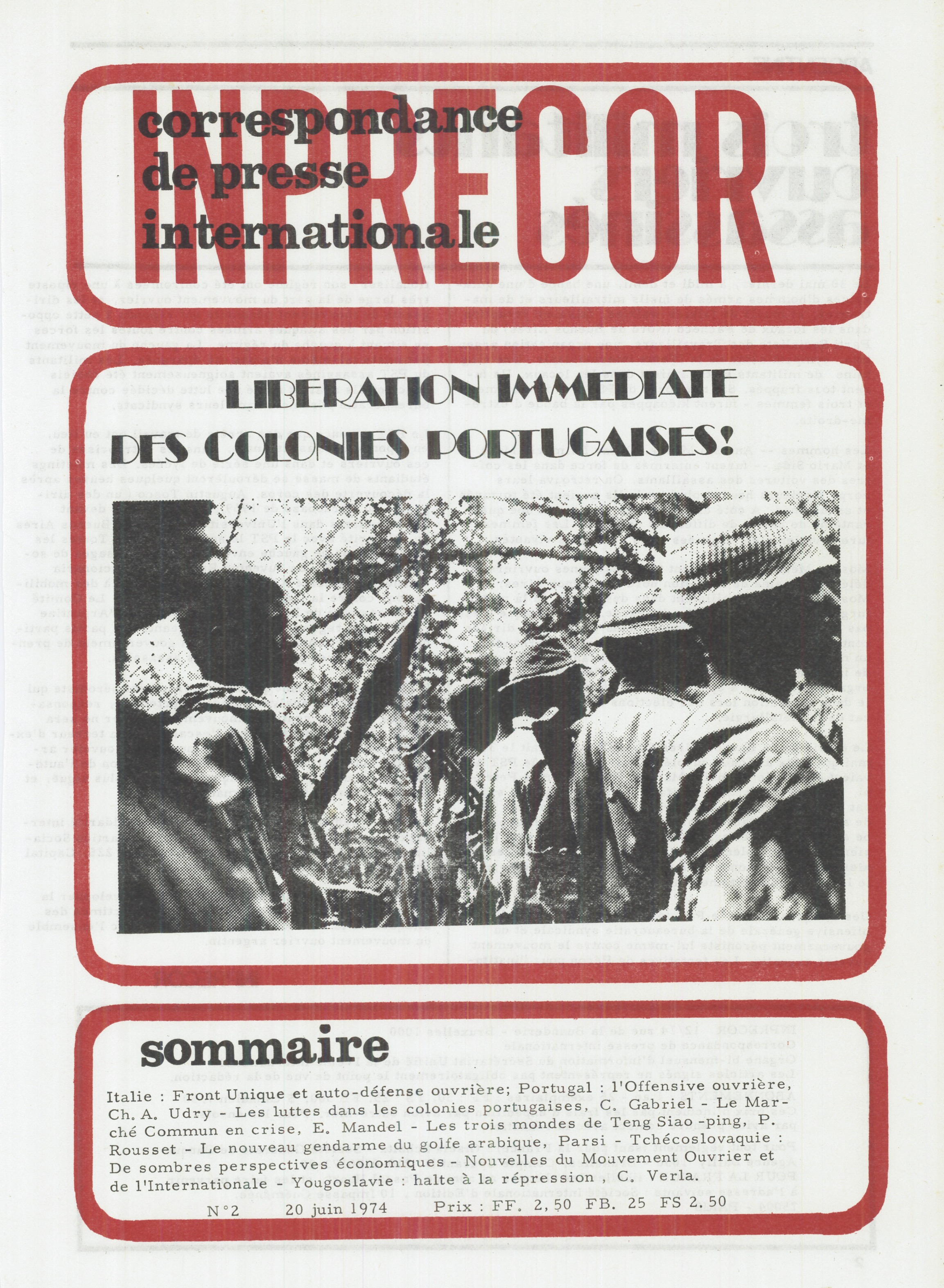Lorsque l'on considère le développement de l'économie tchécoslovaque, on ne peut négliger certains facteurs qui annoncent lentement mais sûrement, une crise économique. La crise énergétique mondiale qui s'est déjà largement développée dans le monde occidental, va encore aggraver la situation économique en Tchécoslovaquie. Car même si la Tchécoslovaquie n'est que légèrement touchée par l'augmentation du prix du pétrole sur le marché mondial, celle-ci se fait tout de même sentir. Pour leur production les entreprises tchécoslovaques ont besoin d'une série de matières premières et de produits semi-finis qu'elles doivent importer des pays capitalistes. Ces importations se font, dans la plupart des cas, sur la base d'accords à court terme, conclus souvent de cas en cas, et par conséquent dans des conditions défavorables. Le coût de production (important pour l'énergie) se reflète dans les prix de ces importations, intégrant l'augmentation du prix du pétrole. Ainsi se développe une crise monétaire défavorable pour l'économie tchécoslovaque.
D'une part, le coût de production des produits tchécoslovaques s'accroît, d'autre part, ces produits sont exportés vers les pays du COMECON à des prix qui sont fixés par des accords à long terme et qui peuvent difficilement être modifiés. Les pertes que notre économie subit à cause de ce système de prix peuvent s'évaluer à environ 11 milliards de dollars pour la période qui va de la mi-73 à mars 1974. Ce que cela signifie pour notre économie — qui se trouve déjà, de façon chronique, dans une situation grave et sans issue apparente — est clair : les évaluations du taux d'inflation se situent entre 2,5 % (évaluation officielle, sur laquelle se base le Plan d'État) et 6 % (évaluation des économistes sceptiques). Si notre économie a pu supporter l'augmentation des prix de l'année dernière — non sans demander le remboursement des prêts à long terme accordés aux pays en voie de développement — il n'en est plus de même aujourd'hui. En 1974, la Tchécoslovaquie n'a pas de devises pour acheter les matières premières sur le marché capitaliste. Il faut, parallèlement, noter que si l'on devait faire face à une crise des récoltes, suite à la sécheresse, il faudrait aussi trouver une solution pour acheter des vivres ce qui aggraverait encore plus la situation négative de la balance des paiements.
Il faut chercher les causes de la crise de l'économie tchécoslovaque autre part que dans la crise énergétique qui n'a influencé que légèrement la situation. Il s'agit plutôt d'un héritage du passé. Les coûts de production de l'industrie tchécoslovaque ont toujours été plus élevés : en 1971, sur une couronne de produit national brut, il y avait 0,44 couronne de dépenses matérielles. Par rapport à 1970, cela représente une augmentation de 6,4 %, alors que le Plan n'avait prévu qu'une augmentation de 3,3 % « seulement ». La part des dépenses matérielles dans le prix des produits représentait 65,1 % en 1970, et déjà 65,5 % en 1971. Ce qui représente une perte de 5 milliards de couronnes en 1971. Parallèlement l'accroissement du fonds de production — en moyenne de 5 % par an — montre que la productivité n'augmente pas tellement non plus, au contraire de ce que clâme sans arrêt la propagande officielle. L'augmentation de la productivité est une conséquence de l'introduction de nouveaux investissements dans l'industrie et ne représente certainement pas une rationalisation de la production.
La direction du Parti communiste tchécoslovaque va chercher une issue à cette situation : il ne fait aucun doute que cela se traduira par une augmentation des prix. On peut toutefois prévoir qu'il ne s'agira pas d'une augmentation massive et générale, telle que celle qui en 1970-71 provoqua des arrêts de travail en Pologne et qui a risqué d'en déclencher en Tchécoslovaquie en juin 1973, mais qui, par crainte de la réaction de la population ne fut pas appliquée, bien que de nouvelles listes de prix avaient déjà été imprimées et diffusées. Il en fut de même en avril de cette année et la direction du PCT dut reconnaître — suite aux rapports de la police secrète sur l'état d'esprit de la population — que la situation n'avait pas changé. L'augmentation fut introduite par étapes, surtout par différents changements, par des retours à des prix initiaux (plus élevés), par la compensation des prix, par la substitution de produits par d'autres, de meilleure qualité, mais aussi plus chers, ou encore en remplaçant le nom d'un produit pour qu'il soit plus « moderne » ou plus « nourrissant », ce qui doit se refléter dans un nouveau prix (exemple typique : le produit de nettoyage TIX…).
La manipulation des prix
C'est avec l'aide de telles manipulations des prix que la direction a déjà voulu dominer la situation dans le passé. Il est vrai notamment que les prix des produits alimentaires de base n'ont pas augmenté depuis l'introduction du blocage des prix en 1970 ; mais les prix des matériaux de construction ont monté (en avril de cette année, le prix du ciment a augmenté de 100 %). Ce qui a eu comme conséquence que les prix des loyers dans les nouveaux immeubles de la construction sociale — qui reflètent le coût de production — ont monté d'une somme mensuelle de 400 couronnes en 1969/70 à une somme mensuelle de 700/800 couronnes en 1973.
Le soir du 27 mars 1974, on communiqua officiellement la modification des prix des transports urbains à Prague, avec entrée en vigueur au 9.5.1974. La télévision transmit une conversation entre la rédactrice de la TV, Ljuba Mestekova, et le maire de Prague, Zuzka. Tous deux louèrent cette modification, ô combien profitable pour l'avenir, ils ont seulement oublié d'admettre que cela ne les touchait pas : quand ils se déplacent avec la voiture de service Tatra 603, ils ne paient certainement pas.
En principe on peut affirmer qu'il s'agit ici d'une augmentation du prix du transport urbain. Même à l'achat de cartes mensuelles moins chères, le prix du transport est supérieur à ce qu'il était avant cette « modification » — dans le meilleur des cas cela fait 20 couronnes en plus par mois. C'est ainsi que pour la moitié des pragois la vie a augmenté de 3 %. Bien qu'il ne s'agisse pas ici d'une grosse augmentation, les milieux officiels essayèrent de manière émouvante d'empêcher que quelqu'un vienne à considérer cette mesure comme une augmentation des prix. En supprimant les contrôleurs dans les trams, la sécurité des transports fut sans doute influencée puisque le conducteur ne contrôlera plus que toutes les 6 portes.
L'argumentation pour justifier l'augmentation du prix des transports est très faible, tout comme celle qui justifia l'augmentation du prix de l'essence. La propagande officielle maintient qu'il s'agit seulement d'une nouvelle lutte contre les impérialistes qui sont venus chez nous pour acheter l'essence moins chère.
Faisons une comparaison : pour un litre d'essence le travailleur ouest-allemand doit travailler environ 6 minutes, alors que le travailleur tchécoslovaque doit travailler 16 minutes pour la même quantité d'une essence d'une qualité inférieure, et cela après une augmentation des prix de 65 %, de telle manière qu'il était déjà dans une situation plus mauvaise que celle du travailleur ouest-allemand avant l'augmentation.
La situation critique de la balance des paiements tchécoslovaque peut également s'illustrer par l'exemple du pétrole. À l'époque de la conclusion d'un contrat quinquennal avec l'URSS, expirant le 31.12.1975, le prix d'une tonne de pétrole avait été fixé à 32 roubles-devise, ce qui représentait le double du prix sur le marché mondial. Il est vrai que la Tchécoslovaquie paie encore ce prix aujourd'hui, bien que le prix pour une tonne de pétrole ait augmenté en quatre ans de 16 $ à 75/80 $ (1 rouble-devise équivaut à peu près à 1 $).
Les discussions actuelles au sein du COMECON, où la Tchécoslovaquie insiste pour que les prix au 1.1.1976 soient en-dessous de ceux du marché mondial ont été résolues de la façon suivante par le journal Krasnaïa Zvezda (Étoile Rouge) : il a déclaré (selon Rudé Právo, le 25.4.1974) que l'URSS livre le pétrole à ses pays « frères » à des prix qui étaient valables à l'époque de la signature de l'accord précédent. Au cours de leur visite à Prague les libyens avaient exigé quelque 300 $ la tonne de pétrole, tout en demandant des investissements tchécoslovaques en Libye. Les tchécoslovaques durent refuser : leurs investissements étrangers atteignent déjà 175 milliards de couronnes. Bien que l'augmentation du coût de la vie mène à une chute relative du niveau de vie, il faut mentionner que les revenus de beaucoup de branches industrielles ont augmenté fortement dans de nombreux cas. Il s'agit principalement de celles qui sont la propriété de l'État ou de l'appareil du Parti, comme les sociétés agricoles. En outre, les revenus des employés dans le secteur tertiaire ont augmenté rapidement. En Tchécoslovaquie il y a de nouveau des millionnaires (par exemple dans la circonscription de Prague/10 il y en a 8, à Nymburk, 13 — il s'agit de sommes gagnées par hasard, et parmi lesquelles les artistes, acteurs, chanteurs pop forment déjà une minorité. Ces gens-là ne tiennent pas à avoir de gros compte en banque, car ils ne savent pas très bien comment dépenser leur argent.) Le chiffre officiel du montant de l'épargne des tchèques (donc sans la Slovaquie) s'élève en 1973 à 90 milliards de couronnes. En outre une indication non officielle parle de stocks de marchandises d'une valeur de seulement 30 milliards de couronnes. Et d'autres sources affirment qu'il y a en Tchécoslovaquie une inflation d'argent équivalant à 75 milliards de couronnes. Vu ces faits, les rumeurs concernant une réforme monétaire et une augmentation des prix — rumeurs qui ont semé la panique parmi la population qui voulait retirer son épargne et acheter des objets inutiles — ont une base rationnelle. Il est cependant peu probable que le gouvernement prenne ces mesures. On assiste cependant à une nouvelle action du gouvernement : le nouveau système des salaires, le dernier mot de la soi-disant rationalisation socialiste.
Le gouvernement a pourtant fait de très mauvaises expériences : en l'introduisant au printemps dans une partie du trust Škoda : il y eut une grève qui ne fut pas la dernière. Bien que toutes les grèves furent réprimées (il s'agissait de grèves de courte durée, uniquement une partie des équipes seulement y participèrent, et elles durèrent au maximum un jour), elles servirent d'avertissement. Il ne resta pratiquement rien de l'intention première qui visait à diminuer ainsi les salaires de 5 % environ. Le cas d'une partie de l'usine ČKD-Prague, où l'introduction du nouveau système de salaire eut récemment comme effet le licenciement d'environ 500 travailleurs, représente également un avertissement pour les directeurs d'usine. L'idée de diminuer les salaires ne peut pas non plus être appliquée par manque aigu de main-d'œuvre ; en effet, on fait déjà appel à la main d'œuvre étrangère. C'est ainsi que les usines textiles dans le nord de la Bohême ne pourraient pas fonctionner sans les travailleuses polonaises. Les polonaises travaillent également à l'usine de construction d'avions AVIA de Prague, ainsi que dans les lavoirs et dégraissages où les Tchèques leur ont abandonné le travail non mécanisé, pour des bas salaires et dans de mauvaises conditions. Le plus ironique, c'est que la Pologne rembourse ainsi les quelques crédits que la Tchécoslovaquie lui avait accordés.
Le mouvement de grève
Le mouvement de grève en Tchécoslovaquie est aujourd'hui l'expression du mécontentement des travailleurs face à cette situation.
Bien que les organes d'information tchécoslovaques étouffent toute nouvelle à propos des grèves, quelques-unes parviennent jusqu'à l'étranger. Avant Noël 1973, il y eut par exemple la grève des transporteurs et convoyeurs d'une firme de transport (les détails ne sont pas encore connus). En janvier 1974, il y eut une grève de trois jours des employés de la firme de travaux publics qui construit la Slavia-Areal à Prague-Vršovice. Là aussi, la cause du mécontentement des travailleurs était le nouveau système de salaire. La grève fut un succès : les salaires ne furent pas modifiés (c'est-à-dire qu'ils ne furent pas diminués). Il s'agissait d'une grève spontanée avec occupation. Les ouvriers demandèrent sans succès que la grève soit menée de façon conjointe avec les syndicats. Le 14 février 1974, il y eut une grève d'un jour à la firme de construction de chemin de fer qui fournit le métro de Prague. Le nombre des grévistes, ici aussi, était de 100, comme dans la grève de l'entreprise de travaux publics. Il s'agissait cette fois des camionneurs qui devaient amener le matériel pour la construction du métro. Ce fut une grève d'un jour avec occupation. Cette fois non plus, les syndicats ne prirent pas part à la grève. Ce qui est significatif c'est que 70 % des ouvriers étaient membres du Syndicat et 5 % du Parti communiste. La cause de la grève était le non paiement de 5 jours de travail. Le résultat de la lutte fut le paiement du salaire pour ces 5 jours de travail à la fin de la grève, bien que le jour de grève ne fut pas payé. La cause originale du non paiement de ces cinq jours fut imputée à un ordinateur. En mars 1974 une information non officielle fit mention d'une courte grève de protestation dans une usine sidérurgique en Slovaquie orientale ; grève qui démarra également sur le nouveau système de salaire. Celui-ci fut reporté dans beaucoup d'entreprises à cause de la protestation des travailleurs.
Pour conclure, on peut dire qu'une certaine pression sociale non négligeable se fait jour. Mais il ne faut cependant pas compter à moyen terme sur une explosion ou un élargissement du mouvement de grève. Les travailleurs répondront plus que probablement par une indifférence totale pour le destin de la direction politique dans le cas d'une catastrophe économique, selon la devise : « ils n'ont rien fait pour nous, qu'ils aillent au diable ! »
Article traduit du journal Informační materiály n° 12, juin 1974, Berlin