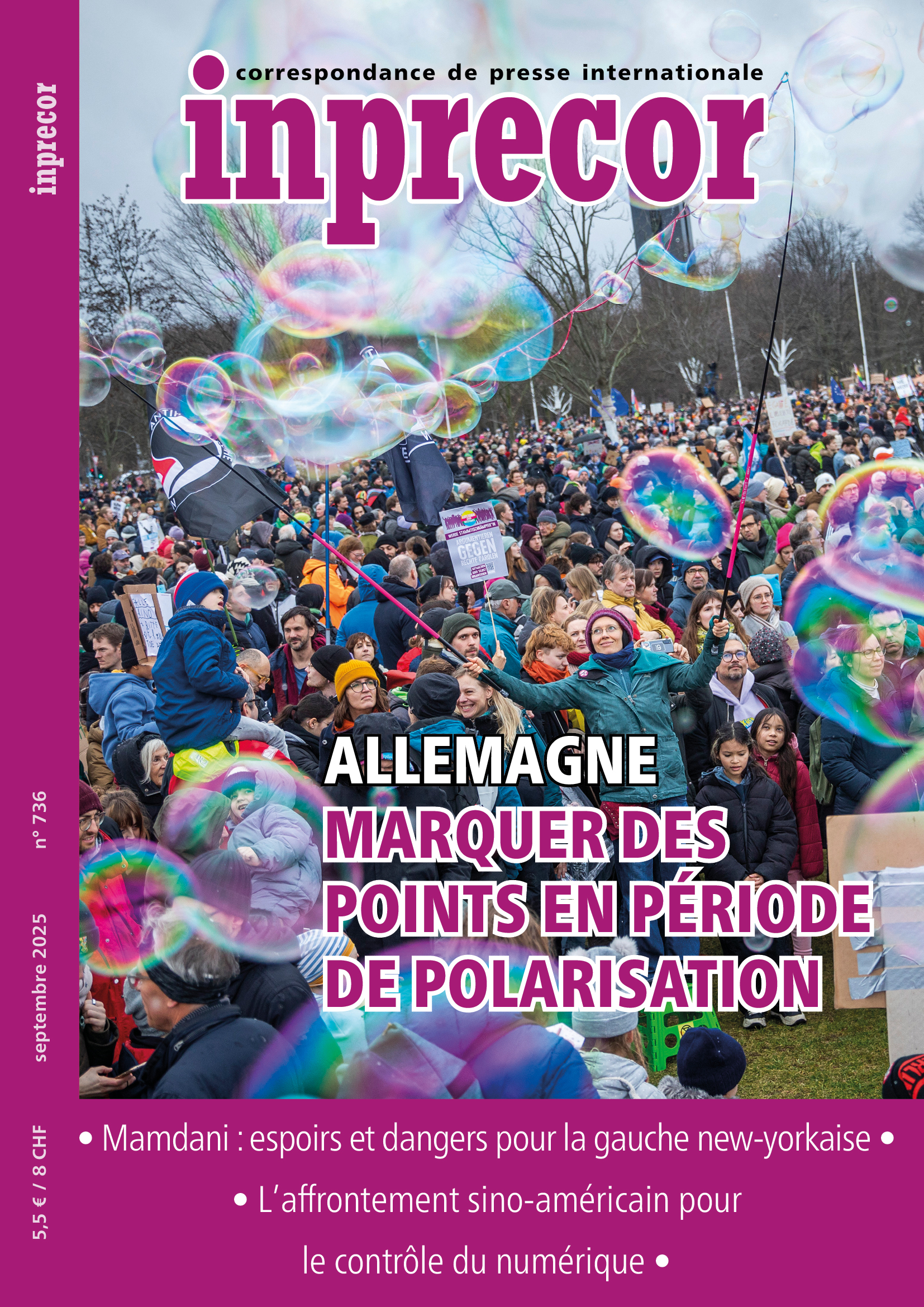La mobilisation en cours contre la loi scélérate votée par le Parlement et avalisée par la présidence et qui met en question l’indépendance des organes anticorruption révèle la force de la société civile ukrainienne.
Elle a réagi au quart de tour, dès l’annonce du vote pourtant calculée pour la prendre par surprise et à revers. Quand on écoute, dans un reportage de Mediapart, ce que disent les manifestant·es, on voit confirmée ce que la sociologue Anna Colin Lebedev a mis en évidence dans ses enquêtes : cette société civile montre un fort engagement sur les deux fronts de la difficile situation qu’impose au pays la cruelle guerre néofasciste russe, le front militaire et le front intérieur, indissociables dans l’esprit de celles et ceux qui battent le pavé.
C’est parce qu’il faut battre l’envahisseur que ces femmes et ces hommes de l’arrière du front, de longue date méfiant·es envers les institutions d’État, lui accordent leur confiance pour diriger la résistance militaire. Mais, comme on le voit aujourd’hui, face à cette loi sur la corruption, cette confiance est limitée, critique, ce n’est en aucune façon une allégeance aveugle aux institutionnels.
Toutes choses, il faut le dire, en ce moment où les poutiniens de Russie et d’ailleurs, manœuvrent pour discréditer l’Ukraine et enfoncer des coins dans les résistances à la barbarie ennemie, qui, en réalité, toute crue, montre ce qui manque à la Russie de Poutine : le peuple ukrainien joue, à l’inverse de ce que subit le peuple russe, un évident rôle de contre-pouvoir, d’autant plus remarquable qu’une situation de guerre, comme celle qui lui est imposée, est a priori propice à militariser et à vassaliser politiquement la société au nom de l’impératif supérieur de la résistance militaire. C’est d’ailleurs le vrai tour de force de ces résistant·es de l’arrière du front que d’avoir conquis, dès le début de la guerre, pour beaucoup les armes à la main (certain·es sont sur le front et payent le prix du sang), la légitimité, difficile à leur contester, d’être un acteur, sinon l’acteur clé, de la mobilisation pour l’indépendance nationale face à un impérialisme des plus meurtriers et totalitaires; l’acteur, sans la mobilisation duquel dès les premières heures de l’invasion, la défaite aurait été inéluctable.
Cette légitimité, transmise par la génération précédente de la révolution du Maïdan (2014) à la jeunesse actuelle, est un atout politique majeur pour que soit posée envers l’État ukrainien la ligne rouge à ne pas dépasser : celle qui crée une démarcation absolue avec tout ce qui, de près ou de loin, signifierait la résurgence du modèle honni de l’URSS stalinienne et de l’actuelle dictature capitaliste russe, oligarchique-mafieuse corrompue, qui en est la continuation dans le dépassement. Cette ligne rouge, qui est un fil rouge, est ce qui permet que s’exprime une dynamique à intense sensibilité démocratique pouvant déboucher sur un processus d’élaboration radical d’alternative globale, sociale, non-capitaliste. Dépassant ce qui participe encore, à une échelle large, d’une forte défiance vis-à-vis de l’idée de gauche qui a tant servi à asservir, réprimer les aspirations à l’indépendance nationale.
De tout ceci il ressort que ce qu’oppose en ce moment la société civile ukrainienne à l’État est le signifiant magistral de ce qui oppose celle-ci, quasi-viscéralement, mais en fait très politiquement, au funeste modèle d’État qu’incarne l’État poutinien. N’en déplaise aux idiots utiles de la gauche internationale qui, remarquablement silencieux sur la nature néofasciste du régime russe, œuvrent à la défaite de la résistance démocratique ukrainienne.
Zelensky serait bien inspiré de reprendre la mesure de ce qu’est la puissance de l’esprit démocratique de sa société.
Le 25 juillet 2025