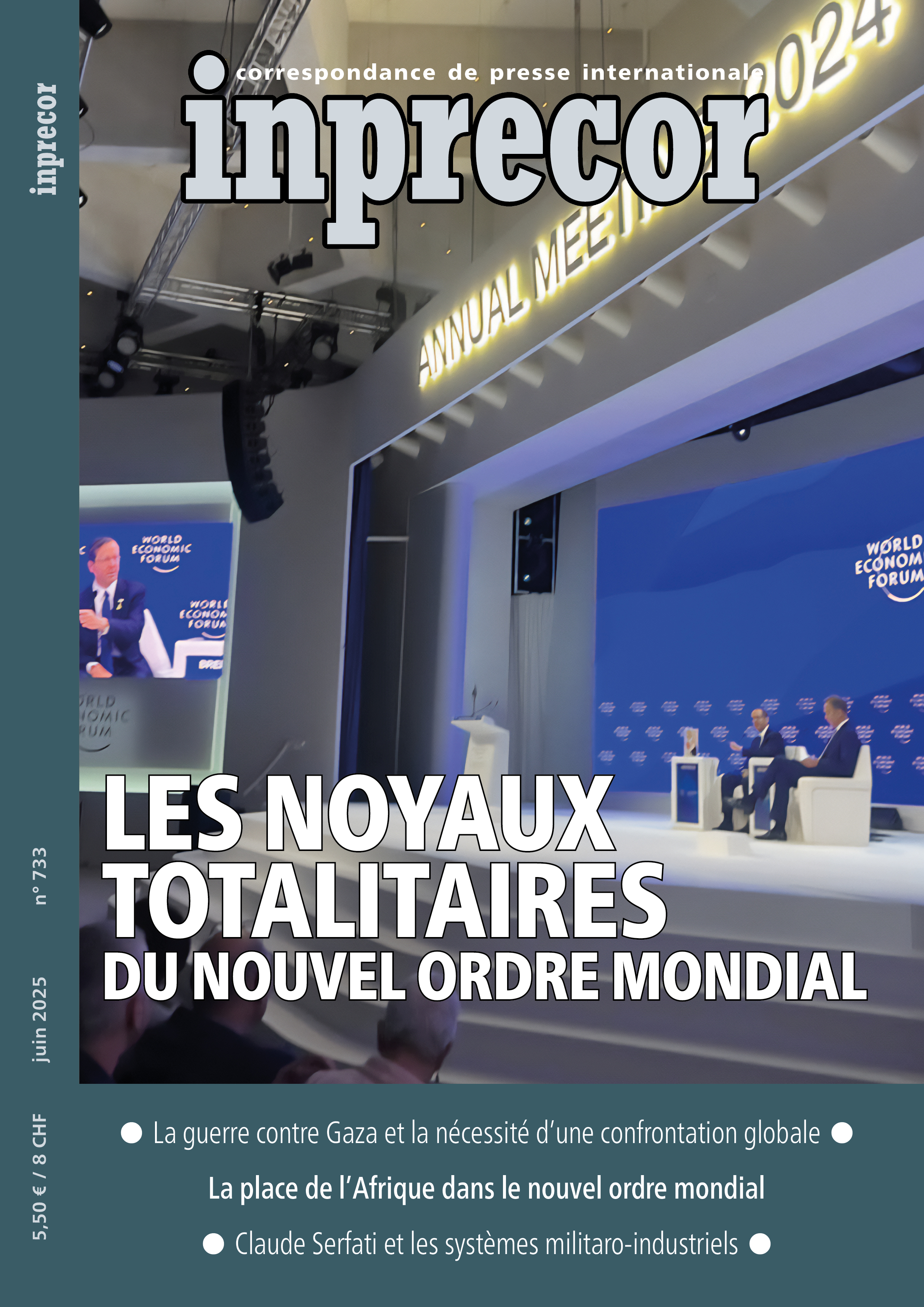Aujourd’hui, l’Afrique se situe à la croisée des chemins, prise entre des crises internes, l’évolution de la dynamique du pouvoir mondial et le lent démantèlement de l’ordre politique issu des luttes de libération. Sur tout le continent, les partis dirigeants qui avaient autrefois tiré leur légitimité de leur rôle dans la libération nationale perdent leur emprise, tandis que les oppositions demeurent encore largement fragmentées, n’offrant pas réellement de gouvernance alternative.
Les élections de 2025 au Mozambique ont fourni l’un des exemples les plus frappants de ce déclin, lorsque le Frelimo, le parti dirigeant, s’est proclamé vainqueur à l’issue d’un processus électoral considéré largement comme frauduleux. Le dirigeant de l’opposition, Venâncio Mondlane, s’était présenté sous les couleurs d’un nouveau parti, Podemos. Après le décompte des suffrages effectué parallèlement à celui d’un pouvoir autoproclamé victorieux, Venâncio Mondlane a accusé le gouvernement d’orchestrer une manipulation électorale massive. Le parti dirigeant a répondu aux protestations massives par une violente répression. C’était la poursuite d’une tendance à la suppression de toute opposition politique et au renforcement du contrôle par des moyens de plus en plus autoritaires.
L’exemple de l’Afrique du Sud
L’illégitimité grandissante de ces gouvernements issus de la période des luttes de libération nationale n’est pas limitée au Mozambique. En Afrique du Sud, l’ANC a perdu sa majorité absolue pour la première fois depuis 1994 en n’obtenant qu’environ 40 % des voix lors des élections de 2024. Après des décennies de domination politique, le parti se trouve maintenant dans une coalition très fragile avec l’Alliance démocratique (AD), sa rivale de longue date. Cela a contraint l’ANC à adopter une position gouvernementale plus modérée, ce qui limite d’autant sa capacité à mettre en œuvre les politiques attendues par sa base politique traditionnelle.
Alors que certains au sein de l’ANC considèrent cette coalition comme un compromis nécessaire pour préserver la stabilité, d’autres pensent que c’est une trahison de la mission historique du parti, notamment au vu de l’orientation politique néolibérale de l’AD. Les conséquences de cet arrangement demeurent incertaines : est-ce que la coalition va durer ? Est-ce qu’elle va fracturer plus profondément l’ANC ? Ou est-ce qu’elle va donner naissance à des mouvements d’opposition plus forts et se situant à l’extérieur du processus électoral traditionnel ?
Le déclin de l’ANC prolonge un processus plus large en Afrique australe. Au Zimbabwe, la ZANU-PF (Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique) s’est retranchée dans la répression plutôt que dans le soutien populaire, utilisant la commission judiciaire et électorale pour bloquer les défis sérieux de l’opposition. Entretemps, la SWAPO (Organisation du peuple du Sud-Ouest africain) en Namibie et le BDP (Parti démocratique du Botswana) au Botswana ont tous les deux fait face à des défis électoraux sans précédent – le BDP a perdu une élection pour la première fois depuis l’indépendance – ce qui souligne que même les partis dominants autrefois stables ne disposent plus de la garantie de remporter facilement des victoires. L’effritement de ces mouvements suggère que le crédit puissant qu’ils ont obtenu autrefois lors des luttes de libération ne leur fournit plus un mandat suffisant pour gouverner.

Conflits
L’affaiblissement de ces gouvernements se produit dans un contexte d’aggravation des conflits et d’instabilité sur le reste du continent.
Le Soudan reste en proie à une guerre dévastatrice entre les Forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide. C’est un conflit qui a provoqué le déplacement de millions de personnes tout en s’internationalisant de plus en plus, avec l’Égypte et les Émirats arabes unis, qui soutiennent des camps opposés. La guerre n’a pas seulement aggravé l’effondrement économique du Soudan, mais elle menace aussi la stabilité régionale avec des effets d’entraînement au Tchad, au Sud-Soudan et en Éthiopie.
La République démocratique du Congo (RDC) continue de combattre des insurrections armées, particulièrement la résurgence du M23, et le soutien de celui-ci par le Rwanda a exacerbé les tensions régionales. Les accusations d’ingérences transfrontalières aggravent encore les relations diplomatiques.
Ces crises ne sont pas isolées ; elles reflètent une faillite plus profonde de la gouvernance en Afrique, où les État sont bien souvent incapables de résoudre les confrontations sociales et économiques sans avoir recours à la violence.
L’effet Trump
Au milieu de ces crises, l’Afrique évolue aussi dans un ordre international en mutation. Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche a déjà commencé à remodeler les relations entre les États-Unis et l’Afrique. Il y a eu un tournant vers un engagement plus transactionnel et un accent renouvelé sur la sécurité plutôt que sur le développement. L’une des premières et principales mesures de politique étrangère prises par Trump a été de réduire l’aide au développement, de démanteler l’USAID (Agence des États-Unis pour le développement international) et de couper les financements des programmes de santé, dont le programme PEPFAR. Ces décisions laissent des millions de personnes sans accès aux traitements contre le VIH et à d’autres services essentiels.
Ceci a été ressenti plus durement dans les pays où les systèmes de santé sont déjà soumis à de fortes pressions, exacerbant des crises de santé publique qui pourraient avoir des effets déstabilisants à long terme. La justification de ces coupes budgétaires par l’administration repose sur l’idéologie de « l’Amérique d’abord ». Cette idéologie considère l’aide aux pays étrangers comme une dépense qui n’est pas nécessaire plutôt que comme un investissement stratégique en faveur de la stabilité.
Et cela a coïncidé avec un durcissement de la politique d’immigration des États-Unis. L’administration envisage également une interdiction générale des visas qui pourrait affecter des dizaines de pays africains, en restreignant également les voyages pour les étudiants, les travailleur·ses et les touristes. Cela rappelle les interdictions de voyager qui avaient marqué le premier mandat de Trump et souligne un approfondissement de l’isolationnisme des États-Unis dans leurs rapports avec l’Afrique ; ils traitent ce continent plus comme un risque en matière de sécurité et de migrations que comme un partenaire diplomatique et économique.
Trump et l’Afrique du Sud
L’hostilité de l’administration vis-à-vis de l’Afrique du Sud est particulièrement frappante. Trump a expulsé l’ambassadeur sud-africain et imposé des sanctions contre le pays. C’était en réponse à la politique d’expropriation des terres prise par Pretoria (capitale administrative de l’Afrique du Sud, NDLR) et à ses positions en matière de politique étrangère, notamment ses efforts pour qu’Israël soit tenu responsable de génocide à Gaza. L’administration étatsunienne considère cela comme une marque de sympathie pour le Hamas et pour l’Iran.
Ces mesures punitives reflètent un malaise plus large vis-à-vis des gouvernements qui défient l’hégémonie des États-Unis, particulièrement ceux qui se retrouvent au sein des BRICS. En caractérisant les positions politiques de l’Afrique du Sud comme « anti-américaines », Trump a effectivement rompu l’une des relations diplomatiques les plus significatives entre les États-Unis et une puissance africaine. Cela s’inscrit également dans la volonté plus générale de son administration de privilégier les relations avec les États de droite, autoritaires, et à isoler les gouvernements perçus comme de gauche ou indépendants.
Les États-Unis, la Chine et les ressources africaines
En même temps, l’administration Trump cherche à mettre en place des relations différentes avec d’autres États africains, particulièrement dans le domaine des ressources.
L’administration étatsunienne est actuellement en négociations avec la RDC pour aboutir à un accord « minéraux contre sécurité ». Les États-Unis offrent une assistance militaire en échange d’un accès exclusif aux minéraux critiques, essentiels pour leurs industries de pointe, particulièrement dans les domaines des technologies et de la défense. Cet accord accorderait aux compagnies étatsuniennes un contrôle total sur le cobalt et d’autres minéraux essentiels. Cela reflète un changement de la stratégie des États-Unis, passant de l’aide au développement à des politiques d’extraction économique directes.
L’administration prétend que ce partenariat aidera la RDC à se stabiliser en lui fournissant une assistance en matière de sécurité. Des voix critiques avertissent que cela risque d’approfondir les dynamiques priorisant l’extraction des ressources au détriment d’un véritable développement économique.
En même temps, l’approche de la Chine vis-à-vis de l’Afrique change également. Pendant deux décennies, Pékin a été le partenaire économique dominant de ce continent, finançant les infrastructures et le commerce à une échelle qui n’était concurrencée par aucune autre puissance extérieure. Cependant avec le ralentissement de l’économie intérieure chinoise, sa volonté d’offrir des prêts à grande échelle s’est réduite. Des pays comme la Zambie et le Kenya, lourdement endettés vis-à-vis de la Chine, ont d’ores et déjà ressenti la pression du recalibrage de la stratégie de prêts de Pékin. L’époque où la Chine offrait des crédits faciles pour les grands projets d’infrastructure est peut-être en train de s’achever, laissant des États africains en situation précaire. De nombreux gouvernements qui avaient restructuré leur économie autour de la poursuite des investissements chinois peinent désormais à s’adapter à cette nouvelle réalité. Cette évolution laisse l’Afrique avec moins d’options de financement externe, les institutions financières occidentales ayant également durci leurs conditions de prêts, particulièrement pour les pays lourdement endettés.
Une nouvelle politique possible ?
Pour les gouvernements africains, ces développements soulèvent des questions difficiles en matière de stratégie politique et économique. Le déclin des mouvements de libération nationale ne s’est pas encore traduit par l’émergence d’alternatives politiques viables. Dans la région, les partis d’opposition ont largement adopté des modèles néolibéraux de gouvernance, plutôt que d’articuler de nouvelles visions de la transformation économique. À la place d’une avancée décisive vers le renouveau démocratique, la plus grande partie du continent apparaît comme dérivant entre une répression étatique croissante et une opposition fragmentée. De nombreux partis d’opposition, tout en critiquant ouvertement les gouvernements en place, ont échoué à offrir des programmes économiques rompant avec le paradigme néolibéral dominant. Tout cela indique que, même là où les partis dominants connaissent un déclin électoral, il n’y a que très peu de perspectives de changement du paysage politique ou économique en cas de transition.
Les mouvements enracinés dans les luttes sociales à la base continuent de faire pression en faveur du changement, mais leur capacité à remettre en cause les structures de pouvoir en place reste incertaine. Aujourd’hui en Afrique, la faiblesse des alternatives de gauche reflète des tendances globales plus larges où les forces socialistes ou social-démocrates ont du mal à se réaffirmer dans un monde façonné par le capital financier et le pouvoir des multinationales.
Cependant il existe des signes indiquant une possibilité de changement. À travers tout le continent se multiplient des appels à la souveraineté économique, des revendications en faveur de meilleurs programmes de protection sociale, et une résistance grandissante aux diktats financiers externes. Si ces combats fusionnent au sein de formations politiques plus cohérentes, cela pourrait jeter les bases d’un nouveau type de politique, en rupture à la fois avec la faillite des partis post luttes de libération et avec les limites des forces d’opposition libérales.
En Afrique, l’ordre politique post-libération se fissure, mais ce qui émerge est loin d’être clair. L’érosion de la légitimité des partis dominants ne s’est pas encore traduite en transformation systémique significative. Dans de nombreux cas, elle a simplement ouvert la porte à de nouvelles manœuvres des élites. Dans ce moment de transition, le combat réel ne concerne pas seulement les élections mais porte également sur la nature profonde de l’État, la gouvernance économique et la place de l’Afrique au sein d’un ordre mondial qui change rapidement. Jusqu’à ce qu’émergent des alternatives qui défient la dépendance du continent à la finance globale, à l’extraction des ressources et à une croissance tirée par la dette, l’Afrique restera enfermée dans des cycles d’instabilité, que les vieux mouvements de libération soient ou non aux commandes.
Le 2 avril 2025
Cet article a été publié par Amandla! et traduit par François Coustal.