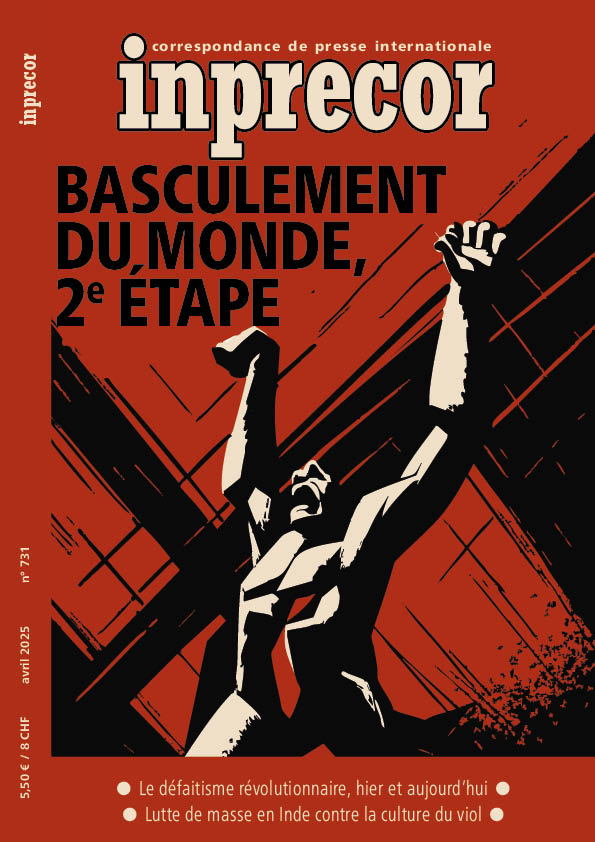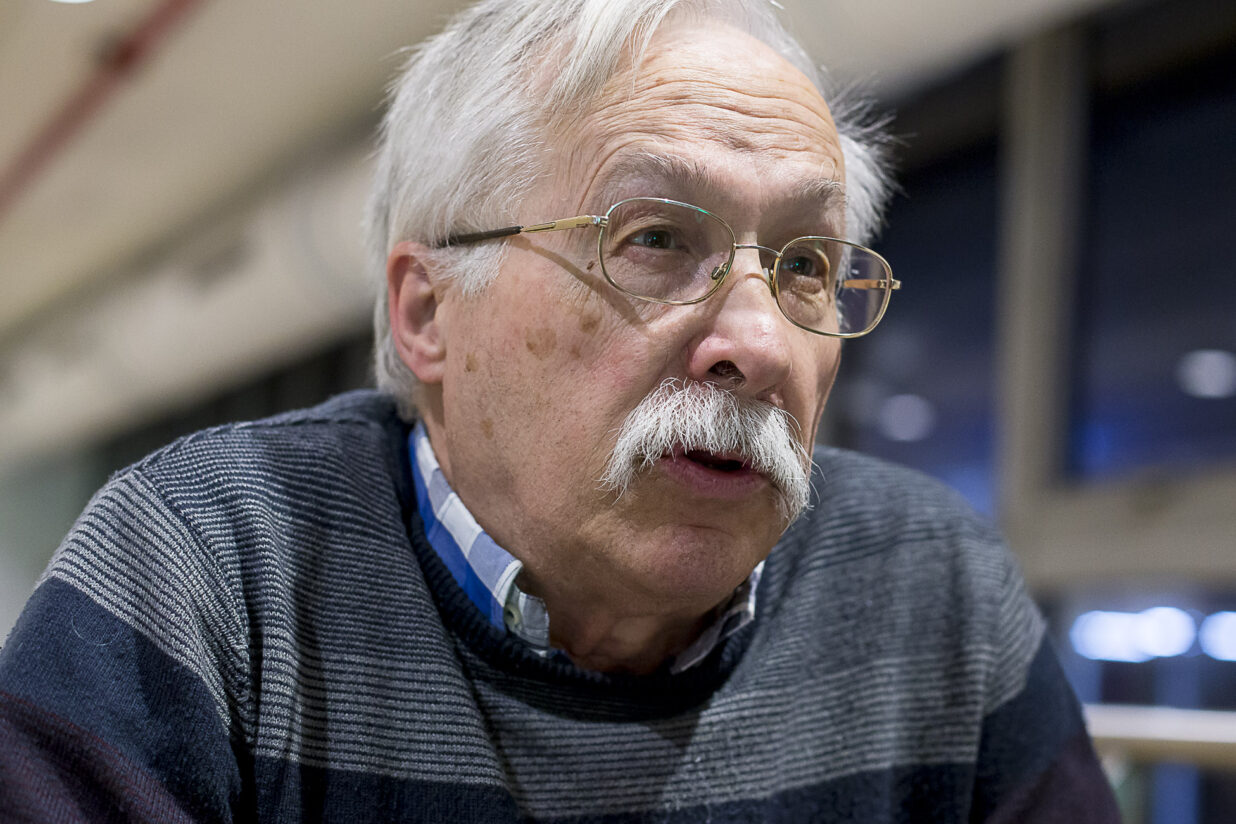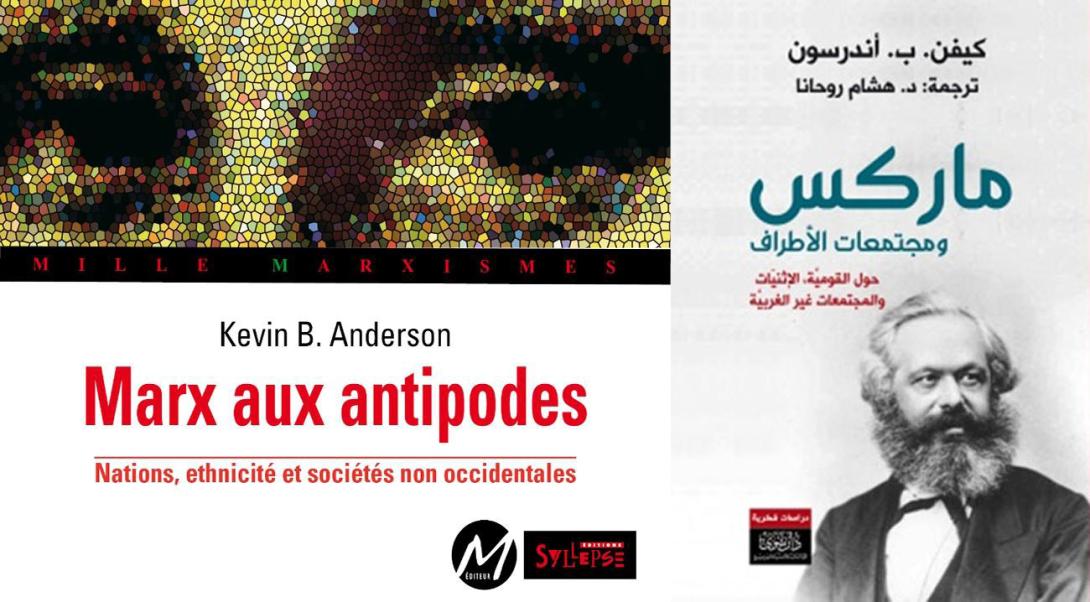
La récente publication en français de Marx aux antipodes, de Kevin B. Anderson, est une très bonne nouvelle. Elle contribue à faire connaître un ambitieux travail de recherche sur les écrits de Marx durant la période allant de 1869 à 1883. En effet, elle accorde une attention particulière à ses notes et commentaires sur les sociétés non occidentales et précapitalistes – bien qu’il se réfère également à des périodes antérieures 1.
Kevin B. Anderson appartient à un courant singulier du marxisme, l’Organisation marxiste-humaniste internationale, dont les références sont Raya Dunayevskaya (autrice, entre autres, de Rosa Luxemburg, Women’s Liberation and the Marxist Philosophy of Revolution) et C.L.R. James (dont l’œuvre la plus connue est les Jacobins noirs), sans oublier l’influence que Frantz Fanon et W.E.B. Du Bois ont eue sur l’évolution personnelle de l’auteur.
Dans cet ouvrage, il s’intéresse, entre autres à l’évolution des réflexions de Marx sur la question nationale en Irlande et en Pologne, aux articles sur la guerre civile en Amérique du Nord et au rôle que peut jouer la commune paysanne en Russie dans un projet socialiste. Il indique également sa préférence pour l’édition française du Capital de 1872-1875 mise à jour par Marx, qui lui permet de clarifier certaines interprétations. Il évoque aussi les Carnets ethnologiques inachevés de 1879-1882 sur les formes agraires et communautaires en Inde, aux Amériques, en Afrique du Nord et dans la Rome antique : il y trouve des notes intéressantes sur le genre et la famille, dans lesquelles on peut trouver des différences avec ce qu’écrira son grand ami Engels.
Marx en marge est également une contribution liée à sa collaboration au projet de publication en 32 volumes intitulé Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA), qui lui a permis d’accéder à des archives d’écrits encore inédits.
Marx intersectionnel
Au travers de ce parcours documenté, Anderson affirme – dans un sens différent de celui défendu par Althusser – que le Marx tardif a évolué vers une conception multilinéaire de l’histoire. Celle-ci, ni déterministe ni économiste, est en même temps très éloignée de la vision eurocentriste qui a pu le caractériser à des stades antérieurs, principalement en ce qui concerne la question coloniale. Cela l’amène à justifier la thèse qu’il défend à la fin de son ouvrage, selon laquelle :
« Marx a développé une théorie dialectique du changement social qui n’était ni unilinéaire ni exclusivement basée sur les classes. Tout comme sa théorie du développement social a évolué dans une direction plus multilinéaire, sa théorie de la révolution a commencé à se concentrer de plus en plus sur l’intersectionnalité de la classe, de l’ethnicité, de la race et du nationalisme. Pour être clair, Marx n’était pas un philosophe de la différence au sens postmoderne, puisque la critique d’une entité globale unique, le capital, était au centre de l’ensemble de son projet intellectuel. Mais centralité ne signifie pas univocité ou exclusivité » (p. 369) 2.
Cette perception d’un Marx intersectionnel peut sembler trop catégorique, mais je crois qu’il y a suffisamment d’éléments dans ses travaux pour affirmer avec Anderson que le Marx tardif s’est orienté vers une vision globale des différentes formes d’exploitation, d’oppression et de domination, d’un point de vue internationaliste et toujours centré sur la critique du capital.
La question nationale
Mais procédons étape par étape. Anderson commence par rappeler les premiers écrits sur l’impact de l’Europe sur l’Inde, l’Indonésie et la Chine, sans nier l’influence de Hegel sur Marx dans sa vision de l’inévitabilité du colonialisme. Il aborde les critiques développées plus tard, entre autres par Edward Saïd, mais leur oppose l’influence que finiront par avoir sur Marx la rébellion des Taiping de 1850-1864 en Chine et celle des Cipayes « insurgés » en 1857 en Inde. Après celles-ci, il en viendra à écrire que « l’Inde est maintenant notre meilleur allié » (p. 88).
Ses réflexions sur la Russie et la Pologne vont également évoluer. Marx reconnait ainsi le rôle de la Pologne en tant que « thermomètre extérieur de la révolution européenne », en particulier depuis l’insurrection polonaise de 1863. Cela apparaît clairement dans le discours inaugural de Marx lors de la fondation de la Première Internationale en 1864, et dans sa polémique avec les Proudhoniens et leur nihilisme national.
Contre le racisme
Un autre chapitre intéressant est celui consacré à la guerre civile en Amérique du Nord, dans lequel est souligné le fort soutien de Marx à la lutte pour l’abolition de l’esclavage, dans le cadre de laquelle il en vient à considérer les Afro-Américains comme des sujets potentiellement révolutionnaires 3, tout en maintenant certaines divergences avec Engels, par exemple en ce qui concerne la Proclamation d’émancipation d’Abraham Lincoln.
La question de l’Irlande est également traitée en profondeur, car Marx et sa famille, comme Engels, y ont été très directement et activement impliqués. Son évolution sur cette question est mieux connue, car elle l’a amené à modifier sa position initiale sur le rapport entre la lutte pour l’indépendance irlandaise et celle du prolétariat anglais. En 1869-1870, il en vient à soutenir que, compte tenu de la prédominance du racisme chez les ouvriers anglais par rapport aux immigré·es irlandais·es, c’est la lutte du peuple irlandais qui doit être le « levier » de la révolution en Angleterre, et non l’inverse.
Marx dé-eurocentré
En ce qui concerne les sociétés non occidentales, Anderson note que, dans ses Manuscrits économiques de 1861-1863, Marx reconnaît déjà la singularité du mode de production asiatique par rapport au féodalisme occidental et il indique ensuite que « le point de vue de Marx sur le “système communal asiatique” et ses villages a manifestement changé par rapport à l’insistance sur le “despotisme oriental” et la léthargie végétative qu’il avait observés auparavant » (p. 263). Cette évolution se reflète également dans son rejet de toute philosophie téléologique de l’histoire, comme le montre la mise à jour par Marx de l’édition française du Capital de 1872-1875 : il y affirme que « Le pays le plus industriellement développé ne montre, à ceux qui le suivent sur l’échelle industrielle, que l’image de son propre avenir » (souligné par Anderson) (p. 276). Il exclut donc de cette conception unilinéaire les pays qui n’entrent pas dans ce cadre, comme la Russie ou l’Inde, et s’engage dans une vision multilinéaire de l’histoire, différente de celle que l’on pouvait interpréter dans le Manifeste communiste et d’autres de ses articles sur la question coloniale.
Inspirations communistes
Ainsi, sous l’influence des écrits de Kovalevsky sur les formes de propriété communale en particulier, Marx en viendra à reconnaître le rôle qu’elles ont joué dans différents pays, tels que l’Inde, l’Algérie, l’Amérique latine et, surtout, la Russie. Ainsi, se référant à la Russie dans sa célèbre correspondance avec Vera Zassoulitch, mais étendant ses réflexions à d’autres régions, il exprime son espoir que les communes rurales soient « des points de départ pour le développement communiste ». Cependant, Anderson ne manque pas de souligner que Marx considère que pour que cela se produise, il faudrait qu’elles soient liées aux « révolutions naissantes de la classe ouvrière dans le développement industriel occidental » (p. 341).
Tout aussi intéressante est la référence à ses écrits de 1879-1882 sur la question du genre à travers ses études sur les peuples indigènes mais aussi sur la société romaine et ses notes sur les travaux de Morgan. Anderson souligne comment Marx, dans ces notes, analyse en termes dialectiques les formes alternatives de relations de genre qui existaient dans ces communautés, en les situant dans leurs époques respectives et en évitant les « idéalisations simplistes ».
Combler le fossé
L’ensemble de ces travaux fournit donc des raisons suffisantes pour soutenir la thèse selon laquelle il est possible de trouver chez Marx l’élaboration progressive d’une « théorie dialectique du changement social qui n’était ni unilinéaire ni exclusivement basée sur les classes ».
Dans la préface rédigée pour l’édition espagnole, Anderson explique également qu’avec ce livre, il a tenté de « combler le fossé entre deux courants » : celui qui se concentre sur la domination de classe, d’une part, et celui qui lutte contre d’autres oppressions ou la destruction de l’environnement, d’autre part. Cette dernière dimension, certes fondamentale en ces temps de capitalisme du désastre, n’entre pas dans le cadre de cet ouvrage, mais l’auteur n’en ignore pas la pertinence en se référant à certaines contributions sur le sujet, notamment celles de Kohei Saito, qui ne sont pourtant pas exemptes de controverses.
Les exemples ne manquent pas de l’utilité de cette vision multidimensionnelle de Marx pour aborder les conflits et les débats d’aujourd’hui avec de meilleurs outils, en dépassant les fausses oppositions binaires. Espérons donc que ce travail ne sera pas reçu comme quelque chose d’étranger aux préoccupations des nouvelles générations qui s’engagent aujourd’hui à « repenser les luttes et la révolution » en ces temps d’urgence mondiale, que ce soit à partir du marxisme ou en dialoguant avec lui 4.
Traduit par Fabrice Germain. Le 21 mai 2024
- 1
Jusqu’à récemment, alors que de nombreuses contributions intéressantes sur cette période ont été publiées (comme celles de Marcello Musto ou d’Álvaro García Linera), on ne disposait en espagnol que de l’édition de 1988 par Siglo XXI de Los apuntes etnológicos de Karl Marx, de Lawrence Krader, ou l’édition de 1990 par EditorialRevolución de El Marx tardío y la vía rusa, coordonnée par Teodor Shanin.
- 2
Les citations sont tirées de l’édition espagnole de Verso. La version française est publiée chez Syllepse.
- 3
Rappelons également sa sentence selon laquelle « l’ouvrier américain à la peau blanche ne peut s’émanciper tant que celui à la peau noire est encore marqué au fer rouge ».
- 4