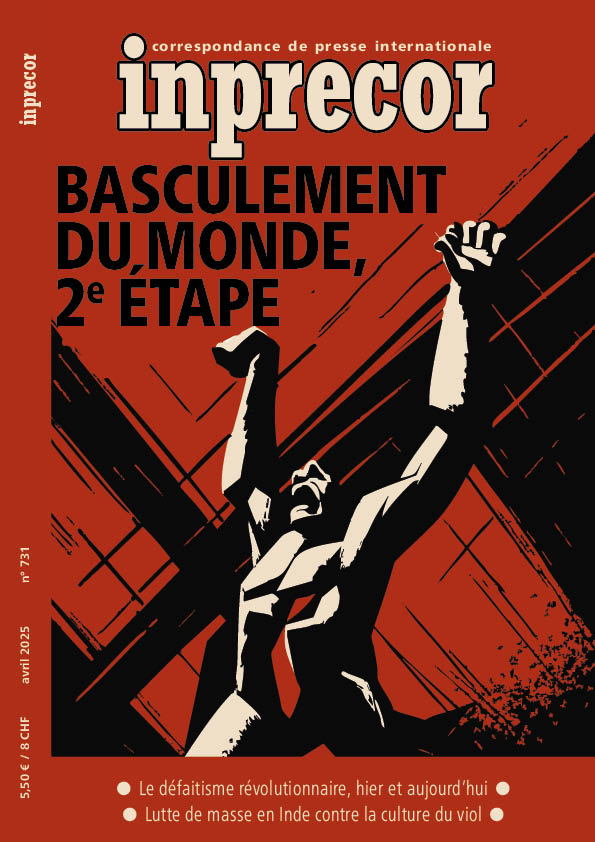Les premiers mois de Trump à la Maison Blanche représentent une gigantesque accélération de l’histoire. Les rapports de forces entre les puissances sont percutés, les politiques antisociales et racistes aux États-Unis sont fortement renforcées. Nous vivons un saut dans la situation : la réaction au « basculement du monde » qu’annonçait François Sabado en 2011 1.
Ce choc était attendu. En effet, la victoire du candidat du Parti républicain était prévisible, en raison des prises de positions de sa concurrente Kamala Harris et du Parti démocrate, qui les ont conduits vers une défaite programmée. La façon dont la départ de Trump s’était déroulé en 2021, avec une répétition générale de coup d’État au Capitole, et le contenu de sa campagne, ont également donné de fortes indications sur sa politique à venir.
Il n’en reste pas moins que le monde entier est percuté par la politique du nouveau président, qui dispose de presque tous les pouvoirs – la présidence, la majorité au Congrès (à la Chambre des représentants comme au Sénat) et à la Cour suprême.
La réaction trumpiste
Les premières mesures de Trump sont terrifiantes, avec notamment ce qu’il appelle « le plus grand programme d’expulsion de l’histoire américaine ». Il qualifie les immigré·es d’« envahisseurs » criminels et a annoncé la fin du statut légal de 532 000 Latino-Américain·es, Cubain·es, Haïtien·es, Nicaraguayen·nes et Vénézuélien·nes, sommés de quitter le territoire avant le 25 avril.
Le droit à l’avortement est gravement attaqué par l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade, tout comme les droits des LGBTI, notamment par la suppression des mesures DEI (diversité, équité, inclusion) et le fait que le gouvernement ne reconnaisse plus comme genres que l’homme et la femme.
Le travail de destruction entrepris par le Département de l’Efficacité gouvernementale (DOGE, Department of Government Efficiency) dirigé par Elon Musk aboutit à la suppression du ministère fédéral de l’Éducation, aux licenciements de milliers de travailleur·es dans diverses agences, administrations, instituts, universités, dans la santé, etc. 50 000 emplois seraient menacés. Plusieurs milliards de subventions seraient retirés également dans la recherche médicale et scientifiques, notamment dans le domaine des maladies infectieuse. Des « juges fédéraux voyous » sont menacés de destitution et reçoivent des menaces de mort. La liberté de la presse et foulée aux pieds.
Trump contribue à la transformation des États-Unis en un système encore plus autoritaire qu’il ne l’était déjà, et la menace d’un coup d’État ou d’une transformation progressive en dictature est concrète 2.
Sur le plan des relations internationales, le changement est considérable avec la mise en place d’une nouvelle stratégie de défense des intérêts des classes dominantes étatsuniennes, qui consiste à exiger une vassalisation accrue de ses alliés, comme en témoigne la pression sur le Canada et le Mexique, en particulier sur les droits de douane. En Ukraine, la politique de Trump semble osciller entre un « deal » avec Poutine visant à se partager le pays et ses richesses – à l’image du partage de la Pologne par Hitler et Staline en 1939 – et la mise en place d’un protectorat par les États-Unis en échange de positions économiques et de la saisie des richesses ukrainiennes… les deux hypothèses n’étant d’ailleurs pas incompatibles.
L’accélération de l’offensive guerrière en Palestine, par le redoublement des bombardements et l’offensive au sol à Gaza, ainsi que les attaques en Cisjordanie, témoigne d’une volonté du couple Israël-USA de renforcer leur mainmise sur la région, quelles qu’en soient les conséquences humaines.
Face à la Russie à de la Chine
Plus fondamentalement, la politique de Trump est une accélération de la réaction des classes dominantes étatsuniennes au basculement du monde en cours depuis près de vingt ans. François Sabado indiquait que « la crise accentue les changements de rapports de forces mondiaux avec la poussée des pays émergents, le recul des USA et surtout de l’Europe. Le monde occidental, surtout nord-américain, conserve sa puissance politique et militaire, il garde sa force économique mais il recule face à la Chine et dans ses rapports avec d’autres puissances montantes » 3. Mais la crise s’est encore accentuée, avec des taux de croissance divisés par 2 ou 3. Et la crise écologique rend vitale pour les capitalistes la reconfiguration du monde, des zones d’influence et de pillage des richesses. La concurrence en est exacerbée et les grandes puissances sont entrées dans une phase de confrontation plus forte.
Ainsi, l’offensive impérialiste des États-Unis n’est pas isolée – nous avons traité à de nombreuses reprises le rôle de la Russie dans l’offensive guerrière en Ukraine, qui vise à coloniser l’Ukraine, à y prendre les richesses et le pouvoir politique. On parle moins souvent de ses interventions en Afrique, à travers le groupe Wagner, notamment en Lybie, en République centrafricaine, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et à travers l’installation d’une base militaire au Soudan, en Libye, au Tchad, etc. La Russie n’a pas pu, dans ce contexte, maintenir sa domination sur la Syrie.
La Chine pousse aussi ses pions, en se positionnant dans toute l’Afrique, mais aussi en Amérique latine où elle est devenue le deuxième partenaire commercial (+ 151 % entre 2007 et 2017, un plan de coopération visant à augmenter le montant du commerce à 500 milliards de dollars et à développer des investissements à hauteur de 250 milliards) 4. Elle constitue une alliance de fait avec la Russie, à la fois sur le plan militaire (exercices communs, ventes d’armes à la Russie…) et sur le plan économique et énergétique, dans une dynamique où la Russie, hier plus avancée, devient de plus en plus dépendante et soumise économiquement à la Chine.
Le troisième pôle
Les tentatives d’accord de Trump avec Poutine ont constitué un électrochoc pour l’Union européenne, plus précisément pour la France et l’Allemagne. Les deux principales puissances européennes – sur le plan militaire et économique – en ont déduit une nécessité d’accélérer la construction de la puissance européenne qui n’avançait plus depuis près de vingt ans. Pour le futur chancelier allemand Merz, il est « minuit moins cinq, et la priorité absolue est que les Européens puissent se défendre eux-mêmes » sur le plan commercial comme militaire.
En quelques jours début mars, les dirigeants français, allemand, britannique et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se sont accordé·es sur la mise en place de plans pour multiplier les dépenses militaires. 4,7% du PIB en Pologne, 5 % en Estonie, 5 à 6% en Lituanie, 2,5 % au Royaume-Uni, 3,5 % en France, doubler les dépenses au Danemark… Merz a fait voter un plan d’investissement de 1 000 milliards sur dix ans remettant en cause la règle du déficit « zéro » dans un pays marqué par le pacifisme depuis 1945. Le gouvernement français veut aller chercher des centaines de milliards de financements dans les livrets A et les assurances vie…
Sur le plan économique, le commissaire européen chargé de la Prospérité et de la Stratégie industrielle décrit une volonté d’« européaniser » les entreprises, tant sur le plan des débouchés que des chaines de production, avec une « préférence européenne », tout cela en mettant de côté les objectifs de décarbonation.
Leur politique est donc de constituer une Europe puissance, capable de concurrencer les États-Unis comme la Russie. À ce stade, l’extrême droite et les secteurs de la bourgeoisie qui l’ont rejointe restent éblouis par Trump et Poutine, qu’ils considèrent comme des modèles. Mais déjà en Italie, l’extrême droite s’aligne sur la volonté de construire la puissance européenne. Giorgia Meloni a ainsi déclaré que l’Italie fait « pleinement partie de l’Europe et du monde occidental ». Le Rassemblement national français a changé de position sur la sortie de l’OTAN. Le positionnement, sur la moyenne durée, des extrêmes droites européennes, et sa capacité à incarner une réaction bourgeoise européenne autoritaire, est encore indéterminé.
Une marche irrésistible
Les dangers de cette accélération des tensions entre les grandes puissances impérialistes sont immenses, sur le plan militaire comme social. Car ces tensions s’inscrivent dans la crise de profitabilité du capitalisme 5, dans son incapacité à relancer la machine et dans l’accélération de son caractère prédateur6. Cette dynamique n’est pas nouvelle, les dépenses militaires étatsuniennes ayant par exemple fortement progressé depuis une dizaine d’années, mais elle s’est fortement renforcée, menant le monde devant la possibilité d’affrontements – économiques ou militaires – d’une ampleur sans précédent depuis la fin de l’URSS.
On ne peut distinguer ces deux types d’affrontements, liés aux besoins des classes dominantes de conquérir de nouveaux espaces d’influence économique, par la modification des balances commerciales, des droits de douane, le pillage de ressources, etc. C’est ainsi qu’il faut comprendre la guerre commerciale des États-Unis avec l’Union européenne.
On ne peut pas non plus distinguer les affrontements interimpérialistes des attaques antisociales, racistes et autoritaires, généralisées dans la plupart des pays du monde, car elles visent elles aussi à décupler les capacités à exploiter chaque espace du capitalisme. C’est le sens de l’ubérisation, de la multiplication de la vente ou la location de services, de la surexploitation des sans-papiers et du développement du travail informel, la destruction-privatisation des services publics, etc. Tandis que le racisme contribue à la surexploitation, à créer un état d’esprit nationaliste et guerrier, et à impacter les capacités de résistance des classes populaires. La répression et toutes les mesures antidémocratiques, combinée au contrôle de l’information et des médias, complètent ce tableau menant à toujours plus de guerres et d’autoritarisme.
L’extrême droite fascisante sous ses multiples formes progresse partout dans le monde et est au pouvoir ou à ses portes dans plusieurs pays d’Europe, car elle offre une réponse sur une grande partie de ces terrains.
Les réactions populaires
Les attaques des classes dominantes ne sont cependant pas sans réponse, et les mobilisations de masse se sont multipliées ces dernières semaines, car les politiques des classes dominantes commencent à toucher au cœur de ce qui permet l’acceptation du capitalisme par les classes populaires : un minimum de respect démocratique et social. Comme le dit Robi Morder, la cassure s’opère lorsque la dignité est attaquée 7.
Et, ainsi, on a vu fleurir de grandes manifestations en Serbie et en Grèce contre les mensonges concernant des accidents ferroviaires, et en Turquie contre l’emprisonnement du maire d’Istanbul. Ces mobilisations s’affrontent au pouvoir politique et ne se contentent pas de revendications immédiates, elles sont aussi le réceptacle de colères sociales et démocratiques plus larges. Aux États-Unis, les mobilisations contre les mesures anti-immigré·es sont conséquentes. En France, les mobilisations féministes surtout, mais aussi antiracistes et contre les licenciements, ont montré que la situation reste très instable. C’est également le cas en Amérique latine, en Grande-Bretagne après les réactions aux attaques racistes, en Allemagne avec les mobilisations contre l’extrême droite et les réactions, même limitées, sur l’emploi. Etc.
Pour les révolutionnaires, la situation est loin d’être simple. Une grande partie de la gauche est prête à s’aligner sur les politiques bellicistes, par chauvinisme ou par accord avec les possibilités de relance provisoire de l’économie par les dépenses militaires. Les organisations de la gauche institutionnelle sont en effet reliées à l’ordre bourgeois par de multiples éléments : les appareils syndicaux dépendent en grande partie de l’État, et certains sont prêts à se laisser emporter dans la fuite en avant guerrière et énergétique sous prétexte de sauvegarde de l’emploi ; les élu·es sont attaché·es à leurs postes ; différents liens humains et idéologiques existent au sein des castes dirigeantes. Dans d’autres secteurs, la tentation campiste domine, ou l’indifférence vis-à-vis de la résistance des peuples – en Palestine ou en Ukraine selon les pays et les organisations –, sacrifiés en fonction des intérêts des grandes puissances.
Face à la montée de la concurrence et du militarisme, les jeux sont loin d’être faits ; comme avant les deux guerres mondiales, les alliances ne sont ni complètement prédéterminées ni figées, car elles dépendent de nombreux facteurs : les intérêts croisés des différents secteurs économiques (nouvelles technologies, industrie, finance…) et des couches de la bourgeoisie qui leur correspondent.
Des éléments d’orientation
On ne peut donc, à ce stade, que déterminer des principes généraux et quelques positions tactiques. Le premier principe est de rappeler que la nature politique des régimes ne détermine pas leur place dans les rapports entre puissances : on doit s’opposer aux impérialistes et soutenir les nations opprimées, quel qu’en soit le pouvoir politique. On doit ainsi s’opposer à l’invasion russe et soutenir l’Ukraine, quelle que soit la nature du régime de Zelenski, en espérant que la défaite de la Russie provoque un bouleversement dans le pays.
Nous devons nous opposer au militarisme des grandes puissances, à l’augmentation des budgets militaires, nous devons promouvoir le désarmement nucléaire, et nous positionner pour la défaite des puissances impérialistes 8. Le positionnement par rapport au militarisme est complexe mais il semble que, dans la période actuelle, nous avons intérêt à renforcer le sentiment anti-guerre et à participer à la construction d’un mouvement contre la montée guerrière. Un tel mouvement ne s’oppose pas – au contraire même il doit les soutenir – aux guerres de libération contre l’impérialisme, armées comme non armées, en Ukraine et en Palestine notamment, et quelles que soient les directions politiques des mouvements de libération.
Troisième point, dans tous les conflits, nous soutenons les solutions par en bas. En Ukraine, où nous savons qu’une victoire a besoin d’une participation populaire, qui nécessite un changement, au moins de la politique antisociale de l’État, si ce n’est un changement de régime. Mais aussi au Kurdistan, en Syrie, et partout ailleurs. C’est le cas aussi, bien sûr, pour les luttes sociales : il est urgent dans chaque pays de s’opposer aux attaques libérales, à l’autoritarisme en défendant la démocratie – notamment contre l’extrême droite –, au racisme et à toutes les discriminations, en construisant des mouvements de masse.
Le quatrième point est la nécessité absolue de l’unité dans cette situation : les contradictions de classes s’exacerbant, et même lorsque les organisations du mouvement ouvrier sont très intégrées et passives, les conflits produiront de façon quasiment mécanique des repositionnements concrétisant politiquement les oppositions entre bourgeoisie et prolétariat. Donc, tout en gardant notre indépendance par rapport à des gouvernements de centre-gauche acquis au libéralisme, et en tout en construisant des forces révolutionnaires ouvertes indépendantes, il est capital de se situer à l’intérieur de l’unité d’action. C’est en particulier le cas dans la lutte contre l’extrême droite et contre les offensives réactionnaires.
Le cinquième point est que toutes les certitudes sur l’appréciation des rapports de forces et de la conscience peuvent être remises en cause du jour au lendemain. D’abord parce que, « au niveau planétaire, si les politiques existantes se poursuivent sans mesures additionnelles, le GIEC (rapport de synthèse 2023) estime que le réchauffement atteindrait +1,5 °C vers 2030, +2 °C vers 2050 et autour de +3 °C en 2100 par rapport à 1900 »9, avec des conséquences imprévisibles. Et parce que les effets de la fuite en avant capitaliste produiront des secousses dans la jeunesse et le monde du travail qui sont impossibles à prévoir. À nous de répondre présent·es.
Mardi 1er avril 2025
- 1
- 2
« États-Unis : Quelle est la distance qui nous sépare du fascisme ? », Dan La Botz, L’Anticapitaliste, 27 mars 2025.
- 3
F. Sabado, idem.
- 4
« Chine : l’autre superpuissance », Alternatives sud, 1er trimestre 2021.
- 5
- 6
- 7
« L’unité et le combat pour la dignité sont les ciments des mobilisations de masse de la jeunesse », Robi Morder, revue L’Anticapitaliste, avril 2023.
- 8
« Le défaitisme révolutionnaire, hier et aujourd’hui », Simon Hannah, Inprecor, 19 mai 2022.
- 9