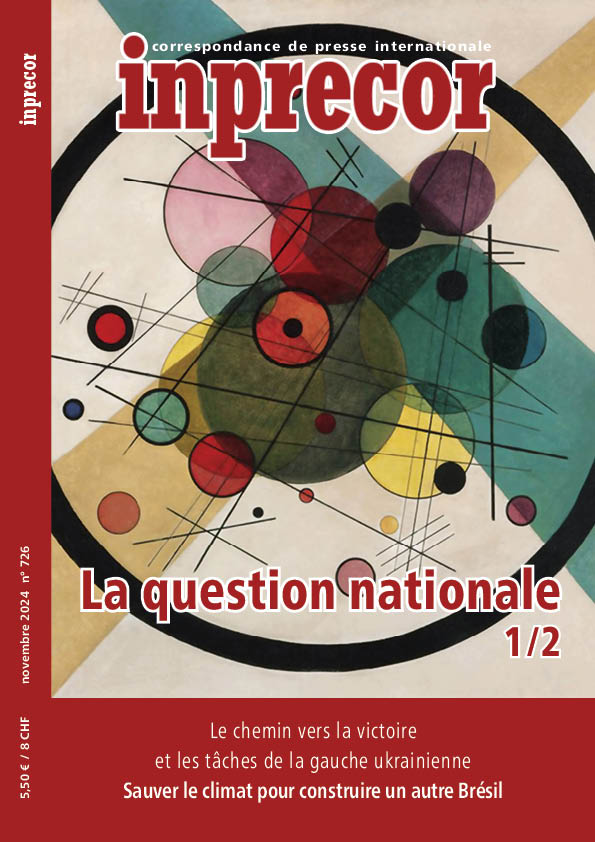La notion d’ethnie, au croisement de filiations culturelles, de pouvoir et de sang, devrait être davantage intégrée dans une analyse marxiste, notamment pour ce que les liens ethniques impliquent comme choix spontanés pour les populations et comme nécessités démocratiques.
Lorsque l’on parle de l’Afrique, on évoque souvent la notion d’ethnie, tant dans les journaux généralistes que parmi les chercheurs/ses en sciences sociales. Comment peut-on définir ce concept ?
En France dans les années 1930, on a commencé à employer le mot ethnie comme un cache-sexe du mot race. Mais ce mot lui-même n’avait pas tout à fait le même sens que celui auquel il est réduit aujourd’hui. Par exemple, Ernest Renan, le grand théoricien de la nation française du 19e siècle, qui a écrit Qu’est-ce qu’une nation ?, parle très couramment de « race française ». Cela signifie communauté, ou nation, mais avec l’idée que la culture est dans le sang. C’est une espèce d’essentialisme. L’Internationale communiste parlait de « nègre », ce qu’on ne fait plus aujourd’hui.
Dans les années 1930, on a commencé à utiliser le mot ethnie de façon aussi essentialiste. En France, dans les sciences sociales, les deux moments fondateurs de la discussion plus moderne du mot et du concept d’ethnie sont, d’abord, le livre de Jean-Loup Amselle et d’Elikia M’Bokolo Au cœur de l’ethnie, publié pour la première fois en 1985, et puis quelques années plus tard le livre de Jean-Pierre Chrétien et Gérard Prunier Les ethnies ont une histoire, publié en 1989. La thèse est que l’ethnie n’est pas simplement une manipulation des colonisateurs, que les Africain·es n’ont pas attendu les Européens pour ressentir des identités – qu’on peut appeler ethnie ou nation – qui sont des constructions sociales et par conséquent fluctuantes. Il y a des identités pluriséculaires en Afrique, je pense par exemple à la nation Kongo, initialement fruit d’une construction politique. Le royaume Kongo existait depuis deux siècles avant l’arrivée des Portugais dans la région en 1482 et l’identité Kongo existe toujours, bien que les frontières coloniales l’aient divisée en cinq morceaux : l’ouest du Congo Brazzaville, l’ouest du Congo « démocratique », l’extrême-sud du Gabon, l’enclave de Cabinda qui appartient à l’Angola et les deux provinces nord de ce pays qui s’appellent d’ailleurs Congo et Zaíre. C’est une entité qui continue d’exister, qui a sa propre langue, ses propres rites, son roi comme dignitaire culturel – même s’il possède un rôle mineur – et dont la capitale est Mbanza-Kongo en Angola.
En tant que marxiste, ce qui m’a toujours frappé, c’est la difficulté à appréhender le phénomène ethnique. Il y avait eu un peu le même débat en Europe sur la question nationale. On se rappelle qu’Engels était en faveur de l’indépendance de l’Irlande et de la Pologne alors que Rosa Luxembourg était contre l’indépendance de cette dernière parce qu’elle considérait que cela allait diviser le prolétariat qui était unifié par la force au sein de l’Empire allemand. Engels expliquait qu’un prolétaire, pour entrer dans la lutte, devait d’abord savoir sur quel territoire il marchait, ce qui relevait de lui : pour qu’un prolétaire irlandais puisse s’allier au prolétaire anglais, il fallait que la question nationale soit résolue. Engels accordait de l’importance à l’Irlande et à la Pologne parce qu’elles étaient colonisées respectivement par l’Angleterre et l’Allemagne, deux grands pays industriels. Il avait une sympathie que je qualifierais d’un peu instrumentale. Et le même Engels eut des phrases épouvantables sur les États des Balkans, petits, avec des peuples « sans histoire ». Comme il ne s’agissait pas de pays industriels, il les considérait comme retardataires. Or, d’un point de vue matérialiste, l’ethnicité est une formation sociale subjective qui exprime des sociétés selon des trajectoires identitaires qui sont les leurs et doivent intégrer notre réflexion.
Peux-tu préciser la notion d’ethnicité ?
Quand je parle d’ethnicité je ne parle pas simplement d’ethnie mais aussi de nation, que contrairement à la tradition jacobine je ne confonds pas avec la République et avec l’État. Par exemple la nation française ne peut pas être définie autrement que de la manière suivante : la nation est l’ensemble des gens qui se sentent Français, point final. De ce point de vue il n’y a strictement aucune raison de faire une différence de nature entre nation et ethnie, si ce n’est un degré d’ethnicité. La nation serait le degré le plus élevé en termes d’intensité de la cristallisation identitaire et de sa durée.
Je ne vois pas pourquoi on utiliserait le terme « nation » pour l’identité française – je suis persuadé que la nation française existe car il y a des gens qui se reconnaissent comme tels – et le terme ethnie pour l’identité Kongo, alors qu’à l’arrivée des Portugais, il y avait déjà un peuple Kongo avec son identité et sa langue. Serait-ce parce qu’on est en Afrique ? Je suis extrêmement méfiant par rapport à la hiérarchisation sémantique que l’on établit entre nations et ethnies. Toutes les nations sont des ethnies mais toutes les ethnies ne sont pas des nations, si on l’accepte mon idée de degrés d’ethnicité, c’est-à-dire que l’ethnie serait un degré moindre, plus fluide, moins cristallisé, peut-être moins durable d’identité. Il y a des ethnies qui ont disparu et d’autres qui sont apparues en raison du colonialisme. Cela ne veut pas dire que ce sont les colonisateurs qui ont créé les ethnies, dans la fameuse idée du diviser pour régner. Les colonisateurs ont classifié les gens, les missionnaires ont traduit la Bible dans les langues les plus efficaces pour eux – et cela a eu des effets très importants – mais ils se sont servis de ce qui existait déjà. On ne peut pas manipuler quelque chose qui n’existe pas.
Pourtant dans le livre Au cœur de l’ethnie, sous la direction de Jean-Loup Amselle et Elikia M’Bokolo, auquel tu faisais référence, un chapitre écrit par Jean-Pierre Dozon est intitulé : « Les Bete : une création coloniale ».
Je ne suis pas du tout spécialiste de cette région. Il a peut-être raison, s’il prouve qu’un administrateur colonial a défini des gens et les a regroupés dans une circonscription qu’il a organisée, et que petit à petit ces gens se sont habitués à cette structuration coloniale qui serait devenue ethnique. Il est possible que ça ait marché mais on ne peut en déduire une loi générale selon laquelle les ethnies auraient été inventées par le colonisateur. Cela signifierait que les Africain·e·s auraient dû attendre l’arrivée des colonisateurs pour ressentir des identités communautaires qui n’étaient pas simplement lignage et clan.
Prenons le cas de deux pays très différents, les îles du Cap-Vert et le Mozambique. Le Mozambique est un pays du cône sud de l’Afrique, riverain de l’océan Indien, et dont la population fait partie de la grande famille des Bantous. Le Cap-Vert est un archipel créole situé dans l’océan Atlantique, 500 km à l’ouest de Dakar, qui n’était pas peuplé quand les Portugais sont arrivés. Il a été peuplé intégralement d’esclaves venus de différents endroits d’Afrique, qui n’avaient pas les mêmes identités, les mêmes religions, qui ne parlaient pas la même langue, et c’est pourquoi ils ont dû forger la langue créole. Une nouvelle identité est donc apparue, l’identité créole, circonscrite territorialement par l’archipel. On peut dire qu’historiquement il y a eu la formation d’une nation tout à fait comparable à nos nations en Europe. Il n’y a pas de problème majeur d’identification entre le Capverdien le plus pauvre et l’État capverdien.
Pour le Mozambique, c’est différent, car on est dans l’Afrique continentale. Le pays a été également colonisé par les Portugais au tout début du 17e siècle, même si la majeure partie du territoire n’a été occupée qu’à la fin du 19e. C’est l’Afrique bantoue avec ses lignages, ses chefferies traditionnelles, ses nations africaines précoloniales, de grands États qui ont été vaincus militairement par les Portugais. Il y avait des identités africaines, mais ce n’était pas forcément des États-nations : le nkosi (roi/chef) de l’une des principales formations politiques au sud du Mozambique, l’empire de Gaza, était un immigrant zoulou lié au Mfecane (grands mouvements des migrations des Zoulous à partir de la fin du 18e siècle). C’était un État tout à esclavagiste et violent qui a partiellement « zouloufié » ces populations. Même ainsi, sa population était loin d’être homogène, ce n’était pas un État-nation précolonial. Mais d’autres entités politiques relevaient de populations bien plus homogènes. Pourquoi ne pas les appeler nations ?
Dans le centre du pays on avait un phénomène très différent, les prazos. Il s’agissait d’anciennes féodalités portugaises qui s’étaient largement africanisées sans se « retraditionnaliser ». Des chefs noirs ou goanais possédaient des terres au nom du roi du Portugal. Ces structures politiques se surimposèrent à des identités existant préalablement. Ces entités étaient des clans ou des lignages, parfois des identités très marquées, dans le nord du pays, notamment chez les Makonde et les Makua. Les Portugais occupant la totalité du territoire à la fin du 19e siècle n’ont pas transformé la population en « Portugais noirs », les gens naturellement ont continué d’être africains. Le Front de libération du Mozambique (Frelimo), prenant le pouvoir en 1975 après dix ans de lutte armée, a refusé de tenir compte de l’existence de nations africaines précoloniales, considérées en bloc comme « tribalisme », n’a pas promu leur culture et leur langue. Mais il n’a pas non plus réussi à être un État social pour les 80% de la population qui était rurale, qui aurait pu mener tous ces groupes à s’identifier au « Mozambique », ce nouvel espace territorial qui fait officiellement nation. À l’inverse, « Pour que la nation vive, la tribu doit mourir », telle fut la politique du Frelimo. L’emploi du mot tribu était fortement contestable et cette politique anti-ethnique eut des conséquences pratiques, comme des campagnes d’alphabétisation menées exclusivement en portugais – avec un taux d’échec gigantesque –, avec l’interdiction des chefs traditionnels, des rituels de la pluie, etc. Cela a été, selon moi, une espèce de tentative de « portugalisation » ou de « lusophonisation » du pays avec l’idée de l’Homme Nouveau, empruntant un jargon un peu maoïsant.
En France, il s’est passé un peu la même chose, avec une très forte répression ethnique ; Napoléon, puis Napoléon III, et surtout la Troisième République ont francisé la France : tout le monde se rappelle des écriteaux « il est interdit de cracher et de parler basque ou breton à la récréation ». Mais cet État français qui réprimait les ethnicités créait en même temps l’école publique obligatoire, des hôpitaux, des routes, des ponts, il apportait le progrès et il y eut ainsi une identification politique à l’État social français, et petit à petit cela devint une identification nationale. Cet échange entre progrès social et répression ethnique – je ne dis pas que ce fut bien – put fonctionner.
L’État capitaliste de la périphérie ou de l’ultra périphérie, comme le sont les États africains, n’est pas, sauf à de rares exceptions, un État social, c’est un État néocolonial, kleptocrate 1 qui opprime socialement, économiquement mais aussi ethniquement bien qu’il ait des pratiques ethno-clientéliste. Des ministres construisent la route qui va à leur village en détournant le budget de leur ministère, mais ce n’est pas du tout une politique de conjugaison des identités africaines pour construire une nation de nations.
Si l’on prend le cas de la Grande-Bretagne, elle n’est pas la fédération de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord. Ce n’est pas un État fédéral, il y a une supra-identité britannique. C’est une identité au singulier d’identités au pluriel. Un Écossais peut admettre qu’il est un Britannique, mais il ne lui plaira pas d’être confondu avec un Anglais. Les États africains n’ont pas suivi ce modèle de l’emboîtement des identités et ils ont opposé des nations africaines précoloniales à la nouvelle nation qui devait être une rupture au lieu d’être cette conjugaison coagulée par un État social.
Le système en Éthiopie tient compte, du moins officiellement, des différentes ethnies.
C’est presque une exception, et qui n’a pas fonctionné du tout. Dans ce pays, on a le fédéralisme identitaire. En principe, chaque nation constitutive dispose d’un territoire avec une province autonome, mais le pays est régi par une dictature et les autonomies n’ont jamais été respectées. Ce qu’il y avait de bien dans la Constitution n’a ainsi pas été matérialisé.
Je ne dis pas qu’il faut le fédéralisme partout au sein de chaque pays en Afrique. Le fédéralisme interne aux pays africains risque de mener à la définition de provinces mono-ethniques. Or en Afrique les provinces mono-ethniques sont très rares. Dans la région Makua, il y a aussi des Makonde, des Yao, un peuple majoritaire et des peuples minoritaires. La question n’est pas de faire du fédéralisme, il faudrait plutôt regarder du côté de la Bolivie d’Evo Morales qui en 2009 a proclamé la Constitution de l’État unitaire plurinational de Bolivie.
Le fait ethnique en Afrique n’est pas un ennemi pour nous, marxistes. C’est tout simplement quelque chose qui existe dans la société, qu’il faut se garder d’essentialiser. Ce sont des identités qui peuvent devenir ou non des nations mais parfois le mécontentement social va s’exprimer selon des alignements ethniques. En général, il n’y a jamais de guerre civile dont la caractéristique serait uniquement inter-ethnique. Par exemple dans le cas du Rwanda, les Hutu et les Tutsi ne sont pas deux ethnies. S’il faut leur donner un nom, ce sont plutôt des castes, deux regroupements ayant la même langue, les mêmes mythes d’origine, le même royaume, mais certains étaient considérés professionnellement comme des agriculteurs et d’autres comme des éleveurs. Tout le monde sera d’accord pour dire que la manipulation coloniale a porté ses fruits, mais ce ne fut pas une guerre ethnique.
Quand il y a un conflit ethnique, c’est souvent qu’il y a des problèmes sociaux. En ce moment, dans le nord du Mozambique, il y a une guérilla djihadiste. Un groupe qui existait préalablement comme secte religieuse s’est militarisé puis s’est affilié à l’État Islamique. Il recrute parmi le groupe côtier Mwani, et parmi les Makua – un grand groupe qui a été assez maltraité par les colonisateurs portugais puis par le Frelimo. Enfin, il y a à la frontière de la Tanzanie le groupe makonde. C’est là qu’a commencé la guerre de libération en 1964. Le groupe makonde, quoique minoritaire dans la région, a été extrêmement important dans la guerre de libération anticoloniale 2. Comme ses membres ont été des acteurs majeurs dans la guerre de libération, ils ont accaparé des rôles de direction importants. De généraux dans la guérilla, ils sont devenus ministres. Bien que très nettement minoritaires à l’échelle du pays (2 % de la population, et à peu près 10 % à l’échelle de la province-nord Cabo Delgado), ils ont accaparé la plupart des postes qui permettent de devenir riche. Aujourd’hui, il y a une expression ethnique du mécontentement social contre les Makonde de la part des Mwani ou des Makua, mais c’est en raison de l’inégalité provoquée par un pouvoir d’État accaparé par une ethnicité particulière en raison des circonstances historiques.
La difficulté en Afrique est qu’on est à la périphérie du capitalisme. Les États ne sont pas des États sociaux mais des États prébendiers, des États compradores, des États qui manipulent les clientélismes ethniques, qui souvent promeuvent une seule ethnicité. Au Sénégal, en ce moment, il y a une « ouolofisation » accentuée et les autres langues africaines sont en déclin et pourraient disparaître à l’avenir. Cela a provoqué une guérilla endémique en Casamance 3 et petit à petit il y pourra y avoir d’autres révoltes (pas forcément sous la même forme), surtout si le développement reste très inégal selon les régions du pays. Derrière tout cela, il y a toujours des conditions matérielles et sociales, ce n’est pas de l’économisme de dire cela : l’identité ne vient jamais seule, elle est l’expression de positionnements face à des changements ressentis comme agressifs ou inquiétants.
Je l’ai bien vu au Mozambique : à l’époque coloniale – donc jusqu’en 1975 – les anthropologues pouvaient repérer une grande zone dans le nord du Mozambique où les gens parlaient une famille de langue appelée makhuwa-lómwè. Après l’arrivée au pouvoir du Frelimo, la politique menée a profité principalement aux sudistes, à la capitale et aux grandes villes. Les gens se sentirent agressés par cet État de modernisation autoritaire, et la rébellion soutenue par l’Afrique du Sud allait prendre beaucoup de poids dans ces zones-là. Les gens ont alors commencé à se dire Makua en réaction. Ils le ressentaient vraiment, et cela n’avance en rien de dire qu’il s’agissait d’une « fausse conscience ».
Comment traiter à la fois les problèmes d’ethnicité et les problèmes sociaux quand les questions d’ethnicité sont totalement manipulées et recouvrent l’ensemble des sujets sociaux ? Certains groupes trotskistes nigérians sous-estiment la question de l’ethnicité, me semble-t-il.
Il y a des entrepreneurs politiques qui manipulent ouvertement l’identité, et pas forcément des identités ethniques. Ils peuvent manipuler des identités noires dans un pays où il y a des métis. On peut manipuler n’importe quoi si cette chose existe. En revanche, il est clair que les problèmes sociaux ont des effets ethniques. Je donnais ainsi tout à l’heure l’exemple du nord du Mozambique, où la guérilla djihadiste n’a pas de mal à recruter de jeunes garçons contre le pouvoir du Frelimo. Même si cela ne concerne naturellement pas toute la population makonde, celle-ci, bien que minoritaire dans la province, a un meilleur accès à la rente de l’État. Cette question d’inégalité socio-économique s’exprime alors de manière ethnique : les Mwani disent « nous, on n’a rien, les Makone mangent tout ». Ce n’est pas une manipulation ethnique, c’est l’expression ethnique d’une inégalité sociale.
Cela me rappelle le fameux débat que Trotsky eut avec ses rares partisans, déjà exclus du Parti communiste, en Afrique du Sud. Le PC et la IIIe Internationale déjà stalinisés défendaient le slogan de République noire et les jeunes trotskistes d’Afrique du Sud étaient pour une république sans couleur, si ce n’est rouge. Il s’agissait de leur part d’un universalisme bien abstrait parce que la règle de la majorité signifiait une république noire. Cela ne voulait pas dire que les Blancs devaient partir, mais qu’ils devaient perdre leurs privilèges de Blancs et Trotsky avait défendu le slogan de République noire.
Nous marxistes, devons comprendre ce que signifie l’expression fameuse « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte des classes ». Elle ne signifie pas qu’il n’y a que la lutte des classes, que la conscience de classe. Une personne peut être blanche, noire ou métisse, elle peut être homme ou femme, elle peut être de gauche ou de droite, elle peut aimer le cidre ou la bière, elle peut préférer le rugby au football, elle peut avoir des tas d’identités, et le seul endroit où toutes les identités se mélangent c’est en elle-même, dans l’individu, le seul endroit indivisible sous peine de mourir. À un moment donné ce n’est pas nécessairement la question de classe qui va être la plus importante pour la mise en mouvement de cette personne : cela peut être le fait d’être musulmane, parce que la mosquée a été incendiée par des racistes, qui la met en mouvement, non pas en tant que prolétaire de religion musulmane mais en tant que personne musulmane tout court.
Ces camarades nigérian·es font des efforts pour dépasser les divisions mais c’est d’autant plus abstrait que précisément, dans l’histoire du Nigeria, la limite entre la zone musulmane et la zone animiste – plus christianisée parce que les missions chrétiennes n’ont réussi qu’en terre non musulmane –, correspond à l’ancien émirat de Sokoto, le grand État précolonial africain. Ces divisions n’ont pas été inventées par le colonisateur, elles sont historiquement produites. Le Nigeria est une construction artificielle comme beaucoup d’États postcoloniaux mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas fonctionner : si c’était un État social et hautement respectueux des différentes identités ethniques historiquement produites sur le territoire du Nigeria actuel. Le Nigeria justement est un État fédéral mais cela ne signifie pas en soi un meilleur respect social, économique et culturel pour les populations, du fait de l’existence de l’État capitaliste de la périphérie et de la catastrophe pétrolière.
La « révolution » de 1959 au Rwanda, où le pouvoir absolu de l’élite tutsi a été mis à bas, au lieu de prendre une trajectoire sociale, a au contraire pris une trajectoire ethniciste avec les conséquences dramatiques que l’on connaît.
Une mobilisation sociale peut s’exprimer selon une polarisation ethnique (plutôt castiste à mon avis dans ce cas) parce que ce sont les lignes d’entendement les plus disponibles pour les gens. Ce sentiment ethnique/castiste prend ensuite son autonomie : même si le problème social d’où il vient est résolu, la question ethnique ne pas disparait pas comme par enchantement. Si une identité est massivement ressentie, le problème social qui l’a nourrie peut disparaître, cela peut éviter des massacres, mais cela n’évitera pas la perpétuation de cette identité sur plusieurs générations et la démocratie politique devrait en tenir compte.
Le cas de la Somalie est intéressant car c’est un État-nation ethniquement homogène, mais dont deux régions demandent leur indépendance, le Somaliland et Puntland.
En effet, il n’y a pas que la question ethnique, il existe en Somalie ce qui est appelé « clans » qui correspondent à ce que l’on appellerait des tribus dans le monde arabe, par exemple. Ce sont des structures politiques, en général pas des identités ethniques. Mais il ne faut pas avoir de l’ethnicité une vision statique. Des gens pouvaient se sentir somaliens auparavant et ne plus se sentir somaliens demain. Le Somaliland réclame son indépendance, et de fait l’a obtenue. C’est un État qui n’est reconnu par personne mais c’est la partie de la Somalie qui fonctionne le mieux ! Il y a même eu des élections qui ont été surveillées par des observateurs internationaux. La domination coloniale a eu aussi des effets identitaires. Je reprends mon exemple du nord du Mozambique avec les Makonde, ce groupe qui a été si important dans la lutte anticoloniale et qui a accaparé les postes de pouvoir. Il y a des Makonde des deux côtés de la frontière : au nord du fleuve Rovuma, on est en Tanzanie et au sud au Mozambique. 120 ans de colonisation, anglaise d’un côté, et portugaise de l’autre, ont eu des effets identitaires. Aujourd’hui, même s’ils reconnaissent que ce sont des cousins, les Makonde du sud savent très bien qu’ils ne sont plus tout à fait identiques aux Makonde du nord.
En Somalie, les ethnologues ont beau parler d’un seul pays, cela n’empêchera pas des contradictions internes qui font que certaines régions vont demander leur indépendance. Mais cette recherche d’indépendance n’est pas nécessairement ethno-nationale, elle peut être motivée par l’absence de fonctionnement de l’État, qui n’est pas démocratique, qui n’apporte pas de progrès social ou qui a été accaparé par un clan alors qu’il y en a une bonne quinzaine, etc.
La Somalie montre deux choses. Premièrement, ce n’est pas parce qu’on a une identité, une homogénéité ethnique, que tout se passera bien, parce qu’il y a d’autres problèmes. Deuxièmement, l’identité change selon des trajectoires qui peuvent provoquer des disparités au sein de la population. L’identité n’est qu’une communauté de gens qui ressentent telle chose à un moment de la trajectoire identitaire.
Et concernant les tribus et les clans ?
On peut parfaitement employer le mot tribu sans paternalisme colonial. Une tribu est l’organisation politique d’une fraction de la population, avec une chefferie, des chefs délégués dans différentes régions. Il y en a dans le monde arabo-berbère, en Somalie (sous le nom de clans).
Au Mozambique par exemple, il y a de nombreuses ethnicités mais il n’y a pas de tribus parce qu’elles ont été brisées par le colonisateur portugais. Contrairement aux Anglais, les Portugais ont pratiqué l’administration directe, ils n’ont pas remis en selle les chefs traditionnels puissants mais vaincus, désormais dociles et gestionnaires locaux de l’État impérial européen.
Le clan est une organisation imaginaire (en tout cas dans les territoires que je connais). Une certaine catégorie de la population, sur la base de mythes animaliers, dit qu’elle descend de la tortue, ou du singe. Il ne faut pas oublier que le mot « Bantou », avant de désigner une famille de civilisations africaines, voulait simplement « être humain » (opposé au règne animal). Ces origines animales mythiques impliquent des tabous alimentaires, par exemple ne pas manger de tortue si on descend de la tortue.
Les lignages sont l’organisation de la parenté – patrilinéaire si la descendance se fait par le père, et matrilinéaire par la mère. Dans ce dernier cas, cela ne désigne pas un pouvoir matriarcal mais une organisation sociale dans laquelle ce n’est pas le mari de la femme qui a le pouvoir mais le frère de la femme. Le lignage est défini par la mère, un peu comme dans le judaïsme classique.
Peut-être un mot de conclusion ?
Pour nous marxistes, il est grand temps de réfléchir pour intégrer l’ethnicité à la démocratie politique. Certes, il n’y a pas que les luttes pour la démocratie, il y a aussi des luttes sociales, les luttes de classes bien sûr, mais ces dernières ont besoin de démocratie et la démocratie politique a besoin qu’on y intègre l’ethnicité plutôt que de la combattre. Il ne s’agit pas de défendre la tradition, telle n’est pas la question. Si des choses sont bien dans la tradition, on les défend, et si des choses y sont mauvaises on les combat. Mais attention de ne pas désigner de faux coupables : par exemple l’excision féminine ne vient pas de l’islam, cela existait bien avant. Et on ne peut lutter contre cette « tradition » qu’avec les gens, pas contre eux.
Derrière le droit à l’identité, il y a le droit à l’égalité. J’ai le droit d’être Yoruba, d’être Makua ou autre, j’ai le droit qu’à l’école mes enfants soient alphabétisés dans cette langue, que le territoire de ma province soit dessiné selon les endroits où les gens qui parlent comme moi sont majoritaires, j’ai le droit que l’État soit localement bilingue. L’État peut être de langue anglaise, swahili ou portugaise mais il doit y avoir un bilinguisme officiel. Les fonctionnaires nommé·es ne doivent pas forcément être de l’ethnicité du lieu mais doivent savoir en parler la langue pour un service public respectueux des gens.
Pour les marxistes, je pense que c’est un enjeu très important en raison de l’évolution socio-économique de l’Afrique. Cette dernière connaît actuellement une urbanisation galopante sans prolétarisation. Les gens qui n’arrivent plus à vivre à la campagne viennent en ville mais n’arrivent généralement pas à entrer dans le mode de production capitaliste. Ils n’arrivent pas à devenir ouvrier·e·, salarié·es. Pour devenir fonctionnaires, il faut des accointances ethno-clientélistes… Ces personnes ont alors besoin, pour leur survie sociale, de sauvegarder des liens de solidarité horizontale comme l’ethnicité. Ce n’est que plus tard peut-être, qu’ils ressentiront les liens de solidarité verticale, c’est-à-dire classe contre classe, prolétariat contre bourgeoisie. Mais l’immense majorité des pauvres en Afrique ne relèvent pas du prolétariat.
En effet, le prolétariat est loin d’y être majoritaire (ni n’est nécessairement le milieu social le plus misérable), face à la plèbe urbaine. La plèbe n’est pas une classe, c’est une formation sociale instable de gens parfaitement inutiles pour le capitalisme puisqu’ils représentent à peine un marché 4. Ils peuvent mourir du sida, du Covid ou dans une guerre civile, ce n’est pas un problème pour le capitalisme. Mais ce sont des gens que les marxistes doivent défendre. Souvent, la question principale en Afrique n’est pas prolétarienne mais plébéienne et il n’est pas facile de définir des revendications transitoires pour ce genre de population. Nous n’avons pas de réelle tradition politique pour défendre ces gens mais il faudra qu’on l’invente. Les actuelles évolutions politiques en Afrique occidentale, par exemple (le raz-de-marée électoral du PASTEF aux élections sénégalaises de 2024, les coups d’État « anti-français » au Mali, au Burkina, au Niger avec, au début, un indéniable appui populaire, etc.) sont l’expression indirecte de la plébéiennisation de la population, de surcroît extrêmement jeune. n
Le 18 août 2024
- 1
Une kleptocratie est un terme désignant un système politique au sein duquel une ou plusieurs personnes, à la tête d’un pays, pratiquent à une très grande échelle la corruption, souvent avec des proches et membres de leur famille.
- 2
Je ne l’appelle pas personnellement nationale mais anticoloniale, puisqu’il n’y avait pas à proprement parler de nation pré-existant à la guerre de libération.
- 3
La Casamance, parfois appelée casa-di-mansa (« la terre des rois »), est une région historique et naturelle du Sénégal, située au sud du pays et bordant le fleuve Casamance.
- 4
Je ne confonds pas la plèbe et lce qu’on appelle « secteur informel ». Le secteur informel est une classification qui recouvre une large partie de la population dont l’activité économique n’est pas « légalisée » dans un cadre juridico-légal. Ce secteur informel recouvre diverses classes et formations sociales (prolétariat de petites entreprises elles-mêmes informelles, plèbe, milieux artisanaux, petits et moyens commerçants…). Je désigne par plèbe la population principalement urbaine qui ne fait plus partie du mode de production domestique de la campagne mais ne peut s’intégrer au mode de production capitaliste du fait du caractère périphérique du capitalisme dans ces pays.