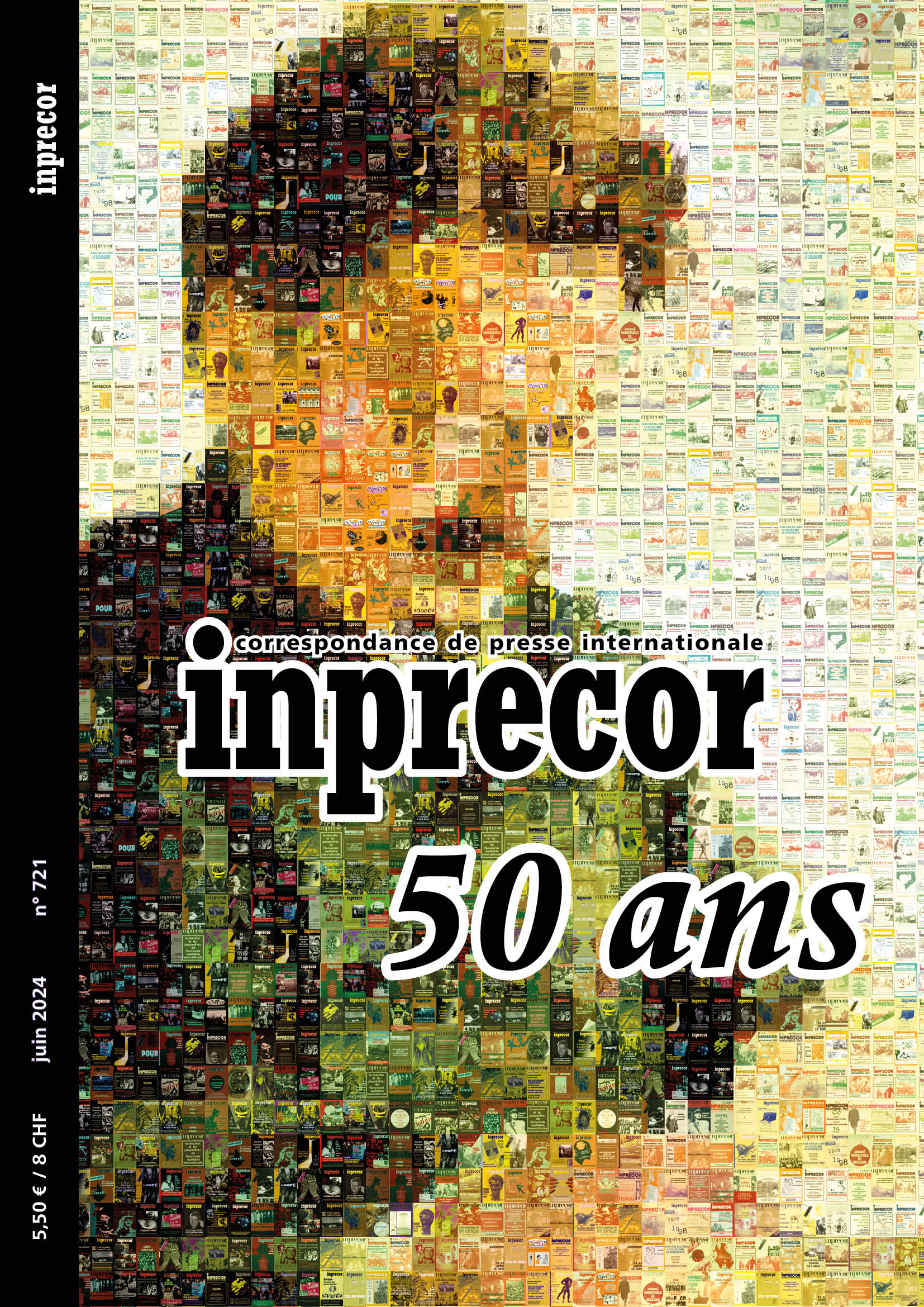Mariana, rédactrice d’Inprecor de 1990 à 1992, raconte l‘évolution de la revue dans le cadre du recul du rapport de forces à l’échelle internationale.
Comment t’es-tu retrouvée à Inprecor ? Qu’est-ce qui t’attirait dans cette revue ?
J’ai collaboré, avec quelques autres camarades investis dans le travail internationaliste de la Ligue (Stellio, Mireille, Jean…) pendant quelques années à la rubrique internationale de Rouge, lorsque le « réd chef » en poste à Inprecor en 1990, Erdal Tan, a annoncé son départ. C’est ainsi que, sûrement dénoncée par ce même camarade, qui était aussi un ami, et par les deux jeunes militantes qui réalisaient la revue avec lui (Natacha et Sophie, des jeunes des JCR, également militantes internationalistes), l’idée est venue de faire appel à moi. Je n’avais pas encore de véritable expérience dans la presse. En revanche, j’ai ensuite travaillé, comme beaucoup d’ancien·es passé·es par l’excellente école de Rouge, dans des magazines et dans un journal grand public pendant près de trente ans…
J’avais auparavant passé quelques années au Nicaragua et j’étais très impliquée dans la solidarité avec la révolution sandiniste, depuis la fin des années 1970. J’imagine que cet investissement internationaliste ainsi que l’expérience de l’hebdo de la Ligue avaient poussé ma candidature, même si j’étais davantage tournée vers l’Amérique centrale et latine que vers l’ex-URSS ou la Yougoslavie. Forcément intéressée par ce qui se jouait alors là-bas, je me suis retrouvée à une place privilégiée et avec des interlocuteurs hors pair à Inprecor pour suivre ces processus !
Lorsque tu étais en charge d’Inprecor, il y avait un Bureau de la IVe Internationale formé d’une dizaine de permanent·es. Et, à côté d’Inprecor, paraissait en anglais la revue sœur International Viewpoint, avec un contenu similaire. Comment se faisait alors le travail de la rédaction ?
Nous avions une liberté de travail que je n’ai pas retrouvée dans la « grande presse », soumise à des pressions en tout genre et notamment politiques : combien d’articles ai-je dû reprendre ou corriger après la relecture par des ministres ou leur cabinet, voire par des comédiens et des attachées de presse ! Les sections de la IV – à l’époque nombreuses et couvrant tous les continents et très actives dans leurs propres pays, du Mexique à l’Allemagne en passant par l’État espagnol ou la Suisse – et des groupes sympathisants de la IV ou des contacts nous proposaient des articles et/ou des documents.
Nous fouillions méthodiquement, avec les deux jeunes camarades, la presse de la IV mais aussi toute la presse radicale voire la presse universitaire spécialisée sans a priori ni sectarisme (sur des sujets comme l’Albanie, par exemple, c’est grâce à des interviews de chercheurs ou d’experts que nous avions pu écrire des articles).
Même si le bureau du SU nous suggérait des articles ou des sujets (il suivait davantage que nous une actualité foisonnante et complexe…), la décision, en dernière instance, nous revenait à nous, équipe rédactionnelle. Nous tenions une réunion hebdomadaire avec un membre du bureau chargé d’Inprecor. C’était souvent Claude Gabriel, que je regrette tant, avec lequel j’ai découvert l’Afrique du Sud ou la Kanaky… Mais la parole de ce « chef à plumes » (remplacé quelquefois par une « cheffe » très branchée Cuba-Amérique latine, Janette Habel…) ne pesait ni plus ni moins que la nôtre à l’heure des choix !
Nous communiquions ensuite le sommaire au bureau, qui pouvait enrichir ou suggérer de combler des oublis, mais sans imposer ni censurer quoi que ce soit. Nous échangions nos projets avec les camarades de IVP et de Inprecor America latina, présent·es dans nos locaux, une autre excellente source de sujets.
Les années où tu rédigeais Inprecor étaient aussi celle de la fin de l’URSS, de la défaite sandiniste au Nicaragua… Comment Inprecor analysait alors ces questions à chaud ? Plus de trente ans plus tard, quel bilan tires-tu de ce que nous avions fait alors ?
En effet, moi qui avais les yeux quasi exclusivement rivés sur l’Amérique latine – voire centrale et notamment le Nicaragua – je me suis retrouvée à suivre le démembrement de l’ex-URSS, les premières expressions de la gauche indépendante à l’Est, que les contacts de Catherine Samary, d’Ernest Mandel – encore régulier aux réunions parisiennes du bureau – mais aussi de militants proches de la IV qui sortaient de la clandestinité comme notre camarade Petr Uhl, nous permettaient de couvrir avec des documents et des interviews exclusives. C’était passionnant, pour moi comme pour mes deux jeunes camarades : nous avions des infos et documents de première main, uniques, sur des sujets d’une actualité brûlante. Cela a été une véritable école politique et journalistique pour nous trois.
Le Nicaragua nous tenait à cœur : les deux jeunes journalistes y étaient allées en brigade ! Le jour de l’annonce de la défaite du FSLN aux élections de 1990, couverte aussi en direct par Alain Krivine pour Rouge, j’ai moi-même décidé de partir au Nicaragua. Privilège immense que j’ai mesuré des années plus tard, quand j’ai vu comment des confrères et consœurs bien plus diplômé·es que moi ont dû souvent batailler avec plus ou moins de succès pour pouvoir partir en reportage quand ce n’était pas la priorité du directeur de leur rédaction… J’ai pu toucher cette nouvelle réalité et voir comment relancer la solidarité – bien vite retombée, malheureusement et étouffée par les déviances d’une partie de la direction du FSLN occupée non pas à sauver les meubles mais à s’enrichir.
J’avais ramené un article dont je me souviens encore le titre optimiste : « Le drapeau sandiniste flotte toujours sur Managua ». J’ai mis longtemps, comme beaucoup d’autres, à comprendre que ce n’était plus le même drapeau, mais une usurpation ! Et que cette direction, et tout d’abord le tyran Ortega, n’avait pas l’intention de « gouverner par en bas »…
Des erreurs ? Des surestimations ? Nous en avons certainement fait, mais ni plus ni moins que la grande presse aux grands moyens qui souvent encense puis démolit, voire qui passe à côté de certains grands événements, n’ayant pas écouté ses reporters sur le terrain, leurs contacts locaux, leurs fixeurs… Nos « fixeurs » et « fixeuses » à nous étaient des hommes et des femmes engagées qui ont partagé leurs espoirs, leurs déceptions, leurs erreurs et leurs intuitions avec nous. Et nous avons eu raison de leur donner la parole : c’étaient ces acteurs et actrices de la « petite » histoire de la lutte sociale, féministe, syndicale qui nous donnaient leurs parts de témoignage et de franchise sur la grande Histoire. Leurs parts d’erreur aussi.
Nous avons essayé de partager toutes ces analyses et témoignages, souvent à chaud, qui essayaient, à un instant T et alors que l’histoire leur mordait la nuque, de prendre un peu de hauteur tout en ayant les mains dans le cambouis. Et nous avons eu raison.
Tu continues à lire Inprecor. En quoi selon toi la revue a-t-elle évolué en 50 ans ? Quelles critiques formulerais-tu aujourd’hui ? Comment pourrait-on tenter de l’améliorer dans les années à venir ?
Je sais que l’équipe s’est réduite et le boulot que vous faites à si peu est formidable ! La IV aussi a changé et s’est affaiblie dans certains continents et pays. Forcément la dimension de reportages, interviews et témoignages que nous avions à cœur de développer Marc et moi-même avec mes camarades, pour faire une revue « écrite pour être lue » par le plus grand nombre et qui illustrent et étayent les grandes questions politiques, se font plus rares. Personnellement, ça me manque… C’est quelque chose que je continue de chercher dans la presse militante mais aussi dans la « grande presse » (il m’arrive de dénicher des pépites de reportages qui sont de vraies leçons de choses politiques en presse quotidienne régionale, voire dans des journaux de droite, notamment sur l’étranger).
Et je garde cette obsession d’essayer d’écrire et de toucher le plus grand nombre, même avec une publication militante.
Le 12 avril 2024
* Mariana a été rédactrice d’Inprecor de 1990 à 1992. Propos recueillis par Jan Malewski.