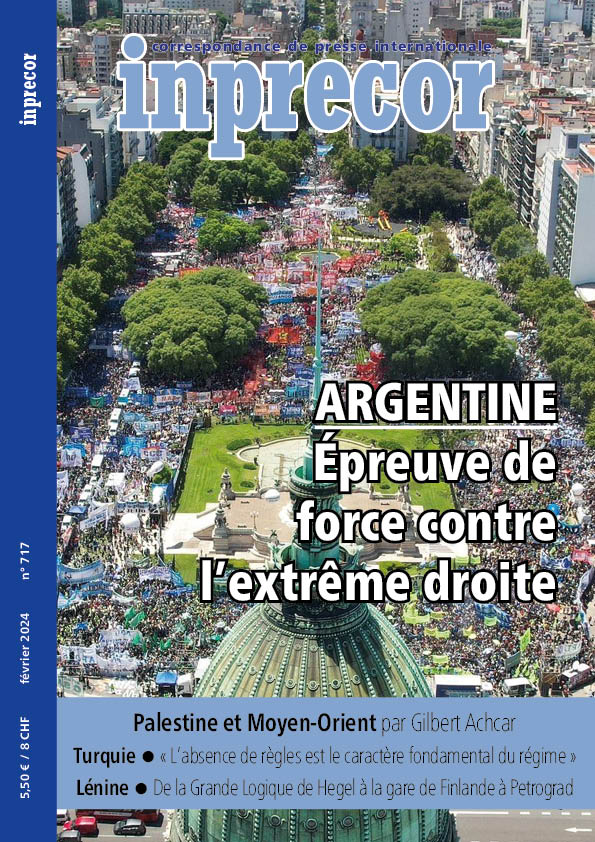Dans notre numéro précédent, nous avons abordé la situation en Grèce par le prisme des luttes sociales. Nous avons retenu l’idée que, si les mobilisations ont été nombreuses ces dernières années, la paralysie des syndicats et l’incapacité de la gauche à proposer des débouchés sont au cœur des difficultés du mouvement ouvrier, avec la responsabilité écrasante de Syriza.
Pour aider à comprendre ce paysage, nous publions un tableau des résultats électoraux aux élections législatives de la ND, du Pasok (Parti Socialiste d’orientation sociale-très libérale, pendant trente ans au cœur du bipartisme bourgeois, et qui s’est présenté parfois en alliance avec de petits groupes centristes) et de partis et groupes de la gauche.
| janvier 2015 | septembre 2015 | juillet 2019 | mai 2023 | juin 2023 | |
| Participation | 64 % | 56,2 % | 57,8 % | 61,7 % | 53,7 % |
| Syriza | 2 245 978 | 1 926 526 | 1 781 057 | 1 184 500 | 930 013 |
| 36,34 % | 35,46 % | 31,53 % | 20,07 % | 17,83 % | |
| ND | 1 718 694 | 1 526 400 | 2 251 618 | 2 407 860 | 2 115 322 |
| 27,8 % | 28,1 % | 39,85 % | 40,79 % | 40,56 % | |
| KKE | 338 188 | 301 684 | 299 621 | 427 000 | 401 224 |
| 5,47 % | 5,5 % | 5,30 % | 7,23 % | 7,69 % | |
| PASOK | 289 469 | 341 732 | 457 623 | 676 166 | 617 487 |
| 4,68 % | 6,29 % | 8,10 % | 11,46 % | 11,84 % | |
| ANTARSYA | 39 497 | 46 183 | 23 239 | 31 746 | 15 887 |
| 0,64 % | 0,85 % | 0,41 % | 0,54 % | 0,30 % | |
| LAE | 155 320 | 15 612 | |||
| 2,86 % | 0,28 % | ||||
| MERA | 194 576 | 155 085 | 130 178 | ||
| 3,44 % | 2,63 % | 2,50 % | |||
| PLEVSI | 82 786 | 170 298 | 165 523 | ||
| 1,46 % | 2,89 % | 3,17 % |
On a écarté de ce tableau les quelques groupes révolutionnaires déterminés à se croire le noyau du parti et ravis d’arracher, lors des élections, quelques centaines de voix au niveau national !
• Le KKE : Parti communiste grec, fondé en 1918.
• Antarsya : coalition d’une bonne partie de la gauche anticapitaliste, fondée en 2009 dans le prolongement de diverses coalitions préexistantes.
• LAE (Unité Populaire) : groupe formé en août 2015 après le reniement du résultat du référendum et l’acceptation par Tsipras des exigences de la troïka. Issu de la Plateforme de gauche avec à sa tête Panagiotis Lafazanis, il dispose alors, avec 25 député·es quittant Syriza, d’un groupe parlementaire jusqu’aux élections de septembre 2015.
• Mera (Jour, ou Front européen de désobéissance réaliste) : groupe formé en 2018 par Yannis Varoufakis, ministre des Finances sous le premier gouvernement Syriza (janvier – juillet 2015), qu’il quitte après son désaccord avec Tsipras.
• Plevsi Eleftherias (Croisière de la Liberté), créé par Zoé Konstantopoúlou, présidente du Parlement de février à août 2015), et à ce titre cofondatrice en avril 2015 de la Commission pour la vérité sur la dette grecque. Konstantopoúlou rejoint LAE en août 2015 puis fonde en 2016 Plevsi avec quelques ancien·nes militant·es de Syriza. On verra que si on pouvait classer à gauche ce groupe en 2016, sa trajectoire rend un tel classement quasi impossible aujourd’hui.
Ces derniers temps, on reparle beaucoup de Syriza, qui s’est doté en octobre d’un nouveau président, fort curieux, pour succéder à Alexis Tsipras. Le constat est accablant : pendant ces quatre dernières années, on a peu parlé de ce qui était le principal parti de la gauche. Et cela pour une raison simple : alors que la Grèce a connu de constantes mobilisations, même pendant la période du Covid, Syriza y était très peu présent, même si des militant·es y participaient, mais davantage de leur propre initiative que par des décisions de collectifs du parti. L’activité parlementaire est certes restée soutenue, avec des interventions souvent brillantes de Tsipras, mais sans pouvoir suppléer un manque décisif : à aucun moment, Syriza n’a su ou voulu tirer parti du résultat des élections de septembre 2019. Certes, Syriza était battu par la droite, mais sans que le « peuple de gauche » ne lui fasse payer chèrement ses reniements et son acceptation des mémorandums, comme si on lui accordait un petit quitus d’avoir tenté la bataille et plié devant la force des adversaires.
Dès septembre 2015 d’ailleurs, on percevait cette tendance à une confiance relativement maintenue : malgré le reniement de l’extraordinaire mandat populaire de juillet (61,3 % de « non » à l’obéissance aux diktats de la troïka, avec 62,15 % de participation au référendum), Syriza gagnait les nouvelles législatives, ne perdant que 300 000 voix, alors que son courant de gauche, LAE, ayant quitté Syriza en août avec 25 député·es, ne récupérait qu’environ la moitié de ces voix et n’avait plus aucun élu. Malgré la défaite, le scénario était quasiment le même en juillet 2019 : LAE s’effondrait totalement et une partie des voix de gauche perdues par Syriza mais aussi celles de LAE était captée par Plevsi et davantage par MERA, qui passait de justesse les 3 % pour obtenir des députés (9, dont Varoufakis).
Aucun des autres groupes de gauche n’a profité électoralement du recul de Syriza
Ni en septembre 2015 ni en juillet 2019. Par contre, c’est un peu dans le Pasok et beaucoup dans l’abstention que se réfugient les déçu·es de Syriza, même si cette abstention est moins un choix politique que la conséquence de profonds bouleversements sociaux se traduisant par des replis individualistes.
On peut dire qu’en juillet 2019, les travailleur·es et les jeunes ont certes perdu leurs espoirs ou illusions par rapport aux promesses de changement radical que Syriza multipliait avant janvier 2015, mais gardaient leur confiance en lui pour mener une opposition de gauche minimum à une droite qui affirmait vouloir « fermer définitivement la parenthèse », et cela dans le cadre d’un nouveau bipartisme (dénoncé par le Pasok) qui verrait désormais l’alternance entre ND et Syriza. Mais on n’aura pas eu l’occasion de savoir si une opposition de gauche classiquement réformiste était possible dans la Grèce des années 2019-2023, car Syriza n’a en rien répondu à cette attente !
Il aurait déjà fallu pour répondre positivement à celle-ci que Syriza procède en 2019 à un bilan de toute la période passée, avec un retour nécessaire sur son programme électoral de 2015, qui, pourtant moins radical que celui du Pasok en 1981, avait dès le départ été grignoté pour être totalement trahi avec l’acceptation du troisième mémorandum.
Un tel bilan, rendu encore plus nécessaire par la place de principal opposant à la ND déterminée par le vote de juillet 2019, aurait permis à Syriza d’une part de donner la parole aux militant·es, d’autre part de tenter – si c’était possible – de proposer un programme ouvertement réformiste sans devenir social-libéral comme le Pasok. Cette absence de débat sur le bilan a conduit à une neutralisation croissante du fonctionnement en parti. Syriza a fonctionné toutes ces années autour de sa direction et de son groupe parlementaire, comme s’il était encore le petit parti eurocommuniste (KKEs) des années 1970. Et, à aucun moment il n’a su construire une activité syndicale réelle.
Il est aussi devenu très minoritaire dans la jeunesse organisée politiquement : aux élections universitaires 2023, il a obtenu environ 2,5 %, loin derrière le courant du KKE (PKS : environ 35 %) et celui de la gauche radicale et révolutionnaire (les EAAK, environ 17 %), le courant de ND obtenant 26 %. Aux législatives du printemps 2023, alors que certains sondages donnaient le vote jeune largement favorable à Syriza, c’est la droite qui l’a emporté dans ce secteur.
Le présidentialisme s’est imposé dans le fonctionnement du parti
En 2022, malgré l’opposition de cadres des courants de gauche, a été décidée l’élection du président·e par les militant·es, avec une possibilité d’adhérer le jour même du vote. Et c’est ainsi qu’en mai 2022, Tsipras a été réélu président avec environ 150 000 voix sur 152 000, ouvrant la voie avec ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaire quant au fonctionnement démocratique du parti.
Mais bien entendu, le plus grave a été l’affirmation d’une ligne de plus en plus social-démocrate, et donc en réalité de plus en plus social-libérale, en se réclamant simplement des « forces de progrès ». Tsipras faisait entre 2005 et 2010 le tour des organisations révolutionnaires anticapitalistes européennes pour lancer Syriza en le faisant passer pour une force de rupture anticapitaliste, mais il s’est en revanche fait inviter ces dernières années aux réunions de l’Internationale socialiste. Cette orientation de pseudo-réalisme a d’ailleurs été visible dans l’activité parlementaire puisque derrière les effets de tribune, on a vu Syriza voter 45 % des projets de la droite (à la différence de Mera – 15 % – et KKE – 4 % –, chiffres donnés sur le site vouliwatch).
Sa recherche d’alliances avec les « forces de progrès » aurait été positive s’il s’était agi d’une unité d’action avec les forces de gauche (KKE, Antarsya…) et d’une alliance électorale avec quelques-unes de ces forces, comme le KKE et Mera… La direction de Syriza a prétendu qu’elle avait tenté cette approche mais que, comme ces forces refusaient toute forme d’action unitaire, il n’y avait rien de possible de ce côté. Or, vu le rapport de forces électoral écrasant en faveur de Syriza, ce dernier avait l’espace pour systématiser cette politique d’alliances à gauche, et l’échec de celles-ci aurait pu alors être mis sur le compte du sectarisme des autres, ce qui aurait amené certainement un résultat électoral et un rapport de forces différents au printemps 2023. Au lieu de cela, en délaissant sans combat cette démarche à gauche, Syriza a officialisé, en vue des élections de 2023, la recherche d’un accord à tout prix avec le Pasok, présenté comme une « force de progrès »… ce qui a permis à celui-ci de se refaire une santé sur le dos de Syriza en se faisant passer comme plus soucieux des intérêts populaires. Cette santé est toute relative pour le Pasok, si l’on compare 2023 aux législatives d’octobre 2009 (avec une participation de 70,95 % et une victoire du Pasok avec 43,92 % des voix) suivies juste après, de l’annonce solennelle par Giorgos Papandreou du terrible déficit de la Grèce, qui la fera entrer dans l’ère des mémorandums et de la déchéance électorale du Pasok…
En 2023, ce qui apparaissait de plus en plus comme une mauvaise farce a conduit à désorienter bien davantage une grande partie du « peuple de gauche » : malgré des sondages qui laissaient entrevoir presque jusqu’au bout une petite possibilité de victoire de Syriza, les résultats de mai et juin, avec l’abstention record de juin, ne sont pas surprenants. Mais ils constituent surtout une terrible défaite pour Syriza, qui ne s’en remettra peut-être pas.
Vers la disparition de Syriza ?
Prenant acte des résultats électoraux désastreux du printemps 2023, Tsipras a démissionné de la présidence de Syriza en juin. Au lieu de convoquer un congrès extraordinaire, la direction de Syriza a lancé la procédure d’élection au poste de président·e, dans les mêmes formes que l’année précédente, personne ne remettant officiellement en cause une procédure encore plus problématique en cette circonstance. Au contraire même, une très large publicité lui a été donnée. Il s’agissait en effet, après le choc électoral, de prouver que Syriza gardait un large écho dans la société, quitte à faire s’inscrire n’importe qui pour voter (contre 2 euros), y compris des cadres de la droite (ça s’est vu).
Plusieurs candidat·es se sont présenté·es, dont trois dirigeant·es et un ex-cadre du Pasok. Le cinquième candidat était un inconnu, Stéfanos Kasselákis, membre récent, qui avait été candidat aux législatives au titre des Grec·ques de l’étranger. Or, au terme d’une campagne à l’américaine menée par ce Grec des États-Unis, et après que le « contrat » a été rempli (de nouveau environ 150 000 électeur·es, dont presque 40 000 nouveaux membres…), c’est Kasselákis qui l’a largement emporté (56 %) au second tour contre la favorite du scrutin, l’ancienne ministre du travail Effie Achtsióglou.
La surprise a été immense et générale, et aujourd’hui encore on débat sur les raisons de ce succès. L’ouverture du scrutin à quiconque voulait s’inscrire a évidemment joué, mais pas au point de « saboter » l’élection. Les trois anciens dirigeants en lice ont payé pour leur enlisement dans le fonctionnement de plus en plus bureaucratique et coupé des luttes de Syriza entre 2019 et 2023. Même si le courant de l’ancien ministre des Finances Euclide Tsakalotos se réclame de la gauche, il a assumé comme les autres le cours de Syriza vers un inexistant centre-gauche. Kasselákis, chouchou des médias et assurément de ND, a pu gagner grâce à au moins trois éléments. Le premier est qu’il s’est présenté comme un « homme nouveau », n’ayant pas trempé dans la politique des mémorandums. Le second, c’est qu’il s’affirme ouvertement homosexuel, ce qui est un critère politique dans une Grèce où Mitsotákis fait tout pour ne pas autoriser le mariage homosexuel, dénoncé comme diabolique par l’église orthodoxe et l’extrême droite de la ND. Et le troisième facteur de cette victoire, c’est tout simplement qu’une partie de l’appareil de Syriza a très vite joué la carte Kasselákis, que ce soit le technocrate Nikos Pappás ou le populiste Pávlos Polákis, avec peut-être de leur part des espoirs de pouvoir manipuler le nouveau président…
Quoi qu’il en soit, Syriza se retrouve brusquement avec un nouveau président sans aucun rapport avec sa courte histoire (et la longue histoire de l’ancien KKEs), et on verra que plus de deux mois après cette élection, le résultat est une crise qui sera peut-être mortelle pour le parti. En effet, Kasselákis est vraiment un « homme nouveau » : cadre d’une grande banque aux États-Unis, il publiait il y a encore peu de temps des louanges sur Mitsotákis, et il est clair qu’il ne connait rien à la gauche, ses critères étant ceux de l’entreprise (il a même admiré les méthodes de patron de Trump…) et du marché. Et il pense donc pouvoir agir dans Syriza comme le patron d’une entreprise à redresser, multipliant des déclarations niant le fonctionnement du parti : il souhaite « récompenser » les cadres qui vont travailler à la cohérence des « objectifs communs », il a déjà tenté de faire voter par référendum des sanctions contre les membres en opposition ouverte, avec la volonté déclarée de « dialoguer » avec la base en passant par-dessus les instances.
S’il multiplie les grandes déclarations, celles-ci sont d’une banalité affligeante (« il faut faire des politiques en plaçant l’humain au centre ») mais aussi d’une mégalomanie inquiétante (lui seul peut battre Mitsotákis sur ce terrain…), et elles n’arrivent pas à cacher le problème désormais flagrant pour beaucoup : Kasselákis n’a aucune connaissance de ce qu’est la gauche. Se précipitant pour des interviews qui font la joie des médias de droite ou des colloques (dont des colloques patronaux), il a notamment précisé son rêve : « Je pense que ce que j’apporte de nouveau est un retour à la Grèce d’autrefois en tant que maison bien tenue. Une Grèce où le propriétaire tenait la maison propre, observait les règles et les lois, avait de l’intérêt et de l’empathie pour son voisin. » Ces propos qui le rapprochent dangereusement des nostalgiques des régimes policiers ou dictatoriaux qui étaient ceux de la Grèce d’autrefois… Le personnage n’arrête pas en outre de se contredire, disant ainsi ne pas être gêné par l’existence de différents points de vue dans le parti mais affirmant qu’il faut interdire les tendances (qui sont inscrites dans les statuts). Ou approuvant d’abord Mitsotákis qui se fâchait avec le Premier ministre anglais à propos des marbres du Parthénon arrachés au début du 19e siècle par l’Anglais Elgin puis, après conseils, le critiquant car Mitsotákis ne négocie pas en réalité le retour définitif de ces marbres au musée de l’Acropole… La profusion de telles contradictions amène le journaliste Dīmītrīs Psarrás (par ailleurs auteur antifasciste d’excellents livres sur Aube dorée) à commenter : « Il me rappelle la célèbre réponse de Groucho Marx, déclarant que tels sont ses principes, mais que s’ils ne plaisent pas, il en a d’autres » (1).
Le résultat de cette étrange élection et les deux premiers mois présidentiels de Kasselákis sont dramatiques : au sein de Syriza, de nombreuses voix critiquent le comportement autoritaire et le vide politique de cet OVNI, et même son entourage de « fidèles » tente souvent de le recadrer, pour tenter de faire croire que le personnage est compétent et de gauche. Sur la ligne politique, il est difficile de savoir où va Syriza : au-delà des proclamations sur l’objectif d’obtenir 17 % aux européennes et de « redevenir le premier parti de la gauche et de la mouvance progressiste », on peut comprendre que l’objectif du nouveau président est de plus en plus celui d’un parti « du centre », calqué sur le parti démocrate américain. Ce qui est sûr, c’est qu’une opération aux relents staliniens de réorientation est en cours, que ce soit au journal Avgi ou la radio Kokkino, les médias liés à Syriza, d’où sont parti·es ou ont été écarté·es plusieurs journalistes.
Des ruptures dans Syriza
Mais la conséquence la plus grave pour l’heure et la plus intéressante est le départ de Syriza de milliers de membres, cadres et militant·es de terrain. Des secteurs entiers (villes, jeunesse…) annoncent leur départ. Et deux courants ont quitté officiellement un parti qu’ils jugent irredressable vu son nouveau fonctionnement : le premier est Ombrella, qui regroupe autour de Tsakalotos de très nombreux cadres historiques très connu·es. Récemment, le courant 6+6 autour d’Effie Achtsióglou a fait la même chose, les deux courants se rejoignant pour former un nouveau groupe parlementaire, Nea Aristera (Nouvelle Gauche), de 11 député·es, qui a pour ambition d’organiser une partie des militant·es quittant Syiza.
Cinq sondages viennent de paraître, qui semblent déjà condamner l’opération Kasselákis : Syriza y est donné entre 10 % et 12 % et troisième parti derrière le Pasok, le cinquième sondage le donnant à 14 %, 2 points devant le Pasok. Alors, en cette fin 2023, quel avenir pour Syriza ? On peut envisager le pire pour lui : même si la direction affirme que les départs déclarés ne concernent que 1 % des effectifs, ce 1 % représente un tissu militant, avec une expérience politique qui n’est pas celui de très nombreux adhérent·es restant ou nouvellement inscrit·es à Syriza. Surtout, bien des adhérent·es ne font tout simplement pas savoir qu’ils ne feront plus rien avec un Syriza désormais sans rapport avec leur ancien parti. Parmi les militant·es qui restent, une bonne partie est en désaccord avec « la ligne Kasselákis », mais y restent pour l’instant par « patriotisme de parti », dans l’attente d’un congrès sans cesse repoussé. Leur maintien dans Syriza est un facteur permettant pour l’instant la survie du parti. La perspective d’un Syriza à la fois radical et « réaliste », prônée par certains cadres voulant masquer le cours « parti démocrate » de Kasselákis, illustre à la fois le malaise et – avec le pitoyable rappel des accents radicaux d’antan – une tentative vaine d’allier deux voies politiques totalement opposées sur le terrain, le choix ayant été fait depuis longtemps d’aller vers toujours plus de « réalisme », c’est-à-dire de gestion soumise au grand capital.
L’autre grande question est celle de l’éventuelle réorganisation des courants sortis de Syriza, dans laquelle, d’après les sondages, une bonne partie des ancien·es électeurs place leurs espoirs. Cette réorganisation suppose la définition d’une ligne politique claire et en rupture avec le suivisme du projet de « pôle progressiste » version Tsipras des années passées. Mais même si Tsakalotos se réclame du marxisme, rien ne permet de dire que l’on va vers un cours plus à gauche. C’est aussi l’évolution du reste de la gauche qui pèsera sur l’orientation à venir. Pour l’heure, l’objectif affiché par le porte-parole du groupe, Alexis Haritsis, est de « donner des réponses de gauche » aux urgences sociales comme « la cherté de la vie, l’effondrement des institutions de l’État de droit, la crise climatique, la progression des inégalités ». Des thèmes que le groupe souhaite mettre en avant en coalisant diverses forces, « de l’écologie politique, des mouvements sociaux et pour la défense des institutions démocratiques ». Est-ce un retour aux objectifs antérieurs de Syriza, après avoir participé aux longues années de gestion et de tournant vers le social-libéralisme ? On peut en douter fortement, vu le profil de gestionnaires des onze député·es et leur respect des « règles européennes ». Mais il serait en tout cas erroné de ne pas s’intéresser à cette démarche, pour l’heure parlementaire, qui pourrait être infléchie si des arrivées militantes d’ex-Syriza – à qui la gauche anticapitaliste doit savoir s’adresser – pesaient pour réorienter un peu plus à gauche.
Pour conclure cet aperçu de la situation de Syriza, on peut dire que sa nouvelle ligne directrice finit d’acter la faillite d’une organisation dans laquelle une majorité de jeunes et de travailleur·es en Grèce et une grande partie de la gauche anticapitaliste européenne avaient placé leurs espoirs et leurs illusions, que pour notre part nous ne partagions pas, non pas par sectarisme, mais par clairvoyance sur la capacité de manœuvres de la majorité inconditionnellement réformiste et sur la nécessité de faire vivre une gauche anticapitaliste indépendante de Syriza. Ajoutons une dernière question, très souvent posée : quel est le projet de Tsipras qui, non content de s’être englué dans la gestion du capitalisme et d’avoir choisi lui-même Kasselákis comme candidat aux législatives, n’est pas intervenu lors de la campagne pour élire son successeur alors que des coups bas étaient portés contre la candidate Achtsióglou, coups bas visiblement venus de l’aile populiste promouvant Kasselákis ? Sa seule intervention récente est de condamner les scissions, couvrant ce qui constitue de fait un sabordage de Syriza…
Quoi de neuf à gauche de Syriza ?
Si l’on regarde le tableau des résultats électoraux, le résultat est presque sans appel : en huit ans, les groupes ou partis à gauche de Syriza, n’ont bénéficié en rien ou presque des reniements de Syriza puis de son recentrage vers le social-libéralisme. Et cela est particulièrement flagrant pour les années 2019-2023, période où Syriza a creusé sa propre tombe : cela vaut pour les groupes issus de Syriza comme pour ceux d’origine différente (le KKE semble remonter légèrement en 2023, effet à nuancer). Pour tous, la raison principale de l’échec est double : une analyse erronée et une logique boutiquière, à l’opposé de ce qui aurait pu permettre d’éviter ce qui est un désastre pour l’ensemble de la gauche. L’analyse erronée porte sur Syriza, placé par tous ces groupes sur le même plan que ND ou le Pasok, alors que le vote de 2019 montrait que les jeunes et les travailleur·es établissaient une forte différence. Pendant les quatre dernières années, et en particulier dans la période électorale, Syriza semblait représenter pour ces groupes l’ennemi à abattre, et cela a certainement contribué à renforcer la droite.
L’échec dans l’objectif de se renforcer aux dépens de Syriza provient aussi de la maladie historique de la plus grande partie de la gauche grecque : son sectarisme. Car, non seulement la gauche, de Mera à Antarsya en passant par le KKE, a concentré ses attaques sur Syriza, mais chaque groupe l’a fait pour sa propre boutique, là où offrir une alternative commune aurait pu être efficace. Et cela apparaît dans la plupart des manifestations, où les rassemblements des différents groupes ou blocs se font dans des endroits et parfois à des moments différents… Le résultat de tout cela est qu’au terme de la « période Syriza », tout ce qui se trouve à sa gauche représente environ 550 000 voix, soit 10,5 % à 11 % des suffrages exprimées en juin 2023. Le gain en 2023, sur fond d’effondrement de Syriza, est d’environ 150 000 voix par rapport à janvier 2015, où ni Mera, ni LAE, ni Plevsi n’existaient, ce qui est très faible si on se souvient de l’importance des luttes sociales de ces dernières années. En même temps, pour les luttes et la recomposition politique qui ne manqueront pas de venir, c’est un potentiel qui peut être qualifié d’encourageant… à partir du moment où ces forces de gauche reconsidèrent au plus vite leur positionnement et leurs objectifs, ce qui n’est malheureusement pas gagné.
Du côté du KKE, on voit certes un gain électoral, puisqu’il gagne environ 100 000 voix depuis 2019. Sa direction a présenté ce gain comme un très grand succès, preuve de la justesse de sa ligne qui malgré de toutes petites ouvertures dans la période électorale, est surtout faite d’auto-affirmation et de division (notamment dans le mouvement syndical, avec sa fraction PAME) avec un discours gauche en apparence (« Seul le peuple peut sauver le peuple, avec un KKE puissant ») mais dont la traduction est électoraliste : pour commencer à changer les choses, il faut attendre que le peuple donne la majorité au KKE. Et il n’y a qu’une chose à faire : construire le KKE (son organisation de jeunesse, la KNE, s’est largement reconstruite après sa quasi-disparition au profit de NAR en 1989), en établissant un cordon sanitaire vis-à-vis des autres forces de gauche.
Le score de 2023 est-il un succès de cette tactique ? On ne peut qu’en douter si on se reporte aux législatives de 2009, où il avait obtenu bien mieux : 536 000 voix (8,48 %) ; de même, dans la grande ville de Patras, où le maire KKE Kostas Peletidis en est à son troisième mandat, on voit aux élections municipales l’érosion du « communisme municipal » classique de la gestion réformiste : élu au second tour en 2014 avec 60 000 voix (63,5 %) et en 2019 avec 55 000 (70,8 %), il vient certes d’être réélu, mais avec seulement 41 000 voix (56,7 %). Quelle sera la position du KKE face à la crise de Syriza ? Comprendra-t-il qu’il est urgent de proposer une démarche large et unitaire par rapport aux adhérent·es et militant·es critiquant le cours de Kasselakis ? Les premières réponses semblent montrer que le KKE reste ferme dans sa logique boutiquière. Sofianos, un de ces dirigeants, a déclaré : « Tous ces gens doivent être avec nous. Peu importe qu’on ne soit pas d’accord sur tout, peu importe qu’on soit en désaccord sur pas mal de choses ». Il semble que le KKE, imperturbable dans sa conviction d’avoir raison, seul, ne veuille pas prendre la mesure de la crise à gauche face à l’offensive généralisée de la droite.
Les anciennes organisations dans l’impasse
En ce qui concerne les trois forces issues de Syriza, leurs évolutions particulières ont été très différentes : LAE, après avoir quitté Syriza à l’été 2015 avec comme seule ligne de dénoncer sa direction traitre, s’est très vite replié dans un cours exigeant avant tout de quitter l’Union européenne et l’euro, qui l’a assez vite amené à une position nationaliste et à une hémorragie en termes de militant·es et d’audience. Mera a connu un certain développement grâce à la renommée de l’ancien ministre Yannis Varoufákis, à qui le refus de suivre Tsipras dans son reniement du référendum de 2015 avait apporté un certain prestige. Si l’on peut retrouver des militant·es de Mera dans certaines mobilisations, l’aspect technocratique de son dirigeant et le caractère confus de son projet politique n’ont pas aidé à des clarifications à gauche. Quant à Plevsi, après s’être créé comme groupe identifié de gauche et avoir travaillé en collaboration avec le mouvement Den Plirono (« Je ne paie pas » les péages), il a véritablement dégénéré en une sorte de secte autour de l’ancienne présidente du Parlement, Zoé Konstantopoúlou, agissant presque comme gourou autoritaire et alternant déclarations nationalistes et paroles d’amour qui ont su séduire un électorat dépolitisé et réactionnaire puisqu’elle a étonnamment obtenu huit député·es. Cela n’a plus rien à voir avec les débats à gauche, donc.
Mais qu’en est-il aujourd’hui de la gauche anticapitaliste, portée pendant des années par la coalition Antarsya, dont le lancement en 2009 avait soulevé bien des espoirs en Grèce, puisqu’une bonne partie de la gauche radicale et révolutionnaire tentait ainsi de passer à la vitesse supérieure, après diverses premières expériences cantonnées au seul terrain électoral ? Dès sa fondation, elle reposait, à la différence par exemple du NPA en France lancé comme volonté d’élargissement et de dépassement de la seule LCR, sur deux grosses forces de la gauche révolutionnaire : d’un côté NAR et son journal Prin, issus en 1989 de la scission majoritaire de la jeunesse communiste KNE, et de l’autre SEK, formation membre de l’IST, avec chacune plusieurs centaines de militant·es. À côté d’elles, plusieurs groupes se sont investis, dont la section grecque de la IVe Internationale, à l’époque formée d’un seul groupe.
Très vite, les résultats électoraux ont montré une distorsion – qui aurait dû être perçue comme problématique – entre les résultats aux scrutins nationaux et ceux aux scrutins locaux : aux législatives, hormis un score de 75 500 voix (1,19 %) en mai 2012, jamais Antarsya n’a atteint les 1 %. Lors de nouvelles législatives en juin 2012, elle retombait à 20 500 voix (0,33 %), pendant que Syriza passait de 1 million de voix (16,79 %) à 1,7 million (26,89 %). Et depuis, comme le montre le tableau, Antarsya stagne à des scores nationaux très faibles. Par contre, aux différentes élections municipales ou régionales, Antarsya obtenait souvent des scores supérieurs à 2 % et faisait élire des conseiller·es dans de nombreuses régions. On peut estimer que la raison principale de cet écart tient avant tout au positionnement central d’Antarsya, qui au lieu d’une position critique par rapport à Syriza, l’a présenté dès le départ comme une force au service de la bourgeoisie, et a dénoncé immédiatement le gouvernement Tsipras, le mettant dans le même sac que ND et le Pasok. Sans comprendre le rapport des masses à ce qui n’était pas le premier gouvernement de gauche en Grèce (le Pasok d’Andreas Papandreou était bien plus radical en 1981) mais qui suscitait cependant des espoirs, sinon de rupture radicale avec l’ordre bourgeois, au moins pour des avancées sociales remettant en cause la logique mortifère des mémorandums. En recanche, au niveau local, les militant·es d’Antarsya sont reconnu·es pour leur implication permanente dans bon nombre de luttes, antiracistes, étudiantes, ouvrières, et de collectifs locaux.
Mais l’échec évident au niveau national a accentué un défaut originel clé : Antarsya se définissant comme coalition, celles et ceux qui voulaient y militer sans être membres d’un groupe constitué ne pouvaient pas y trouver une place. Au fil des années, ces diverses difficultés ont accentué une tendance fatale : pour NAR et pour SEK en particulier, l’intérêt d’Antarsya était de recruter pour leurs groupes respectifs, d’autant qu’il n’était pas question que la coalition permette de « dépasser » chacun des groupes. Depuis plusieurs années, Antarsya est devenue un simple un regroupement électoral, et, dans les faits, elle a éclaté. Non seulement il n’est pas rare de voir dans les manifs athéniennes deux banderoles d’Antarsya séparées, l’une de SEK, l’autre de NAR, mais à plusieurs élections locales, comme les régionales dans la région athénienne, il y avait deux listes se réclamant d’Antarsya…
Dans ces conditions, aux élections municipales d’Athènes de cet automne, la belle campagne autour de l’avocat antifasciste très connu Kostas Papadákis, militant d’Antarsya et candidat d’une liste large et unitaire qui a obtenu 6,09 %, relève à la fois de l’exception (aux régionales dans la même région, il fallait 3 % pour obtenir un·e conseiller·e mais chacune des deux listes concurrentes n’a eu qu’un peu plus de 2 %…) et du potentiel qui existe encore au niveau local… pour peu que la gauche anticapitaliste établisse elle aussi son propre bilan et revoie de fond en comble son projet.
Ce n’est pas pour l’instant ce qui semble se dessiner, NAR s’étant lancé depuis pas mal de temps dans un vaste débat sur le futur parti dont il serait le noyau, et SEK s’activant comme toujours dans divers fronts stricts qui sont des émanations de son groupe…
Alors, par rapport aux urgences sociales et politiques, par rapport à la nécessité de battre Mitsotákis, on peut espérer que du marasme actuel dans la gauche anticapitaliste, qui se traduit par des scissions et des regroupements, naitra peut-être une perspective politique de construction patiente mais solide de ce qu’Antarsya n’a pas pu être : un regroupement anticapitaliste large, ouvert, refusant les sectarismes, et doté d’une boussole qui manque terriblement à la gauche grecque, la nécessité de proposer des fronts uniques à toute la gauche parallèlement à la discussion sur le projet politique d’une force anticapitaliste.
La possibilité de reconstruire
Il semble qu’aujourd’hui presque tout le monde a compris que, au-delà de la déroute de Syriza au printemps, c’est toute la gauche qui a subi une inquiétante défaite, et cela ouvre des possibilités de discussions au sein de la gauche anticapitaliste. On le voit notamment avec l’exemple du groupe Anametrissi, dont une bonne partie est issue de Syriza ou de NAR, et dans lequel milite un des deux groupes qui forment désormais la section grecque, la Tendance Programmatique IVe Internationale. Pour celle-ci, au cœur des discussions à venir sur le projet à gauche, doit être aussi avancée une autre boussole : la solidarité internationale contre l’impérialisme, que ce soit en soutien au peuple palestinien (les manifestations antifascistes et anti-impérialistes du 17 novembre en ont été une éclatante démonstration) mais aussi au peuple ukrainien, dont la résistance à l’impérialisme russe et ses enjeux restent largement incompris de la majorité des organisations de la gauche réformiste et révolutionnaire grecque, demeurées sur des positions campistes. (2)
Il va de soi que de telles conceptions réactionnaires écartent la possibilité d’impliquer le KKE dans les discussions programmatiques qui s’ouvrent ou vont s’ouvrir en vue des élections européennes, pour lesquelles la présentation d’une liste unique et ouverte de la gauche anticapitaliste pourrait être une étape importante. Mais la constitution et l’écho d’une telle liste seront d’autant plus possibles que cette gauche saura systématiquement être à l’initiative de propositions d’action à toute la gauche, contre la politique de misère et de répression de Mitsotákis et de son parti.
Andreas Sartzekis est militant de la Tendance programmatique IVe Internationale, un des deux groupes de la section grecque de la Quatrième Internationale.
Le 13 décembre 2023