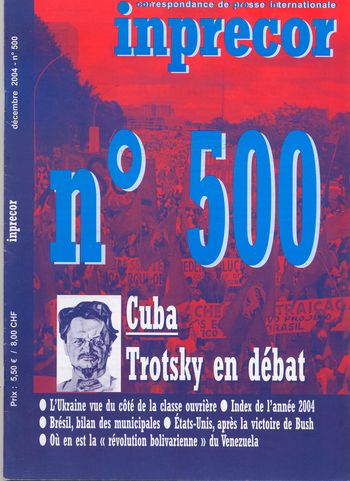Au cours de sa visite à Madrid le président Hugo Chávez a discuté à bâtons rompus avec plusieurs dizaines d'intellectuels dans le Cercle des Beaux-Arts. Durant deux heures il a répondu aux inquiétudes et aux doutes formulés par des écrivains, des acteurs, des éditeurs et des journalistes, pour ne citer que ceux-là, qui intervenaient librement et sans que leurs interventions ne soient présélectionnées. Voici quelques extraits de cette conversation.1
Comment voyez-vous la prochaine réunion des présidents des États de l'Amérique du Sud ?
Nous avons été très critiques du processus d'intégration latino-américain, qui a souvent été un processus de désintégration. C'est Simón Bolívar qui a formulé avec le plus d'impact l'idée géopolitique d'une ligue des nations latino-américaines. Lorsque le premier Sommet des Amériques s'est tenu, il y a dix ans, à Miami, Clinton avait dit que c'était la réalisation du rêve de Bolívar — mais non, en réalité c'était le rêve de Monroe, le rêve d'un contrôle des pays latino-américains par les États-Unis qu'il tentait de réaliser.
Les initiatives telles par exemple le Mercosur ne sont en réalité que des rencontres commerciales, ce n'est pas une intégration authentique. Jusqu'à l'arrivée de Lula, il y a deux ans, nous nous sentions bien seuls avec notre projet d'intégration. L'Empire avait toujours tenté d'éviter ce qui se forme maintenant : Lula, Kirchner, la chute du gouvernement néolibéral en Bolivie et le début d'une autre transition, et aujourd'hui Tabaré en Uruguay… Même si le président du Paraguay continue à tenir un discours néolibéral. Le Sommet d'Ayacucho va nous permettre de faire un pas, parce que l'unité du bloc des nations latino-américaines avance fermement.
Vous avez dénoncé la manière de traiter votre gouvernement et la situation par les moyens de communication, au Venezuela et en dehors. Comment voyez-vous cette situation maintenant ?
Cela a été terrible. Comme l'aurait dit Galeano " jamais ils ne furent autant à tant tromper autant de personnes ". Ils ont fait un coup d'État contre moi, il m'ont kidnappé et amené dans un avion sur une île et personne ne disait la vérité. Tous annonçaient que j'avais signé une démission, ce qui était un mensonge car ils auraient d'abord dû me fusiller. Mais avant que le coq ne chante deux fois le peuple et les militaires loyaux à la Constitution ont réussi à restaurer le gouvernement légitime et l'ordre constitutionnel. Alors un journal, ici en Espagne, a titré " Le peuple a renversé Chávez et les militaires l'ont réinstallé ". Ensuite nous avons dû faire face au sabotage de notre entreprise pétrolière publique, la PDVSA, le cœur de l'économie vénézuélienne. Puis il y eut le référendum, où nous avons gagné 60 % d'appui populaire. On vient de démontrer que l'opposition recourt au terrorisme avec le meurtre du juge qui enquêtait sur le coup d'État. La situation tend à s'améliorer. Les médias tendent à reprendre leur tâche. La critique est la bienvenue. Nous n'avons fermé aucun des médias malgré leurs insultes et leurs agressions verbales contre ma personne. Nous croyons qu'en Espagne il y a aussi une évolution en ce qui concerne le traitement des informations sur le Venezuela.
Quel allié international soutient-il votre politique au Venezuela ?
Lorsque nous sommes arrivés dans l'OPEP ce pays ne valait pas un baril de pétrole. Jusque-là le Venezuela était la cinquième colonne états-unienne au sein de l'OPEP. Nous nous sommes réunis avec tous les pays et nous avons relancé l'organisation. Lorsque nous souffrions du lock-out patronal qui a paralysé notre économie, nous avons pu juger de la solidarité du Brésil, qui nous a envoyé son pétrole, de Cuba qui nous a fourni les aliments et le sucre, de la Colombie qui nous a permis d'utiliser ses ports de Santa Marta et de Cartagena. La Russie aussi nous a envoyé du pétrole et l'Algérie et d'autres pays de l'OPEP ont mis des techniciens à notre service.
Après l'échec du coup d'État et ma reconfirmation comme président du Venezuela, les États-Unis ont voulu m'appliquer la Charte démocratique interaméricaine — une intervention en règle, prétendant que c'est moi qui ai fait le coup à Carmona. Les pays de la Caraïbe — petits en taille mais grands en dignité — et beaucoup de latino-américains ont fait face aux États-Unis.
Il est vrai que l'Union soviétique n'est plus, mais il y a beaucoup d'amis dans le monde.
Votre système dit avancer vers une démocratie participative. Mais lors des dernières élections régionales le taux de participation fut franchement faible, comment l'expliquez-vous ?
L'abstention lors des récentes élections des maires et gouverneurs a atteint 51 %. Lors des élections des années 1980 l'abstention dans les municipales avait atteint 90 % et dans les élections des gouverneurs 60 %. L'abstention lors du référendum révocatoire [en août] ne fut que de 35 %, un niveau sans précédent au Venezuela.
Il faut tenir compte du fait que lors des dernières élections locales l'opposition avait appelé à ne pas se rendre aux urnes. De ce fait nous avons remporté vingt des vingt-deux États.
Bien que le taux de participation revête une grande importance, on ne peut mesurer la démocratie participative par l'afflux des électeurs le jour du vote. C'est la participation des citoyens aux diverses tâches quotidiennes qui permet de la mesurer : la santé, les comités de la terre, les armées volontaires d'alphabétisation, les cercles bolivariens, les groupes d'études de l'utilisation de l'eau, les comités de voisinage qui définissent les besoins et les emplois du budget… La démocratie se mesure au quotidien, pas le jour des élections. Si nous voulons mettre un terme à la pauvreté, donnons le pouvoir aux pauvres. C'est pourquoi nous avons pris des initiatives, telle la micro-banque, pour donner des prêts à des gens qui s'organisent dans les quartiers pauvres.
Vue depuis l'Europe la société vénézuélienne apparaît comme très polarisée. Envisagez vous une initiative pour apaiser les rapports entre votre gouvernement et l'opposition ?
Ce qui arrive au Venezuela arrive aussi, d'un point de vue mathématique, dans le monde entier. Bush-Kerry aux États-Unis, Zapatero-Rajoy en Espagne, Lula-Serra au Brésil. En 1998 nous avions obtenu autour de 56 % des voix, l'opposition autour de 40 %. En 2000, avec la nouvelle Constitution, nous avions gagné 58 % des suffrages. Quatre ans plus tard nous avons obtenu l'appui de 59 % des votants. En 1998 et 1999 il n'y avait eu aucune violence sociale, la paix était absolue. Pourtant nous avions traité des questions conflictuelles, comme l'avortement ou les droits des homosexuels, etc. En 2000 il n'y a pas eu de tensions non plus. Mais vint l'année 2001 et lorsque nous avons touché aux privilèges économiques de l'oligarchie, une conspiration a explosé, les médias ont commencé à dire que oui, Chávez était un fasciste, ou un communiste qui voulait transformer le Venezuela en un autre Cuba. La situation était tellement crispée que les gens étaient capables de faire des concerts de casseroles en étant en famille dans un restaurant ou au théâtre jusqu'à ce qu'on les oblige à partir. A la télévision des militaires en uniforme appelaient à l'insurrection, ils payaient des soldats pour qu'ils lancent toute sorte d'accusations contre moi, ils ont été jusqu'à payer un pilote pour qu'il dise qu'il avait transporté dans son avion de la drogue ou des armes pour la guérilla colombienne…
Voilà les méthodes que nous devons dépasser au Venezuela pour assumer et normaliser les divergences politiques, comme dans n'importe quel autre pays.
A mon avis Cuba est une dictature inefficace. Est-ce que vous ne devriez pas soutenir une transition à Cuba ? Que peut faire le Venezuela pour que l'aide à Cuba la transforme en une démocratie ?
Nous sommes très respectueux envers Cuba. Nous lui fournissons la même aide que nous fournissons, par exemple, à la République dominicaine. Jamais il ne nous est arrivé d'envisager que cette aide puisse être conditionnelle. Les amis sont les amis. Nous respectons Cuba et nous avons nos propres critères. Personne ne peut répondre mieux à votre question que Fidel Castro. Mais je ne dirai jamais que ce qui se passe à Cuba peut être comparé à une dictature. Je n'ai pas une telle certitude. Pourquoi ici, en Europe, on ne pose pas la question aux Arabes pour quelle raison ils n'élisent pas leurs présidents ? A Cuba il n'y a pas d'analphabétisme, mais dans les pays qui se considèrent démocratiques il y a 40 % d'analphabètes. Ce sujet est très délicat pour moi, du fait de mon respect pour Cuba et pour sa révolution. Dans mon pays nous avons des médecins cubains qui travaillent dans les quartiers pauvres. ils ont laissé leur famille à La Havane et passent jusqu'à deux ans à assister les Vénézuéliens. Sans aucun doute le modèle d'intégration et de coopération que nous essayons entre Cuba et le Venezuela est un exemple que nous donnons à de nombreux pays latino-américains. Mais je crois qu'un Cubain donnerait une réponse plus précise à cette question.
Comment les politiques redistributrices de la richesse sont-elles appliquées au Venezuela ? Comment la corruption étatique qui existe dans l'administration vénézuélienne affecte-t-elle la révolution bolivarienne et comment les mouvements sociaux participent-ils à la lutte contre la corruption ?
Toute transformation économique doit avoir un effet social. Nous avons fait quelques pas au cours de ces cinq années. La récupération de l'entreprise pétrolière publique PDVSA, qui était entre les mains d'une technocratie dénationalisée, nous a coûté beaucoup. Lorsque j'étais jeune lieutenant on m'avait donné l'ordre de rechercher et d'appréhender des guérilleros comme Alí Rodríguez et Guillermo García Ponce, qui aujourd'hui sont tous les deux avec moi, l'un comme ministre, l'autre comme directeur d'un périodique. Je me suis rendu compte qu'ils avaient raison, tant en ce qui concerne leur lutte qu'en ce qui concerne leurs revendications.
La récupération de la PDVSA fut une œuvre titanesque. Un des gérants de cette entreprise a fini comme conseiller du président des États-Unis, ce qui montre au service de qui il était toujours. Ils allaient tout privatiser, ils avaient déjà privatisé le cerveau de l'entreprise pétrolière, c'est-à-dire l'ensemble du contrôle informatique était dans les mains d'une entreprise mixte dont les directeurs étaient tous des membres de la CIA. Ils étaient un État dans l'État, ne pouvant être soumis à un audit ni à un contrôle et cela ni par le gouvernement, ni par le Congrès, ni par la Cour des Comptes. Ils ont commencé des investissements dans le monde entier qui n'apportaient pas un centime au Venezuela. A la suite du coup d'État manqué et de la grève patronale pétrolière 17 000 gérants ont pu être écartés légalement pour avoir abandonné leur poste durant deux mois et avoir pris des vacances. Mais la PDVSA possède jusqu'à aujourd'hui des pompes a essence et des raffineries aux États-Unis qui n'ont jamais apporté un centime et auxquelles nous devons faire des remises sur le prix du pétrole. Et nous ne pouvons mettre un terme à cette situation car nous perdrions devant les tribunaux états-uniens. Ainsi, je suis le financier de Bush. Mais on m'accuse de financer Fidel Castro alors que nous donnons de l'argent au président des États-Unis et non à Fidel.
Au moins nous avons récupéré la partie vénézuélienne de la PDVSA et 1 700 millions de dollars du budget de la PDVSA ont pu être consacrés à la lutte contre la pauvreté. L'année prochaine nous pourrons encore employer 2 milliards de dollars de ce budget à des fins sociales. Par contre eux, lorsqu'ils tenaient l'entreprise pétrolière, ne payaient pas d'impôts car ils déclaraient des frais fictifs. Ils ont même été jusqu'à organiser des recherches de pétrole dans des lieux dont ils savaient parfaitement qu'ils n'en trouveront pas dans le seul but de justifier les déductions.
La collecte des impôts constitue un autre problème. Au Venezuela personne ne payait les impôts. Maintenant nous automatisons les douanes, car la contrebande était, par exemple, courante.
Mais par-dessus tout cela, nous voulons dépasser le néolibéralisme pour arriver à un État social, démocratique et juste.
En Espagne il est difficile de comprendre le grand rôle des militaires au sein de votre gouvernement et de votre administration. Pouvez vous l'expliquer ?
Certains croient que mon gouvernement est un gouvernement militaire, mais ce n'est pas le cas. En effet les Forces armées participent à notre processus. Notre arrivée a coïncidé avec le " caracazo " [révolte populaire], au cours duquel sont morts des milliers de Vénézuéliens réprimés pour avoir réclamé plus de justice sociale. Ils m'ont qualifié de putschiste, mais ce que nous avions fait en 1992 c'était une rébellion civico-militaire. Mon actuel ministre Alí Rodríguez, un civil, était alors en attente des armes et nous avions projeté un soulèvement pour conduire le pays vers une période constituante. Le Venezuela était alors sous le contrôle d'une classe politique corrompue. Nous avons été emprisonnés après avoir demandé qu'il n'y ait pas un seul tir, pour éviter l'effusion de sang. Il y avait alors plus de quarante assassinats à Caracas en un week-end, mais durant les douze heures de notre rébellion il n'y a eu que 17 morts — et il s'agit de morts qui me chagrinent beaucoup. Lorsque nous sommes sortis de prison, nous avons construit un parti et nous nous sommes présentés aux élections. Et nous avons gagné, nous gagnons et gagnerons encore.
Il faut aussi réfléchir à l'origine sociale des officiers vénézuéliens. Ils viennent des classes sociales pauvres, sont des enfants de paysans, c'est pourquoi ils comprennent la nécessité de s'engager dans un projet de lutte contre la pauvreté.
- 1Pascual Serrano, qui a pris part à la rencontre avec le président vénézuélien Hugo Chávez, a publié ce rapport sur le site web Rebelion le 26 novembre 2004 www.rebelion.org/noticia.php?id=8113<