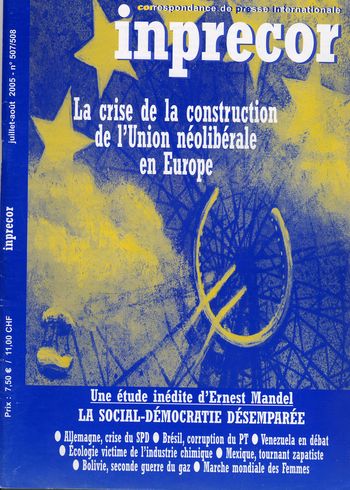<i>Laurent Carasso, militant syndicaliste, membre du Bureau politique de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR, section française de la IVe Internationale), est membre du Bureau exécutif du Comité international de la IVe Internationale.</i>
Le référendum français a été un choc politique en France et en Europe. Un choc politique car, malgré l'engagement des plus grands partis de gauche et de droite dans la campagne pour le " oui » (l'UMP, l'UDF et le PS), le désaveu électoral a été sans appel.
Nous avons assisté à un mouvement de fond de la société française. Le plus spectaculaire est évidemment son caractère de classe : 80 % des ouvriers, 70 % des employés, plus de 60 % de la jeunesse ont voté pour le " non ». Ce sont les villes et les bureaux de vote populaires qui ont voté " non ».
Ce " non » exprime ainsi directement la crise sociale et politique qui traverse le pays depuis des années. Elle pouvait être aperçue dans les précédentes consultations électorales, soit dans l'abstention populaire, soit dans la sanction systématique des partis responsables du gouvernement. C'est une telle sanction qu'avait subie Lionel Jospin, premier ministre socialiste de l'époque, lors de l'élection présidentielle de 2002. Il en a été de même en 2004, lors des élections régionales et européennes, qui avaient été un désastre pour l'UMP et l'UDF, sous le gouvernement de l'UMP Raffarin. L'aspect inédit de cette consultation sur le Traité constitutionnel est que les électeurs ont pu voter en même temps contre l'ensemble des partis responsables des politiques libérales, qu'ils soient de gauche ou de droite.
C'est une revanche des classes populaires. Le vote a cristallisé sur un terrain électoral un mécontentement social profond. Ce n'est pas étonnant puisque les gouvernements successifs ne se sont jamais privés de faire le lien entre leurs mesures de régression sociale et l'Union européenne. Mais c'est une réalité qui a été largement sous-estimée, à droite, mais aussi par la direction Hollande du Parti socialiste.
Une décennie de résistances
Depuis dix ans, en France, comme dans les autres pays de l'Union européenne, s'accumulent les attaques libérales remettant en cause les services publics, la protection sociale et l'emploi stable. Chaque salarié est directement concerné par ces attaques. L'avancée vers le modèle libéral a été continue. En 1995 eut lieu une grève générale contre le plan Juppé de réforme de la Sécurité sociale, mouvement dont l'ossature était représentée par les cheminots. La droite avait payé au prix fort cette attaque, la réforme avait été bloquée et deux ans plus tard, la gauche arrivait en force à l'Assemblée nationale.
En cinq ans, cette dernière avait largement épuisé son capital de confiance, privatisant à elle seule plus d'entreprises que les deux gouvernements de droite précédents. En 2002, lors de l'élection présidentielle, un premier coup de semonce avait ébranlé les dirigeants libéraux : Lionel Jospin, candidat du Parti socialiste, était absent du second tour, l'extrême gauche recueillait 10 % des voix, presque trois fois plus que le Parti communiste, et Jacques Chirac n'obtenait les voix que de 19 % des inscrits. Seule une campagne de dramatisation permettait un plébiscite au second tour pour Jacques Chirac opposé à J.-M. Le Pen, candidat du Front national. En faisant de ce second tour un vote antifasciste, le PS comme la droite voulaient masquer leur brèche grandissante d'avec l'électorat populaire.
Malgré cela, un an après, pendant plusieurs semaines, un mouvement de grève puissant devait mobiliser les salariés contre la réforme du système de retraites, en lien avec un mouvement de grève générale des enseignants. Ce mouvement avait été finalement défait mais laissait, dans la conscience populaire et parmi les militants du mouvement ouvrier, la compréhension que la bourgeoisie était partie pour démanteler l'ensemble des acquis sociaux des décennies précédentes, démantèlement justifié en permanence par les impératifs de la mondialisation et de la construction de l'Union européenne, démantèlement assumé par la droite comme par la gauche social-libérale.
Depuis 2003, l'agenda des réformes libérales ne s'est pas refermé. En 2004, notamment, le gouvernement Raffarin a mis sur pied le plan Douste-Blazy de remise en cause de l'Assurance-maladie, avec la même logique que l'attaque précédente contre les retraites. Attaque menée parallèlement avec une réforme des hôpitaux (" hôpital 2007 »), devant aboutir lui aussi à une mise en coupe réglée, avec un cloisonnement par activité et la mise sur pied d'agences régionales de l'hospitalisation chargées de rentabiliser les hôpitaux selon des critères capitalistes. Seule la complicité active des directions politiques et syndicales du mouvement ouvrier a empêché que se construise un mouvement de riposte similaire à celui de l'année précédente, même si la tâche avait été facilitée par la démoralisation de nombreux secteurs militants accusant le coup de la défaite de l'année passée.
Néanmoins, sous l'impulsion d'ATTAC, de la fondation Copernic et de nombreux secteurs syndicaux, de la LCR et du PCF, le pays s'était maillé de collectifs de défense de la Sécurité sociale, reprenant les réponses antilibérales avancées l'année précédente lors du débat sur les retraites. Défaite sans bataille mais qui, là encore, renforçait la conscience de la nécessité de combattre un projet de société qui, pas après pas, fragilisait les salariés et renforçait les inégalités sociales.
Parallèlement, les secteurs de l'énergie étaient attaqués par le changement de statut d'EDF-GDF (Électricité et Gaz de France), pour l'ouvrir aux capitaux privés. Malheureusement, la direction fédérale Énergie de la CGT, largement majoritaire dans le secteur, ne fit rien pour organiser la riposte et coordonner les actions combatives menées dans plusieurs régions. Durant l'été 2004, l'annonce successive de la privatisation de France Télécom et de la fermeture de six mille bureaux de postes complétait le tableau du calendrier libéral.
Dans tous ces domaines de privatisation, le mouvement syndical français n'apporta pas de réponse globale, ne cherchant pas à construire une mobilisation générale qui aurait dû être portée par un projet alternatif de développement des services publics au service des besoins sociaux. La CGT a dans ce domaine une responsabilité première, car là réside l'essentiel des forces militantes qui auraient pu construire une telle riposte, mais cela ne doit évidemment masquer ni l'adhésion de la direction de la CFDT, deuxième centrale syndicale à de tels projets, ni la passivité de Force ouvrière. Chaque secteur fut laissé à lui-même et la volonté de lutte de secteurs combatifs de la CGT, ou de SUD PTT, ne put entraver ces processus. Par contre, la défense des services publics, donna encore fois une base à la construction de nombreux collectifs locaux et à l'organisation, en février 2005, d'une mobilisation nationale à Guéret, préfecture du département de la Creuse, dans le centre de la France, symbole de la désertification des services publics.
A ces questions de politique sociale globale, se sont ajoutées, ces derniers mois, la continuation de plans de licenciements et de fermetures d'entreprises ainsi que la remontée inexorable du nombre de chômeurs, soumis à une culpabilisation croissante et à des indemnités réduites. La question des délocalisations, présente fortement dans la campagne européenne, vient de la volonté croissante des employeurs d'accroître leurs marges, par le déplacement d'unités de production vers l'Europe de l'Est, ou, plus généralement par la pression exercée sur les salaires et les conditions de travail avec le chantage aux délocalisations. De même, la question des salaires est revenue au premier plan, le secteur public comme privé étant soumis à une rigueur salariale qui entraîne une baisse du pouvoir d'achat, attaqué par la hausse des loyers, des produits de consommation courante et de l'énergie.
Ainsi ces dernières années et les mois précédents le référendum ont vu à la fois l'accroissement des attaques, la désorganisation de la riposte, et un sentiment croissant de fragilisation et de précarité parmi les salariés. Et cela, sans que ce sentiment puisse se traduire positivement par des perspectives de luttes sociales ou d'alternative politique, la direction du Parti socialiste s'étant soumise depuis longtemps à de telles évolutions libérales.
Parallèlement, s'est produite une politisation large de secteurs syndicaux et du mouvement altermondialiste, exprimée notamment lors du forum social européen de Paris-St Denis en novembre 2003.
Accumulation d'expériences mal interprétée
Dans ce contexte, les élections régionales d'avril 2004 avaient pu donner une vision fausse de la situation. Sans avoir mené de campagne réellement dynamique, le Parti socialiste, essentiellement, et ses alliés traditionnels, Verts et PCF, avaient bénéficié d'un vote sanction écrasant contre la droite, donnant à la social-démocratie la direction de 21 régions sur 23. Malgré une campagne unitaire menée entre LO (Lutte ouvrière) et la LCR, l'extrême gauche se trouvait réduite par ce mouvement électoral, tombant en dessous de 5 %. Certains avaient pu y voir, après des votes " protestataires » de 2002, l'expression que la politique traditionnelle retrouvait ses marques et que l'alternance de gauche avait retrouvé sa crédibilité perdue. La suite devait intégrer ce vote dans une perspective globale, faisant apparaître le vote pour le PS comme un vote sanction de la droite, et nullement comme une adhésion populaire retrouvée, ou une marginalisation des positions radicales de l'extrême gauche.
C'est sans doute une vision faussée de la réalité et une sous-estimation du mécontentement populaire, qui ont conduit Jacques Chirac à s'engager dans l'aventure du référendum, et François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste à engager fortement son parti dans la bataille du " oui ». En n'ayant qu'une vision superficielle des votes de 2002 et de 2004, il semblait, à l'un comme à l'autre, que la victoire du " oui » était assurée. A tel point que François Hollande n'hésita pas à apparaître en photo, au côté de Nicolas Sarkozy, sur la couverture d'un magazine de grande diffusion. De plus, Jacques Chirac, voyait là l'assurance d'être le grand bénéficiaire de ce résultat face à un Parti socialiste qui ne manquerait pas de se diviser sur la question.
Une particularité française réside dans le fait qu'existe largement dans le mouvement ouvrier une sensibilité politique antilibérale, faisant le lien entre la mondialisation capitaliste, la politique de l'Union européenne et les politiques nationales de remise en cause des acquis sociaux. Cette sensibilité a été constamment alimentée par les luttes sociales des dernières années, les actions menées aussi par le mouvement altermondialiste et la Confédération paysanne, la présence en France d'un mouvement social radical, au niveau associatif et syndical, et d'une extrême gauche bien présente sur la scène politique, notamment ces dernières années avec la popularité d'Olivier Besancenot. Cette sensibilité politique a aussi ses aspects négatifs dans une vision nationale un peu hautaine vis-à-vis des autres pays de l'Europe de l'Ouest, considérant la France comme une citadelle de l'État social, assiégée par le modèle anglo-saxon, ignorant en cela les acquis obtenus, dans les années d'après-guerre, tant en Europe du Nord qu'en Grande-Bretagne, en Allemagne ou en Italie, par exemple. Cette vision alimente des courants souverainistes ou républicains qui voient dans l'État français, en tant que tel, une protection contre les remises en cause sociales.
Néanmoins, au total, c'est cette sensibilité bien prégnante qui explique que, seul en Europe, le Parti socialiste français ait pu être à ce point divisé sur la question de la Constitution, avec un référendum interne donnant plus de 40 % de votes des militants pour le rejet du Traité constitutionnel européen (TCE).
Ce mouvement pour le " non » vient donc de loin avec une structuration sociale, associative, syndicale, politique.
Une campagne construite patiemment
Dès que la question du référendum est venue à l'ordre du jour, à l'été 2004, la fondation Copernic centre d'initiative et de réflexion qui regroupe des militants politiques (LCR, PCF, Verts, socialistes critiques), syndicaux, associatifs antilibéraux a pris l'initiative de lancer un appel large pour organiser une campagne pour le refus de la constitution libérale sur des bases de gauche, pour un " non social et internationaliste ». La question du référendum ne préoccupait alors que les secteurs militants, mais cet appel a permis, dès l'automne, la construction de nombreux collectifs unitaires. La LCR s'est totalement investie dans cet appel et la construction de collectifs unitaires. Sur la palette politique l'appel des 200 rassemblait, outre la Ligue, le PCF, des militants de PRS (Pour la République Sociale, club du PS autour de J.-L. Mélenchon), de MARS (courant issu du Mouvement des Citoyens de J.-P. Chevènement), les " écolos pour le non » de la minorité des Verts, des militants associatifs et syndicaux.
Lutte Ouvrière eut une attitude particulière durant toute cette campagne. A la différence de sa position lors du Traité de Maastricht, où elle avait appelé à l'abstention, encourant la critique d'avoir ainsi favorisé la petite victoire du " oui » avec 51 % lors du référendum français de septembre 1992, elle décida en décembre 2004 de se prononcer pour le " non », plus pour éviter de nouvelles critiques que pour mener réellement campagne. Durant tout le premier semestre 2005, les militants de LO furent absents des collectifs, de la campagne unitaire et ne menèrent eux-mêmes pratiquement aucune campagne, Arlette Laguillier ne faisant que quelques apparitions à la télévision sur cette question.
Le PCF, signataire de l'appel des 200, joua dans un premier temps les cavaliers seuls, organisant surtout sa propre campagne et attendant la prise de position du PS, espérant une victoire du " non » pour jouer le moteur d'une campagne de toute la gauche. Le PCF fut ensuite réellement partie prenante de la campagne unitaire dans l'essentiel des villes du pays.
Il y eut deux réels tournants dans la campagne. Le référendum interne du Parti socialiste, en décembre, pour lequel Laurent Fabius, numéro deux du Parti, après avoir " longtemps hésité » se prononça pour le " non ». Ce choix, venant d'un social-libéral convaincu, ayant lui-même soutenu tous les Traités antérieurs depuis l'Acte unique de Maastricht en étonna plus d'un. Positionnement tactique, avec en ligne de mire la présidentielle de 2007 ? Évidemment. Mais aussi compréhension sans doute plus fine que son compère Hollande du ressentiment populaire vis-à-vis de l'Europe libérale. Le vote obtenu de 59 % pour le " oui », entraîna comme conséquence un investissement plus net des courants minoritaires du PS dans la campagne, même si Henri Emmanuelli et Laurent Fabius menèrent surtout leur propre campagne, ce dernier ne pouvant évidemment pas se reconnaître dans les bases radicales de l'appel des 200 et de la campagne unitaire. Ce résultat engagea plus nettement aussi le PCF dans les collectifs et les meetings unitaires.
Après un réel débat interne, ATTAC se prononça sans hésitation pour le " non » et joua un rôle important dans tout le travail local d'explication et de sensibilisation. Il en fut de même pour la Confédération paysanne.
Ces deux prises de position furent de taille à gauche. En effet, François Hollande, tout comme Daniel Cohn-Bendit tentèrent durant toute la campagne de présenter le " oui » comme un vote " intelligent, ouvert » face au " non peureux et frustre ». La crédibilité de la Confédération paysanne comme d'ATTAC dans les couches intellectuelles et les couches aisées du salariat aidèrent à asseoir largement le vote " non ».
Les Verts français tranchèrent de justesse pour un " " oui critique ». Mais l'omniprésence de Cohn-Bendit dans la campagne du " oui » libéral, souvent au côté de François Bayrou, dirigeant de l'UDF éclipsa toute campagne autonome, et laissa le champs libre aux minoritaires, présents dans les collectifs et les rassemblements unitaires.
Le problème majeur restait celui du mouvement syndical.
Englué dans son aggiornamento de syndicat de négociation et d'insertion dans la CES (Confédération européenne des syndicats), la direction confédérale de la CGT fut longtemps tentée d'épouser la position de la confédération européenne de soutien au TCE, position partagée en France par la CFDT. Cette position allait évidemment à l'encontre de la sensibilité de la grande majorité des militants. Mais la direction Thibault s'arc-bouta pour refuser l'engagement de la centrale. Cela eut, dans les faits, un effet de blocage tant dans la principale fédération enseignante la FSU que dans l'Union Solidaires (qui regroupe les SUD). Bien que ces deux organisations aient pris une claire position de rejet du Traité, des résistances se maintinrent en leur sein pour un clair engagement dans la campagne du " non », absence d'engagement confortée par celle de la CGT. Heureusement, en février, lors d'un comité confédéral national, par 81 voix contre 18, la CGT se prononça clairement pour le rejet du Traité. Ce fut le second élément décisif de la campagne, qui permit d'asseoir solidement le " non de gauche ».
Pourtant, même avant ce vote, de nombreux militants syndicalistes, de la CGT, de la FSU ou des SUD étaient présents dans la campagne, et de nombreux syndicats avaient eux-mêmes pris position.
Dominée par le " non de gauche »
Au total, c'est l'investissement de toutes ces forces qui donna toute son ampleur à la campagne du " non » et lui imprima un clair contenu social.
Dès les premiers mois de 2005, la question de la constitution et du référendum devint la question politique centrale dans le pays. Toutes les questions sociales venaient alimenter la force du " non » : le débat sur les délocalisations, la mobilisation contre la directive Bolkestein, une mobilisation nationale trop éphémère de défense des salaires le 10 mars 2005, le mouvement de protestation des lycéens qui durant tout le printemps s'opposa à une réforme du baccalauréat qui s'insérait dans un plan du ministre Fillon de remise en cause du système scolaire, aboutissant à une plus grande discrimination sociale. Il en fut de même de la question de la remise en cause de la semaines des 35 heures par le déblocage des quotas d'heures supplémentaires, et surtout de la décision gouvernementale de suppression d'un jour férié, le lundi de Pentecôte. Cette décision, prise dans une quasi indifférence à la suite de la canicule de l'été 2004, qui avait entraîné la mort de plus de 10 000 personnes âgées, prenait comme prétexte la création d'un fonds de financement pour les personnes âgées dépendantes devant être financé par ce jour de travail supplémentaire non rémunéré. Mais l'application de la mesure, à la veille du référendum entraîna une levée de boucliers et vint, là encore, alimenter la montée du " non ». Après plusieurs jours de grève exemplaire des salariés de Total contre la suppression du lundi de Pentecôte, le gouvernement, paniqué, dut laisser la direction du groupe négocier l'abandon du jour de travail supplémentaire pour ses salariés.
Face à cette force du " non », durant toute la campagne, l'ensemble de la presse écrite et parlée, les chaînes de télévision menèrent une campagne partisane de défense du " oui », de caricature du " non », une campagne prédisant le chaos, la mise au ban de la France par les autres pays de l'UE en cas de refus de la ratification. Jacques Chirac intervint à trois reprises à la télévision, mettant tout son poids dans la balance. Rien n'y fit !
La campagne fut clairement dominée par le " non de gauche », qui rassembla près de 200 000 personnes dans des meetings unitaires, dans des centaines de réunions publiques locales. Les livres sur la Constitution, les suppléments des périodiques se diffusèrent à une large échelle. Contraste saisissant avec la campagne dans l'État espagnol où les électeurs ne purent même pas prendre connaissance du Titre III, contenant l'essentiel des traités antérieurs et les dispositions concrètes ultra-libérales.
Autant durant l'automne 2004, les leaders du " non » de droite, comme Philippe De Villiers, tenaient souvent le devant de la scène en marquant sa campagne du refus de l'adhésion de la Turquie, autant le printemps marginalisa ces thèmes, tout comme la campagne fort discrète du Front national, qui ne tint au total que quelques meetings.
Crise de légitimité et déni de la démocratie
Le résultat de ce référendum a un effet politique corrosif. Son score sans appel révèle au grand jour la faiblesse de la base sociale des partis libéraux de droite et de gauche. Alors que 92 % des députés et sénateurs français ont approuvé par leur vote la Constitution, 55 % des électeurs l'ont repoussée. Il y a évidemment une crise de légitimité, pour Chirac, pour l'Assemblée.
Un total déni de démocratie apparaît au grand jour dans le mépris avec lequel Chirac considère qu'il n'a pas à se faire l'écho du vote populaire dans les instances européennes. En 2003, Raffarin disait aux millions de salariés qui occupaient les rues contre la réforme des retraites : " ce n'est pas la rue qui gouverne ! ». Aujourd'hui Chirac dit en substance " ce ne sont pas les urnes qui gouvernent ! ». Cela ne peut que renforcer la crise de légitimité des institutions parlementaires et des mécanismes électoraux.
Jamais un gouvernement ne fut aussi discrédité au lendemain de sa mise en place que le nouveau gouvernement Villepin, nommé en catastrophe pour remplacer Raffarin au lendemain du 29 mai.
Mais l'effet corrosif du référendum se voit dans la composition même de ce gouvernement. Un seul ministre de l'UDF (rompant les consignes de son parti et exclu de celui-ci quelques jours après), un gouvernement autour de la garde rapprochée de Jacques Chirac, évinçant même tous les ministres partisans de son rival Nicolas Sarkozy au sein de l'UMP, n'intégrant celui-ci que pour lui enlever une marge de manoeuvre supplémentaire dans la préparation de l'élection présidentielle de 2007.
De même dans le Parti socialiste, la première décision de la direction Hollande, fut là aussi d'évincer Laurent Fabius de son rang de numéro 2 et du Secrétariat national, formaté là aussi uniquement autour des battus du 29 mai. On peut prévoir qu'il sera très difficile pour les dirigeants socialistes de recomposer tout cela.
Tous ces réflexes de défense témoignent aussi que ce vote est une nouvelle fois un vote anti-système. Un vote contre tous les partis de gouvernement. D'un certain point de vue cela confirme les facteurs de distanciation entre les appareils traditionnels de la gauche et les classes populaires. Ce sont des tendances lourdes sur le plan social et politique. Mais il fait ressortir avec plus de force la crise de représentation des partis.
Le 29 mai pose aussi une question sociale fondamentale. Il n'a pas changé le rapport de force social et le gouvernement met en oeuvre de nouvelles attaques. Le caractère de classe de ce vote interpelle directement le mouvement social, en premier lieu le mouvement syndical. Il témoigne non pas forcément d'une combativité accrue, mais d'une disponibilité au rassemblement sur les objectifs sociaux fondamentaux autour desquels les directions se refusent jusqu'à aujourd'hui d'organiser l'action au niveau que cela nécessite. Cette situation renforce l'urgence de l'action convergente des forces militantes qui dans la CGT, la FSU, Solidaires partagent cette volonté de riposte d'ensemble contre les réformes libérales.
Le PCF au coeur des contradictions
La question politique interpelle évidemment les forces du " non » de gauche. Les porte-parole du PCF et des minorités du PS déclarent déjà refuser toute logique de construction d'un " pôle de radicalité » et vouloir réunifier le " non de gauche » et le " oui de gauche », dans une perspective de rassemblement pour les élections générales de 2007, alors que tout montre que le PS maintiendra les orientations mises en oeuvre depuis des années et qui s'inscrivent dans le cadre du libéralisme.
Le coeur de la contradiction à gauche se trouve désormais au sein du PCF. Celui-ci s'est refait une santé dans cette campagne. Il a été dans nombre de rassemblements et meetings la force dominante. Il n'y a pas de nouvelles vagues d'adhésions, notamment dans les nouvelles générations, mais le " peuple communiste » avec beaucoup de têtes grises et de cheveux blancs s'est réveillé. Cela fait encore des dizaines de milliers de militants. Mais il s'est réveillé sur une orientation combative, anti-libérale et opposée à la direction du PS. Plus exactement, la direction du PCF a tenu un double discours durant toute la campagne : une vive dénonciation du libéralisme mais aussi la nécessité de renouer avec le " oui de gauche », cela dans une perspective de majorité parlementaire et gouvernementale. De même, Marie-Georges Buffet est souvent revenue sur l'idée qu'il n'y avait pas deux gauches mais une seule du PS à la LCR et qu'il fallait réunifier tout cela !
Si l'unité la plus large est évidemment nécessaire contre le MEDEF (syndicat patronal) et la droite, la question qui est maintenant posée à ces dizaines de milliers de militants communistes est la suivante : Dans les rapports de forces actuels où les appareils et les institutions sont dominés à gauche par le social-libéralisme cela inclut le " non » de Laurent Fabius , refait-on une " union de la gauche relookée » sur une orientation imprimée par la direction du PS ou alors opère-t-on un autre rassemblement, dans la dynamique du " non » de gauche, à savoir une alliance réellement anti-libérale et anticapitaliste ?
C'est la vraie question qui est posée. Engager le fer pour modifier les rapports de force à gauche, dans une perspective de rupture avec les impératifs capitalistes, avec tous les risques que cela comporte, ou alors retomber dans les ornières de toutes les formules de gouvernement du passé qui ont toujours respecté l'économie et les institutions capitalistes. C'est la question que va poser la LCR en particulier au PCF, mais aussi à des secteurs des mouvements sociaux, à des secteurs socialistes de gauche et des Verts : alternance social-libérale ou alternative anticapitaliste, voilà la question clé des semaines et mois à venir. De ce point de vue, même si le plus probable reste une orientation qui va essayer de reconstruire une union des gauches avec tout le PS dans une perspective gouvernementale, des secteurs du PCF peuvent opter pour un pas à gauche et une rupture avec la direction du PS. Dans ce cas, cela poserait sérieusement la question d'un front ou d'une nouvelle alliance anticapitaliste incluant, outre les révolutionnaires, un PCF ou des secteurs du PCF qui rompraient avec toute politique d'alliance gouvernementale avec les sociaux libéraux. Mais cette question concerne aussi les militants syndicaux et associatifs investis dans la campagne. Ne pas se donner les moyens de changer le paysage politique à gauche, ou se soumettre à de nouvelles perspectives gouvernementales sous la houlette du PS serait en quelque sorte incohérent avec la force politique apparue durant la campagne.
Collectifs unitaires et nouvelle force anticapitaliste
Ce débat s'insère évidemment dans celui sur la suite à donner au mouvement des collectifs. Aujourd'hui, la dynamique unitaire est telle que les secteurs qui se sont engagés dans cette campagne, du moins à la base, ont une envie forte de continuer. La LCR va proposer des actions et objectifs unitaires sociaux et politiques contre le programme du nouveau gouvernement et de la droite, notamment en matière de défense de l'emploi, du droit du travail et des salaires, car le nouveau gouvernement multiplie les déclarations pour " adopter le modèle social français » à des modèles " qui créent des emplois » même si ces emplois sont des plus précaires.
La LCR propose aussi de prolonger le " non » français et néerlandais dans un rassemblement européen pour tracer de nouvelles perspectives européennes correspondant aux besoins sociaux.
Mais en même temps, se pose dans les collectifs une discussion sur les conditions d'une alternative politique anticapitaliste, sur un programme de rupture avec la loi du profit. C'est dans ce sens que la LCR a développé durant toute la campagne, un plan de 10 mesures d'urgence anticapitalistes, qui partant de revendications immédiates, met au centre une nouvelle répartition des richesses et une incursion dans la propriété capitaliste. Cette perspective, bien sûr, s'oppose à toutes les combinaisons de gouvernement social libérales ou de tout autre gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de l'économie et des institutions capitalistes. Mais l'essentiel, c'est de poursuivre ce mouvement unitaire, de faire des tests, sur l'action pratique, comme dans les luttes, pour faire avancer l'action et la réflexion. Le " non » a été un moment décisif du combat politique. Il a porté non seulement des refus mais aussi en positif des premières réponses, des exigences, des débats, des espoirs. Il faut maintenant aller au-delà car le " non de gauche », en tant que tel, ne constitue pas une réponse politique suffisante pour construire une alternative anticapitaliste. Il faut approfondir, apporter des propositions globales, mais sans diviser le mouvement. C'est en particulier, une question clé pour rassembler les militants et courants qui peuvent se retrouver dans la perspective d'une nouvelle force anticapitaliste.
Cette question est évidemment fondamentale, car le fossé qui sépare aujourd'hui les salariés de leur représentation politique pose objectivement la question de cette nouvelle force. La LCR, a été une composante à part entière du front unitaire. Olivier Besancenot a été un des principaux porte-parole de la campagne, une situation politique dans laquelle la LCR peut jouer un rôle important s'est ouverte à nouveau. Et l'écho du porte-parole de la LCR dépasse largement l'audience des sections de la LCR montrant là aussi l'espace politique que pourrait occuper une force anticapitaliste large sur un programme indépendant des compromis avec la social-démocratie. Le bilan de cette campagne est une nouvelle occasion d'avancer dans ce sens.