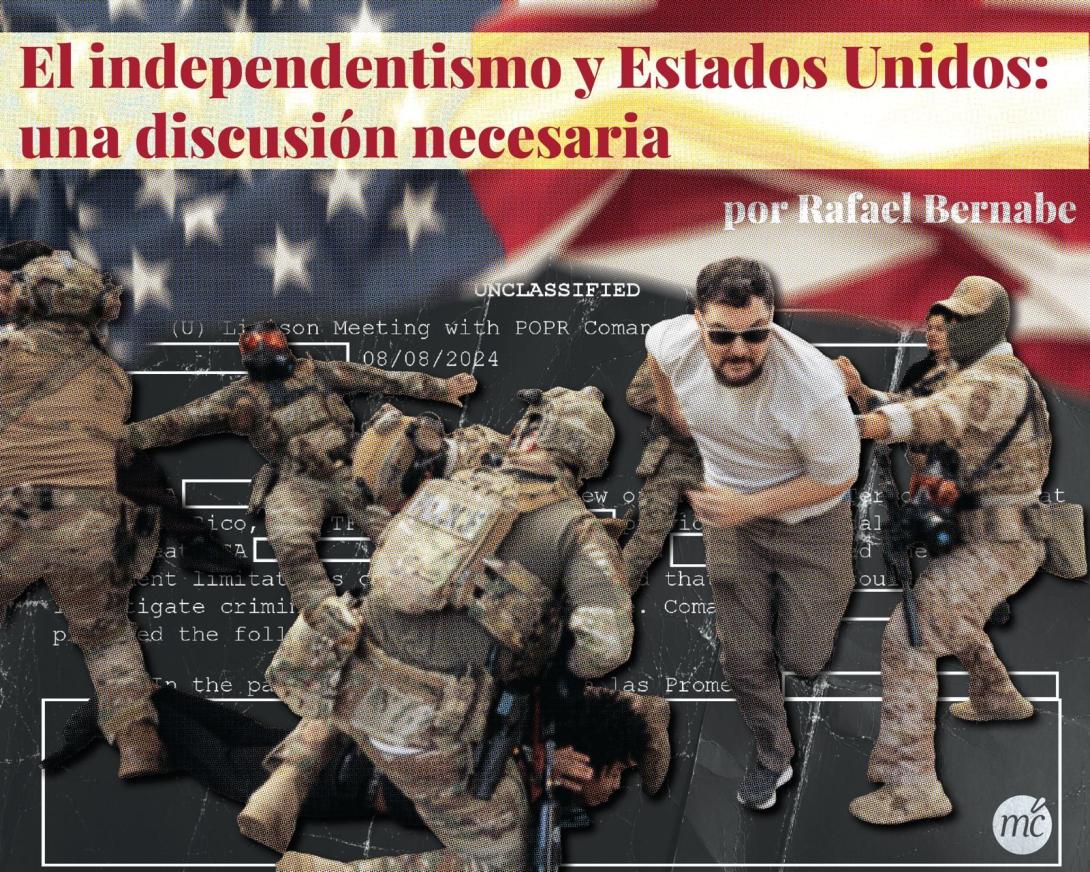
En lisant et en écoutant de nombreux camarades partisans de l’indépendance, nous avons constaté plusieurs attitudes différentes envers les États-Unis et les conflits sociaux, culturels et politiques qui déchirent ce pays. Retenons trois positions :
1. La première position insiste sur le renforcement de la droite trumpiste, du racisme et des politiques anti-immigrés comme argument en faveur de l’indépendance. Dans certains cas, le renforcement de la droite américaine est presque salué, car on estime que cela facilite la tâche de convaincre les Portoricains de la nécessité et de la pertinence de l’indépendance. Cette position suppose, présume ou suggère souvent que les États-Unis sont une entité monolithique et essentiellement raciste, xénophobe, etc. Le trumpisme serait l’expression la plus récente de cette essence réactionnaire. Cette idée prend souvent la forme d’expressions selon lesquelles les « Américains » ou les « gringos » sont tels ou tels (racistes, chauvins, incultes, etc.) ou pensent ceci ou cela (« ils nous méprisent », « ils nous rejettent », « ils ne nous aiment pas »).
2. Une deuxième position décrit les États-Unis comme une société en voie de désintégration ou au bord d’une « guerre civile », non pas pour prendre parti dans ce conflit social et politique, mais uniquement comme un argument en faveur de l’indépendance. Il faut se séparer d’« un pays en déclin » ou en pleine décomposition interne. Cela s’accompagne de références ou d’images des problèmes sociaux graves dans ce pays : SDF, toxicomanie, fusillades dans les écoles, etc.
3. La troisième est tout simplement indifférente à ce qui se passe aux États-Unis. Pour cette position, celles et ceux qui défendent l’indépendance n’ont pas à se préoccuper des conflits aux États-Unis. Ce ne sont pas nos luttes et nous n’avons pas à nous y impliquer.
Il nous semble que ces trois positions posent de sérieux problèmes analytiques et politiques : des défauts dans l’analyse qui empêchent de comprendre ce qui se passe aux États-Unis, ce qui, à son tour, empêche d’élaborer une politique indépendantiste plus efficace.
Commençons par quelque chose qui devrait être évident : les millions de Portoricains et Portoricaines qui résident aux États-Unis ne peuvent être indifférents à l’évolution de la politique ou de la société aux États-Unis. Si une « guerre civile » se profile, ils ne peuvent être indifférents à qui sortira renforcé ou victorieux de cette « guerre civile » ni aux conflits en cours. Leurs droits et leur situation matérielle dépendent de son issue. Il n’est pas indifférent, par exemple, que les projets xénophobes, racistes, écocidaires, misogynes, homophobes et anti-ouvriers de Trump s’imposent ou soient renversés.
D’autre part, penser que les États-Unis sont par essence et irrémédiablement une société raciste, ou une société inévitablement de plus en plus inégale et violente, impliquerait que notre diaspora doive se résigner à vivre pour toujours sous le régime de la discrimination, des préjugés et des mauvais traitements. Mais cette affirmation n’a aucun fondement. Les États-Unis sont une société profondément divisée, c’est vrai. Mais cela n’a rien d’étrange ou d’exceptionnel : c’est le cas de toutes les sociétés capitalistes qui combinent différentes formes d’exploitation, d’inégalité et d’oppression. Mais précisément ces divisions et ces conflits indiquent que les États-Unis ne sont pas une réalité monolithique et statique, mais une réalité contradictoire avec des forces différentes et opposées en son sein : des forces racistes, xénophobes, autoritaires, éco-cidaires, anti-ouvrières, voire fascistes, entre autres. D’un côté, mais aussi des résistances et des mouvements antiracistes, démocratiques, écologistes, féministes, syndicaux, antifascistes, etc. Une « guerre civile » implique non pas un, mais au moins deux camps en conflit. Répétons-le : pour les millions de Portoricains et Portoricaines qui résident aux États-Unis, il n’est pas indifférent que l’un ou l’autre camp politique et social l’emporte. Ils ne peuvent rester indifférents à un conflit qui déterminera le type de société dans lequel ils vivront. Ils ne peuvent pas dire « ce ne sont pas nos luttes et nous n’avons pas à nous en préoccuper ».
Mais il faut se poser la question suivante : une future république portoricaine se préoccupera-t-elle de savoir qui gouverne les États-Unis ? Pour ceux et celles qui aspirent à une république qui soit la représentation de la majorité des travailleuses et des travailleurs organisé·es en vue de s’autogouverner, qui socialise la partie la plus importante de l’activité économique, qui la soumette à un plan élaboré démocratiquement afin d’assurer le bien-être social et la réparation de notre relation avec la nature, pouvons-nous être indifférent.es à qui gouverne et à la nature des politiques adoptées dans d’autres pays, notamment aux États-Unis ? Une telle société peut-elle être construite de manière isolée ? Poser cette question, c’est y répondre : non, une telle société ne peut être construite de manière isolée. Ce que nous pouvons faire dans ce sens dépendra en grande partie de nos efforts et de nos capacités, mais également de notre environnement, de son hostilité ou de sa bienveillance à l’égard de nos objectifs. Tout comme notre diaspora, notre future république ne pourra pas rester indifférente aux politiques qui prévalent aux États-Unis. Et tout comme la future république, le mouvement indépendantiste aujourd’hui ne peut pas y rester indifférent. Nous avons besoin que les forces qui partagent nos objectifs y prévalent également. Ces luttes sont aussi les nôtres.
Nous ne pouvons donc ni pointer du doigt ni saluer la montée de la droite aux États-Unis comme un argument en faveur de l’indépendance, alors que cette montée réduit les chances d’une indépendance fructueuse et libératrice. Il est vrai que les États-Unis connaissent une désintégration sociale croissante, mais celle-ci résulte de la structure et du fonctionnement d’un capitalisme en crise. Pour cette raison, nous ne pouvons pas considérer ces tensions comme de simples symptômes de désastre ou des signes de désintégration et de décadence : c’est aussi de ces tensions internes que peuvent émerger des forces capables de changer radicalement n’importe quelle société, y compris les États-Unis. Nous voyons souvent des camarades indépendantistes mettre en ligne des images qui illustrent les actions de la droite ou la désintégration sociale aux États-Unis, mais il est tout aussi important pour nous de reconnaître et de souligner qu’il existe des forces actives qui résistent à cette droite et à cette désintégration sociale.
Bien sûr, ce que nous disons des États-Unis, nous le disons aussi de Porto Rico : Porto Rico est également une société en crise, une société divisée en classes, une société avec de graves tensions internes. D’un côté de cette division, la droite patronale domine et est bien organisée et financée. De l’autre côté, la classe ouvrière et les autres secteurs exploités et opprimés sont fragmentés ; pour la plupart, ils ne sont pas organisés, bien qu’il existe des mouvements minoritaires qui résistent avec persévérance et héroïsme. L’indépendance à laquelle nous aspirons doit s’appuyer sur l’organisation et la mobilisation croissantes de ce peuple travailleur et dépossédé, sinon elle deviendra un moyen pour les détenteurs actuels du pouvoir colonial de continuer à gouverner. Cette indépendance par et pour le peuple travailleur a besoin d’alliés internationaux, ce qui englobe les forces qui partagent les mêmes préoccupations aux États-Unis et qui luttent pour le changement social dans ce pays où, comme nous l’avons déjà indiqué, résident et doivent lutter plus de quatre millions de Portoricains.
Certains diront que les luttes et la résistance aux États-Unis sont faibles et dispersées. Discuter de l’état de ces luttes dépasserait le cadre de cet article. Il suffit de dire que ces luttes ne sont pas plus faibles ni plus dispersées que celles qui existent actuellement à Porto Rico. Si nous comptons sur le fait que les nôtres se renforceront, grandiront et progresseront, il n’y a aucune raison de ne pas reconnaître le même potentiel aux luttes qui se déroulent aujourd’hui aux États-Unis. Nous faisons référence au présent et à l’avenir, mais il est bon de rappeler que les États-Unis ont une longue tradition de militantisme et de luttes ouvrières, antiracistes et anti-impérialistes, entre autres. Dans un autre article, nous avons rappelé cela aux partisans de l’État libre associé, mais cette remarque vaut également pour les indépendantistes.
Ce qui manque dans les trois positions que nous avons présentées ci-dessus (et leurs variantes), et ce que nous proposons comme alternative, c’est une analyse de classe, tant aux États-Unis qu’à Porto Rico, tant de la lutte pour l’indépendance que des conflits et de la réalité politique et sociale aux États-Unis. Il n’est pas inutile de rappeler la célèbre affirmation de Marx et Engels à la veille des révolutions de 1848 : « L’histoire de l’humanité est l’histoire de la lutte des classes ». Cela est vrai à Porto Rico et également aux États-Unis. Le grand militant indépendantiste et socialiste de la communauté portoricaine de New York, Jesús Colón, l’a résumé en 1943 : « Il y a deux États-Unis comme il y a deux Porto Rico. » Il y avait, selon Colón, des exploiteurs et des accapareurs dans les deux pays. Le peuple portoricain devait donc « faire cause commune avec le PEUPLE des États-Unis » tout en luttant pour l’indépendance. C’était de cela dont avaient besoin tant la diaspora à laquelle Colón appartenait que la lutte pour l’indépendance à laquelle il était engagé. Et c’est ce dont les luttes de la diaspora et la lutte pour l’indépendance ont encore besoin aujourd’hui : une analyse de classe et une perspective internationaliste.
Si Colón abordait le lien entre les luttes à Porto Rico et aux États-Unis d’un point de vue socialiste, d’autres indépendantistes l’avaient déjà abordé d’un point de vue anti-impérialiste et démocratique. Hostos, par exemple, dénonçait en 1899 l’émergence des « coalitions de capitaux » et des trusts (monopoles et associations de grandes entreprises) qui favorisaient la politique impérialiste des États-Unis et l’occupation de Porto Rico et des Philippines qui, selon lui, menaçaient également la démocratie dans ce pays, démocratie qu’il associait à la domination de la petite propriété et à ce qu’il appelait les intérêts du « travail », de la « production » et de la « consommation ».
Pour lui, la lutte contre le colonialisme à Porto Rico s’inscrivait dans un combat international pour la démocratie, qui incluait également la résistance à la consolidation de « la machine des usurpateurs de la richesse et du pouvoir » aux États-Unis. Les Antilles ne pouvaient ignorer les conflits dans ce pays, car leur issue déterminerait en grande partie les conditions dans lesquelles elles devraient lutter pour leur autodétermination.
Il serait facile de citer d’autres exemples. Nous nous limiterons à rappeler le soutien apporté par Gilberto Concepción au député de gauche Vito Marcantonio, la figure politique la plus importante de son époque aux États-Unis qui s’était engagée en faveur de l’indépendance de Porto Rico. Concepción a collaboré étroitement avec Marcantonio entre 1937 et 1944, lorsque celui-ci résidait à New York, et en 1949, il s’est rendu dans cette ville pour soutenir sa candidature à la mairie : de toute évidence, Concepción, loin d’être indifférent, prenait parti dans cette campagne et comprenait l’importance de ce qui se passait aux États-Unis pour la lutte pour l’indépendance. Au-delà de Porto Rico, il convient de souligner, même brièvement, que de nombreuses luttes anticoloniales ont impliqué une interaction avec les forces progressistes des métropoles, comme ce fut le cas en Algérie, au Vietnam et dans les colonies portugaises en Afrique, entre autres.
Comparons cette attitude à d’autres que nous pouvons observer aujourd’hui. Comme on le sait, aux États-Unis, le principe de la citoyenneté acquise par la naissance s’applique : toute personne née aux États-Unis est citoyenne américaine. Cette disposition est incluse dans l’un des amendements à la Constitution adoptés à la suite de la guerre civile et de l’abolition de l’esclavage (le XIVe amendement). Il s’agit d’une grande avancée démocratique qui revêt aujourd’hui une importance particulière pour la communauté immigrée, en particulier pour les plus vulnérables qui se trouvent aux États-Unis sans les documents requis. C’est pourquoi Trump entend supprimer le principe de la citoyenneté par naissance et a déjà approuvé un décret dans ce sens.
La Cour suprême fédérale devra déterminer si elle donne raison à Trump ou si elle lui fait obstacle. Évidemment, les forces démocratiques et progressistes défendent l’idée de la citoyenneté par naissance que Trump entend supprimer. Comme certains le soulignent, l’enjeu ne se limite pas à cette disposition : si Trump peut abroger une disposition aussi claire que celle qui figure dans le quatorzième amendement, alors il peut abroger n’importe quelle autre disposition. Dans ce contexte, notre camarade Javier A. Hernández écrit toutefois que « la fin de la citoyenneté par naissance pourrait être une opportunité pour l’indépendance de Porto Rico ». En d’autres termes, on se réjouit de la menace qui pèse sur un droit démocratique aux États-Unis, car cette mesure rétrograde faciliterait, supposément, l’indépendance de Porto Rico. L’indépendance serait liée non pas à l’avancée des forces démocratiques aux États-Unis, mais à leur défaite face au programme réactionnaire de Trump.
Malheureusement, ce n’est pas le seul exemple que nous pouvons donner. Le camarade Hernández a également cherché à lier la question de l’indépendance au programme de licenciements massifs mené par Elon Musk au début de l’administration Trump. En d’autres termes, les attaques contre la classe ouvrière aux États-Unis (qui toucheront également bon nombre de Portoricains) sont également considérées comme une occasion de promouvoir l’indépendance. Comme nous l’avons indiqué, cela ne peut être la position ni des quatre millions de Portoricains qui résident aux États-Unis, ni de celles et ceux qui aspirent à une indépendance socialement émancipatrice. Le bien-être des premiers et une voie plus large pour les seconds exigent une avancée, non pas du trumpisme, mais de ses opposants. Précisons que lorsque nous parlons de luttes et de résistances anti-MAGA, nous ne faisons pas référence au Parti démocrate, mais à l’éventail de mouvements et d’initiatives qui existent indépendamment de lui (même si certains sont liés à cette organisation de différentes manières selon les cas).
Ces derniers jours, certains aspects du sujet dont nous discutons ont été soulevés autour de la place importante qu’a prise Bad Bunny [Benito Ocasio, célèbre rappeur portoricain ndt] dans le débat politique et culturel aux États-Unis. Prenons un exemple au hasard, vu sur un compte X : « Les Américains [sont] offensés parce que Benito ne s’est pas levé quand ils ont joué « God Bless America ». Ils sont tellement stupides qu’ils disent que Benito ne s’est pas levé quand ils ont joué l’hymne. Ils ne savent pas que ce n’est pas l’hymne des États-Unis. » On pourrait avoir l’impression que c’est la position générale des « Américains ». Mais si l’on regarde les timelines des comptes X ou Facebook, on constate que les expressions des « Américains offensés » ont reçu des centaines de réponses d’autres Américains indiquant précisément que cette chanson n’est pas l’hymne national des États-Unis et que personne n’est obligé de se lever. Certains vont même jusqu’à dire que, même s’il s’agissait de l’hymne national, personne n’est obligé de se lever.
Il existe donc aux États-Unis deux camps dans ce débat, comme dans d’autres. C’est pourquoi nous ne pouvons pas affirmer que les « Américains » pensent ceci ou cela, car parmi les « Américains », il existe des courants, des tendances et des mouvements qui pensent des choses très différentes, voire opposées. Certains indépendantistes refusent de reconnaître ce fait, peut-être parce qu’ils pensent ou estiment que cela affaiblit l’argumentation en faveur de l’indépendance. Et c’est là un autre point fondamental : notre défense de l’indépendance ne repose pas, ou ne doit pas reposer, sur la tentative de démontrer que les Américains « ne nous aiment pas » ou qu’ils sont invariablement racistes, brutaux, etc., mais sur le fait que ce qui convient le mieux au peuple portoricain, c’est de s’organiser démocratiquement en tant que république souveraine en collaboration avec les autres peuples du monde. Et cette collaboration englobe les secteurs apparentés aux États-Unis, dont nous devons reconnaître l’existence.
À propos de cette collaboration, le débat entre le courant MAGA et les milieux libéraux aux États-Unis sur la prestation de Bad Bunny au Super Bowl a soulevé un autre problème. Dans leurs attaques méprisantes envers les Portoricains (et les autres Latinos), les MAGA et la droite insistent sur le fait que les Portoricains ne sont pas américains. De leur côté, de nombreux Libéraux, indignés par le racisme et la xénophobie des MAGA, répondent en notre défense en expliquant que les Portoricains sont américains. C’est une situation paradoxale : les partisans de MAGA, avec leur haine à notre égard, affirment notre identité. De nombreux libéraux et progressistes se solidarisent avec nous contre cette haine, mais ils le font d’une manière qui nie notre identité. Certains concluent que favoriser le statut d’État est la meilleure façon de répondre à la discrimination et à l’injustice dont sont victimes les Portoricains.
Comment faire face à cette situation ? En suivant la logique des positions résumées au début de cet article : bon nombre d’indépendantistes en concluent que les partisans de MAGA et les libéraux ou progressistes gringos sont identiques ; ils dénoncent les seconds de la même manière que les premiers et en concluent qu’il s’agit là d’une nouvelle démonstration de la nécessité de nous séparer d’un pays qui ne sera jamais capable de nous comprendre et qui est uniformément réactionnaire. Dans le passé, nous sommes intervenus dans ce débat aux États-Unis, mais dans une perspective différente. Il n’est pas logique de traiter de la même manière des ennemis et des alliés potentiels. Personne ne peut douter de la nature raciste des milieux MAGA. Nous ne pouvons pas non plus ignorer que la réponse anti-MAGA de beaucoup est erronée lorsqu’elle affirme que les Portoricains sont « américains ».
Mais il est également incorrect d’ignorer que ces derniers réagissent et s’opposent aux premiers. Ils expriment leur solidarité avec les Portoricains de manière erronée, mais c’est de la solidarité, qu’ils tentent d’exprimer, et non de la haine ou du rejet comme les MAGA, Notre réponse doit donc être la suivante : bien sûr, nous sommes avec vous contre le racisme MAGA et pour la défense de la diversité culturelle aux États-Unis, mais nous vous rappelons que nous ne sommes pas Américains, mais Portoricains, et qu’il est nécessaire que vous assumiez la décolonisation de Porto Rico dans le cadre de la lutte anti-MAGA. C’est ainsi que vous pouvez être solidaires et répondre aux MAGA sans effacer notre identité.
L’une de nos tâches consiste donc à aider les différentes forces et mouvements progressistes aux États-Unis à comprendre notre situation particulière et à inclure la décolonisation de Porto Rico dans leur agenda, leur programme ou leurs revendications. Et pas seulement la décolonisation en général, mais aussi des propositions concrètes telles que l’abrogation de la loi PROMESA et la suppression de la Junta [mise sous tutelle financière par les €tats-Unis ndt], l’annulation des dettes publiques insoutenables, la contribution substantielle du gouvernement américain à la reconstruction économique et sociale de Porto Rico, la mise en place d’un processus de décolonisation contraignant, profond et juste.
Qu’il n’y ait pas de malentendu : rien de tout cela n’implique de reporter ou de subordonner nos initiatives à la progression de ces revendications aux États-Unis. Nous devons prendre toutes les mesures possibles pour progresser vers l’indépendance. Mais ces mesures doivent s’accompagner de la recherche de la connexion et de la collaboration que nous avons soulignées.
En fin de compte, la lutte pour une indépendance libératrice et émancipatrice ne peut être séparée des luttes de la majorité des travailleurs et des démunis, et ces luttes à Porto Rico ne peuvent être séparées de la même lutte dans d’autres pays, y compris aux États-Unis.
Publié le 16 octobre par la revue Momento Critico, traduit par Pierre Vandevoorde