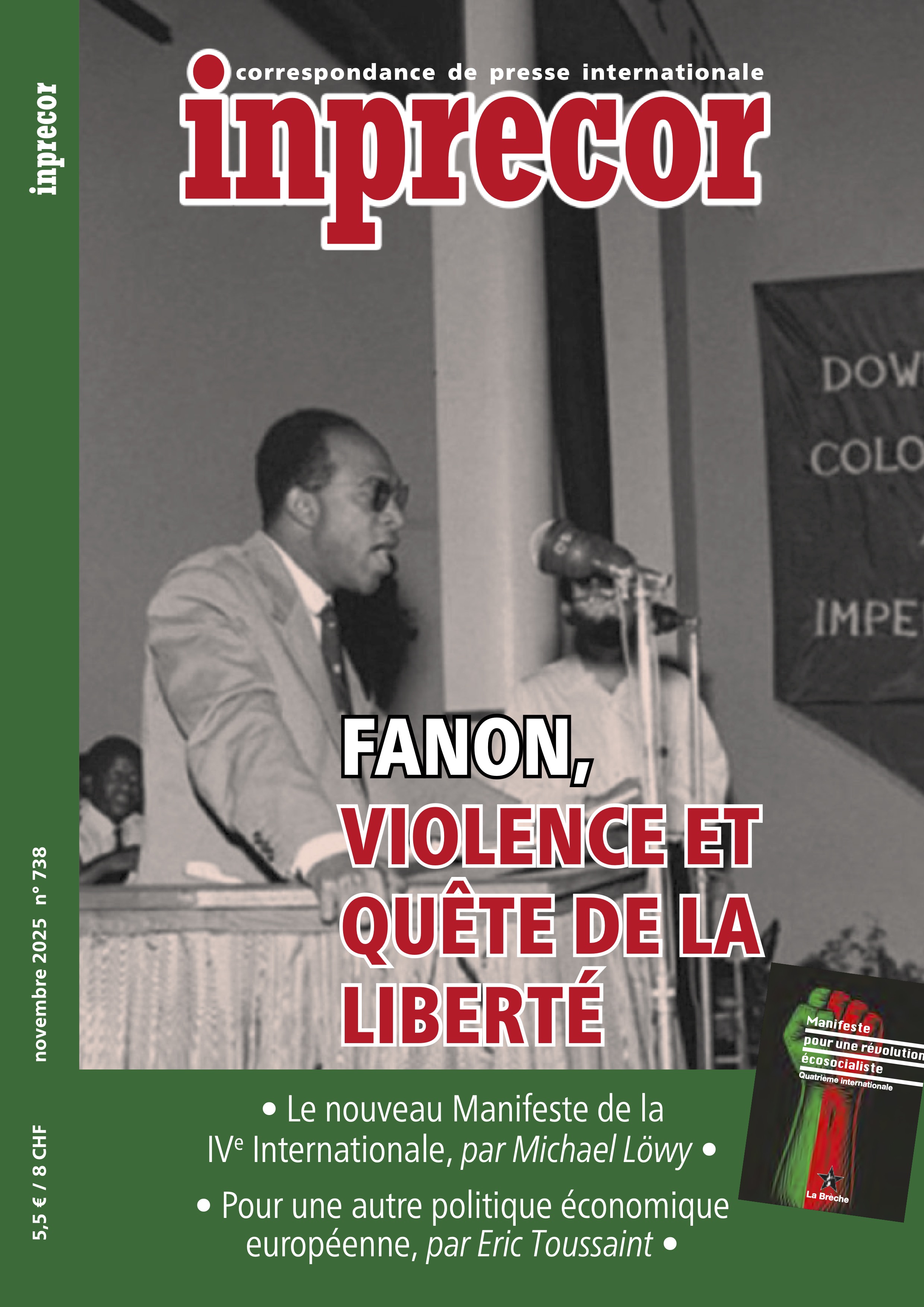Les violents affrontements entre milices survenues en mai 2025 dans le quartier résidentiel de Tripoli soulignent l’instabilité chronique de la Libye. Le pays reste divisé avec deux gouvernements et le pouvoir de ces groupes armés règne, sur fond de corruption généralisée. Cependant, les récents évènements pourraient bouleverser ce statu quo.
Depuis 2014, la Libye connait deux autorités concurrentes. Une première, installée dans la capitale Tripoli, qui voit son appellation changer au cours des années, est actuellement intitulée Gouvernement d’Union nationale (GUN). Elle a à sa tête le Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah et un Haut Conseil d’État, une sorte de parlement reconnu au plan international et qui gouverne la partie ouest du pays. La seconde est dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, qui est à la tête d’une Armée nationale libyenne (ANL) autoproclamée, qui soutient un gouvernement de stabilité nationale et un parlement appelé chambre des représentants. Le pouvoir d’Haftar s’étend sur la partie est et une grande proportion du sud du pays. Si les deux autorités assoient leur pouvoir sur les milices, elle se différencient par le degré d’unification et de contrôle de ces dernières, bien plus important du côté d’Haftar.
Ces cohortes armées sont apparues du fait même de la spécificité de la révolution libyenne, découlant de l’organisation du pouvoir, dans laquelle les tribus restent des acteurs majeurs de la vie sociale et politique du pays. À cela s’est ajoutée la facilité d’obtenir des armes après la chute de Kadhafi. Ainsi, progressivement, une économie politique singulière s’est installée, fondée sur la captation des ressources du pays, l’infiltration des structures étatiques et la construction d’un équilibre des pouvoirs qui reste précaire entre les milices, particulièrement à l’ouest du pays.
Des milices de Tripoli…
À Tripoli, la puissance de ces formations vient en partie de leur capacité à accompagner et soutenir militairement le Gouvernement d’Accord national (qui deviendra, après moult péripéties, le GUN) issu des accords de Skhira 1 et censé préparer les élections. Les milices n’apparaissent plus comme des groupes armés, qui sont prohibés par les accords, mais se définissent comme des forces de police adoubées par le ministère de l’Intérieur.
Fort de cette légitimité reconnue sur le plan international, ces unités vont expulser militairement de Tripoli les groupes armés de Misrata2. Une fois le terrain conquis, elles vont promouvoir leurs activités policières contre la criminalité et les différents trafics, même si elles vont s’adonner elles aussi à ces activités illégales. Leur capacité à apparaître comme le garant d’un pôle de stabilité et de sécurité essentiel dans la lutte contre le terrorisme et l’immigration illégale vont satisfaire aussi bien les Nations unies que les pays occidentaux. Six milices ont joué un rôle prépondérant à Tripoli.
• La Brigade des révolutionnaires de Tripoli (BRT) dirigée par Haytham Al-Tajouri et Hachim Bishr, basée dans le quartier de Souq Al-Juma’a, est responsable de disparitions et de tortures dans des centres de détention informels. Ces dirigeants sont impliqués dans des détournements de fonds parfois avec violence pour obtenir des lettres de crédit.
• La Brigade Nawasi, dirigée par la famille Qaddur (Kaddour) est également basée à Souq Al-Juma’a. Elle s’est dotée d’un service de renseignement. Ses membres sont responsables de la répression contre une manifestation qui s’est déroulée en 2020.
• Les forces d’Abdelghani Al-Kikli dit « Ghneiwa », appelées Forces de sécurité centrales puis Autorité de Soutien à la Stabilité (SSA), sont basées dans le quartier d’Abou Salim. Elles ont été décisives pour repousser les attaques des troupes d’Haftar contre Tripoli en 2020 mais ont été perdantes lors des affrontements du 13 mai dernier.
• Les Forces spéciales de dissuasion, communément appelées Force Radaa, dirigées par Abdel Raouf Kara, basées à l’aéroport de Mitiga, sont largement influencées par les combattants se réclamant du courant madkhaliste3. Elles sont spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et contre les atteintes à l’islam. Ces combattants ont fermé la deuxième édition de Comic-Con Libya, un festival de bandes dessinées qu’elles accusent de satanisme, et se sont attaquées aux concerts pop, considérés comme des lieux de dépravation morale. La force Radaa est responsable d’un centre de détention situé dans l’aéroport de Mitiga où les meurtres et les tortures sont courants. Elle est désormais en opposition au le gouvernement de Tripoli.
À cela s’ajoutent la brigade 301, qui rassemble des combattants de l’ouest du pays et dont les dirigeants sont issus de Misrata, et le Bataillon 444, qui va jouer un rôle décisif dans les derniers affrontements et qui dépend du ministère de la Défense.
Le pouvoir d’Abdel Hamid Dbeibah dépend largement de ces groupes d’autant que son élection est controversée. Sa désignation en février 2021 comme Premier ministre par le Forum de dialogue politique libyen a été obtenue grâce aux distributions de commissions occultes. Les experts de l’ONU ont réuni les preuves qu’au moins trois membres ont reçu des enveloppes de 200 000 dollars en échange de leur vote.
… à l’ANL de Benghazi
À la différence de Tripoli, l’Armée nationale libyenne (ANL) relève d’un commandement unique. Au départ, l’ANL s’est formée à partir d’un conglomérat d’anciens militaires kadhafistes, et de civils rejoints par des troupes locales, des combattants étrangers comme des Soudanais et des Tchadiens ainsi que des miliciens madkhalistes. C’est lors de la bataille de Benghazi en 2016 contre les islamistes que Haftar a pu faire émerger son armée grâce à l’important soutien des Émirats arabes unis (EAU). Le maréchal Haftar a tenu le discours qui correspondait à la vision politique que les EAU souhaitent pour la région. Un projet ordonné autour de la stabilité, d’un pouvoir autoritaire menant la lutte contre l’islamisme politique.
Cette armée a pu se déployer progressivement dans le sud du pays et prendre le contrôle du croissant pétrolier où se situent les principales unités d’extraction de l’or noir.
À chaque fois, les différentes batailles de l’ANL sont menées au nom de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, cela lui permettant de recueillir un large soutien à l’international. L’Égypte offre son appui technique, la Russie a déployé les mercenaires de Wagner, les EAU financent et la France, plus discrètement, est intervenue avec ses forces spéciales.
D’autres milices existent à travers le pays. À l’extrême sud, elles présentent un caractère de défense communautaire notamment pour les Toubou et les Berbères. Il faut mentionner aussi les milices de la ville portuaire de Misrata qui jouent un rôle non négligeable à travers leurs alliances versatiles.
Des plans de paix récurrents et inefficaces
Le point commun entre les groupes armés, les différents gouvernements et autres institutions, qu’ils soient de Tripoli ou de Benghazi, est leur volonté de faire échec à toutes solutions politiques qui sortiraient le pays du chaos, ce qui serait synonyme d’une menace pour leurs intérêts économiques. Abdoulaye Bathily, ancien émissaire de l’ONU, le résume parfaitement lorsqu’il déclare : « La plupart des leaders libyens ne veulent pas d’élections ».
Une situation qui a usé plus de neuf envoyé·es spéciaux des Nations unies qui ont tous tenté, en vain, la mise en place d’une autorité commune visant l’organisation d’élections. L’actuelle émissaire, la dixième donc, est l’ancienne ministre des Affaires étrangères du Ghana, Hanna Serwaa Tetteh. Elle vient de présenter sa feuille de route, qui ne se différencie guère des autres. L’objectif étant la mise en place d’élections législatives et présidentielle organisées par un gouvernement unifié dans un délai de 12 à 18 mois. Il n’y a aucune raison objective pour que ce plan rencontre un quelconque succès.
Pourtant, il existe un désir partagé par une majorité de Libyen·nes de bénéficier d’une gouvernance démocratique, comme en témoignent les élections municipales qui se sont déroulées dans la partie ouest du pays et qui ont vu une participation électorale de 74 %. Dans la zone est, contrôlée par le maréchal Haftar, les élections ont été annulées et certains bureaux de vote dans la partie ouest ont été incendiés par des groupes armés, révélateur d’une volonté de maintenir le statu quo et par là même le bâillon sur les populations.
Une économie politique singulière
Si la Libye est divisée, certaines structures restent unitaires, tout en faisant l’objet de rivalités parfois violentes. Parmi elles la National Oil Company (NOC). Elle est la seule structure habilitée à vendre le pétrole libyen à l’étranger. Les recettes sont versées à la Central Bank of Libya (CBL). Cette dernière contribue au budget des deux entités Tripoli et Benghazi, comprenant notamment les salaires des combattants des milices affiliées – du moins formellement – aux structures gouvernementales.
Les différentes malversations qui financent les milices passent en premier lieu par le détournement de l’essence raffinée. Cette dernière est très fortement subventionnée mais la plupart des livraisons n’atteignent jamais les stations-services du pays car elles sont revendues à l’étranger, engrangeant ainsi de forts profits pour les auteurs de cette contrebande. Un autre système est celui des fraudes aux lettres de crédit. La CBL octroie des devises, soit en dollars soit en euros, sur la base du taux de change officiel pour favoriser les importations de marchandises. Que ce soit du côté de Tripoli ou de Benghazi, les dirigeants des milices bénéficient de ces devises sans rien importer et les échangent au marché noir, triplant voire quadruplant leur valeur en dinars. Ces pratiques illégales de grande envergure ne peuvent s’effectuer qu’avec la complicité des autorités.
À ces différents trafics s’ajoute celui des êtres humains, qui utilise les fonds européens destinés à la lutte contre l’immigration clandestine.
Si toutes les factions et les dirigeants politiques peuvent trouver leur compte dans cette corruption généralisée, cela n’annihile pas pour autant les compétitions entre elles avec cette volonté de part et d’autre d’accroitre voire de contrôler la totalité du pouvoir en Libye. Ainsi Haftar a tenté de s’emparer de Tripoli en 2019 avec une guerre qui a duré près d’une année. Dbeibah s’est attaqué au gouverneur de la Banque centrale, lui reprochant ses critiques sur sa politique dispendieuse et surtout d’être trop proche des autorités de Benghazi en finançant la reconstruction de l’est du pays fortement touché par le cyclone Daniel, notamment à Derna, avec les effondrements des barrages. Ibrahim Dbeibah, le neveu du Premier ministre, avec l’aide des milices, a tenté de remplacer Sadiq Al Kabir, le gouverneur de la CBL, par un homme dévoué à leur clan. Al Kabir s’est enfui, dénonçant notamment les enlèvements de cadres de la banque comme moyen de pression pour détourner de l’argent. Le remplaçant à la solde de Dbeibah s’est retrouvé rapidement impuissant, puisque les grandes banques internationales ont bloqué toutes les transactions, et Haftar a coupé les exportations de pétrole. C’est sous l’égide de l’ONU que Naji Issa Belqasem, directeur du contrôle monétaire et figure consensuelle, a pu être nommé à la tête de la CBL.
Volonté d’affermir ses positions
À Benghazi, le maréchal Haftar conforte le pouvoir de son clan familial en nommant ses fils à des postes stratégiques ou lucratifs. Al-Muntasir Haftar dirige des sociétés immobilières en Virginie aux USA, dont les actifs sont évalués à huit millions de dollars. Belgacem Haftar est à la tête du Fonds de développement et de reconstruction pour l’est de la Libye, avec un budget de 10 milliards de dinars libyens. Saddam Haftar est nommé vice-commandant de l’ALN et fait figure de successeur de son père. Khaled Haftar est le chef d’état-major des forces de l’est. Les principaux dirigeants de l’ALN sont aussi des hommes d’affaires reproduisant le système économique que l’on peut trouver en Égypte ou au Soudan, où les officiers supérieurs ont accaparé les principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles du pays.
Pour Tripoli, on a affaire à un partage entre les élites issues des milices, des ministères ou du parlement créant une sorte d’équilibre par l’établissement d’alliances précaires. Une milice qui risque de prendre le dessus engendrera contre elle une alliance des autres. En septembre 2021 la milice de l’Autorité de soutien à la stabilité (SSA) de Ghneiwa avait attaqué la caserne de Khalifa El-Tekbali, siège de la brigade 444 placée sous la responsabilité du ministère de la Défense. Deux ans plus tard, c’est le commandant de la brigade 444, le colonel Mahmoud Hamza, qui est enlevé par les forces Radaa ; occasionnant la mort d’une cinquantaine de personnes lors des affrontements entre les deux structures. Sa libération a été le fruit de pourparlers entre les deux groupes sous l’égide des autorités de Tripoli.
Les affrontements du 13 mai
La dernière confrontation importante a eu lieu le 13 mai dernier, quelques semaines avant la fête de l’Aïd. Ghneiwa, le dirigeant de la SSA, a été assassiné au quartier général de la brigade 444, qui s’est attaquée aussitôt à la SSA, provoquant son démantèlement.
Ghneiwa, un ancien criminel, avait au fil du temps pris du poids dans l’appareil sécuritaire de Tripoli et avait réussi à infiltrer l’appareil d’État, la Banque centrale et les principales entreprises publiques. L’alliance nouée entre Dbeibah et Ghneiwa s’est détériorée. Le patron de la SSA, d’allié est devenu un concurrent sérieux du Premier ministre, au moins au niveau économique. L’objet du litige était le contrôle de la compagnie nationale des télécoms, dotée d’un trésor de guerre de plusieurs milliards de dinars.
Fort du succès de l’opération contre la SSA, Dbeibah a voulu l’étendre contre Radaa, au motif de la lutte contre les milices qui, dans les faits, se traduit par la lutte contre une des milices. Mais Radaa a résisté avec l’aide de plusieurs autres milices de Misrata venues en renfort. Après une journée de combats, un cessez-le-feu a été décrété, suivi d’un accord entre les protagonistes, sous la supervision du responsable des services secrets turcs. Radaa était dans le collimateur de Dbeibah car cette force s’est opposée de plus en plus fréquemment au Premier ministre, et a soutenu le gouverneur de la Banque centrale.
De nouveau, un calme précaire s’est installé sur Tripoli. Il est certain que Dbeibah est sorti affaibli de cette confrontation. La nomination de Hassan Bouzriba à la tête des restes de la SSA par Mohammed el-Menfi, le chef du Conseil présidentiel libyen, même si cette structure a peu de pouvoir, révèle les oppositions. En effet, Hassan Bouzriba, l’ancien bras droit de Ghneiwa, est issu d’une grande famille et est un opposant déclaré à Dbeibah. Il entretient de bonnes relations avec le maréchal Haftar et a la capacité de reconstruire la SSA. De plus, une alliance s’est formée entre les milices de Misrata et Radaa. Enfin le Premier ministre est complètement discrédité aux yeux des populations qui voient en lui le premier responsable des violents affrontements qui ont eu lieu à l’arme lourde au milieu d’un quartier résidentiel, alors qu’il avait promis de ramener la paix et l’ordre.
Désormais les principales chancelleries doutent de la capacité de Dbeibah à jouer son rôle de dirigeant de Tripoli et de garant de l’équilibre entre les différentes forces présentes dans la capitale.
Une recomposition possible
Si la Turquie est le principal soutien du GUN de Tripoli, cette configuration est en train de changer. En effet, cette politique de soutien est avant tout motivée par ses propres intérêts économiques et géopolitiques. Ainsi, Recep Erdoğan a conditionné son soutien militaire au GUN – qui s’est avéré décisif lors de l’attaque des troupes d’Haftar contre la capitale – à la signature d’un accord économique très favorable à Ankara pour l’exploitation du pétrole en Méditerranée.
L’affaiblissement du Premier ministre sur la scène libyenne pousse les autorités turques à diversifier leurs alliances, notamment avec le clan Haftar. Sadam Haftar s’est ainsi rendu à Istanbul, où il a rencontré le ministre turc de la Défense, Yaşar Güler, et le chef d’état-major Selçuk Oğuz. Après cette visite inédite, une autre rencontre a eu lieu, cette fois entre le maréchal Haftar et le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan – un poids lourd du gouvernement Erdogan – et Ibrahim Kalin, chef du Service national du renseignement turc (MIT). Des entrevues qui se déroulent dans le cadre d’une offensive diplomatique d’Haftar en direction des USA mais aussi de la France et de l’Italie, qui reste un soutien de Tripoli.
Un autre facteur souvent sous-estimé est la force de plus en plus importante du courant islamiste madkhaliste. Comme nous l’avons vu, ce courant est présent, avec une influence certaine, dans les forces de l’ALN d’Haftar et contrôle la milice de Tripoli Radaa. Les madkhalistes sont aussi présents dans d’autres milices à travers le pays et sont aussi capables de transcender les appartenances tribales.
Les affrontements du 13 mai ont peut-être ouvert une nouvelle séquence autour de l’affaiblissement de Dbeibah. Son camp est miné par les oppositions de certaines milices de Misrata et de Radaa qui peut devenir le cheval de Troie d’Haftar à Tripoli. Le crédit politique du Premier ministre s’est effrité et ses soutiens internationaux n’hésitent plus à nouer des relations avec son principal adversaire, le maréchal Haftar. Ce dernier arrive à engranger des succès en élargissant son pouvoir au sud, en contrôlant les principaux puits de pétrole et en gardant des bons contacts avec une partie des dirigeants des principales institutions publiques du pays qui siègent à Tripoli.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la nouvelle feuille de route de l’ONU qui vise à réunifier les deux autorités politiques du pays pourrait être une occasion pour Haftar de montrer sa capacité à fournir des gages aux différents acteurs internationaux même si leurs agendas sont opposés. Pour les pays du Golfe, il peut offrir une stabilité politique basée autant sur la répression des mouvements citoyens que sur le courant islamiste quiétiste représenté par des madkhalistes. Il peut garantir à la Russie la pérennité de leur emprise dans le sud du pays pour organiser les flux logistiques de leurs mercenaires en Afrique et offrir aux pays européens un contrôle strict de l’immigration. Le tout couronné par une augmentation des exportations de pétrole. Certes Haftar est loin d’avoir un soutien unanime, surtout de la part des dirigeants des milices qui, dans cette configuration, risquent d’être dépossédés de leur pouvoir et de leur manne financière. Mais en l’absence d’un soutien de l’étranger, le rapport de force diplomatique et militaire joue en la défaveur des milices, surtout si les puissances occidentales agitent la menace de sanctions économiques et de gel des avoirs aux motifs d’une obstruction à l’unité du pays.
Les grands perdants resteraient les populations. Après avoir subi la dictature de Kadhafi, puis celle des différentes milices, elles seraient de nouveau en butte à un népotisme autoritaire comme le montrent les violations systématiques des droits humains dont sont victimes les opposant·es dans les territoires que les Haftar contrôlent.
Pour les pouvoirs réactionnaires de la région, cette recomposition en Libye, tout comme la guerre au Soudan, participerait à tourner la page du Printemps arabe. Mais c’est sans compter sur les désirs de changement de la jeunesse, que l’on voit un peu partout à travers le monde, et qui pourrait écrire un nouveau chapitre.
Le 4 octobre 2025
- 1
Ces accords ont été signés le 17 décembre 2015 entre les représentants du Congrès général national et ceux de la Chambre des représentants dans la ville marocaine de Skhirat. Ils prévoient la formation d’un gouvernement annoncé le 19 janvier 2016 et composé de trente-deux membres. Il est dirigé par Fayez el-Sarraj, également président du Conseil présidentiel. L’accord prévoit également la mise en place d’un Conseil présidentiel et d’un Haut Conseil d’État.
- 2
2) Misrata est une ville de Libye, située à 200 km à l’est de Tripoli, la capitale.
- 3
3) Cette tendance se réclame d’un érudit musulman saoudien Rabi al-Madkhali (1933-2025), un ultraconservateur très rigoriste dans les préceptes religieux. Il se prononce notamment contre la démocratie et pour l’établissement d’une gouvernance basée sur la Sharia mais est fermement opposé à l’islam politique. Il enjoint les fidèles à se soumettre au pouvoir politique en place et interdit toute forme de rébellion.