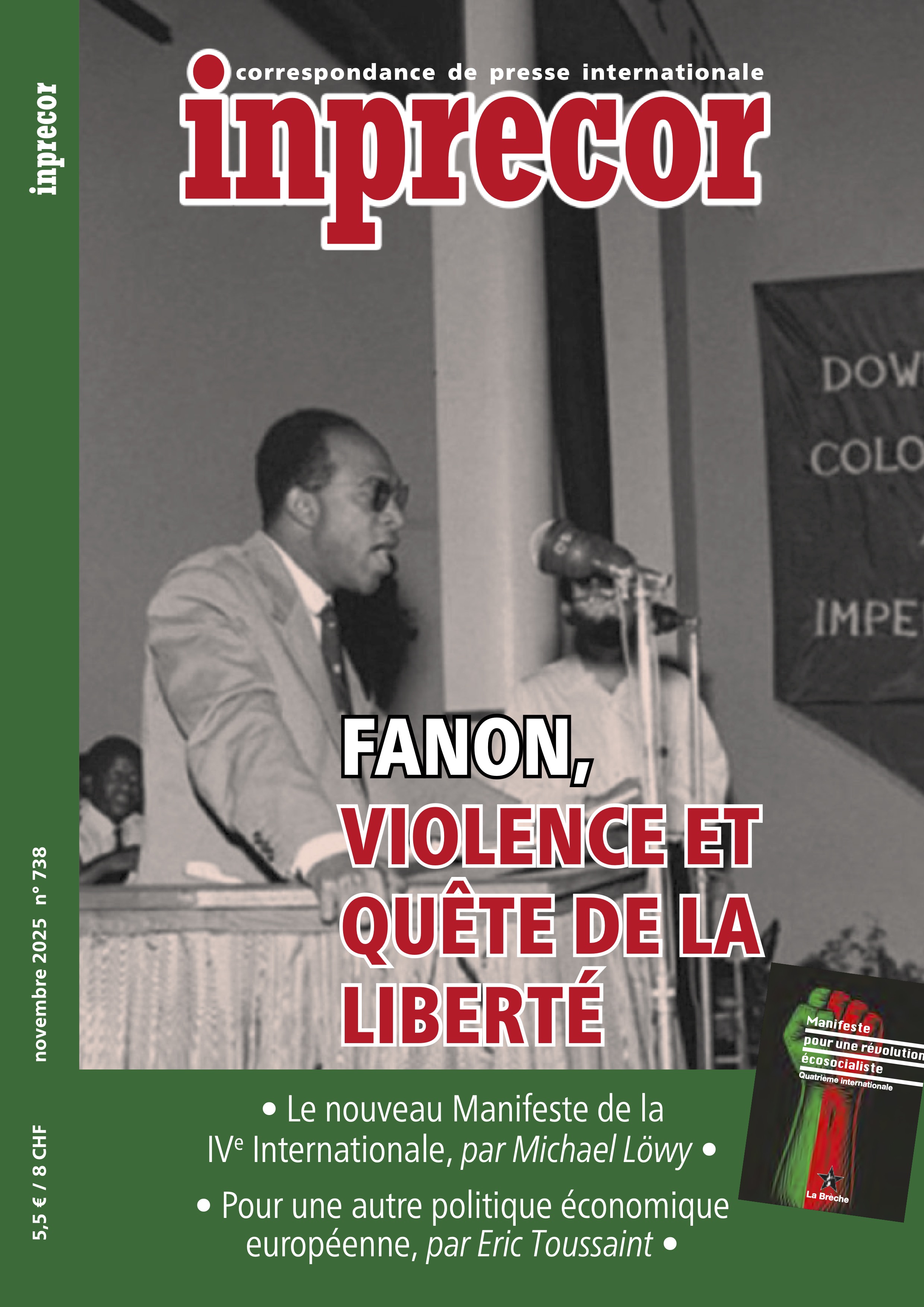La chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024 et la levée des sanctions américaines qui s’en est suivie ont suscité des espoirs pour l’avenir de la Syrie. Cependant, plus de dix mois après, le caractère antidémocratique, néolibéral et pro-impérialiste du régime est de plus en plus visible.
Le pays fait face à une fragmentation territoriale et politique, des influences et occupations étrangères et des tensions confessionnelles. Celles-ci se sont traduites notamment par les massacres de mars contre les populations alaouites des zones côtières, qui ont fait plus de 1 000 morts, après les attaques contre les populations druzes d’avril, mai et juillet, et après un attentat-suicide dans une église de Damas commis en juin.
Une instabilité persistante
À la mi-juillet, les événements dramatiques dans la province de Soueïda n’ont fait qu’aggraver la situation : des violations massives des droits humains ont été commises, notamment par des groupes armés affiliés et soutenant les autorités centrales de Damas. Plus récemment, début octobre, des affrontements ont éclaté à Alep entre deux quartiers à majorité kurde (Cheikh Maqsoud et Achrafieh) et les zones tenues par les forces gouvernementales. Un cessez-le-feu local y a mis fin le lendemain à l’aube. Depuis la chute du régime Assad, des affrontements réguliers opposent les Forces démocratiques syriennes (FDS) – dominées par le groupe armé kurde des YPG – et le nouveau régime dirigé par Hayat Tahrir al-Cham (HTC) dans le nord et le nord-est de la Syrie, malgré un accord conclu en mars entre Damas et les autorités du nord-est de la Syrie prévoyant une intégration des institutions civiles et militaires de l’administration autonome kurde dans les institutions nationales. Or, de nombreux points restaient en suspens sur son application réelle.
Tout cela se déroule dans l’absence persistante d’une phase de transition politique inclusive et démocratique. Ces défis ont un impact négatif sur la reprise économique potentielle et le futur processus de reconstruction, pourtant crucial. Sans oublier que plus de la moitié des Syrien·nes restent déplacé·es, à l’intérieur du pays ou à l’étranger. Plus de 90 % des Syrien·nes vivent sous le seuil de pauvreté et 16,7 millions de personnes – c’est-à-dire les trois quarts de la population – ont eu besoin d’aide humanitaire en 2024, selon l’ONU.
Dans ce contexte difficile, la nouvelle élite dirigeante menée par Hayat Tahrir al-Cham est plus intéressée par la consolidation de son pouvoir sur le pays que par la mise en place d’une transition politique favorisant une participation large et inclusive de la société syrienne. Pour ce faire, les autorités dirigeantes menées par HTC ont développé une stratégie basée sur trois facteurs principaux : de nouvelles alliances internationales, la domination des institutions étatiques et de la société civile, et l’instrumentalisation du confessionnalisme.
Cet article vise à analyser comment les politiques de HTC renforcent son contrôle et sa domination sur la population, en totale opposition avec les revendications initiales du soulèvement populaire syrien de mars 2011, se comportant ainsi comme un acteur contre-révolutionnaire. Les actions contre-révolutionnaires des autorités dirigées par HTC démontrent également que dans un processus révolutionnaire, l’« ancien régime » ou les éléments qui y sont liés ne sont pas le seul pôle contre-révolutionnaire menaçant les intérêts des classes populaires.
La Syrie dans une nouvelle alliance internationale
Les nouvelles autorités au pouvoir, dirigées par HTC à Damas, s’enracinent dans une alliance ancrée par les États-Unis, incluant des États régionaux comme la Turquie, le Qatar et l’Arabie saoudite. Si Ankara et Doha ont été les principaux gagnants de la chute du régime d’Assad et entretiennent des relations avec HTC depuis des années, les autorités syriennes ont veillé à diversifier leurs relations avec d’autres pays de la région, et plus particulièrement avec le Royaume d’Arabie saoudite. Riyad est en effet l’acteur clé pour accélérer la reconnaissance et l’acceptation régionales, notamment parmi les autres monarchies du Golfe.
La reconnaissance des nouvelles autorités syriennes par les puissances internationales et régionales a également été symbolisée par la participation du régime de Damas à l’Assemblée générale des Nations unies à New York en septembre 2025. Le président par intérim Ahmed al-Charaa a été le premier dirigeant syrien à participer à une réunion de haut niveau des Nations unies depuis près de 60 ans, et a prononcé un discours devant l’Assemblée générale. La dernière participation à celle-ci d’un président syrien remontait à 1967, avant les 50 ans de règne de la dynastie Assad. En outre, la délégation syrienne a tenu de nombreuses réunions avec les dirigeants de différents pays, notamment une deuxième rencontre entre al-Charaa et le président américain Trump après celle qui avait eu lieu en Arabie saoudite en mai 2025.
Adaptation au marché mondial
Cette politique de légitimation du nouveau pouvoir a permis d’amorcer un processus de levée des sanctions contre la Syrie – ouvrant la voie à la facilitation des échanges financiers et à la réintégration de l’économie syrienne dans le marché financier mondial. Elle essaie ainsi de mettre en place les conditions pour attirer des investissements directs étrangers (IDE) et des entreprises de la diaspora syrienne, autant d’objectifs clés pour les nouvelles autorités. Dans ce contexte, Damas s’efforce d’attirer des entreprises régionales et internationales afin qu’elles investissent dans le pays, notamment pour moderniser ses infrastructures et générer des revenus. Après l’annonce de la levée des sanctions, le gouvernement syrien a multiplié les protocoles d’accord avec des entreprises régionales et internationales.
L’orientation politico-économique des nouvelles autorités au pouvoir semble de plus en plus privilégier un modèle économique commercial, caractérisé par des investissements axés sur le profit à court terme, au détriment des secteurs productifs de l’économie. Cela se reflète largement dans la nature des promesses d’investissement faites à la Syrie. Les autorités de Damas privilégient l’attraction d’investissements dans des secteurs tels que le tourisme, l’immobilier et les services financiers, généralement rentables à court terme, plutôt que de chercher à encourager les Investissements directs étrangers dans des secteurs productifs comme l’industrie manufacturière et l’agriculture.
La « normalisation » des relations avec Israël
Cette voie comprend également une forme de « normalisation » avec Israël, directe ou indirecte. Le président par intérim al-Charaa a répété à plusieurs reprises que son régime ne constituait pas une menace pour Israël et a apparemment également déclaré au président Trump sa volonté d’adhérer aux accords d’Abraham si les conditions le permettent. En référence à cela, il a fait valoir que la Syrie peut « jouer un rôle majeur dans la sécurité régionale ». Al-Charaa a ajouté que la Syrie partage des « ennemis communs » Israël, notamment l’Iran et le Hezbollah. Ainsi, Damas n’a pas condamné les frappes israéliennes massives contre l’Iran, considérant tout affaiblissement de la République islamique (et du Hezbollah au Liban) comme un élément positif. Cette position est non seulement liée au rôle violent de l’Iran dans le soutien à Assad pendant le soulèvement syrien, mais elle reflète également l’orientation politique de la nouvelle élite dirigeante, alignée sur les politiques américaines. Il est indéniable que la chute du régime d’Assad en décembre 2024 a représenté un impact régional majeur dans les rapports de forces géopolitiques au détriment de la République islamique d’Iran et de ses réseaux d’influence.
Alors que les tensions se sont intensifiées entre Damas et Tel-Aviv à la mi-juillet, suite aux massacres commis par des milices armées affiliées ou soutenant les autorités de Damas dans le gouvernorat de Soueïda et aux frappes aériennes israéliennes qui ont suivi contre la Syrie, les discussions et les rencontres entre responsables des deux pays se sont poursuivies. Par ailleurs, des négociations se sont poursuivies entre les deux acteurs, sous la médiation des États-Unis, en vue de conclure un accord sécuritaire visant à stabiliser la frontière. Il doit se traduire notamment par la promesse syrienne d’empêcher que son territoire ne soit utilisé pour des attaques contre Israël et par des mesures de démilitarisation du côté syrien, afin d’éviter une escalade, première étape avant l’établissement de relations plus formelles.
Dominations sur les institutions étatiques et la société
S’appuyant sur la légitimation continue de son pouvoir par les puissances régionales et internationales, les nouvelles autorités de HTC ont pris des mesures pour consolider leur emprise sur les acteurs politiques, économiques et sociaux. HTC domine les postes clés des institutions étatiques, de l’armée et des services de sécurité. De même, des postes clés au sein du gouvernement de transition sont occupés par des personnalités proches d’al-Charaa. Par exemple, Assad al-Chibani et Abou Qasra ont conservé respectivement leurs postes de ministre des Affaires étrangères et de ministre de la Défense, tandis que Anas Khattab a été nommé ministre de l’Intérieur. Par ailleurs, les nouvelles autorités ont mis en place des institutions parallèles pour consolider leur pouvoir, comme le Conseil national de sécurité syrien, dirigé par al-Charaa et composé de ses proches collaborateurs (ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, ministre de l’Intérieur et directeur des renseignements généraux). De manière similaire, le ministère des Affaires étrangères a créé fin mars le Secrétariat général aux affaires politiques, chargé de superviser les activités politiques intérieures, d’élaborer les orientations générales en matière politique et de gérer les actifs du parti Baas dissous.
L’absence de processus démocratique inclusif au sein du nouveau pouvoir s’est également reflétée dans diverses initiatives, conférences et comités censés être participatifs et définir les prochaines étapes du pays. Parmi ces initiatives, la Conférence de dialogue national syrien, tenue le 25 février, a été largement critiquée pour son manque de préparation, de représentativité et de sérieux, compte tenu du temps limité alloué aux sessions. La Constitution intérimaire, signée par le président syrien par intérim, a également été vivement critiquée par divers acteurs politiques et sociaux, tant pour le manque de transparence des critères de sélection du comité de rédaction que pour son contenu. De plus, si la Constitution intérimaire proclame formellement la séparation des pouvoirs, celle-ci est entravée par l’étendue des pouvoirs conférés à la présidence. Le dernier exemple en date est celui des prétendues « élections » de l’Assemblée du peuple d’octobre, qui ont suscité de nombreuses critiques. La méthodologie et le processus adoptés pour sélectionner les membres du futur parlement ont manqué de transparence et d’inclusivité, favorisant ainsi les acteurs proches des nouveaux dirigeants. En outre, le président par intérim Ahmed al-Charaa nomme un tiers des membres du Parlement, tandis que les deux tiers restants sont sélectionnés par des « sous-comités régionaux » eux-mêmes nommés par le Comité supérieur pour l’élection de l’Assemblée du peuple, dont les membres sont choisis par la présidence… Sans oublier que vingt et un sièges sont laissés vacants pour le moment, ceux rattachés aux provinces de Hassaké et Raqqa dans le nord-est à majorité kurde, et de Soueïda dans le Sud à majorité druze, qui échappent encore au contrôle de l’État. En attendant de réunir les « conditions politiques et sécuritaires appropriées », a déclaré le porte-parole de la commission électorale…
De manière plus générale, des réseaux informels composés de « cheikhs administratifs » et d’autres comités secrets au sein des ministères et des institutions de l’État se sont développés afin de gérer les secteurs essentiels, de la sécurité et des finances à la politique étrangère et à l’administration interne, sans aucune restriction ou avec des restrictions minimes de la part de l’appareil étatique. Dans ces circonstances, les canaux officiels des institutions de l’État sont souvent ignorés, et le pouvoir réel est exercé par un petit réseau informel d’individus jouissant d’une autonomie et d’une confidentialité importantes.
Gestion en famille
En dehors des institutions étatiques, les autorités au pouvoir dirigées par HTC ont également tenté d’étendre leur domination sur d’autres acteurs politiques et sociaux. Elles ont par exemple restructuré les chambres de commerce et d’industrie du pays en remplaçant la majorité des membres et en réduisant le nombre de membres du conseil d’administration des principales chambres, notamment celles de Damas, de la campagne de Damas, d’Alep et de Homs. Plusieurs nouveaux membres du conseil d’administration sont connus pour leurs relations étroites avec HTC. En outre, les autorités ont également fait appel à de nouvelles personnalités affiliées pour diriger les syndicats et les associations professionnelles, sans qu’aucune élection n’ait eu lieu pour élire leurs nouveaux dirigeants. Ces pratiques consistant à nommer des membres plutôt qu’à promouvoir des élections internes s’inscrivent dans la continuité directe de l’ancien régime d’Assad.
En outre, le frère du président autoproclamé de la Syrie, Hazem al-Charaa, s’est progressivement imposé comme une figure importante dans les affaires économiques et la gestion des élites commerciales. Il a notamment accompagné Ahmed al-Charaa lors de ses premières visites à l’étranger, en Arabie saoudite et en Turquie. Une récente enquête de Reuters a également révélé que Hazem al-Charaa est chargé de mettre en place un comité dont l’objectif est de remodeler l’économie syrienne par le biais d’acquisitions secrètes d’entreprises appartenant à des hommes d’affaires affiliés à l’ancien régime d’Assad. Selon cette enquête, ce comité a pris le contrôle d’actifs d’une valeur de plus de 1,6 milliard de dollars américains appartenant à des hommes d’affaires et à des entreprises anciennement affiliés à l’ancien régime d’Assad. De plus, la tâche principale de Hazem al-Charaa consiste à gérer les relations avec les hommes d’affaires locaux et à attirer d’autres hommes d’affaires résidant à l’étranger, tout en gérant les investissements et les fonds de développement créés par le président par intérim al-Charaa. Dans le même temps, certaines personnalités proches de l’ancien palais Assad, comme Mohammad Hamcho – allié historique de Maher el-Assad – et Salim Daaboul, propriétaire de plus de 25 entreprises et fils d’un secrétaire de longue date de l’ancien dirigeant Hafez el-Assad, ont réussi à négocier des réconciliations avec les autorités au pouvoir. Cela s’est notamment traduit par la présence des fils de Mohammad Hamcho lors du lancement du Fonds de développement syrien à Damas, le 4 septembre, pour lequel ils ont fait un don d’un million de dollars.
Le risque d’un contrôle exclusif par HTC et ses alliés des institutions étatiques et d’une extension de leur pouvoir sur la société pourrait créer de nouveaux cycles de violence et de tensions confessionnelles, tout en aboutissant à un processus de transition et de reconstruction mené par l’élite, qui ne fera que reproduire les inégalités sociales, l’appauvrissement, la concentration des richesses entre les mains d’une minorité et l’absence de développement productif.
Le confessionnalisme, un outil de domination et de contrôle sur la société
Enfin, pour consolider son pouvoir sur la société, HTC utilise le confessionnalisme comme un outil de domination et de contrôle de la population. Si les violences confessionnelles déclenchées en mars contre les civils alaouites ont été initialement provoquées par les vestiges du régime d’Assad, qui ont organisé des attaques coordonnées contre des membres des services de sécurité et des civils, la contre-réaction a englobé tous les Alaouites, selon une logique de haine confessionnelle et de vengeance. En avril et mai, des groupes armés liés aux autorités ou les soutenant ont lancé des attaques contre la population druze, avant les massacres commis à Soueïda à la mi-juillet.
La responsabilité des massacres commis en mars et juillet, des meurtres et enlèvements incessants de civils alaouites dans les zones côtières et du siège continu de la province de Soueïda incombe principalement aux nouvelles autorités syriennes. Elles n’ont pas réussi à les empêcher, et certaines milices ont même été directement impliquées dans les attaques. Les hautes sphères de l’État étaient au courant des massacres et les ont approuvés, comme l’ont rapporté Reuters et Human Rights Watch 1. De plus, les autorités au pouvoir de HTC ont créé les conditions politiques qui les ont rendus possibles.
En effet, les violations des droits humains à l’encontre des individus et des populations alaouites, notamment les enlèvements et les assassinats, ont augmenté depuis le début de l’année, certaines d’entre elles, comme le massacre de Fahil à la fin du mois de décembre 2024 et celui d’Arzah au début du mois de février 2025, ressemblant à des répétitions générales avant les massacres survenus sur la côte. Puis, des attaques confessionnelles contre les populations druzes à Damas et dans le sud, à Soueïda, ont eu lieu avant les massacres de la mi-juillet. Une fois de plus, aucune mesure n’a été prise contre les milices impliquées dans les attaques, ni contre les individus ayant lancé des appels et mené des actions confessionnelles. Les autorités au pouvoir ont continuellement qualifié ces actes d’isolés, sans prendre de mesures sérieuses contre leurs auteurs.
De plus, HTC et les responsables syriens ont à plusieurs reprises présenté à tort la population alaouite comme un instrument de l’ancien régime contre le peuple syrien. Par exemple, lors de son discours à la 9e édition de la conférence des donateurs pour la Syrie à Bruxelles, en Belgique, le ministre syrien des Affaires étrangères, Asaad al-Chibani, a déclaré : « 54 ans de règne minoritaire ont conduit au déplacement de 15 millions de Syriens... », suggérant implicitement que la communauté alaouite dans son ensemble avait dirigé le pays pendant des décennies, plutôt qu’une dictature contrôlée par la famille Assad. S’il est incontestable que des personnalités alaouites occupaient des postes clés dans l’ancien régime, en particulier au sein de l’appareil militaire et sécuritaire, réduire la nature de l’État et de ses institutions dominantes à une « identité alaouite », comme présenter le régime comme favorisant les minorités religieuses et discriminant systématiquement la majorité arabe sunnite, est à la fois trompeur et loin de la réalité.
Les autorités n’ont pas non plus mis en place de mécanisme favorisant un processus complet de justice transitionnelle visant à punir toutes les personnes et tous les groupes impliqués dans des crimes de guerre pendant le conflit syrien. Cela aurait pu jouer un rôle crucial dans la prévention des actes de vengeance et dans l’apaisement des tensions confessionnelles croissantes.
De manière plus générale, ces tensions et attaques confessionnelles poursuivent trois objectifs principaux. Premièrement, instrumentaliser les tensions confessionnelles et le discours de la « Mazlumiya Sunniya » (victimisation des sunnites) afin de tenter de rallier l’opinion publique et d’unir autour d’eux une grande partie de la communauté arabe sunnite, malgré les nombreuses divergences politiques et sociales qui existent au sein de cette communauté.
Le confessionnalisme est fondamentalement un outil permettant de consolider le pouvoir et de diviser la société. Il sert à détourner l’attention des classes populaires des questions socio-économiques et politiques en désignant un groupe particulier – défini par sa confession ou son appartenance ethnique – comme étant à l’origine des problèmes du pays et comme une menace pour la sécurité, justifiant ainsi les politiques répressives et discriminatoires à son égard. De plus, le confessionnalisme agit comme un puissant mécanisme de contrôle social, façonnant le cours de la lutte des classes en favorisant la dépendance des classes populaires vis-à-vis de leurs dirigeants élitistes. En conséquence, les classes populaires sont privées de leur capacité d’action politique indépendante et en viennent à être définies – et à s’engager politiquement – à travers leur identité confessionnelle. À cet égard également, la nouvelle autorité au pouvoir suit les traces de l’ancien régime d’Assad, continuant à utiliser des politiques et des pratiques confessionnelles comme moyen de gouvernance, de contrôle et de division sociale.
Deuxièmement, ces attaques confessionnelles et ces tensions visent à briser l’espace démocratique ou la dynamique venue d’en bas. À la suite des massacres de la marche, les gens ont plus peur de s’organiser. Par exemple, des manifestations ont été organisées en janvier et février 2025 dans différents gouvernorats par des fonctionnaires licenciés. On peut aussi relever des tentatives d’organisation de syndicats alternatifs, ou du moins de structures de coordination. Cependant, les massacres confessionnels dans les zones côtières ont considérablement réduit la puissance du mouvement de protestation, en raison de la crainte que des groupes armés proches ou issus des nouvelles autorités au pouvoir ne réagissent par la violence. Les massacres de Soueïda n’ont fait que renforcer cette dynamique.
Troisièmement, ces attaques confessionnelles ont permis aux nouvelles autorités au pouvoir à Damas de réévaluer leur domination dans certaines régions (zones côtières) et de tenter de faire de même dans les zones à forte population druze, bien que cela n’ait pas abouti, en particulier dans la province de Soueïda, ce qui a frustré les autorités centrales. Les objectifs des autorités au pouvoir dans ces événements s’inscrivaient donc dans une stratégie plus large visant à centraliser le pouvoir et à consolider leur domination dans des zones qui n’étaient pas sous leur contrôle total.
Conclusion
Si tout gouvernement post-Assad aurait hérité d’un ensemble de problèmes politiques et économiques redoutables, les autorités au pouvoir actuelles, dirigées par HTC, posent leurs propres défis. Leur orientation politique et économique rend encore plus difficile l’établissement des bases d’un processus démocratique et de reconstruction viable et inclusif. De plus, leurs politiques entraînent une perte croissante de la souveraineté du pays au profit d’acteurs étrangers. Au contraire, HTC a cherché à consolider son propre pouvoir dans les institutions de l’État, l’armée et la société.
C’est pourquoi les politiques de HTC dans les domaines diplomatiques, économiques, intérieurs, etc. doivent être analysées dans leur cohérence. La volonté d’ancrer la nouvelle Syrie dans une alliance totale avec l’axe occidental, avec ses alliés régionaux, et rechercher des formes de normalisation avec Israël, contribue à consolider la légitimité externe de la nouvelle élite dirigeante et à attirer les investissements étrangers, notamment par la privatisation des actifs de l’État et la libéralisation de l’économie. La mise en œuvre de telles politiques, la normalisation avec Israël et la dynamique néolibérale qui appauvrit davantage la société et aggrave les inégalités socio-économiques, pourraient créer une instabilité dans le pays, qui pourraient se traduire notamment par des mouvements de protestation et de critiques croissantes.
Dans ce contexte, le confessionnalisme est un outil pour tenter de construire un bloc sunnite dit homogène, en essayant d’ignorer et de masquer les différences socio-économiques et régionales, afin de neutraliser la dissidence dans le pays ou de mobiliser certaines parties de la population contre des groupes particuliers afin de les détourner de la dynamique de classe, et afin de diviser la population.
Soyons clairs : les autorités au pouvoir ne changeront pas leurs politiques et pratiques, ni ne feront de réelles concessions en faveur des intérêts politiques et socio-économiques des classes populaires syriennes, sans un changement dans le rapport des forces et, surtout, sans la construction et le développement d’un contre-pouvoir au sein de la société, qui rassemble des réseaux et des acteurs démocratiques et progressistes.
Le 10 octobre 2025
- 1
« Syrie : une enquête de Reuters sur le massacre d’Alaouites en mars retrace une chaîne de commandement jusqu’à Damas », Hala Kodmani, Libération, le 2 juillet 2024. « Syrie : Les commandants impliqués dans les atrocités en mars devraient rendre des comptes », Human Rights Watch, 23 septembre 2025.