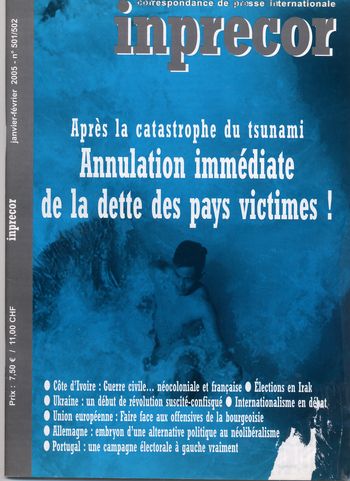Michel Husson, économiste, est membre du Conseil scientifique d'ATTAC. Il a publié notamment : Les casseurs de l'État social, La Découverte, collection " Sur le vif ", 2003 ; Solidarités et compétences, idéologies et pratiques, L'Harmattan, 2003 ; Le grand bluff capitaliste, éd. La Dispute, 2001 ; Avenue du plein emploi, ATTAC-Mille et une nuits, 2001 (avec Thomas Coutrot) ; Six milliards sur la planète : sommes-nous de trop ?, éd. Textuel, 2000 ; Les ajustements de l'emploi, éd. Page 2, 1998 ; et a collaboré à l'ouvrage collectif de la Fondation Copernic, Les retraites au péril du libéralisme, éd. Syllepse, 2002.
Les années 2000-2001 auront marqué un tournant, en réduisant à peu de choses les espoirs placés dans la généralisation des bienfaits de la " nouvelle économie " et de l'" exubérance irrationnelle " des marchés financiers. Certes, les États-Unis ont réussi à minimiser l'ampleur de la récession mais ils n'en sont sortis qu'au prix de nouveaux déséquilibres, tandis que l'Europe s'enlise à nouveau dans une conjoncture morose. Les pays du Sud ont rattrapé en partie les conséquences des crises financières, mais restent soumis à l'incertitude de la conjoncture internationale.
Une reprise atypique aux États-Unis
Contrairement aux espoirs qu'elle avait pu susciter, la " nouvelle économie " a fait baisser le taux de profit aux États-Unis dès 1997. Le graphique 1 en illustre la raison principale : les nouvelles technologies ont sans doute permis des gains de productivité mais ceux-ci n'ont pas été suffisants pour compenser une augmentation spectaculaire du taux d'accumulation. La " nouvelle économie " a donc été coûteuse en investissements et, en dépit d'une baisse de leur prix relatif, cela a finalement pesé sur la composition organique du capital. Ce point est fondamental, car il met fin aux illusions sur la capacité du capitalisme à se libérer de ses lois fondamentales. Les nouvelles technologies ne sont pas l'instrument magique qui permettrait d'accumuler le capital gratuitement.
Graphique 1. Profit et accumulation
Taux de profit : profit en % du capital (échelle de gauche)
Taux d'accumulation : investissement en % du capital (échelle de droite)
La récession qui s'en est suivie à partir de 2001 a donc eu une double fonction. Elle a permis en premier lieu de restaurer la rentabilité du capital au moyen d'une gestion très serrée de l'emploi. On a pu parler de reprise sans emplois (jobless recovery) dans la mesure où celle-ci a été l'occasion d'emmagasiner les gains de productivité potentiels. Mais les moyens plus classiques de rétablissement du taux de plus-value n'ont pas non plus été négligés, tels l'allongement de la durée du travail ou le blocage des salaires rendu encore plus facile par le faible dynamisme du marché du travail. Cette période a été également mise à profit pour ramener le taux d'accumulation à un niveau plus conforme à celui de la rentabilité. Il est frappant de voir comment les deux courbes se rejoignent après avoir considérablement divergé.
Cet ajustement ne s'est pourtant pas fait au prix d'un ralentissement durable et profond de l'économie, en raison de la politique économique menée par Bush après le 11 septembre. Elle comporte trois principaux volets qui vont tous dans le sens d'un soutien de l'activité. Le premier a été une sorte de " keynésianisme militaire " consistant à augmenter les dépenses militaires. Le second levier a été une baisse spectaculaire des impôts qui a permis de stimuler la consommation des riches. Enfin, les taux d'intérêt ont été ramenés à un niveau très bas, de manière à soutenir le marché intérieur, en particulier celui de l'immobilier. Le dynamisme de la consommation intérieure a pu ainsi être maintenu, et l'ampleur de la récession limitée. Cette politique a cependant creusé toute une série de contradictions, qui sont l'envers de ses avantages. Les principales sont les suivantes.
1) la baisse des impôts, combinée aux dépenses militaires a fait passer le budget de l'excédent à un déficit important ;
2) le soutien de la demande des ménages par la baisse des taux d'intérêt a porté à des montants sans précédent leur endettement, et conduit à un début de " bulle " sur le marché hypothécaire ;
3) les inégalités de revenus se sont encore creusées, jusqu'à la caricature ;
4) le déficit commercial vis-à-vis du reste du monde a continué à se creuser et représente aujourd'hui plus de 5 % du PIB (Produit intérieur brut) des États-Unis, soit plus d'un point du PIB mondial.
Dans ce contexte, le scénario d'ajustement brutal qui menace l'économie des États-Unis gagne en plausibilité. Il s'enclencherait si les capitaux du reste du monde refusaient de financer le déficit commercial ou si, ce qui revient à peu près au même, les Banques centrales des autres pays n'acceptaient plus de détenir des réserves croissantes en dollars et se mettaient à les vendre, faisant baisser encore plus le cours du dollar. Il faudrait alors relever les taux d'intérêt pour rassurer les capitaux étrangers et/ou freiner la croissance du marché intérieur pour dégager les financements que ces capitaux n'assureraient plus en quantité voulue. Ce retournement non maîtrisé conduirait alors à une implosion boursière et hypothécaire et à une crise sociale frappant non seulement les salariés mais aussi les couches sociales dont la richesse et les revenus dépendent de la valeur de leurs actifs financiers.
Ce n'est pas un travers catastrophiste qui conduit à envisager un tel scénario, et la non-soutenabilité du cours actuel fait pratiquement consensus. Pour ne prendre qu'un exemple, le dernier rapport de l'OCDE consacre un chapitre entier à la réduction du déficit extérieur des États-Unis, qui cherche à chiffrer son impact sur l'économie mondiale (1). L'important n'est pas de réaliser des prophéties, mais de bien identifier les deux facteurs essentiels dont dépend la trajectoire de l'économie US dans les années à venir, à savoir son articulation avec les autres zones de l'économie mondiale et sa capacité à dégager des gains de productivité.
La question de la productivité
Cette question absolument décisive est au centre du débat sur la santé de l'économie US, et Alain Greenspan, le président de la Banque fédérale, ne manque aucune occasion d'y faire référence. Le débat peut prendre ici un tour technique mais renvoie à une caractérisation essentielle du capitalisme contemporain. Le point de départ est la progression plus rapide de la productivité - autrement dit du rapport entre production et emploi - enregistrée aux États-Unis à partir du milieu des années 90. Cette accélération tranchait sur des performances jusque-là médiocres, et nettement inférieures à celles que l'on pouvait enregistrer en Europe. Elle justifiait les espoirs placés dans la " nouvelle économie " et permettait de donner sens à l'explosion boursière. Selon cette ligne d'analyse, l'augmentation vertigineuse des cours boursiers ne faisait qu'anticiper celle des profits à venir, grâce à la productivité dopée par l'introduction des nouvelles technologies. Les capitaux avaient donc raison d'affluer aux États-Unis, même si cela avait comme contrepartie un creusement du déficit commercial.
On pouvait alors opposer deux thèses, celle du cycle " high tech ", et celle de la nouvelle croissance. Pour la première, les gains de productivité n'étaient que le produit transitoire du boom de l'investissement dans les nouvelles technologies. La productivité reviendrait sur sa tendance passée dès lors que cet effort d'investissement se relâcherait. Pour les tenants de la nouvelle croissance, les mutations technologiques devaient au contraire avoir un impact durable sur les gains de productivité. Les faits récents semblent donner raison à ces derniers, puisque la productivité a continué à s'accélérer en dépit d'un recul du taux d'investissement (graphique 2). De plus, ces gains de productivité semblent diffuser à l'ensemble des secteurs, au lieu de se cantonner dans les secteurs les plus avancés technologiquement, ce qui met à mal l'un des principaux arguments des " sceptiques ".
Graphique 2. Productivité et investissement
Productivité : taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) par tête (échelle de gauche)
Taux d'investissement : investissement en % du PIB (échelle de droite)
Le débat n'est cependant pas tranché, car les sorties de récession aux États-Unis s'accompagnent traditionnellement de pics de productivité significatifs. Certes, cette phase de reprise est particulièrement atypique puisqu'elle se fait avec très peu de créations d'emplois. Le repli marqué du profit des entreprises les a incitées à une politique très rigoureuse de restructurations et d'intensification du travail. On peut dire qu'elles engrangent ainsi les bénéfices des nouvelles technologies, mais il serait très hasardeux d'avancer que ce mouvement peut continuer au même rythme.
L'observation même des faits est obscurcie par des phénomènes parasites comme l'allongement de la durée du travail, l'extension du travail non déclaré ou du multi-emplois, sans parler du flou des données statistiques. Il faut rendre compte ici d'une discussion technique, mais qui entretient un rapport étroit avec l'analyse de la " nouvelle économie ". Celle-ci se traduit par un bond en avant de l'investissement qui concerne particulièrement les équipements informatiques. Mais s'agit-il d'accumulation de capital ou de consommation productive ? La convention statistique retenue n'est pas la même aux États-Unis et dans la plupart des pays européens : aux États-Unis, un ordinateur est compté comme du capital ; en Europe, comme une consommation intermédiaire. Les statistiques US ont alors tendance à surestimer le PIB (et donc la productivité) par rapport aux statistiques européennes (2), puisqu'elles y incluent la dépréciation du capital. Le PIB se met à croître plus vite que le Produit intérieur net qui défalque cette dépréciation. En termes marxistes, le fait de raisonner " en brut " revient à inclure (à tort) le capital constant consommé dans la définition de la valeur nouvelle créée.
Si on corrige ce biais, ainsi que l'effet de la durée du travail, on constate que l'écart entre les États-Unis et l'Europe se réduit. Julian Callow, économiste au Crédit Suisse First Boston, a mené ces calculs sur la période 1996-2001. Ils montrent que la productivité horaire a progressé de 1.8 % par an aux États-Unis contre 1,4 % en Europe : une telle différence peut très bien s'expliquer par la croissance plus rapide aux États-Unis.
L'imbrication complexe de l'économie mondiale
La question du déficit extérieur américain est étroitement liée à cette analyse des gains de productivité, puisque ces derniers sont la base objective d'une rentabilité supérieure, capable de reproduire l'attractivité des États-Unis. On peut donc imaginer deux scénarios polaires. Le premier est la prolongation de la situation actuelle, où les gains de productivité plus rapides et la profitabilité supérieure continueraient à attirer les capitaux nécessaires au financement du déficit commercial des États-Unis. Cette configuration est cependant difficilement soutenable : elle implique en effet le maintien d'un différentiel de croissance entre les États-Unis et l'ensemble Europe-Japon, autrement dit un déséquilibre croissant de l'économie mondiale. Celui-ci aurait d'abord pour conséquence des tensions sociales accrues en Europe ou au Japon. De plus, le déficit commercial n'est pas seulement l'indicateur de la suprématie US imposée au reste du monde ; c'est aussi, en dernière instance, la mesure d'une compétitivité fragile de leur économie, confrontée à une concurrence accrue sur le marché mondial. Le paradoxe est alors le suivant : la croissance médiocre imposée à l'Europe et au Japon aurait pour contrepartie la reconstitution de leur compétitivité à partir du blocage salarial plutôt que de la productivité.
La suprématie réelle de l'économie des États-Unis est d'ailleurs en grande partie une illusion. Dans un article synthétique, Will Hutton (3) insiste sur le fait qu'en dehors du complexe militaro-industriel, " on aurait du mal à citer un secteur de haute technologie où les entreprises US peuvent prétendre à une supériorité systématique sur leurs concurrents européens ". Elles sont distancées en matière de technologie, d'inventivité ou d'innovation dans des secteurs qui vont " de l'automobile à l'aérospatiale, des gaz industriels aux téléphones cellulaires ".
La montée en puissance de la Chine est un autre sujet d'inquiétude qui domine le débat économique aux États-Unis. Elle représente aujourd'hui près de la moitié du déficit commercial US, et cette part ne fait qu'augmenter. Entre 1970 et 2002, les exportations chinoises ont été multipliées par 140, et leur compétitivité est assurée par l'ancrage du yuan au dollar, qui est l'une des cibles du gouvernement états-unien, d'autant plus que la concurrence chinoise commence en outre à toucher les secteurs de haute technologie. On discute beaucoup de délocalisations et de désindustrialisation, même si l'essentiel des pertes d'emplois manufacturiers s'explique par les gains de productivité et les restructurations.
Autrement dit, les États-Unis ne dominent pas en fonction des performances intrinsèques de leur économie, mais grâce à leur capacité de " fixer " l'accumulation du capital à l'échelle mondiale qui dépend en dernier ressort de rapports de forces de nature politique. Cette affirmation hégémonique n'est pas sans limites, et c'est pourquoi il faut envisager un second scénario où la compétitivité, et la balance commerciale, seraient rétablies par une baisse du dollar par rapport aux autres devises, notamment l'euro.
La baisse impériale du dollar
Ce scénario est d'ailleurs largement engagé, et s'exprime notamment par les pressions exercées sur la Chine pour que le yuan soit réévalué. Par rapport à l'euro, le mouvement de baisse du dollar a d'ores et déjà conduit à une dévaluation considérable (de l'ordre de 40 % par rapport à son point le plus haut d'il y a un peu plus de trois ans). Si on remonte dans le temps, on remarque que le taux de change du dollar vis-à-vis de l'euro (ou des monnaies européennes avant) a connu de très importantes fluctuations. Pour mieux en apprécier l'ampleur, il faut tenir compte de l'inflation respective en Europe et aux États-Unis ; on peut calculer ainsi un taux de change réel, et le comparer au taux de change effectif pour repérer les phases de " sous-évaluation " et de " surévaluation " du dollar par rapport à l'euro (ou à un panier de monnaies équivalent avant sa création). Ces appréciations sont évidemment relatives au choix de la période de référence retenue, qui est ici l'année 1986 (graphique 3).
On peut distinguer plusieurs phases, en partant de 1971, quand le dollar s'est détaché de sa définition par rapport à l'or. Il se met alors à baisser par rapport aux autres monnaies, jusqu'au choc financier de 1979, marqué par une très forte augmentation des taux d'intérêt américains, qui le fait repartir à la hausse. En cinq ans, le cours réel du dollar se redresse et retrouve à peu près son niveau de 1971. Mais cette appréciation du dollar a des inconvénients, et les États-Unis décident d'y mettre fin en imposant à leurs partenaires européens et japonais, les accords du Plaza de 1985, qui font baisser brutalement le dollar, de manière à redonner aux produits US leur compétitivité perdue. La baisse continue pendant une dizaine d'années, puis le dollar repart à la hausse à partir de 1996-97, jusqu'à la récession de 2000. A cette date intervient un nouveau retournement qui ouvre la phase que nous connaissons, marquée par une baisse continue du dollar, et donc par une hausse symétrique de l'euro. Aujourd'hui le taux de change réel du dollar est à son point le plus bas jamais enregistré depuis au moins un demi-siècle.
Graphique 3. La valeur réelle du dollar par rapport à l'euro
Taux de change effectif rapporté au taux de change réel (corrigé pour inflation). L'indice vaut 100 en 1986.
L'ampleur de ces fluctuations échappe aux déterminants strictement économiques. On peut les interpréter comme le résultat d'une contradiction dans les modalités de la domination US : les États-Unis ont besoin d'un dollar fort en tant que puissance financière et monétaire dominante, mais plutôt d'un dollar faible en tant que puissance économique et commerciale. Les hausses et les baisses successives du dollar peuvent alors s'expliquer par la priorité relative accordée à ces deux manières d'affirmer leur suprématie. Les phases de hausse correspondent à la volonté de restaurer cette suprématie sur l'économie mondiale quand celle-ci semble menacée sur le plan financier, puis les phases de baisse permettent de rétablir leur compétitivité et de consolider les positions acquises. Chaque période de hausse renvoie cependant à des conjonctures particulières : la phase 1980-1985 correspond au tournant néolibéral destiné à nettoyer une économie mondiale en crise, en la plaçant dans le corset de la discipline financière ; la phase 1996-2000 correspond ,quant à elle, à un double phénomène : la fuite en avant dans la " nouvelle économie " et le retour des capitaux échaudés par les crises financières à répétition dans les pays émergents.
Graphique 4. Différentiel de croissance USA/EU et taux de change ñ/$
L'intégration croissante de l'économie mondiale a pour conséquence une sensibilité accrue de la croissance européenne au taux de change de l'euro par rapport au dollar. Il s'agit d'une variable-pivot qui ne joue pas seulement sur les échanges bilatéraux entre les États-Unis et l'Europe mais qui contribue à déterminer leurs performances respectives sur l'ensemble des marchés tiers. Une baisse du dollar par rapport à l'euro rend les produits US plus compétitifs, non seulement sur le marché européen mais sur l'ensemble du marché mondial. C'est pourquoi on constate sur la dernière décennie une corrélation étroite (et qui n'existait pas auparavant) entre le différentiel de croissance Europe/États-Unis et le taux de change de l'euro par rapport au dollar. Quand ce dernier baisse, l'écart entre la croissance en Europe et aux États-Unis s'accroît au bénéfice de ces derniers (graphique 4).
Les États-Unis ont ainsi reporté le ralentissement de la croissance vers l'Euroland qui, après les années d'embellie (1997-2000), se voit à nouveau plongée dans une conjoncture médiocre et qui se retourne vers le bas. Ce mouvement des taux de change se combine avec les politiques économiques désastreuses menées en Europe. Le bel enthousiasme de la " Stratégie européenne pour l'emploi " s'est dissipé, et le Pacte de stabilité économique s'est révélé impraticable. L'insistance à mener des politiques d'austérité salariale de plus en plus dures (sous prétexte de compétitivité) a réussi à étouffer le marché intérieur, les baisses d'impôts ciblées sur les riches n'ayant pas durablement dopé la consommation. La faiblesse de l'investissement ne permet pas de renouer avec des gains de productivité suffisants, en dépit d'une politique systématique de restructurations des firmes européennes.
Ce contraste entre la conjoncture des États-Unis et celle de l'Europe vient souligner la faible intégration du capitalisme européen sur deux points. Chacun des pays de l'Union européenne se positionne différemment par rapport à cette configuration d'ensemble, et l'on assiste à un début d'éclatement de leurs trajectoires : certains tirent mieux leur épingle du jeu (notamment le Royaume-Uni et les petits pays) par rapport aux pays du " cœur " européen (France, Allemagne et Italie), et ce phénomène est un obstacle supplémentaire à la coordination de leurs politiques économiques. On voit aussi apparaître un écart grandissant entre économies nationales et groupes mondiaux, notamment en matière d'accumulation du capital. Les grands groupes sont jusqu'à un certain point indifférents à la morosité du marché européen dans la mesure où ils investissent et vendent sur d'autres marchés. Leurs intérêts tendent donc à être de plus en plus dissociés de la santé relative de l'économie européenne, et c'est de cette manière que l'on peut comprendre comment ils peuvent échapper aux contradictions de la politique économique européenne. Celle-ci peut sembler suicidaire, puisqu'elle revient à casser systématiquement les débouchés en bloquant les salaires, mais c'est le marché mondial qui sert ici d'échappatoire.
Le prix du pétrole
2004 a enregistré une hausse significative du prix du pétrole. Alors qu'il avait fluctué autour de 30 $ le baril tout au long de 2003, il a franchi la barre des 50 $, avant de redescendre aux environs de 40 $. Cette évolution impressionnante doit cependant être mise en perspective. Le cours du pétrole a connu deux marches d'escalier, en 1973-74 puis en 1979, qui correspondent à ce que l'on a appelé à l'époque les " chocs pétroliers " : le prix du baril avait été multiplié environ par 18. Les années 80 ont été celles du " contre-choc pétrolier ", le prix du pétrole étant progressivement ramené aux alentours de 20 $. Puis une nouvelle hausse s'est enclenchée à partir de 1999, et celle-ci a conduit le prix du baril à doubler et à se situer à nouveau au sommet atteint au début des années 80.
Graphique 5
Prix du baril en dollars
Mais cette évolution du prix du pétrole doit être corrigée de l'inflation, puisque tous les prix ont eux aussi augmenté. Il faut donc convertir les cours passés en dollars de 2004, si on veut rendre possible la comparaison dans le temps. Celle-ci livre alors des enseignements différents. Le prix réel du pétrole ne fait aujourd'hui que retrouver le niveau atteint entre les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 (graphique 5). Un autre correctif doit être ajouté en ce qui concerne l'Union européenne sur la période récente : ses pays paient le pétrole en dollars, de telle sorte que la baisse du dollar par rapport à l'euro compense en partie la hausse du prix du pétrole libellé quant à lui en dollars. On constate alors que cette hausse est relativement faible et que, pour l'Europe, le prix du baril est à peu près le même depuis 2000, date de la dernière augmentation significative (graphique 6). L'invocation rituelle du prix du pétrole pour expliquer les révisions à la baisse des perspectives de croissance doit donc être relativisée : l'effet global est relativement réduit à court et moyen terme. La question de fond, celle d'une raréfaction des ressources, pèse comme une épée de Damoclès sur l'économie mondiale mais à un horizon plus éloigné. Dans l'immédiat, la hausse du prix du pétrole est plutôt une arme qui va être utilisée pour obtenir une réévaluation du yuan qui permettrait d'alléger la facture de la Chine, grand importateur de pétrole, tout en améliorant la compétitivité des produits US.
Graphique 6
Prix du baril aux prix de 2004
L'effet boomerang de la mondialisation
Le scepticisme quant aux bienfaits de la mondialisation est en train de gagner les hautes sphères de l'économie dominante. Paul Samuelson, prix Nobel et théoricien de l'enrichissement mutuel des nations grâce au commerce international, vient de publier un article où s'expriment bien ces doutes (4). Leur point de départ est le constat de la baisse tendancielle de la part des États-Unis dans la production mondiale : elle était voisine de 50 % au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et se situe aujourd'hui entre 20 et 25 %. Soit dit en passant, la théorie libérale ne garantissait en rien le maintien du poids relatif de l'économie des États-Unis. Tout se passe comme si la théorie devenait moins intéressante à partir du moment où sa mise en œuvre ne conduit plus à ce qui était son objectif pratique. Le vague à l'âme du prix Nobel vient de ce que le progrès technique en Chine concerne désormais les secteurs pour lesquels les États-Unis disposaient des avantages comparatifs les plus nets. Cela en dit long sur l'absurdité de la théorie, qui postulait donc l'absence de rattrapage technologique, et sur les liens étroits qu'elle entretient avec les intérêts de la puissance dominante. Certes, l'article de Samuelson a donné lieu à d'énergiques protestations des doctrinaires du libre échange, parmi lesquels Jagdish Bhagwati (par ailleurs auteur d'un hymne à la mondialisation) (5) mais il est révélateur d'une prise de conscience naissante à propos des effets en retour de cette mondialisation sur l'économie US.
Tout cela revient à dire que la configuration actuelle de l'économie mondiale s'accompagne d'un approfondissement des contradictions liées au processus de la mondialisation capitaliste. L'" Empire " est en réalité profondément divisé, et on peut y voir l'expression moderne de la loi du développement inégal et combiné. On voit en effet apparaître une double ligne de fracture au sein des zones de cette économie mondiale : entre les États-Unis et les autres économies dominantes, autour de la baisse du dollar ; et entre économies dominantes et " pays émergents ". Ces derniers menacent la stabilité d'ensemble de l'économie mondiale en gagnant des parts de marché et en réussissant à augmenter le prix des matières premières, notamment celui du pétrole.
Le capitalisme s'est aujourd'hui libéré de ses " entraves " : la circulation des capitaux est à peu près libre, et les acquis sociaux ont déjà largement reculé à travers le monde. De ce point de vue, l'emprise de la finance ne doit pas être comprise comme une forme de parasitisme qui empêcherait le capitalisme de fonctionner correctement. Il s'agit au contraire d'un dispositif permettant l'établissement tendanciel d'un marché mondial, où les salariés sont directement mis en concurrence et soumis à des exigences de profitabilité qui s'opposent à la satisfaction des besoins sociaux non rentables. Grâce à la finance, le capitalisme contemporain se rapproche d'un fonctionnement " pur " en ce sens qu'il se débarrasse progressivement de tout ce qui pouvait l'encadrer ou le réguler. Ce mouvement ne saurait s'auto-réformer et implique une redistribution régressive des richesses. C'est pourquoi les constructions qui visent à séparer le bon grain de l'ivraie - par exemple le " bon " capitalisme productif du " mauvais " capitalisme financier - ou à imaginer un capitalisme à la fois hyper-compétitif et plus égalitaire, relèvent donc d'une utopie réformiste qui ne correspond pas à son cours actuel.
Le paradoxe de la mondialisation pourrait alors s'énoncer ainsi : plus le capitalisme réussit à modeler l'économie mondiale à sa convenance, plus les tensions s'accroissent. Le capitalisme mondial est aujourd'hui installé dans une phase d'instabilité durable. Et la question fondamentale est de savoir si cette instabilité va se dénouer selon l'axe des conflits inter-capitalistes ou celui des affrontements sociaux.
1. " Les enjeux de la réduction du déficit de la balance courante des États-Unis ", Perspectives économiques de l'OCDE n° 75, chap. 5 http ://gesd.free.fr/ozusbal.pdf
2. Sur ce point, voir François Lequiller, " The new economy and the measurement of GDP growth ", document de travail INSEE G2001/1, février 2001 http ://gesd.free.fr/lequill.pdf
3. Will Hutton, " The American Prosperity Myth ", The Nation, September 1, 2003 http ://guesde.free.fr/hutton04.pdf
4. les principales pièces de ce dossier sont disponibles sur le site http ://hussonet.free.fr/mondiali.htm.
5. In Defense of Globalization, Oxford University Press, 2004.