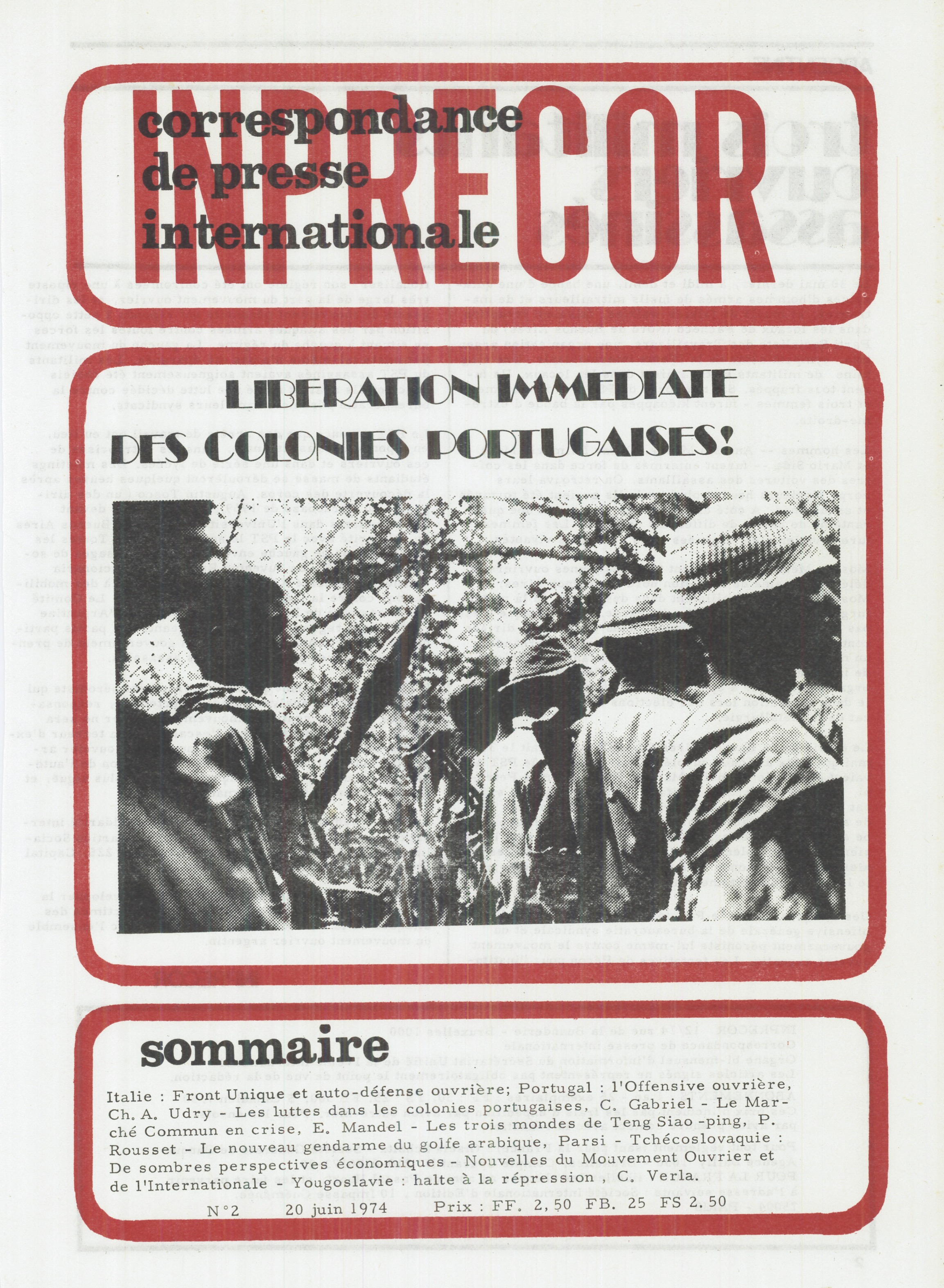Depuis décembre 1971, la bureaucratie titiste a engagé un vaste mouvement de « reprise en main » de toute la vie politique, économique et culturelle, sans pour autant remettre encore explicitement en cause la réforme économique de 1965. C’est pourtant la combinaison des contradictions d’une société bureaucratisée et de celles propres au « libéralisme économique » qui constitue l’arrière-fond des considérables tensions sociales dont une des étapes fut marquée, fin 1971, par la « crise croate » : les inégalités régionales croissantes, le développement du chômage1, la hausse considérable des prix (environ 20 % en 1973) restent autant de problèmes cruciaux qui alimentent de nombreux conflits. Conflit entre nationalités, entre la bureaucratie fédérale et celle des diverses républiques, entre les fonctionnaires politiques et les dirigeants des secteurs financiers et bancaires, grèves des travailleurs pour l’augmentation de leurs salaires, le respect de leurs droits d’autogestionnaires. Face à de telles tensions, la bureaucratie titiste a fait le seul choix compatible avec le maintien de ses privilèges : loin de toucher aux causes des inégalités et des tensions sociales, elle chercha d’une part des boucs émissaires susceptibles d’apaiser la colère des masses (c’est la fameuse campagne impulsée par Tito contre tous ceux qui se sont « abusivement » enrichis) et, d’autre part, elle réprima l’ensemble des oppositions en s’efforçant de remodeler une Ligue des Communistes Yougoslaves à la mesure de ses exigences de reprise en main de la société yougoslave.
Mais la décentralisation introduite de plus en plus largement depuis les années 50 a eu ses contreparties : une vie culturelle et politique sans commune mesure en Yougoslavie par rapport aux « démocraties populaires ». La revue philosophique PRAXIS, l’école annuelle de KORČULA ont acquis un renom international qui satisfaisait y compris l’image de marque que la bureaucratie titiste tenait à conserver. Mais au-delà de ces manifestations des philosophes marxistes yougoslaves, l’ampleur du mouvement étudiant, de ses thèmes de lutte en mai 68 (« La révolution n’est pas terminée, autogestion de bas en haut ! »), ont témoigné de la progression des idées marxistes révolutionnaires au sein de la jeunesse militante. La « reprise en main » n’est donc pas acquise, ni facile pour la bureaucratie, surtout si elle veut — comme c’est encore le cas — préserver cette apparence de démocratie et aussi d’autonomie vis-à-vis de la bureaucratie soviétique, sa sœur ennemie.
Depuis 1971, les purges internes à la LCY ont été considérables (quelque 55 000 personnes limogées). Il s’agit de combattre à la fois les néo-staliniens « purs et durs » qui profitent des conflits actuels pour prendre des forces et faire pression pour un retour à une centralisation totale, mais aussi de réprimer les « libéraux », « anarcos et restaurationnistes divers », qualifiés comme tels par la bureaucratie, parfois partisans réels d’une extension des lois du marché, souvent simplement hostiles à l’actuel cours répressif et au rôle nouveau attribué à la LCY. En fait, le centre des attaques porte actuellement contre ceux qui sont le mieux à même d’exprimer à la fois le rejet du centralisme bureaucratique, l’acquis de l’autogestion mais la ferme volonté d’en faire une réalité : les professeurs marxistes qui collaborent avec la revue PRAXIS, et peut-être surtout les étudiants qui militent activement pour qu’au-delà de la liberté d’expression et de travail de leurs professeurs s’affirme un programme de lutte authentiquement socialiste.
Depuis quelques mois, les autorités yougoslaves ont tout fait pour obtenir l’exclusion de huit professeurs de la faculté de philosophie de Belgrade, participants à PRAXIS2. Pressions diverses, retraits de passeports, campagne de presse, « lettres d’ouvriers » qui pour la cause découvrent la philosophie, demandes explicites de licenciement. Mais les organes légaux de la faculté ont résisté. La bureaucratie a dès lors cherché à changer la légalité ! Tentative de mettre en place un nouveau conseil de faculté dont la moitié des membres serait désignée par les autorités, définition de nouveaux critères « politiques et théoriques » pour l’habilitation des professeurs à enseigner, etc. Mais la résistance a été pour l’instant la plus forte. Les professeurs sont toujours en place. Leurs étudiants se sont organisés pour les soutenir. La solidarité s’est étendue aux facultés de Zagreb et Ljubljana. En janvier 1974, une coordination s’est faite entre les trois facultés, au cours de laquelle une résolution affirma, au-delà du soutien aux professeurs, la lutte commune des étudiants pour un socialisme qui mette réellement le prolétariat au pouvoir : l’appel à coordonner tous les efforts socialistes pour une lutte contre les privilèges bureaucratiques, contre les inégalités sociales, contre l’exode des travailleurs, témoigne d’une volonté militante qui ne peut qu’être réprimée par la bureaucratie. Déjà, l’étudiant Vladimir PALANCANIN a été arrêté en mars pour « avoir lu une telle résolution ». Des inculpations sont en cours contre 11 des étudiants des trois facultés. Dès que le congrès de la LCY sera terminé, affirmant la reprise en main de sa direction, dès que l’attention et la mobilisation paraîtront moins soutenues, à la faveur des mois d’été, les procès risquent de pleuvoir, la répression de s’accentuer encore.
La bureaucratie titiste se heurtera à la solidarité que les révolutionnaires du monde entier apporteront aux professeurs marxistes et aux étudiants communistes yougoslaves. Au moment où elle affirme démagogiquement vouloir renforcer l’autogestion, elle réprime ceux qui veulent réaliser de telles promesses. Elle s’engage à nouveau sur le terrain des procès, de la répression envers d’authentiques socialistes, parce que l’heure des bilans est venue où le prolétariat yougoslave pourrait bien trouver dans les appels des étudiants et des professeurs, la voie que la bureaucratie lui ferme : celle du pouvoir.
Juin 1974. Écrit sous le pseudonyme C. Verla.