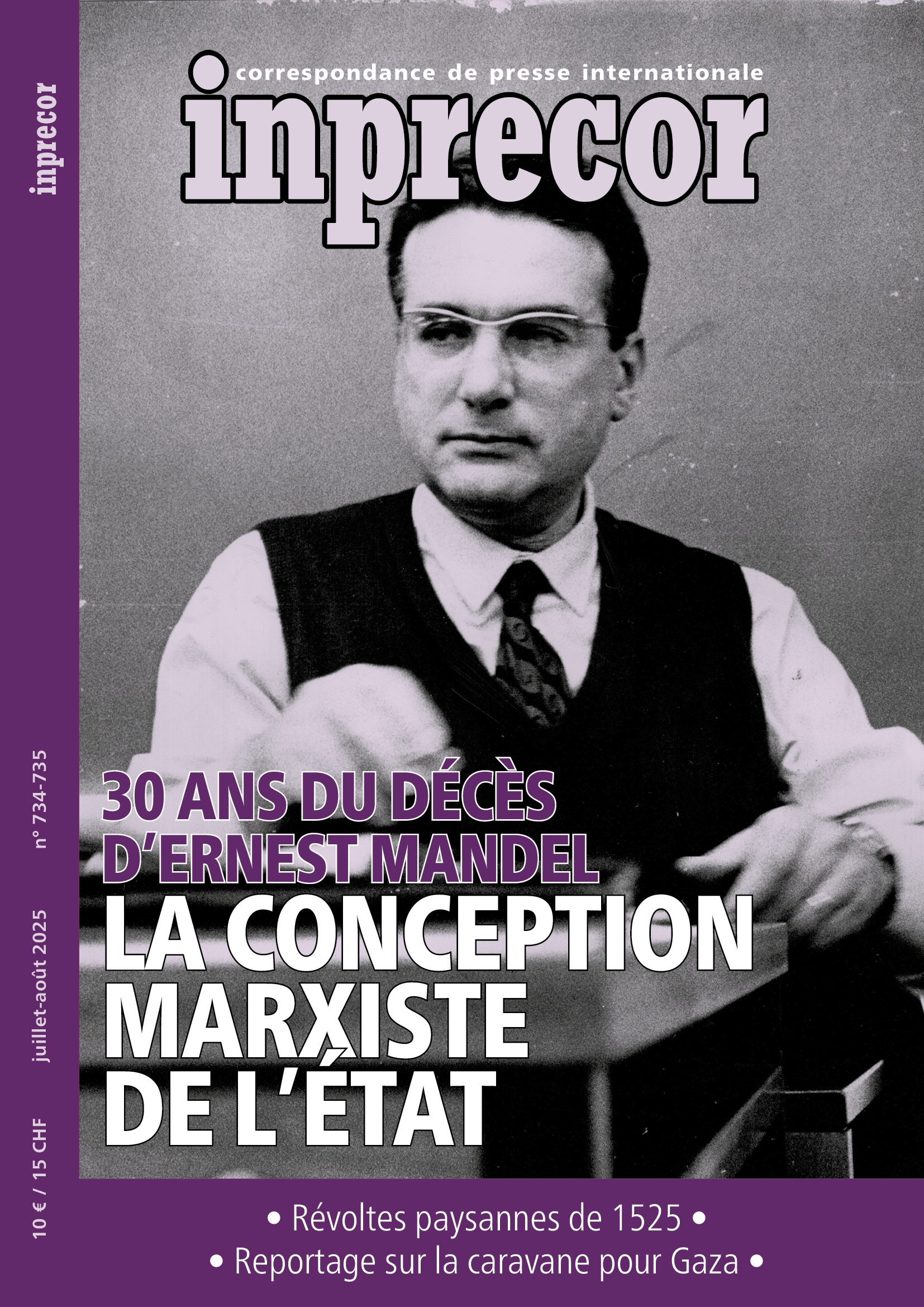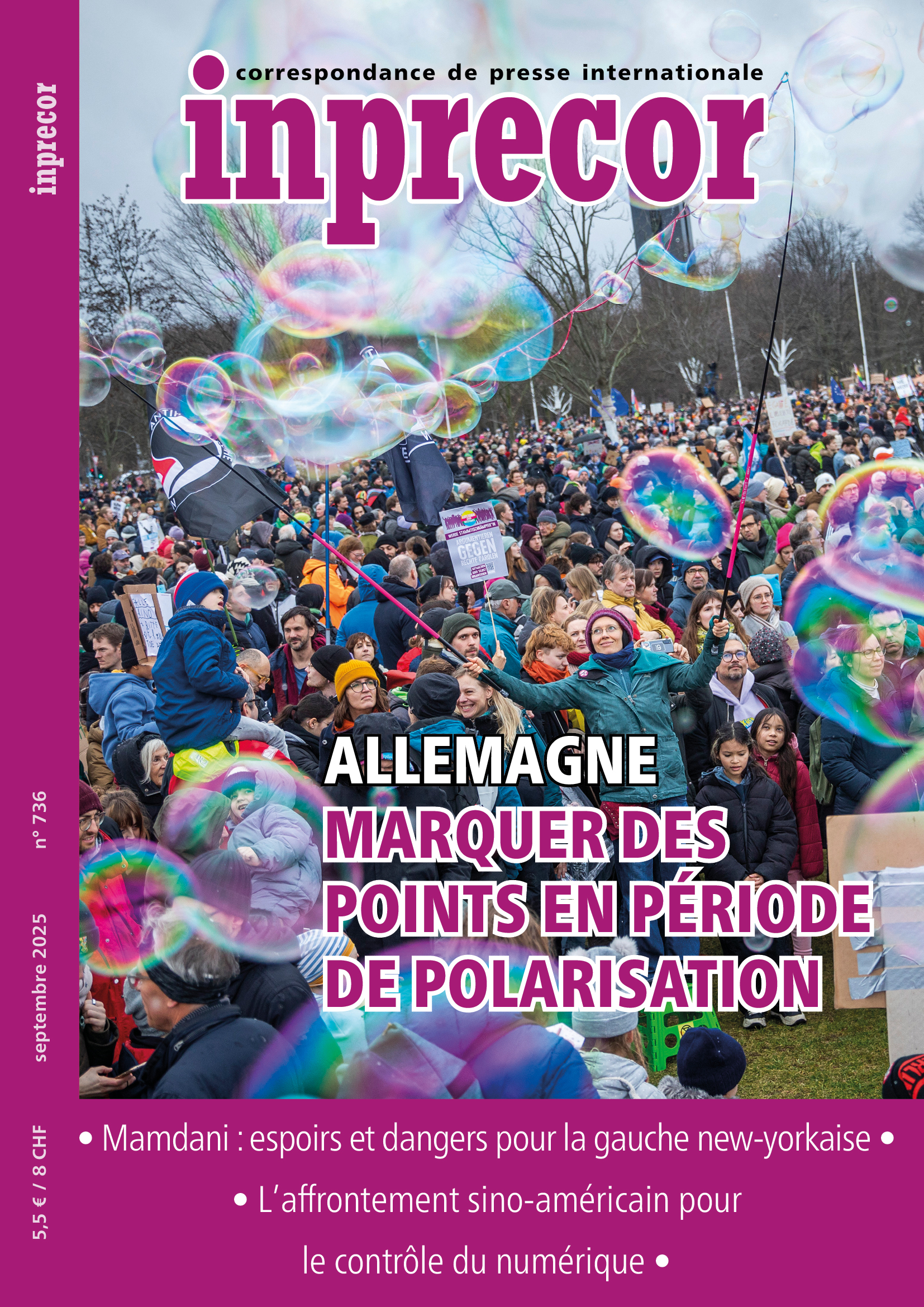Cette année les révolutionnaires du monde entier célèbrent la mémoire de Thomas Müntzer (1490-1525), exécuté à Mühlhausen, le 27 mai 1525. Prédicateur anabaptiste et l’un des chefs religieux de la guerre des paysans dans le Saint-Empire romain germanique au 16e siècle, il fut un véritable dirigeant révolutionnaire.
Né dans une famille d’artisans pauvres, Thomas Müntzer suit des études de théologie et est ordonné prêtre, mais se rallie en 1519 à Luther. Peu après, en 1521, il rédige le Manifeste de Prague, qui est un appel à la révolte contre « la putain de Babylone », l’Église de Rome. Cependant, il va bientôt critiquer Luther pour sa collusion avec les puissants. C’est le Sermon aux Princes qu’il prononce en 1524, où il attaque avec virulence l’autorité de l’Église et de l’Empire. S’associant au mouvement paysan anabaptiste, il prêche pour un rétablissement de l’Église apostolique, par la violence s’il le faut, pour pouvoir préparer le plus vite possible le règne du Christ. Thomas Müntzer et son groupe prennent le pouvoir en février 1525 à Mühlhausen en Thuringe, où ils instaurent une sorte de pouvoir révolutionnaire radical et égalitaire, allié à la révolte des paysans.
Le chef des paysans séditieux
Mystique et millénariste, inspiré par la doctrine médiévale du « Troisième Âge » de Joachim de Flore 1, Müntzer est aussi un révolutionnaire, qui dénonce la puissance des riches et la complicité de Luther avec les princes. Comme les anabaptistes, il demande à ses partisans de pratiquer le baptême d’adulte. Dans la tradition apocalyptique, il annonce l’imminence de la Fin des Temps et du Jugement. Dans ses sermons de Wittenberg (1523), il essaie de soulever les artisans et paysans contre les princes régnants et les pouvoirs ecclésiastiques.
Décidé avec la révolte paysanne, Thomas Müntzer prend en mai 1525 la tête d’une armée de sept mille soldats paysans qui se prépare à combattre les princes à Frankenhausen. La bataille aura lieu le 15 mai : mal équipés et inexpérimentés, les paysans se feront massacrer par les armées princières composées de mercenaires professionnels lourdement armés, disposant de canons. Blessé, Müntzer est capturé dans une maison de Frankenhausen où il s’était réfugié. Après avoir été torturé, il fut décapité à Mühlhausen (Thuringe) devant un parterre de représentants de la haute noblesse. À l’attention du bon peuple, sa tête empalée fut exposée sur les remparts de la ville.
Une inscription murale dans la ville de Heldrungen le stigmatise comme archifanaticus patronus et capitaneus seditiosorum rusticorum 2 : un hommage involontaire…
Un prophète révolutionnaire
Les socialistes allemands ont, dès le 19e siècle, trouvé dans la guerre des paysans du 16e siècle et dans le personnage de Thomas Müntzer une source d’inspiration et un précédent historique capital.
C’est le cas notamment de Friedrich Engels qui va leur dédier une de ses principales – sinon la plus importante – études historiques : le livre La guerre des paysans (1850). Son intérêt, sa fascination même, résulte probablement du fait que ce soulèvement était la seule tradition proprement révolutionnaire dans l’histoire allemande. Analysant la Réforme protestante et la crise religieuse du tournant du siècle en Allemagne en termes de lutte de classes, Engels distingue trois camps qui s’affrontent sur un champ de bataille politico-religieux : le camp conservateur catholique, composé du pouvoir de l’Empire, des prélats et d’une partie des princes, de la noblesse riche et du patriciat des villes ; le parti de la Réforme luthérienne bourgeoise modérée, groupant les éléments possédants de l’opposition, la masse de la petite noblesse, la bourgeoisie et même une partie des princes, qui espéraient s’enrichir par la confiscation des biens de l’Église. Enfin, les paysans et les plébéiens constituaient un parti révolutionnaire, « dont les revendications et les doctrines furent exprimées le plus nettement par Thomas Müntzer » 3.
Cette analyse des affrontements religieux à travers la grille des classes sociales antagonistes est remarquable, même si Engels semble ne considérer la religion que comme un « masque » ou « couverture » (Decke) derrière lequel se cachent « les intérêts, besoins, et les revendications des différentes classes ». Dans le cas de Müntzer, il prétend qu’il « dissimulait » ses convictions révolutionnaires sous une « phraséologie chrétienne » ou sous un « masque biblique » ; s’il s’adressait au peuple « dans le langage du prophétisme religieux », c’est parce que celui-ci était « le seul qu’il fût capable de comprendre à l’époque ». La dimension spécifiquement religieuse du millénarisme müntzerien, sa force spirituelle et morale, sa profondeur mystique authentiquement vécue, sont absents de cette approche.
En même temps, il ne cache pas son admiration pour la figure du prophète chiliastique 4, dont il décrit les idées comme « quasi-communistes » et « religieuses révolutionnaires » :
Sa doctrine politique se rattachait exactement à cette conception religieuse révolutionnaire et dépassait tout autant les rapports sociaux et politiques existants que sa théologie dépassait les conceptions religieuses de l’époque. […] Ce programme, qui était moins la synthèse des revendications des plébéiens de l’époque, qu’une anticipation géniale des conditions d’émancipation des éléments prolétariens en germe parmi ces plébéiens, exigeait l’instauration immédiate sur terre du royaume de Dieu, du millénium des prophètes, par le retour de l’Église à son origine et par la suppression de toutes les institutions en contradiction avec cette Église soi-disant primitive, mais en réalité toute nouvelle. Pour Müntzer, le royaume de Dieu n’était pas autre chose qu’une société où il n’y aurait plus aucune différence de classes, aucune propriété privée, aucun pouvoir d’État autonome, étranger aux membres de la société » 5
Ce qui est suggéré dans ce paragraphe étonnant, c’est non seulement la fonction protestataire et même révolutionnaire d’un mouvement religieux, mais aussi sa dimension anticipatrice, sa fonction utopique. Nous sommes ici aux antipodes de la théorie du « reflet » : loin d’être la simple « expression » des conditions existantes, la doctrine politico-religieuse de Müntzer apparaît comme une « anticipation géniale » des aspirations communistes de l’avenir. On trouve dans ce texte une piste nouvelle, qui n’est pas explorée par Engels, mais qui sera, plus tard, richement travaillée par Ernst Bloch, depuis son essai de jeunesse sur Thomas Müntzer jusqu’à son magnus opus sur Le Principe espérance.
Pour un bilan sobre et équitable de l’apport d’Engels à l’étude socio-historique de la Réforme, on peut se rapporter à la préface de Leonard Krieger à l’édition anglaise du livre (1967) : « La connexion entre les sectes radicales et les classes “plébéiennes-paysannes” – la connexion qui a permis à Engels ses analyses historiques les plus pénétrantes – reste la seule relation précise qui a été acceptée par les historiens des deux côtés de la ligne de division marxiste. En général, cependant, même si la priorité attribuée par Engels aux intérêts sociaux et sa corrélation univoque des autres confessions religieuses avec les classes sociales n’a pas connu une telle acceptation, l’importance de la dimension sociale pour les conflits religieux de l’ère de la Réforme n’est pas mise en doute, et la découverte du mode par lequel cette relation a pu fonctionner reste une des questions vivantes pour l’historiographie européenne ».6
Quasi-communiste
Presque un siècle plus tard, en 1921, le jeune Ernst Bloch va publier son Thomas Müntzer, théologien de la révolution, un hommage enthousiaste, par un marxiste libertaire, au chef des anabaptistes, et une analyse détaillée de ses proclamations. La dimension apocalyptique du discours de Müntzer est mise en évidence avec admiration :
« Ici ce n’était point pour des temps meilleurs que l’on menait le combat, mais pour la fin de tous les temps : à proprement parler dans une propagande apocalyptique de l’action. Non pour vaincre les difficultés terrestres dans une civilisation eudémoniste, mais pour […] l’irruption du Royaume ». 7
Dans une interprétation à tonalité anarchiste, Bloch perçoit la doctrine de Müntzer et des anabaptistes comme une négation de l’autorité de l’État et de toute loi imposée du dehors, « devançant presque Bakounine ». Müntzer prêche « une république mystique et universelle » et même « quelque chose de plus profond encore : une complète communauté de biens, le retour aux origines chrétiennes, le rejet de toute autorité publique » 8.
Pour Bloch, Müntzer se situe aux antipodes de la divinisation luthérienne de l’État et du « capitalisme comme religion » de Calvin. Il décrit son appel de 1525 aux mineurs comme une « déclaration de guerre aux maisons de Baal », et même comme « le plus passionné, comme le plus furieux manifeste révolutionnaire de tous les temps » – hélas, sans grand résultat 9.
Peu après, à Frankenhausen, « l’armée révolutionnaire et messianique » des paysans, mal armés – manquant d’artillerie et de poudre – et sans état-major exercé, inspirée mais non commandée par Müntzer, a été exterminée par les seigneurs.
Ernst Bloch voit Thomas Müntzer comme un moment crucial de l’histoire souterraine de la révolution, qui va des Cathares, des Vaudois et des Albigeois à Rousseau, Weitling et Tolstoï : une immense tradition qui veut « en finir avec la peur, avec l’État, avec tout pouvoir inhumain ». 10
Quels seraient aujourd’hui les héritiers de Thomas Müntzer et de cette histoire souterraine ? Ernst Bloch évoque Karl Liebknecht et Lénine, et appelle de ses vœux, dans la conclusion de son essai, à une alliance « entre le marxisme et le rêve de l’inconditionné […] dans le même plan de campagne ». L’essai de Bloch a été écrit à un moment, 1921, où la révolution en Allemagne semblait encore possible. D’où cette étonnante conclusion du livre :
« Haut dressé sur les décombres d’une civilisation ruinée, voici que s’élève l’esprit de l’indéracinable utopie »11.
Le 15 juin 2025
Bibliographie
• G. Bischoff, La guerre des paysans. L’Alsace et la révolution du Bundschuh, Strasbourg, La Nuée bleue, 2010 (un exemple alsacien).
• P. Blicke, The Revolution of 1525. The German Peasant’s War from a New Perspective, Baltimore, J. Hopkins University Press,
1981 (l’ouvrage classique d’un grand historien allemand sensible aux questions sociales).
• O. Cristin et N. Ghermani, « Guerre des paysans : une révolution allemande », dans L’Histoire, 532 (2025), p. 12-21.
• F. Engels, La guerre des paysans en Allemagne, Paris, Ampelos, 2019.
• L. Roper, Summer of Fire and Blood. The German Peasants‘ War, New York, Basic Books, 2025 (plus religieux que social).
• G. Schwerdoff, Der Bauernkrieg. Geschichte einer wilder Handlung, Munich, Beck, 2025 (un livre qui relativise les perspectives
sociales de Blicke).
- 1
Le « Troisième Âge » est conçu comme une époque future marquée par la venue de l’Esprit Saint, succédant à l’Âge du Père (Ancien Testament) et à l’Âge du Fils (Église du Christ). Cela doit être une ère de liberté spirituelle, sans hiérarchie, où chacun aura un accès direct à Dieu. Joachim y voit une société pacifiée et guidée par l’amour.
- 2
« Archifanatique, protecteur et chef des paysans séditieux ».
- 3
- 4
En religion, lié au chiliasme, doctrine religieuse pour laquelle les élus vivraient mille ans de paradis, après le jugement dernier.
- 5
Idem.
- 6
Leonard Krieger, Introduction à F. Engels, The German Revolutions, Chicago, 1967, pp. XLI.
- 7
E. Bloch, Thomas Müntzer, théologien de la révolution (1921), Paris, Julliard, trad. Maurice de Gandillac, 1975, p. 91. Cet ouvrage a été réédité en 2022 par les éditions Amsterdam.
- 8
Ibid, pp. 119, 137.
- 9
Ibid, pp. 182-183, 96-98.
- 10
Ibid, p. 305.
- 11
Ibid, pp. 154, 306.