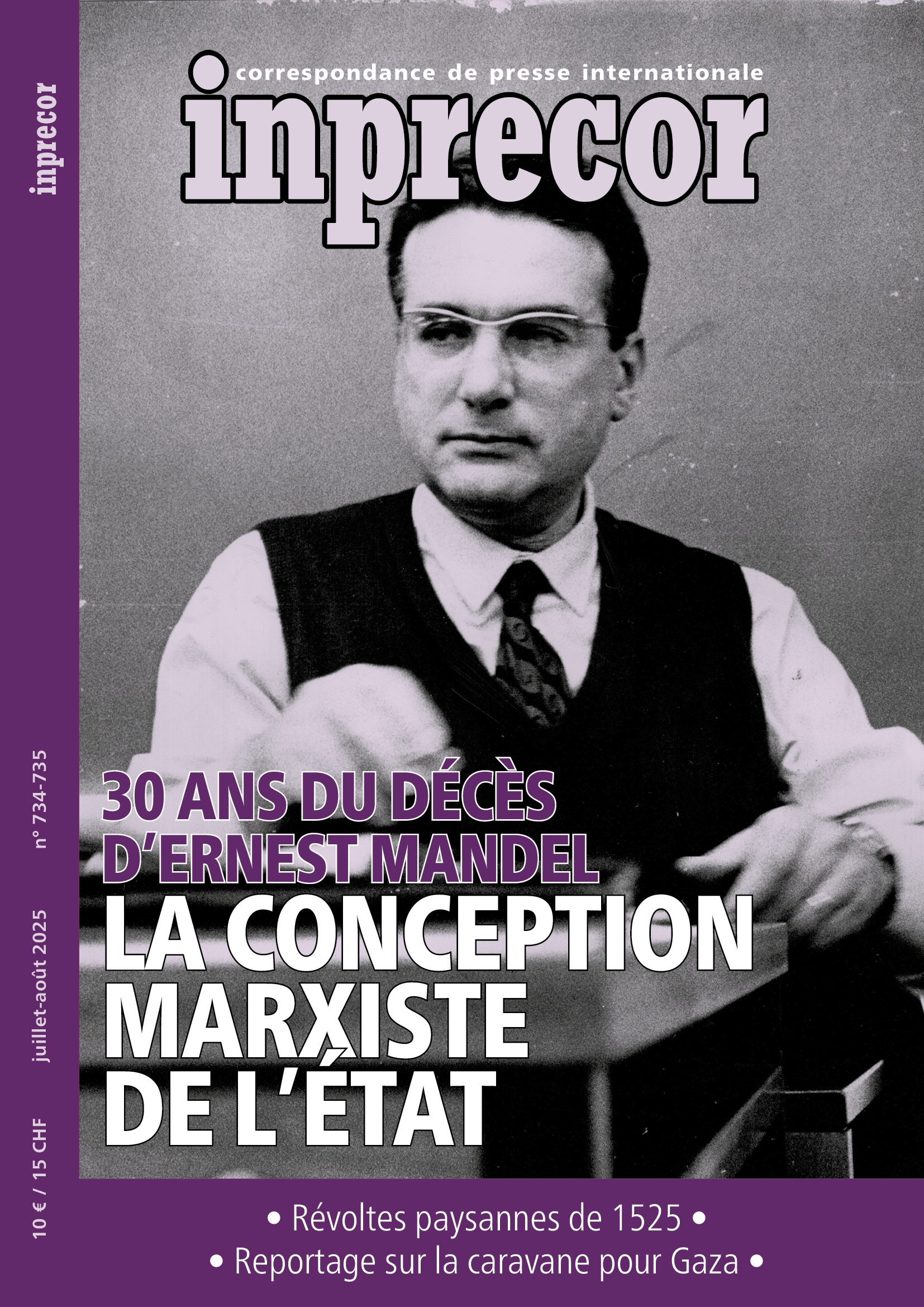Ce texte a initialement rédigé pour servir d’introduction à une table ronde à l’université « Católica » de Lima (Pérou) qui s’est tenue 1er février 2025.
1. Le « fascisme », idéologie nationaliste xénophobe et mouvement politique visant à homogénéiser les populations au sein des États-nations existe depuis cent ans.
Sa fonction était et reste la défense de l’économie capitaliste par la suppression de la démocratie parlementaire (élections libres, compétition entre les partis, séparation des pouvoirs, garantie des droits de l’homme) et son remplacement par un régime « autoritaire » (dictature à parti unique, fusion des pouvoirs législatif, judiciaire et de l’exécutif), qui ne se trouve pas en opposition avec la structure oligopolistique de l’économie, mais est en symbiose avec elle. La fonction contre-révolutionnaire du fascisme demeure, seule sa manière de se présenter change.
2. Le fascisme allemand des années 1933-1945 fut le plus meurtrier de tous les régimes fascistes, suivi par les régimes espagnol et italien, et probablement dépassé par la dictature russe de Staline (1929-1953), qui fit peut-être encore plus de victimes que le fascisme hitlérien, mais avait une autre fonction socio-économique, à savoir la défense par la terreur des moyens de production étatisés et leur gestion bureaucratique.
3. Le régime fasciste allemand (tout comme son rival stalinien) réussit à éliminer l’opposition interne et les groupes de population potentiellement « déloyaux » soit en les expulsant du territoire national (par l’émigration forcée et les déportations de masse), soit en ayant recours à des exécutions massives, aux camps d’extermination et de travail forcé (« génocide politique »). L’État SS (en tant que dictature basée sur le « consentement" ») ne pouvait pas être renversé « de l’intérieur », comme l’Empire allemand en 1918, mais uniquement « de l’extérieur », c’est-à-dire par l’intervention conjointe des forces venant de l’ouest et de l’est.
4. La Première Guerre mondiale a pris fin en 1917-18 grâce à la révolte de soldats, d’ouvriers et de paysans, dont l’objectif n’était pas seulement de remplacer les monarchies par des démocraties parlementaires, en outre d’assurer leur assise par la démocratisation de l’économie, c’est-à-dire en éliminant la propriété privée des grands domaines agricoles et par le contrôle public de la finance et de la production industrielle. Pour s’opposer à cette démocratisation radicale de l’économie et de la société, le gouvernement et les grands capitalistes ont financé et armé des milices fascistes qui, au cours d’une guerre civile de plusieurs années, ont pris le dessus sur les partisans de la démocratisation de l’économie. Les fragiles démocraties parlementaires établies sur des bases capitalistes ont muté après quelques années en dictatures présidentialistes, puis ont été transformées en dictatures fascistes.
5. Avant d’en arriver là, il a fallu une transformation en profondeur de la structure sociale, c’est-à-dire le passage d’une société constituée de petits et moyens propriétaires privés à une société de salarié.e.s et de grands capitalistes, qui s’est opérée dans le cadre de l’expansion du capitalisme (colonialiste) à l’ensemble de l’économie mondiale et de l’internationalisation des grands groupes et des institutions financières. L’expropriation des petits et moyens propriétaires privés, qui agissaient de manière plus ou moins autonome dans des conditions de concurrence, a dépossédé l’idéal bourgeois d’autonomie de son fondement. Les individus dépendant d’un salaire n’avaient pratiquement plus la capacité d’agir de manière « autonome ». La nouvelle division de classe entre des millions de personnes dépendantes et quelques milliers de magnats de l’industrie, de la banque et des médias a entraîné, tout comme l’écrasement des révolutions conduites par les combattant.e.s de la démocratie économique, un affaiblissement de la capacité de résister ainsi que de la « spontanéité » de la majorité de la population. En l’espace de quelques générations, des structures de caractère « autoritaires » bien ancrées se sont établies chez des hommes et des femmes dominé.e.s par la « peur de la liberté » et dont le ressentiment est dirigé contre les individus et les groupes qui ont un mode de vie alternatif et des privilèges réels ou apparents. Une grande partie du peuple, dont l’expérience quotidienne est celle de l’impuissance (face à la conjoncture et à la crise, à la guerre et à la paix), a tendance à suivre des démagogues qui lui promettent, à ce grand peuple enraciné de longue date, de remédier à la situation en mettant un terme à la modernisation qui le dépasse et en éliminant tous les fauteurs de troubles et les concurrents « étrangers ». C’est à eux qu’ils commencent par prêter volontiers leurs voix, et ensuite leurs poings.
6. Cette « mentalité », qui s’est consolidée à la suite d’une longue série de défaites de tous les mouvements, groupes et partis qui aspiraient à une démocratisation de l’économie, a finalement fait échouer toutes les efforts de rééducation démocratique.visant à empêcher qu’ après la Seconde Guerre mondiale ne réapparaissent à nouveau des prétendant.e.s fascistes à la résolution des crises En l’absence d’alternatives réelles et de programmes réalistes pour instaurer une démocratie économique, les régimes fascistes disparus exercent une fascination inquiétante sur une nouvelle génération, pour laquelle les horreurs du passé ne sont plus qu’un vague souvenir. Ainsi, lors des dernières élections en Allemagne, environ six millions d’électrices et d’électeurs ont voté pour le parti fasciste « Alternative für Deutschland » (AfD), parmi lesquels les jeunes électeurs formaient un groupe important, bien que (ou parce que) son programme, à ce stade, ne repose au fond que sur deux revendications : la destruction de toutes les éoliennes et la déportation de millions d’étrangerEs à la manière de Trump.
7. Comme toutes les « institutions » humaines qui s’imposent comme « naturelles » (et donc immuables), les mentalités peuvent également être changées. Ainsi, au printemps 2024, puis à nouveau au printemps de cette année, nous avons pu voir comment plusieurs millions de ces Allemand.e.s, longtemps considéré.e.s comme apathiques et léthargiques, se sont mobilisé.e.s spontanément dans les plus grandes manifestations de protestation depuis 1945. D’abord en apprenant que le parti fasciste AfD prévoyait de renvoyer des millions d’« étrangerEs » vivant en Allemagne vers les pays où sévissent la guerre et la famine d’où eux-mêmes (ou leurs aïeux) avaient fui. Et ensuite, lorsqu’elles ont vu que le parti le plus important, la CDU-CSU conservatrice, faisait cause commune avec les députés de l’AfD au Bundestag afin d’obtenir une majorité de voix pour son plan de réduction de l’immigration. Cet exemple nous fait une fois de plus comprendre que ce n’est pas parce qu’une chose est telle qu’elle est qu’elle restera ainsi, ou bien encore : il n’existe pas de situation qui soit sans espoir.
Traduit pour ESSF par Pierre Vandevoorde, Source. Publié le 12 juillet 2025