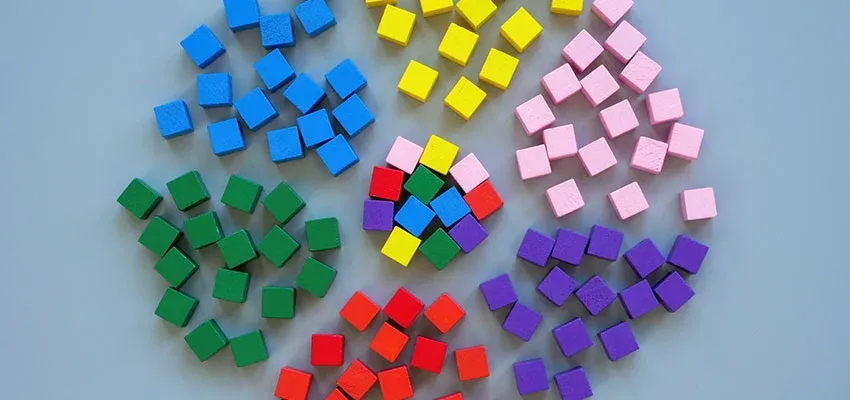
Dans cet essai, je discute d’une notion spécifique qui est devenue particulièrement influente pour encadrer la discussion sur l’identité et la politique de l’identité : l’intersectionnalité. Je montre que la formulation originale de cette notion était étroitement liée aux débats sur la classe et les politiques de classe. Après avoir fait la lumière sur la « préhistoire » de l’intersectionnalité dans le féminisme noir, je discute des formulations originales du concept dans les travaux de Kimberlé Crenshaw et Patricia Hill Collins. L’accent mis sur la notion d’« oppression » ainsi que sur les tensions entre l’« irréductibilité » et la « simultanéité » des systèmes d’oppression dans les écrits intersectionnels m’amène à examiner certains des pièges de la politique identitaire aujourd’hui. Une tentative de repenser la notion de classe à la lumière de l’intersectionnalité clôt l’essai.
Identité et classe
Si l’identité est bien sûr une catégorie fondamentale de la philosophie européenne au moins depuis Aristote, sa politisation est un phénomène beaucoup plus récent. On peut dire que ce n’est que dans la seconde moitié du 20e siècle que le développement de l’anthropologie culturelle et de la sociologie a jeté les bases théoriques d’une telle politisation, qui ne peut se concevoir sans tenir compte de l’émergence, dans de nombreuses régions du monde, de mouvements féministes ainsi que d’une panoplie de luttes contre la domination raciale et pour les droits des « minorités ». Des débats aussi importants que celui sur le multiculturalisme ont contribué à encourager les politiques identitaires et, plus généralement, à codifier la politique en termes d’identité (culturelle). Les revendications fondées sur l’identité ont joué un rôle important dans la dénonciation de la « neutralité » présumée, voire de l’universalisme des institutions politiques, et dans la mise en lumière de la continuité des histoires passées de conquête et de domination. Ce fut par exemple le cas dans les pays coloniaux comme l’Australie, le Canada et les États-Unis en ce qui concerne la condition des peuples indigènes. Plus généralement, l’identité a fourni un langage pour l’articulation des revendications et des désirs de libération d’une multiplicité de sujets dont l’oppression était fondée sur des systèmes d’oppression spécifiques qui n’étaient pas ciblés en tant que tels par les traditions établies de la politique d’émancipation. Les luttes des personnes racisées ou des minorités sexuelles sont de bons exemples à cet égard, de même que les revendications proliférant au sein du féminisme selon des lignes qui fracturent les figures unitaires de la « femme » et de la « sororité universelle » (il suffit de penser aux débats autour du « féminisme postcolonial » depuis les années 1980).
De ce point de vue, il n’est pas surprenant que l’une des premières cibles polémiques des politiques identitaires ait été le concept de classe et de politique de classe. Si l’on considère la classe comme un sujet collectif (et même comme une identité collective) dont l’unité et l’homogénéité sont immédiatement données comme un résultat « objectif » des rapports de production, il est facile de voir qu’il n’y a pas d’espace ici pour une politique capable de saisir les revendications et les mouvements articulés en termes spécifiques, que ce soit en termes de genre ou de race. Les exemples historiques de tels conflits et affrontements au sein du mouvement ouvrier ne manquent pas. Prenons l’exemple de B.R. Ambedkar, le grand porte-parole des Dalits dans l’Inde coloniale. À la fin des années 1920, il a eu plusieurs débats avec les dirigeants du Parti communiste indien, soulignant toujours la particularité de la position des Dalits et la propagation des pratiques d’intouchabilité dans le monde du travail, et insistant sur la nécessité de donner la priorité à ces questions dans la politique ouvrière. C’est précisément ce que les dirigeants communistes n’ont pas voulu accepter, ce qui a conduit à une rupture avec Ambedkar (Roy, 2016 : 110). Ce dernier, dans son ouvrage The Annihilation of Caste(1936), fait le point sur ces débats en écrivant que la caste est « une division des travailleurs », et même plus précisément « c’est une hiérarchie dans laquelle les divisions des travailleurs sont classées les unes au-dessus des autres » (Ambedkar, 2016 : 233-234). La question de la caste est ici directement abordée sous l’angle de ce que l’on pourrait appeler la composition du travail, de la rupture de son unité comme facteur sociologique et comme sujet politique. Et Ambedkar souligne la pertinence des conflits dans les rangs des travailleurs – conflits qui ont joué un rôle important ailleurs dans le monde, par exemple dans la relation entre les luttes afro-américaines et le mouvement ouvrier aux États-Unis1.
Dans cet essai, je discuterai d’une notion spécifique qui est devenue particulièrement influente pour encadrer la discussion sur l’identité et la politique de l’identité : l’intersectionnalité. Je montrerai que la formulation originale de cette notion était étroitement liée aux débats sur la classe et la politique de classe. Parallèlement, mon argumentation s’inspire d’une préoccupation théorique et politique concernant les principales formes de politiques identitaires contemporaines, qui se nourrissent de notions telles que le « privilège blanc » et d’un langage et de théories « décoloniaux » (Mezzadra, 2021 : 30-33). Si je me méfie des tonalités moralisatrices des politiques identitaires actuelles, ce qui me trouble davantage, c’est la tendance à simplement affirmer une identité subalterne comme une identité fermée et limitée (souvent dans le cadre d’une course visant à établir cette identité comme la plus opprimée et la plus humiliée). Cela rend les alliances, les convergences et les coalitions – ainsi que l’opposition – finalement impossibles (Haider, 2018 : 40). C’est dans ce contexte que j’interroge, dans la dernière section de l’essai, la possibilité, voire la nécessité, de repenser le concept même de classe afin d’ouvrir une perspective politique différente pour les luttes et les mouvements tels que ceux qui sont au centre des théories de l’intersectionnalité. Il va sans dire que cela nécessite d’aller au-delà de la notion traditionnelle de classe que j’ai esquissée plus haut, en la caricaturant en quelque sorte, je l’admets.
L’intersectionnalité, et alors ?
Il y a une chose importante qu’il faut souligner dès le début de cette section. Depuis quelques années, la notion d’intersectionnalité, forgée à l’origine aux États-Unis, commence à voyager. Et comme c’est souvent le cas avec les « théories voyageuses » (Said, 1983, 1994), elle a acquis de nouvelles significations et a même été, d’une certaine manière, réinventée, tout d’abord dans la rue, en dehors du monde universitaire. Cela s’est produit en particulier dans le cadre de la nouvelle vague de mouvements féministes en Amérique Latine et en Europe du Sud, qui utilisaient souvent le slogan Ni Una Menos (Pas une de moins). En Argentine et au Brésil, la notion d’intersectionnalité est utilisée pour articuler et relier les mouvements et les revendications des femmes indigènes et noires, des communautés rurales et métropolitaines, des minorités sexuelles et des femmes vivant dans les bidonvilles, sans perdre de vue leur spécificité, tandis qu’en Italie et en Espagne, elle permet d’aborder les questions de migration, de colonialisme et de sexualité. D’une certaine manière, on peut dire que cette appropriation et ces usages de l’intersectionnalité ont suscité une repolitisation de la notion, où ce qui est en jeu, pour reprendre les mots d’Angela Davis, n’est « pas tant l’intersectionnalité des identités que l’intersectionnalité des luttes » (Davis, 2016 : 144). Il est intéressant de noter que cette notion d’intersectionnalité a également joué un rôle important dans les débats au sein du mouvement massif Black Lives Matter et contre les brutalités policières aux États-Unis à l’été 20202.
J’ai parlé d’une repolitisation de l’intersectionnalité parce qu’au cours des dernières années aux États-Unis, la notion est devenue une sorte de référence académique standard et que son empreinte politique originale a été dans une certaine mesure neutralisée (ce qui ne signifie pas, bien sûr, que de nombreux chercheurs n’ont pas continué à faire un travail très intéressant et même radical dans le cadre de l’intersectionnalité)3. C’est pourquoi il est nécessaire de revenir à l’origine de la notion, et même au-delà, de reconstruire brièvement sa généalogie. Comme je l’ai anticipé plus haut, la référence au monde du travail est fondatrice de l’intersectionnalité. Kimberlé Crenshaw, à qui l’on attribue généralement l’« invention » de la notion, la définit ainsi. L’intersectionnalité, écrit-elle, désigne « les diverses façons dont la race et le sexe interagissent pour façonner les multiples dimensions des expériences professionnelles des femmes noires » (Crenshaw, 1991 : 1244). Discutant de l’affaire De Graffenreid vs. General Motors de 1977, dans laquelle le tribunal a rejeté l’allégation de cinq femmes noires selon laquelle le système d’ancienneté de l’entreprise était discriminatoire à leur égard, Crenshaw écrit fameusement que le refus du tribunal de reconnaître la « discrimination combinée de race et de sexe » reposait sur l’hypothèse « que les limites de la discrimination de race et de sexe sont définies respectivement par les expériences des femmes blanches et des hommes noirs » (Crenshaw, 1989, p. 143). L’interaction de ces frontières obscurcit et supprime effectivement une expérience subjective spécifique dans les rangs des travailleurs, celle des femmes noires. En se concentrant sur une différence aussi négligée, l’intersectionnalité cherche à mettre en lumière le fonctionnement parallèle des systèmes d’oppression et de domination qui hiérarchisent la classe ouvrière.
Écrivant en 1989, Kimberlé Crenshaw était consciente du fait que la notion d’intersectionnalité qu’elle avait forgée à partir d’une perspective spécifique de pensée juridique critique était depuis longtemps en gestation dans la pensée féministe noire ainsi que dans le labeur et les luttes des travailleuses noires aux États-Unis4. Dans la tourmente des années 1970, on trouve par exemple dans la « Déclaration » du Combahee River Collective (1977) une formulation frappante de la problématique de l’intersectionnalité. Nommé d’après le raid d’Harriet Tubman sur la rivière Combahee en Caroline du Sud pendant la guerre civile, qui a libéré 750 personnes asservies, le collectif était une organisation féministe et lesbienne radicale noire formée en 1974 (Taylor, 2017). Comme elles l’écrivent, leur politique se définit par un engagement actif « à lutter contre l’oppression raciale, sexuelle, hétérosexuelle et de classe » et elles considèrent comme leur « tâche particulière le développement d’une analyse et d’une pratique intégrées basées sur le fait que les principaux systèmes d’oppression sont imbriqués les uns dans les autres » (ibidem : 15). Cette notion d’« imbrication » des systèmes d’oppression préfigure clairement l’intersectionnalité. En même temps, elle attire l’attention précisément sur le moment de l’« emboîtement », c’est-à-dire sur les points de jonction et d’articulation entre eux. « Il nous est également difficile », écrit le collectif, « de séparer la race de la classe et de l’oppression sexuelle parce que, dans nos vies, elles sont le plus souvent vécues simultanément » (ibidem : 19). Le concept de « politique identitaire » que les lecteurs peuvent trouver dans l’une de ses premières utilisations dans la « Déclaration » du Combahee River Collective a par conséquent des significations tout à fait différentes de celles qui sont devenues habituelles par la suite. Ce concept est ici un cri de ralliement et de guerre, incitant les femmes noires à se concentrer sur leur « propre oppression » et à lutter pour leur propre libération, qui serait nécessairement une libération générale puisque « notre liberté nécessiterait la destruction de tous les systèmes d’oppression » (ibidem : 23).
Bien avant les années 1970, l’expérience de l’« imbrication » de l’oppression raciale, sexuelle et de classe avait déjà façonné la vie d’une multitude de femmes noires aux États-Unis. Elle a été contestée de multiples façons par les luttes et l’organisation, d’abord contre l’esclavage, puis contre le lynchage et la ségrégation. Alors que les écrits de la première phase de la pensée féministe noire (y compris des noms aussi importants que Sojourner Truth et Ida B. Wells-Barnett) constituent des archives importantes pour quiconque s’intéresse à la généalogie et à la préhistoire de l’intersectionnalité (Gines, 2014), je voudrais m’attarder brièvement sur les débats concernant la condition de la femme noire prolétaire au sein du Parti communiste des États-Unis dans les années 1930 et 1940. Dans les écrits de Louise Thompson et de Claudia Jones, les questions de race et de sexe sont en effet discutées sous l’angle du concept d’exploitation, qui sera plus tard marginalisé dans le débat intersectionnel. Écrivant en 1936, Louise Thompson fournit dans Toward a Brighter Dawn une analyse frappante de la condition des femmes noires, en se concentrant sur une « route du Sud », sur « les plantations du Sud » et sur « Bronx Park, New York ». L’héritage de l’esclavage est présent tout au long de l’article, qui trouve un point culminant dans la description de la situation difficile des employées de maison noires dans le Bronx. Thompson parle d’un « marché aux esclaves » dans le Bronx et le présente comme un « monument graphique de l’amère exploitation de cette section la plus exploitée de la population active américaine – les femmes noires ». Et ce, parce qu’elles « subissent cette triple exploitation – en tant que travailleuses, en tant que femmes et en tant que Noires » (Thompson, 1936).
Plus d’une décennie plus tard, Claudia Jones, née à Trinidad et condamnée à vivre et à travailler au Royaume-Uni après avoir été expulsée des États-Unis en 1955, approfondit cette analyse. Son ouvrage An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman ! (1949) commence par mettre l’accent sur l’augmentation de la participation militante des femmes noires « dans tous les aspects de la lutte pour la paix, les droits civiques et la sécurité économique » (ibidem). C’est face à cette intensification du militantisme que Jones appelle à une nouvelle compréhension du rôle des femmes noires et à la fin de la négligence de ce rôle au sein du mouvement ouvrier. Jones s’attarde sur la position des femmes noires dans les différentes sphères sociales, de la famille aux organisations de masse. Elle analyse soigneusement la condition des travailleurs domestiques noirs, en se concentrant sur les raisons qui conduisent à la relégation des femmes noires aux « tâches domestiques et autres travaux subalternes similaires » et en soulignant leur « insupportable misère » (ibidem). Elle fait écho à Thompson en écrivant que les employées de maison noires « souffrent de l’indignité supplémentaire, dans certaines régions, de devoir chercher du travail dans des “marchés d’esclaves” virtuels dans les rues où des offres sont faites, comme sur un socle à esclave, pour les travailleurs les plus robustes » (ibidem). Il est intéressant de noter qu’elle analyse également les raisons qui divisent les femmes noires et blanches au sein de la classe ouvrière. Le « chauvinisme blanc » fonctionne comme une frontière au niveau sociétal, une frontière qui traverse et divise également la composition de la classe ouvrière. Même l’expérience de l’exploitation est hiérarchisée, comme le montrent clairement les femmes noires. Comme l’écrit Jones, « pas d’égalité, mais dégradation et surexploitation : tel est le sort réel des femmes noires ! » (ibidem).
Les figures de l’oppression
La « triple exploitation » et la « super-exploitation », concepts introduits par Linda Thompson et Claudia Jones, sont clairement des tentatives d’utiliser un langage marxiste pour rendre compte de la condition spécifique des travailleuses noires. La diversification et même la hiérarchisation proposées de l’exploitation soulèvent cependant plusieurs problèmes. C’est notamment le cas lorsque la notion d’exploitation est comprise en termes purement économistes et strictement liée à une interprétation étroite du « travail productif ». Une telle conception économiste de l’exploitation a longtemps prévalu dans le marxisme, y compris aux États-Unis, et a permis de subordonner toutes les formes d’oppression (par exemple, selon les termes de Thompson, l’oppression « en tant que femmes et en tant que Noirs ») à l’exploitation elle-même (« en tant que travailleurs ») et à la politique de classe qui s’y rattache. En conséquence, plusieurs militant·es et universitaires ont commencé à souligner l’autonomie de ces systèmes d’oppression (par exemple, le sexisme et le racisme) et à donner la priorité aux luttes contre eux, en occultant souvent complètement la pertinence de l’exploitation. C’est ce qui caractérise le courant principal des débats sur l’intersectionnalité, qui sont souvent façonnés par une opposition conceptuelle entre l’oppression et l’exploitation (Bohrer, 2019).
L’important ouvrage de Patricia Hill Collins, Black Feminist Thought (publié initialement en 1990), s’inscrit dans une longue tradition de réflexion théorique sur l’héritage de l’esclavage en définissant la condition des femmes afro-américaines à l’aide de la notion d’oppression comme principale référence conceptuelle de son analyse. Il convient de citer longuement l’ouvrage de Collins sur ce point. « L’oppression », écrit-elle, « décrit toute situation injuste dans laquelle, systématiquement et sur une longue période, un groupe refuse à un autre groupe l’accès aux ressources de la société. La race, la classe, le sexe, la sexualité, la nation, l’âge et l’ethnicité, entre autres, constituent les principales formes d’oppression aux États-Unis. Cependant, la convergence de l’oppression fondée sur la race, la classe et le sexe, caractéristique de l’esclavage aux États-Unis, a façonné toutes les relations ultérieures des femmes d’ascendance africaine au sein des familles et des communautés noires américaines, avec leurs employeurs et entre elles. Elle a également créé le contexte politique du travail intellectuel des femmes noires » (Collins, 2000 : 4).
La théorie de Collins sur les « oppressions croisées » a eu une grande influence sur la création du domaine de l’intersectionnalité (ou « matrice de domination », comme elle préférait le dire en 1990). Il est facile de voir que la plupart des « formes d’oppression » mentionnées par Collins (race, genre, sexualité, ethnicité…) sont ouvertes à des processus de multiplication de l’intérieur, et une prolifération des figures d’oppression caractérise en effet les débats sur l’intersectionnalité. Le féminisme chicana, par exemple, a introduit de nouvelles perspectives dans un débat né de la condition et des luttes des femmes noires5, tandis que les thèmes de l’oppression sexuelle et de l’hétéronormativité ont pris de l’importance dans les écrits sur l’intersectionnalité. Cela a conduit à une sorte d’explosion du champ, qui a permis de multiples processus d’expression et de constitution subjectives, mettant en lumière des formes de domination longtemps restées invisibles, et élargissant de manière productive le terrain des luttes pour la libération. En même temps, elle a soulevé des problèmes spécifiques pour une théorie de l’intersectionnalité.
Il est tout à fait vrai que, comme l’écrit Ashley Bohrer, les théoriciens de l’intersectionnalité « se sont opposés aux modèles additifs et multiplicatifs pour leur incapacité à mettre en évidence la constitution mutuelle des structures de domination » (2019 : 102). Néanmoins, il est important de rappeler que la notion d’oppression dans les débats intersectionnels se caractérise par l’accent mis sur l’« irréductibilité » (des systèmes uniques d’oppression), qui va de pair avec l’accent mis sur la « simultanéité », c’est-à-dire avec l’affirmation selon laquelle ces systèmes « sont vécus simultanément et sont inséparables » (Carasthatis, 2016 : 57). Il y a là une tension évidente, et si la critique de la pensée « à axe unique » est un moment constitutif des théories de l’intersectionnalité, on peut dire que le principe d’« irréductibilité » a souvent eu tendance à occulter celui de « simultanéité ». Ce qui est en jeu ici, c’est le risque d’une politique identitaire qui prend la spécificité d’un système d’oppression comme cadre exclusif non seulement pour l’analyse mais aussi pour le processus de constitution du sujet. Il ne s’agit pas de proposer comme alternative une hiérarchisation des oppressions et par conséquent des luttes et des revendications, ce qui est un anathème pour les théories de l’intersectionnalité. Il s’agit plutôt de déplacer l’attention sur le moment unitaire dans le fonctionnement des systèmes de domination et d’oppression et de travailler à l’établissement d’espaces de convergence pour des sujets divers et hétérogènes. La focalisation sur un système d’oppression spécifique peut être un moment important dans un processus de subjectivation, voire nécessaire pour briser les processus de marginalisation et ouvrir de nouvelles perspectives de libération. Néanmoins, lorsque l’« identité » forgée par une telle focalisation se fige, elle risque paradoxalement de reproduire les limites du système d’oppression spécifique qu’elle vise à contester. Et elle devient un obstacle à des processus plus larges de subjectivation.
Dans les débats intersectionnels, ce problème est souvent abordé sous l’angle d’une théorie de la coalition. « Il a fallu un certain temps », écrit Audre Lorde, « avant que nous réalisions que notre place était la maison même de la différence plutôt qu’une différence particulière » (1982 : 226). Ces mots résument bien le point que je viens de soulever sur l’identité et la politique de l’identité. La « maison de la différence » peut être une image puissante pour décrire une coalition intersectionnelle, entrelaçant solidarité et résistance vers une politique capable de faire « naître les mondes dont nous avons vraiment besoin » (Bohrer, 2019 : 257). Une telle coalition, comme le souligne à juste titre Bohrer (ibidem : 256), est nécessairement différente de ce qui est traditionnellement compris comme le plus petit dénominateur minimum parmi différents groupes. Si, dans ce cas, la subjectivité et l’identité des collectifs impliqués restent intactes, une coalition intersectionnelle est un espace de convergence pour une multitude de personnes diverses et hétérogènes, au sein duquel de nouvelles subjectivités et même identités sont continuellement fabriquées dans le cadre d’une lutte commune pour la libération. Il va sans dire que l’unité même d’une coalition n’est pas donnée d’avance, elle est elle-même en jeu dans ce processus de subjectivation.
Classe, le retour
La critique de la notion économiste d’exploitation que j’ai esquissée plus haut a conduit à une marginalisation de la classe, et même du capitalisme, dans de nombreux débats sur l’intersectionnalité. Comme cela s’est produit dans les études culturelles et postcoloniales (Mezzadra, 2011), le capital et le capitalisme ont été confinés au domaine de l’« économie », tandis que la classe était souvent identifiée aux travailleurs blancs, masculins et hétérosexuels dans le cadre d’une relation d’emploi standard. Les systèmes d’oppression différentiels tels que le sexisme et le racisme étaient considérés comme opérant en marge du capitalisme, qui pouvait définitivement instrumentaliser les processus de hiérarchisation qu’ils généraient sans cesser d’être un pouvoir fondamentalement homogénéisant. Je suis convaincue qu’une telle compréhension du capitalisme est profondément erronée, et qu’un regard différent sur l’histoire et le fonctionnement contemporain du capitalisme pourrait nous fournir un moyen efficace d’aborder la question de la « simultanéité » des systèmes d’oppression soulevée par les théories de l’intersectionnalité.
Ce qui est en jeu ici, c’est tout d’abord la question de la relation du capital avec la « différence » (Mezzadra et Neilson, 2019 : 32-38). C’est une question qui a été recadrée au cours des dernières années par les historiens du colonialisme et les historiens mondiaux du travail, par les universitaires postcoloniaux et les chercheurs critiques travaillant sur le thème du développement. Il y a un consensus émergent sur le fait que ce que Lisa Lowe appelle la « production sociale de la “différence” » (1996 : 28) est un moment distinct et crucial dans les opérations du capital, qui travaille en tandem avec (et permet) la production de « travail abstrait » en tant que norme pour la reproduction du capitalisme au sens large. Dans mon travail avec Brett Neilson (2013, 2019), j’ai soutenu que l’interaction entre la différence et l’abstraction, ou l’homogénéité et l’hétérogénéité, est particulièrement apparente dans le fonctionnement du capitalisme mondial contemporain. Cette interaction concerne en particulier la question du travail. Suivant la définition de Marx de la force de travail comme « l’ensemble des attitudes et des capacités » contenues dans le corps, « la personnalité vivante d’un être humain » (Marx, 1976 : 270), je soutiens qu’il est nécessaire de souligner l’écart entre la part des attitudes et des capacités et leur « contenant », le corps (Marx utilise le mot allemand Leiblichkeit, dont la matérialité absolue n’est pas rendue de manière adéquate par la traduction anglaise « forme physique »).
Une telle insistance sur le corps ouvre de nouveaux continents à la compréhension de la force de travail ainsi que de sa production en tant que marchandise. Ce qui est en jeu ici, c’est ce que nous pouvons appeler la production de la subjectivité qui est nécessaire à l’existence même de cette marchandise. La fabrication différentielle de corps hiérarchisés, où les systèmes d’oppression comme le sexisme et le racisme ont un rôle de premier plan à jouer, émerge comme un moment crucial dans la production de la force de travail en tant que marchandise, qui est, selon Marx, la pierre angulaire sur laquelle repose rien de moins que l’existence du capitalisme. La frontière même entre la production et la reproduction, ainsi qu’entre le travail productif et le travail improductif, apparaît évaluée et floue de ce point de vue. Et il est facile de voir qu’une compréhension purement économiste du capitalisme et de l’exploitation devient intenable. Le moment que j’ai appelé d’une production de subjectivité a des dimensions plutôt multiples qu’il faut reconnaître comme internes à l’exploitation. Nous sommes ici confrontés à une panoplie de figures subjectives (exploitées), dont l’expérience de l’oppression et de l’exploitation est certainement médiatisée par différentes positions de sujet (où par exemple le racisme, le sexisme ou l’hétéronormativité peuvent prévaloir) tandis que leur « simultanéité » est orchestrée par les opérations du capital.
La classe est aujourd’hui composée de cette multitude de différences qui vivent, peinent et luttent sous la pression de l’exploitation du capital. La multiplicité est la marque de la classe. Bien que je souligne la pertinence d’une notion non économiste de l’exploitation pour repenser la classe aujourd’hui, il est nécessaire d’ajouter que la politique de classe exige aujourd’hui une panoplie de mouvements et de luttes qui vont bien au-delà des frontières de classe. Une fois que nous reconnaissons la pertinence constitutive pour le fonctionnement de l’exploitation du racisme et du sexisme, par exemple, les mobilisations contre eux, qui peuvent bien inclure des personnes qui ne sont pas « exploitées », sont de la plus haute importance – et ne peuvent jamais être considérées comme s’attaquant à une sorte de contradiction « secondaire ». Parallèlement à ces luttes transversales, il est nécessaire de forger et de pratiquer de nouvelles formes de solidarité et des espaces de convergence, où l’intersectionnalité devient une méthode pour une multiplicité de rencontres et pour contrer toute ossification des politiques identitaires. Ce dernier peut certainement jouer un rôle positif dans l’ouverture de nouveaux champs de lutte, mais il risque toujours de devenir un obstacle à des processus plus larges de subjectivation – à la construction d’une base plus efficace pour les luttes contre l’exploitation et l’oppression. La notion de classe, une « classe multitudinaire » ou une « classe intersectionnelle » pour le dire avec Michael Hardt et Toni Negri (2019 : 84), donne un nom subjectif à cette base et ouvre de nouvelles pistes d’investigation et d’intervention politique. Et la réinvention de l’intersectionnalité que j’ai évoquée plus haut (en tant qu’« intersectionnalité des luttes », pour rappeler les mots d’Angela Davis) semble préfigurer une nouvelle politique de solidarité et même une nouvelle politique de classe.
Le 5 octobre 2021, publié par Papeles de Identidad, traduit par Laurent Creuse
Références
Ambedkar, B.R. (2016). The Annihilation of Caste. Ed. and annotated by S. Anand, London – New York: Verso.
Bohrer, A.J. (2019). Marxism and Intersectionality. Race, Gender, Class, and Sexuality Under Contemporary Capitalism. Bielefeld: Transcript.
Carasthatis, A. (2016). Intersectionality. Origins, Contestations, Horizons. Lincoln and London: University of Nebraska Press.
Collins, P.H. (2000). Black Feminist Thought. Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment, second edition. New York and London: Routledge.
Crenshaw, K.C. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory, and Antiracist Politics. University of Chicago Legal Forum, 140, 139-167.
Crenshaw, K.C. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.
Davis, A. (2016). Freedom is a Constant Struggle. Ferguson, Palestine, and the Foundations of a Movement. Chicago: Haymarket Books.
Gines, K.T. (2014). Race Women, Race Men and Early Expressions of Proto-Intersectionality. In N. Goswami, M. O’Donovan & L. Yount (Eds.). Why Race and Gender Still Matter: An Intersectional Approach (pp. 13-26). London: Pickering & Chatto.
Haider, A. (2018). Mistaken Identity. Race and Class in the Age of Trump. London – New York: Verso.
Hardt, M., & Negri, T. (2019). Empire, Twenty Years On. New Left Review, 120, 67-92.
Jones, C. (1949). An End to the Neglect of the Problems of the Negro Woman! In New Frame. Available at: https://www.newframe.com/from-the-archive-an-end-to-the-neglect-of-the-….
Lorde, A. (1982). Zami: A New Spelling of My Name. A Biomythography. Berkley, Calif.: The Crossing Press.
Lowe, L. (1996). Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics. Durham, NC: Duke University Press.
Marx, K. (1976). Capital, Vol. 1. New York: Vintage Books.
Mezzadra, S. (2011). Bringing Capital Back In: A Materialist Turn in Postcolonial Studies? Inter-Asia Cultural Studies, 12(1), 154-164.
Mezzadra, S. (2021). Challenging Borders. The Legacy of Postcolonial Critique in the Present Conjuncture. Soft Power, 7(2), 21-44.
Mezzadra, S., & Neilson, B. (2013). Border as Method, or, the Multiplication of Labor. Durham: Duke University Press.
Mezzadra, S., & Neilson, B. (2019). The Politics of Operations. Excavating Contemporary Capitalism. Durham: Duke University Press.
Nash, J.C. (2019). Black Feminism Reimagined After Intersectionality. Durham: Duke University Press.
Roediger, D. (1991). The Wages of Whiteness: Race and the Making of American Working Class. London – New York: Verso.
Roy, A. (2016). The Doctor and the Saint. In B.R. Ambedkar (Ed.). The Annihilation of Caste (pp. ). London – New York: Verso.
Said, E.W. (1983). Traveling Theory. In The World, the Text, and the Critic (pp. 226–247). Cambridge: Harvard University Press.
Said, E.W. (1994). Traveling Theory Reconsidered. In Reflections on Exile and Other Essays (pp. 436-452). Cambridge: Harvard University Press.
Taylor, K.-Y. (2017). How We Get Free. Black Feminism and the Combahee River Collective. Chicago: Haymarket Books.
Thompson, D. (2020). The Intersectional Politics of Black Lives Matter. In A. Dobrowolsky & F. MacDonald (Eds.). Turbulent Times, Transformational Possibilities? Gender Politics Today and Tomorrow (pp. 240-257). Toronto: University of Toronto Press.
Thompson, L. (1936). Toward a Brighter Dawn. In Viewpoint Magazine (2015).