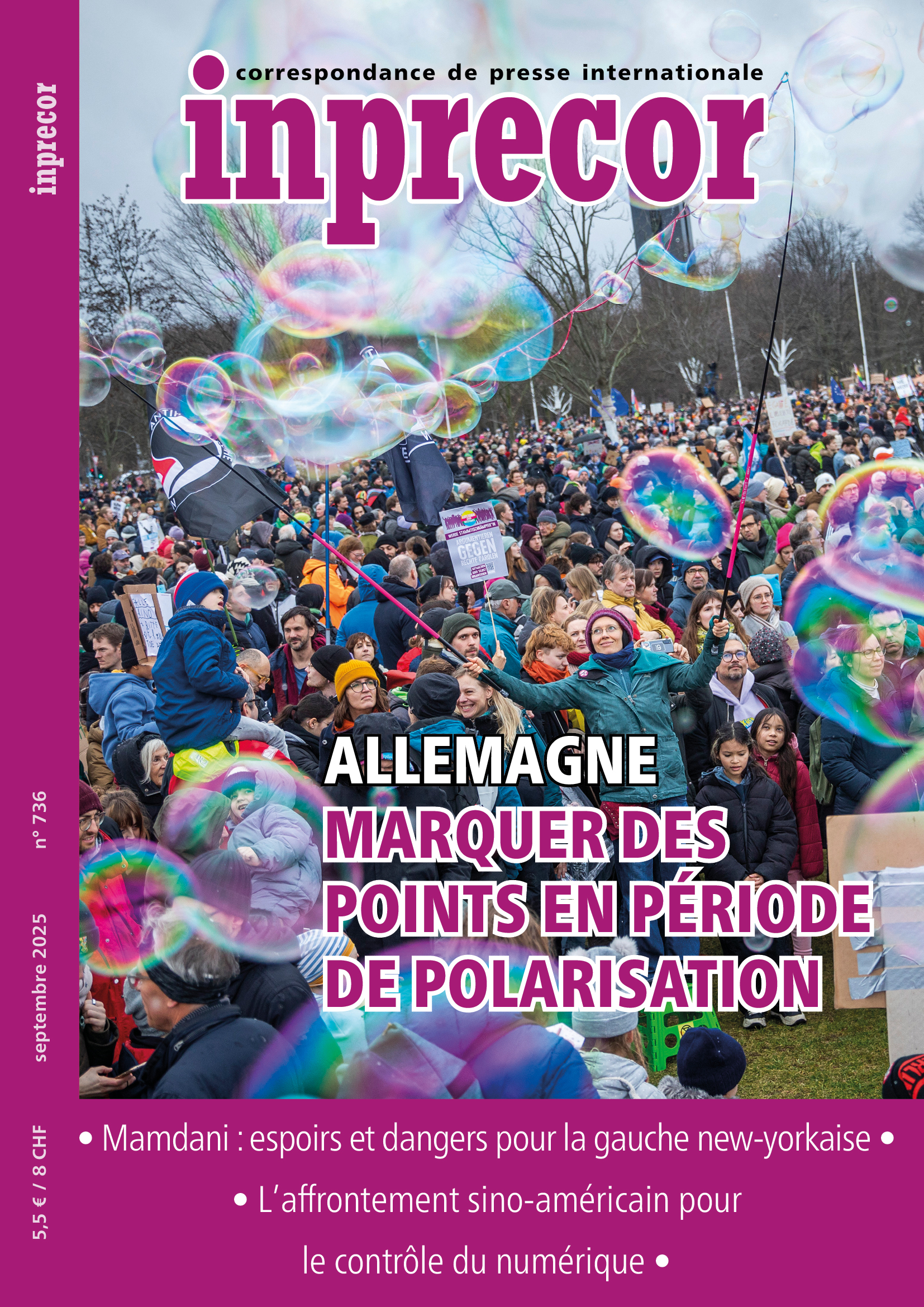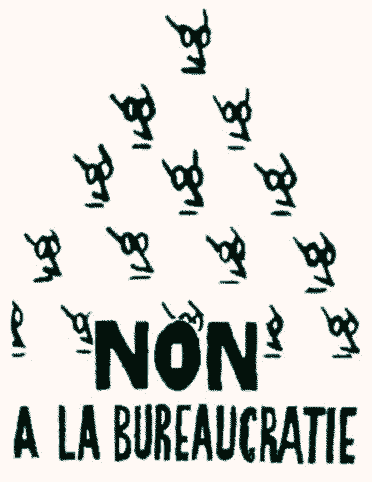
« La seconde grande question qui taraude Mandel est celle des phénomènes de bureaucratisation dans la société en général, dans le mouvement ouvrier en particulier, et dans les pays du socialisme réellement inexistant. S’agit-il d’une tendance inéluctable, inhérente au procès de rationalisation et de désenchantement moderne ? Ou bien du produit historique non fatal de la division sociale du travail. Ce thème est traité systématiquement dans l’un des derniers livres, Power and Money » – Daniel Bensaïd. Le marxisme d’Ernest Mandel
La dégénérescence bureaucratique de l’URSS a été parmi les grands sujets qui ont traversé le court XXème siècle, et, pour les marxistes révolutionnaires, une des grandes interrogations sur les capacités de maintenir un processus révolutionnaire une fois que le renversement d’un pouvoir bourgeois s’est produit. Dans cette contribution, Marion Beauvalet revient sur les apports d’Ernest Mandel qui a été l’un des contributeurs les plus prolifiques à ce propos.
Récemment édité par les éditions La Brèche, Aux sources du phénomène bureaucratique nous présente une analyse systématique sociologique de la bureaucratie en URSS. Cet ouvrage est constitué de deux textes à savoir Power and Money d’Ernest Mandel (1992) et un texte plus court, Ouvriers et bureaucrates, comment les rapports d’exploitation se sont formés et ont fonctionné dans le bloc soviétique de Zbignew Marcin Kowalewski1. Dans cet article, nous nous concentrerons sur le premier texte cité, que nous mettrons en relation avec deux autres textes du même auteur, à savoirDe la bureaucratie (1978) et Où va l’URSS de Gorbatchev ? (1989). La date de publication de 1992 peut donner le sentiment d’une publication à contretemps, dans le sens où cette étude paraît après l’effondrement de l’URSS. Avec la perspective historique, ce texte dense acquiert une pertinence accrue, notamment parce qu’il permet de porter un regard rétrospectif sur la bureaucratisation des régimes soviétiques. Mandel n’a jamais cessé de se pencher sur cette question au cours de sa vie, offrant une réflexion continue et évolutive sur la bureaucratie, qu’il percevait comme un processus à la fois politique et économique, enraciné dans les contradictions mêmes des sociétés socialistes.
Quelques repères biographiques
Ernest Mandel est une figure centrale de la IVᵉ Internationale, né en avril 1923 à Francfort-sur-le-Main et décédé en avril 1995 à Bruxelles. Théoricien, militant internationaliste et responsable politique, il s’est distingué par son opposition au stalinisme, bien qu’il considère ce dernier comme un phénomène temporaire. Son combat principal reste dirigé contre le capitalisme, comme l’a relevé Gilbert Achcar. Mandel combine une analyse scientifique rigoureuse, particulièrement en ce qui concerne l’économie et les structures capitalistes, avec une participation active dans les organisations auxquelles il était affilié. Issu d’une famille juive polonaise ayant quitté l’Allemagne pour la Belgique face à la montée du nazisme, son père, ancien membre du Spartakusbund, avait combattu aux côtés de Rosa Luxemburg et s’était opposé au fascisme et également au stalinisme dans les années 1930. Mandel est à l’origine d’une œuvre variée, dont de nombreux textes n’ont toujours pas été traduits en français, y compris des introductions en anglais à certaines parties du Capital et des travaux de mise à jour et de réappropriation des thèses marxistes. Il écrit également en anglais et en flamand. Son ouvrage le plus connu est le Troisième âge du capitalisme que Perry Anderson (1978) qualifie comme « la première analyse théorique du développement global du mode de production capitaliste depuis la Seconde Guerre mondiale, conçue dans le cadre des catégories marxistes classiques » (cité dans Contretemps).
Avant d’entrer à proprement parler dans la recension du texte, prenons le temps d’un détour biographique pour situer l’œuvre et l’engagement – les deux étant intrinsèquement liés – de Mandel. Daniel Bensaïd décrit Mandel comme « l’une des dernières figures symboliques de la grande tradition culturelle du mouvement ouvrier moderne, né au début du siècle, à la charnière entre l’héritage des Lumières et le mouvement socialiste naissant »2. « Mandel était connu non seulement comme le théoricien principal de la Quatrième Internationale, mais aussi comme l’un des plus grands économistes marxistes de la deuxième moitié du vingtième siècle »3 affirme quant à lui Michael Löwy, qui le qualifie d’humaniste révolutionnaire, dans le sens où chez Mandel l’avenir de l’humanité dépend de la lutte des classes (un élément central chez lui que l’on retrouve en ouverture de Power and Money par exemple). Bensaïd et Löwy ont par ailleurs milité avec Mandel. C’est dans cette perspective que Mandel écrit que
« les marxistes ne combattent pas l’exploitation, l’oppression, la violence massive contre les êtres humains et l’injustice à grande échelle uniquement parce que cette lutte promeut le développement des forces productives ou un progrès historique étroitement défini… Encore moins, combattent-ils ces phénomènes uniquement dans la mesure où il est scientifiquement démontré que la lutte prendra fin avec la victoire du socialisme. Ils combattent l’exploitation, l’oppression, l’injustice et l’aliénation en tant que conditions inhumaines, indignes. C’est un fondement et une raison suffisantes »4.
Précisons qu’à l’instar d’autres marxistes (et dans le prolongement des analyses différentes de figures comme Léon Trotski5 et Rosa Luxemburg6), c’est la dégradation de la situation ouverte par la révolution d’Octobre qui pousse Mandel à s’intéresser à une autre forme d’exploitation et d’aliénation, à savoir celle résultant de la bureaucratisation de l’État ouvrier soviétique et du recul des mouvements révolutionnaires. Selon lui, il devenait essentiel de reconstituer progressivement l’avant-garde ouvrière en réorganisant les divers mouvements sociaux d’émancipation à l’échelle internationale. Mandel souligne que même la planification économique peut masquer des relations sociales d’exploitation et d’aliénation, notamment dans les secteurs de production soumis à une planification centralisée, et même en l’absence de participation active de la monnaie.
L’anayse mandélienne se positionne aussi comme une relecture critique de l’analyse wéberienne de la bureaucratie. Ainsi, Mandel écrit que même si la théorie de Weber critique certains aspects de la bureaucratie, elle constitue « dans une grande mesure, une défense et une apologie de la bureaucratie » (Power and Money, p.260). La critique la plus forte réside dans le fait que Weber estime que « la gestion bureaucratique est intrinsèquement rationnelle », or une rationalité croissante de chaque secteur (indépendamment des uns des autres) ne correspond à rien d’autre qu’une irrationalité croissante du système dans son ensemble. À ce propos, Weber ne dit rien. C’est par exemple ce que traduisent les crises de surproduction ou les guerres toujours plus violentes, pour ne citer que quelques exemples choisis par Ernest Mandel. Cette irrationalité n’est pas une erreur de jugement de la bureaucratie mais « le résultat inévitable des contradictions internes de la société bourgeoise » (p.262)7.
La bureaucratie selon Ernest Mandel
Pour Mandel, la bureaucratie est une entité dynamique dont la définition varie selon les contextes socio-économiques. Elle peut être un appareil d’État consolidé, comme c’est le cas dans les régimes soviétiques, mais aussi un phénomène plus diffus, enraciné dans la division du travail et l’autonomisation des appareils administratifs et syndicaux. Il distingue ainsi la bureaucratie comme classe spécifique, surtout dans les sociétés socialistes, où elle devient un obstacle à la réalisation des idéaux communistes, tout en restant critique de sa formation dans les sociétés capitalistes, où elle agit comme un mécanisme de régulation sociale pour éviter les soulèvements prolétariens. D’une caractérisation précise, on aboutit à l’évocation dans Où va l’URSS de Gorbatchev ? à une mention systématique de la bureaucratie à chaque échelon de la société (dans les hôpitaux, etc.). Dans son analyse de la bureaucratie, Mandel met en avant les conséquences de la délégation de pouvoir et de la division du travail dans les sociétés sous-développées et estime que les effets sont amplifiés par des facteurs politiques. En étudiant la bureaucratisation de l’État ouvrier, il renforce ses arguments et conclusions militantes : seul le travailleur, à travers son activité et son auto-organisation, peut garantir le double dépérissement de l’État et du marché, conditions nécessaires pour tout projet socialiste d’avenir.
Dans De la bureaucratie, Mandel postule que, parmi les groupes non producteurs, la bureaucratie joue un rôle prédominant dans la société soviétique. Elle exerce une influence considérable sur le développement des sociétés socialistes. Selon lui, la bureaucratie constitue une catégorie à part, capable de se reproduire et de s’autonomiser. Dans le contexte socialiste, cela va souvent en contradiction avec les intérêts du prolétariat, qu’elle serait pourtant censée représenter, ainsi que le « problème de l’appareil des organisations ouvrières : problème des permanents, problème des intellectuels petit-bourgeois qui apparaissent à des fonctions de direction moyenne ou supérieure, au sein des organisations ouvrières ». En effet, le développement d’organisations de masse politiques ou syndicales nécessite la création d’un appareil, en partie composé de permanents. Cependant, cet appareil tend à s’autonomiser et certains de ses membres peuvent capter des privilèges qui sont de différents ordres. De cette autonomisation relative qui a été envisagée selon lui par tous les « marxistes sérieux » (p. 268), à l’instar de Trotski ou Gramsci, résulte dès lors une séparation des « dirigeants » qui se construit sur l’acquisition de compétences, de spécialisation technique, de pouvoir de décision, de possibilité de représentation, du reste de la société. La détention de postes d’élus accroît les risques de bureaucratisation, avec le développement de postes de collaborateurs. De même, à l’échelle individuelle, une personne risquera de viser davantage à sa réélection pour différentes formes d’avantages que son statut lui procure (il ne s’agit pas nécessairement d’un capital économique comme l’indique le titre de l’ouvrage Power and Money), au détriment de la cause qu’elle est censée porter.
Selon Mandel, la bureaucratisation des États ouvriers, se déroule en trois phases, à savoir :
1/ « D’abord, les seuls privilèges d’autorité et les avantages politiques issus du monopole de pouvoir au sein de l’appareil d’État ;
2/ Ensuite, surtout à l’intérieur d’un pays arriéré, naissance des privilèges bureaucratiques aussi bien sur le plan matériel que culturel ;
3/ Finalement, la dégénérescence bureaucratique complète, lorsque la direction ne résiste plus à ce phénomène, l’accepte consciemment, s’y intègre, en devient le moteur et essaie d’accumuler les privilèges » (De la bureaucratie, p.5).
Il prend pour exemple les comptes en banque fixes (un compte dont le crédit est toujours au même niveau, donc une possibilité de consommer autant que l’on veut) et les magasins spéciaux (un phénomène, né à l’époque stalinienne, qui a continué d’exister dans la plupart des États ouvriers jusqu’en 1956-57).
Caractériser la bureaucratie : classe ou couche sociale ?
Dans De la bureaucratie, Mandel caractérise ce groupe comme l’un des « groupes non fondamentaux qui ne sont pas des classes, qui n’ont pas de racines dans le processus de production, mais qui n’en jouent pas moins un rôle important dans le développement de notre société de transition entre le capitalisme et le socialisme ». Si la bureaucratie correspond souvent à un groupe vu comme parasitaire et conservateur, il convient d’en saisir précisément les caractéristiques, ses manifestations dans le monde ouvrier (à la fois au niveau de l’État que dans les structures politiques et syndicales) pour envisager des pistes de réponses à ce que Mandel, à l’instar d’autres théoriciens, présente comme un problème.
Pour Mandel, ces privilèges correspondent au moment où les organisations « commencent à occuper des positions de force à l’intérieur de la société capitaliste ». En ce sens, la bureaucratie correspond également à la défense d’intérêts matériels et de privilèges. Mandel met en garde contre une analyse simpliste de la bureaucratie, réduite à la défense d’intérêts matériels. Pour lui, cette couche sociale se distingue par des motivations plus complexes, où se mêlent une idéologie propre, un sentiment de légitimité lié à son rôle dans l’appareil d’État, et une tendance à l’autonomisation vis-à-vis du prolétariat. Mandel montre que la bureaucratie, en s’appropriant des compétences spécifiques et en monopolisant la gestion administrative, finit par se distancer des travailleurs qu’elle prétend représenter, devenant ainsi une force conservatrice dans les régimes socialistes. Il ne s’agit pas d’une couche en rupture totale avec la classe ouvrière mais d’une couche selon Mandel qui se comporte en catégorie parasitaire ou privilégiée. Dans les faits, Mandel analyse que l’apparition d’un appareil avec des permanents va de pair avec l’essor même du mouvement ouvrier et l’apparition d’organisations de masse. Ce n’est donc à ce stade paradoxalement pas un problème en soi, mais plutôt le signe d’une bonne santé du mouvement ouvrier à un moment précis de l’Histoire. Les causes à cela ? L’objectif de ces organisations est de « combler les lacunes créées par la condition prolétarienne au sein de la classe ouvrière ». Cela entraîne néanmoins une spécialisation de certains qui peuvent se consacrer pleinement et intégralement à l’activité syndicale et ouvrière, là où les travailleurs doivent eux travailler pour assurer leur subsistance et celle de leur famille et participer à la reproduction capitaliste. L’émergence de la bureaucratie sous le capitalisme et dans les sociétés post-capitalistes trouve ses racines dans la reproduction de la division sociale du travail entre travail manuel et travail intellectuel. Cette division engendre une couche d’officiels à plein temps qui administrent des partis, des syndicats de masse ou un appareil d’État. Dans la plupart des cas, cette couche évolue de manière distincte de la classe ouvrière, en ayant ses propres intérêts matériels, sa propre politique et sa propre idéologie. Elle n’améliore pas l’efficience ou l’efficacité des organisations de masse des travailleurs, au lieu de cela leur monopole du pouvoir sape la capacité de la classe ouvrière à défendre ses intérêts les plus immédiats sous le capitalisme et à construire une alternative viable au capitalisme. En ce sens, une « minorité militante », à laquelle vient s’ajouter des intellectuels (cela ne sera pas développé ici mais Mandel s’y intéresse notamment dans Les étudiants, les intellectuels et la lutte des classes publié en 1979) qui sont dotés de capitaux culturels dont est exclue la majorité de la classe ouvrière, va assumer l’administration des syndicats et partis.
On trouve une analyse similaire dans Les leçons d’Octobre de Trotski (1924), lorsque ce dernier écrit que
« tout parti, même le plus révolutionnaire, élabore inévitablement son conservatisme d’organisation : sinon, il manquerait de la stabilité nécessaire. Mais, en l’occurrence, tout est affaire de degré. Dans un parti révolutionnaire, la dose nécessaire de conservatisme doit se combiner avec l’entier affranchissement de la routine, la souplesse d’orientation, l’audace agissante […] Le conservatisme du Parti, comme son initiative révolutionnaire, trouvent leur expression la plus concentrée dans les organes de la direction ».
Le recul historique permet en quelque sorte d’approfondir et affirmer cette analyse.
Comment se constitue la bureaucratie ? La bureaucratie intègre des membres qui se distinguent par des dispositions différentes. Mandel cite par exemple l’intelligence, le sens de l’initiative, le sens pratique ou encore le fait de n’avoir que peu de scrupules (p.125). Ces caractéristiques permettent le développement d’une couche moyenne de la bureaucratie :
« il est vrai qu’aujourd’hui, on trouve difficilement des fils et des filles de travailleurs manuels dans les couches supérieures de la nomenklatura. Mais d’un autre côté, seule une minorité d’entre eux sont d’anciens hauts bureaucrates ».
La bureaucratie soviétique permet une légère ascension sociale, chose qu’il nuance dans Où va l’URSS de Gorbatchev où il fait davantage de la bureaucratie une instance de reproduction sociale (accès à des réseaux d’interconnaissance, des universités, etc.).
De plus, comme l’a analysé Trotski dans Staline (1940), il ne s’agit pas d’une bureaucratie ouvrière pure :
« l’armée du Thermidor soviétique était recrutée essentiellement parmi les restes des anciens partis dirigeants et leurs représentants idéologiques. Les anciens grands propriétaires fonciers, les capitalistes, les avocats, leurs fils – c’est-à-dire ceux d’entre eux qui n’avaient pas fui à l’étranger – étaient incorporés dans la machine de l’État, et même une portion non négligeable dans le Parti, mais le plus grand nombre de ceux qui furent admis dans les appareils de l’État et du Parti étaient d’anciens membres de formations petites-bourgeoises ».
Ce à quoi il faut ajouter des gens qui « se vouaient avec une passion singulière à la noble tâche de s’assurer des emplois agréables et permanents ». Néanmoins, dans le Programme de transition, Trotski estime que ce rapport de force n’est pas voué à perdurer. Comment expliquer la perte de vue de l’objectif plus large par les membres de la bureaucratie ? Pour Mandel, cela ne vient pas seulement de la défense des intérêts matériels mais aussi de la répétition qui a deux conséquences, à savoir la fétichisation et la réification, par la répétition des mêmes gestes, les mêmes tâches, c’est l’activité qui doit être accomplie qui devient un objectif en soi et non le cadre plus large dans lequel elle s’inscrit (construire une organisation révolutionnaire, construire la révolution). Il y a dès lors un désencastrement du geste, de l’action du cadre plus global (citons l’organisation du mouvement ouvrier et l’objectif d’abolition du capitalisme ou l’organisation de la grève générale) pour se placer du point de vue des organisations qui façonnent le mouvement ouvrier.
La structure qui devrait être le moyen de cela devient progressivement une fin en soi pour les personnes qui constituent la couche de permanents que Mandel qualifie de bureaucrates en herbe. Cette rapide esquisse du fonctionnement des organisations dès lors qu’elles atteignent un certain niveau de structuration donne un cadre idéologique et débouche sur « le phénomène de la dialectique des conquêtes partielles ». De quoi s’agit-il ? Selon Ernest Mandel, ces conquêtes partielles constituent une dialectique qui finit par se retourner contre le mouvement ouvrier. Il s’agit par exemple de la baisse de la conflictualité sociale, de l’affaissement du niveau de conscience, affaiblissement et de l’adaptation idéologique des appareils. Tout cela alimente une spirale régressive difficile à inverser : les bureaucrates sont « [ceux qui] se comportent comme si toute nouvelle conquête du mouvement ouvrier devait être subordonnée de manière absolue et impérative à la défense de ce qui existe » (De la bureaucratie, p.3).
Ce cercle vicieux s’avère particulièrement dur dans un contexte de reflux des mobilisations, puisqu’il génère des attitudes conservatrices. À cet égard, Trotski décrit que « celui qui ne sait pas défendre les conquêtes existantes n’en fera jamais de nouvelles ». En effet, le fait de considérer qu’un saut révolutionnaire « menace automatiquement les conquêtes ultérieures » relève d’une attitude conservatrice. Pour traduire concrètement ce paradoxe, Mandel s’appuie sur quelques exemples des partis communistes dans les pays où ces derniers ne sont pas au pouvoir, comme c’est le cas, en France ou en Italie, dans les années 1960. Dans certains pays le salaire des permanents n’est par exemple pas supérieur à celui des ouvriers qualifiés donc l’explication est ailleurs, « par contre, joue à plein le phénomène de la dialectique des conquêtes partielles : identification du but et des moyens, de l’individu bureaucratique et de l’organisation, du but historique à atteindre et de l’organisation, cette identification devenant une cause profonde d’attitude conservatrice susceptible de s’opposer très violemment aux intérêts du mouvement ouvrier ». Cela entraîne comme problème que
« cette dialectique se manifeste dans les comportements de ceux qui subordonnent la poursuite et la victoire des luttes ouvrières pour parvenir à la conquête du pouvoir dans les pays capitalistes à la seule défense des organisations ouvrières existantes ; de ceux qui subordonnent sur le plan international l’expansion de la révolution mondiale et le développement de la révolution coloniale à la défense statique de l’Union Soviétique et des États ouvriers. Ils se comportent comme si les éléments de démocratie ouvrière au sein du monde capitaliste et l’existence d’États ouvriers étaient des buts en soi, étaient déjà l’achèvement du socialisme. Ils se comportent comme si toute nouvelle conquête du mouvement ouvrier devait être subordonnée de manière absolue et impérative à la défense de ce qui existe. Cela crée une mentalité fondamentalement conservatrice. […] Dès que cela n’est plus vrai à cent pour cent, dès qu’une partie du prolétariat (soit la bureaucratie ouvrière, soit l’aristocratie ouvrière constituée dans le prolétariat des pays impérialistes développés) possède une organisation ou un niveau de vie supérieur à l’état de néant initial, il y a risque de développement d’une nouvelle mentalité. Il n’est plus exact que le prolétariat n’ait plus rien à défendre : dans chaque nouvelle action, il faut peser le pour et le contre : est-ce que l’action envisagée ne risque pas, au lieu d’apporter quelque chose de positif, de faire perdre ce que l’on possède déjà ? »
écrit également Mandel. Dans cette perspective, la situation soviétique existe avant même la dégénérescence stalinienne.
En 1987, un article publié dans Quatrième Internationale intitulé Bureaucratie et Production Marchande permet à Mandel de s’interroger sur la position de la bureaucratie dans la société soviétique. Ce texte lui permet de dessiner un parallèle entre les fractions des couches supérieures de la bureaucratie soviétique et les couches rentières parasitaires que l’on retrouve dans le capitalisme monopolistique. Dans ce même texte, il estime que
« si l’on assiste en Union soviétique et dans les sociétés similaires à une transformation embryonnaire de parties de la bureaucratie en une « classe dirigeante », ce n’est pas d’une « nouvelle classe dirigeante bureaucratique » qu’il s’agit, mais bien de l’embryon de la bonne vieille classe de capitalistes et de propriétaires privés des moyens de production. Si elle devait se réaliser, cette transformation des bureaucrates en capitalistes reflèterait le processus par lequel la loi de la valeur parviendra finalement à dominer l’économie soviétique au lieu de l’influencer. Un tel processus exige une généralisation de la production marchande, c’est-à-dire une transformation des moyens de production et de la force de travail en marchandise ».
Ce faisant, il discute l’économiste et historien Charles Bettelheim et plus précisément son texte Les Luttes de Classe en Union Soviétique (1974). Pour Mandel, l’aspect dualiste des prix soviétiques (comme coexistence de prix déterminés arbitrairement dans le cadre de la planification avec des prix déterminés par la loi de la valeur) empêche la bureaucratie de devenir une classe dominante. Pour le devenir, il faudrait que seule la loi de la valeur subsiste. Il n’y a pas non plus de nouveau mode de production associé à la bureaucratie. Dans Power and Money et Où va l’URSS de Gorbatchev, Mandel décrit le fonctionnement de la société soviétique par des systèmes de représentations pyramidales. On assiste à un mouvement plus large de restructuration de la société avec des systèmes de promotion interne dans chaque catégorie de la bureaucratie (bureaucratie policière, bureaucratie des organisations de masse, de jeunesse, administration centrale de l’économie, bureaucratie de la culture). Chaque strate de la société va fonctionner via des mécanismes de promotion interne où interviennent de l’intérieur des membres du Parti. Un autre problème vient enrichir ce retournement de la dialectique moyen / fin qui est celui du substitutisme. Ce phénomène déjà analysé par Trotski, correspond au moment où le Parti se substitue aux masses laborieuses (en agissant en leur nom et à leur place sans se référer à ce qui peut les motiver principalement, ce qui pose un problème comme la bureaucratie produit une propre idéologie et est mue par des intérêts spécifiques). La seule garantie trouvée contre le « substitutisme » réside dans le parti de masse prolétarien, dirigé démocratiquement, ce que Trotski nomme « un parti à base large ».
Le développement des bureaucraties bourgeoises et l’appareil d’État en système capitaliste
Jusqu’à maintenant, nous nous sommes surtout intéressés à la bureaucratie soviétique. Cependant, Mandel ne limite pas son analyse de la bureaucratie à ce régime et s’intéresse également à son fonctionnement dans un système capitaliste. La fonction de celle-ci est de « réduire les risques d’explosion sociale » (p.225). Cette bureaucratie se décline par strate de la société jusqu’au niveau municipal, ce qui l’invite à produire une critique du socialisme municipal. Il analyse par ailleurs une phase de dégénérescence des partis de masse dès le milieu des années 1970 avec l’incursion dans les organisations d’hommes d’affaires, à l’instar de Jean-Baptiste Doumeng, membre du PCF. De même, la multiplication des élus dans des organisations a une implication sur la direction des partis, d’autant plus quand le parti demeure dans l’opposition. Cela engendre une forme de socialisme gestionnaire qui, selon Mandel, devient de plus en plus indifférent aux besoins des masses : il correspond en fait à l’émergence et à la primauté progressive du credo qu’il est possible de gagner si démonstration est faite que les forces censées représenter le mouvement ouvrier sont des meilleures gestionnaires que les autres (p.231). Si la traduction de ce phénomène semble évidente dans le cas des partis, son pendant dans le cas des syndicats est l’étatisation qui entraîne une dépossession pour le mouvement ouvrier du contrôle de son niveau de vie et une institutionnalisation de la collaboration de classe.
Poulantzas : mode d’organisation, couche parasitaire ou classe dominante ?
Pour compléter la lecture de notre corpus de texte, nous proposons un détour par la philosophe Nicos Poulantzas qui s’intéresse également à la bureaucratie, ses effets, à une époque similaire à celle de Mandel. Poulantzas estime que la bureaucratie constitue une catégorie spécifique et que lorsque Friedrich Engels en parle comme classe, il s’agit quasiment d’un abus de langage. Il présente la bureaucratie de la manière qui suit, en faisant un parallèle avec les « intellectuels » dans leur rapport à la région de l’idéologie :
« si l’on prend en considération le tout complexe d’un mode de production et l’efficace spécifique de ses diverses instances, on voit que la bureaucratie est l’effet spécifique de la structure régionale de l’État sur les agents, dans une formation sociale »8.
Il s’agit d’une catégorie sociale de l’appareil d’État. Il rappelle également la deuxième définition de la bureaucratie qui serait
« un système spécifique d’organisation et de fonctionnement interne de l’appareil d’État, qui manifeste surtout l’impact politique de l’idéologie bourgeoise sur l’État : phénomène souvent exprimé sous le terme particulier de bureaucratisme ou de bureaucratisation ».
Cette distinction est déjà présente chez Weber. Cela pose la question de la permanence d’une bureaucratie, comme on peut le lire chez Lénine sur l’État de transition en URSS quand il parle de tendance à la bureaucratisation, sans l’existence de la bureaucratie comme catégorie spécifique. « Si la bureaucratie constitue une catégorie spécifique, cela veut dire qu’elle a elle-même une appartenance de classe » indique Poulantzas (concrètement, là où on va recruter les différentes composantes de l’administration). À cet égard, Lénine et Engels vont distinguer les espaces de recrutement de cette administration (bourgeoisie, sous-fraction de la bourgeoisie, noblesse foncière, etc.).
« La nécessité du renversement par une révolution politique et non par une révolution sociale du pouvoir de la bureaucratie découle logiquement de sa caractérisation comme caste ou couche sociale et non comme classe sociale ayant ses racines et ses fonctions propres dans le processus de production » (De la bureaucratie, p.25).
Il s’agit d’une question centrale pour penser la révolution. Mandel interroge et note une confusion qui est liée au fait que certains aspects de la bureaucratie dans les États ouvriers les rapprochent de la classe sociale (il évoque par exemple « des privilèges idéologiques et matériels, conscience collective des prérogatives acquises et à défendre », p.26). Cependant, s’il s’agit d’une classe, c’est que celle-ci a pris le pouvoir après la révolution, or ce serait une première qu’une classe ne se constitue qu’après la révolution,
« ce serait la première fois dans l’histoire qu’une classe n’aurait d’existence qu’après sa prise de pouvoir, soit qu’elle préexiste en tant que classe avant sa prise de pouvoir. Certains affirment que la bureaucratie existe en tant que classe avant de prendre le pouvoir, et qu’elle est constituée dans les pays capitalistes par les directions des partis communistes. Si on utilise la définition marxiste d’une classe sociale, c’est évidemment une monstruosité : quelle est la place de ces directions dans le processus de production ? » (p.26).
Mandel illustre cette impasse avec les exemples suivants :
« En France et en Italie par exemple le prolétariat, qui n’a rien de commun avec cette classe, doit rompre radicalement avec elle : une grève dirigée par le Parti communiste n’est plus une lutte entre le prolétariat et la bourgeoisie, mais entre la bourgeoisie et la bureaucratie qui veut devenir la classe dominante : le prolétariat doit alors être neutre ».
Si la bureaucratie des organisations peut détourner la lutte pour des fins propres, cela n’induit pas forcément un morcellement de la lutte entre trois classes aux intérêts antagoniques.
Comment limiter les effets de la bureaucratie et en finir avec elle ?
Il s’agit d’une question posée par Mandel, la IVe Internationale et nombre de marxistes, d’acteurs politiques, ainsi qu’une question qui revêt des implications contemporaines :
« le seul moyen pour éliminer à la fois la bourgeoisie et la bureaucratie, c’est d’appuyer à fond la lutte des ouvriers et des peuples coloniaux contre l’impérialisme, même si cette lutte est actuellement dirigée par les Partis communistes, car seule la victoire la plus large de la révolution internationale peut être la garantie ultime d’une élimination définitive du pouvoir de la bureaucratie ».
Dans ses textes, il propose des pistes que nous allons passer en revue :
- « la lutte contre les privilèges matériels, et l’excès d’écart des salaires ; notamment, les fonctionnaires politiques de l’État ouvrier ne doivent pas avoir des salaires plus élevés que ceux de l’ouvrier qualifié. Marx ajoute que le but est surtout préventif, pour éviter que certains éléments corrompus ne recherchent les fonctions publiques comme un avancement social, par « carriérisme »,
- La deuxième règle, c’est l’éligibilité et la révocabilité des élus à tous les niveaux. Elle peut se compléter par la règle de roulement préconisée par Lénine. Cela peut amener progressivement un dépérissement de l’État (une fois que les classes auront disparu et que chaque citoyen aura fait l’expérience concrète de l’économie et de l’État).
- La solution marxiste-révolutionnaire du problème a été donnée par la théorie léniniste du parti et par la théorie trotskiste de l’État ouvrier et du rôle conscient de l’avant-garde dans la direction d’un État ouvrier pour lutter contre la bureaucratie. Il faut être lucide et comprendre le problème objectif qui est le caractère inévitable de la présence, sous une forme embryonnaire et potentielle, des germes de la bureaucratisation et parallèlement saisir quels sont les moyens les plus efficaces pour combattre ces tendances et en réduire au maximum l’ampleur, dans différentes conditions matérielles et subjectives » (De la bureaucratie).
Dans Où va l’URSS de Gorbatchev, Mandel propose de mettre en place des mesures de contrôle des représentants : révocabilité des élus, élections libres, droits pour les délégués syndicaux, contrôle ouvrier sur la gestion de l’économie, notamment stocks et flux. La révolution apparaît comme un horizon nécessaire pour faire le socialisme et renverser le capitalisme à l’échelle mondiale. Dans le chapitre 2 (intitulé « Organisation et usurpation du pouvoir ») de Power and Money, il analyse que les socialistes et communistes doivent prendre part aux luttes pour agir sur l’auto-organisation de la classe ouvrière, en vue de son auto-émancipation. Dans le chapitre 5 intitulé « Autogestion, abondance et dépérissement de la bureaucratie », il insiste sur des pistes similaires à celles proposées dans Où va l’URSS de Gorbatchev, à savoir l’élaboration d’une démocratie directe et la mise en place de référendums et la diminution du temps de travail pour augmenter le temps qui peut être consacré à l’activité politique.
Pour Mandel, le dépérissement de la bureaucratie est non seulement une nécessité politique pour garantir la démocratie ouvrière, mais il s’inscrit également dans une vision écologique globale. Cette dimension apparaît tardivement dans son œuvre, mais est suffisamment importante pour constituer le dernier temps du texte Power and money. Il voit la bureaucratisation comme un obstacle à la gestion durable des ressources et à la résolution de la crise écologique. Selon lui, la survie de l’humanité dépend d’une transformation radicale des structures sociales, économiques et bureaucratiques, où la planification démocratique remplacerait les hiérarchies bureaucratiques rigides, ouvrant ainsi la voie à une gestion plus rationnelle et écologique des ressources planétaires :
« la question de la survie de l’être humain est donc d’arriver à une maîtrise progressive consciente des développements sociaux au lieu de les laisser aux mains de processus spontanés, incontrôlés et toujours plus destructeurs. C’est encore plus vrai des rapports entre l’homme et la nature » (p.344).
Ce passage est extrêmement intéressant puisqu’il fait du dépérissement de cette couche un impératif pour la survie de l’humanité (ce qui rappelle la citation de Löwy, au début de cet article) : il ne peut y avoir d’abondance sans ordre social socialiste compris comme un système de producteurs librement associés.
En définitive, la bureaucratie constitue un obstacle à la révolution dans un premier temps et à l’effectivité du socialisme ensuite. C’est un sujet qui comprend également une actualité du fait des limites planétaires et du pillage des ressources. En intégrant la question écologique à son analyse, Mandel fait du socialisme non bureaucratique une impérieuse nécessité pour la survie de l’humanité. Il faut dès lors créer les conditions d’une révolution mondiale et mettre en place un ordre social socialiste compris comme un système de producteurs librement associés :
« l’argument de fond en faveur du socialisme aujourd’hui est que le genre humain ne peut plus supporter le coût de toute cette irrationalité. C’est devenu une question de vie ou de mort : il faut pouvoir maîtriser les tendances les plus irrationnelles de l’évolution sociale » (p.344).
Publié le 3 avril 2025 par Contretemps.
Bibliographie
Ernest Mandel
Mandel, E. (1978). De la bureaucratie. La Brèche.
Mandel, E. (1979). Les étudiants, les intellectuels et la lutte des classes. La Brèche.
Mandel, E. (2000). Où va l’URSS de Gorbatchev ? La Brèche.
Mandel, E. (2023). Power and money. La Brèche.
Autres auteurs
Anderson, P. (1978). Sur le marxisme occidental, Maspéro (PCM n° 194), Paris.
Anter, A. (2010). « L’histoire de l’État comme histoire de la bureaucratie ». Trivium, 7.
Bensaïd, D. (1995). « L’héritage théorique de Ernest Mandel ». La Gauche, 15/16.
Freund, J. (1990). VIII. « L’inévitable bureaucratie. Contribution à une étude critique des idées de Max Weber sur la bureaucratie ». In Études sur Max Weber (p. 203‑235). Librairie Droz.
Marx, K. (2018). Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel. Éditions sociales.
Poulantzas, N. (1982). 4—La bureaucratie et la lutte des classes. In Pouvoir politique et classes sociales (p. 383‑392). La Découverte.
Samary, C. (2018). Les conceptions d’Ernest Mandel sur la question de la transition au socialisme. Contretemps.
- 1Zbignew Marcin Kowalewski est un chercheur polonais né en 1943, spécialiste de l’histoire des mouvements révolutionnaires et du mouvement ouvrier. Au début des années 1980, il est membre de la direction régionale du syndicat Solidarność à Łódź avant d’être exilé en France, où il poursuit son engagement. Le texte mentionné peut être consulté ici.
- 2https://www.socialgerie.net/spip.php?article1607a
- 3Löwy, M. (2018), « L’humanisme révolutionnaire d’Ernest Mandel », Contretemps.
- 4“ Die zukünftige Funktion des Marxismus ”, in H. Spatzenegger, ed., Das verspielte “ Kapital ” ? Die marxistische Ideologie nach dem Scheitern des Realen Sozialismus, Verlag Anton Pustet, Salzburg 1991, p. 173.
- 5Trotski est ainsi cité à 39 reprises dans De la bureaucratie.
- 6Bureaucratie comme facteur du conservatisme croissant dans les organisations social-démocrates allemandes. Situation où les directions politiques soutiennent peu d’autres initiatives que les tâches les plus routinières et la participation à des élections. Précisons que pour Luxemburg, le problème a notamment trait à l’aspect non démocratique de la révolution bolchévique et la bureaucratisation du mouvement ouvrier. Pour Trotski, le cœur du problème est lié au stalinisme que Luxemburg qui décède en 1919 ne connaît pas.
- 7Concernant l’éthique de responsabilité de Weber, la nécessité pour certains politiques d’assumer des décisions, Mandel parle de relativisme moral.
- 8Poulantzas, Nicos. « 2 – La position marxiste et la question d’appartenance de classe de l’appareil d’État », Pouvoir politique et classes sociales. Sous la direction de Poulantzas Nicos. La Découverte, 1982, pp. 360-370.