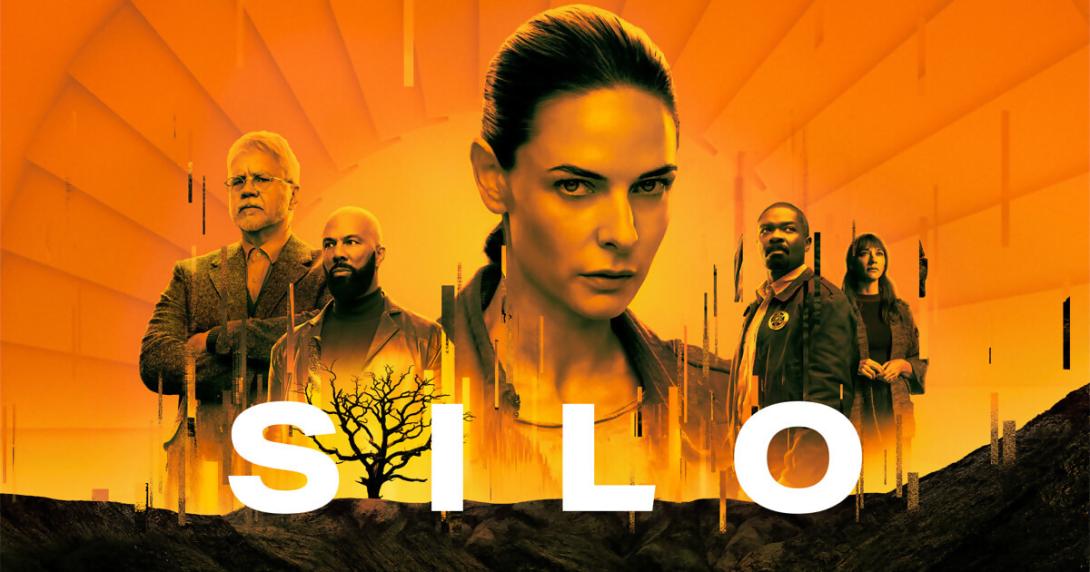
La trilogie Silo de Hugh Howey est en cours d’adaptation et de diffusion par Apple TV. La série réussit particulièrement bien le pari de donner vie à un univers riche et qu’on aurait pu imaginer difficile à mettre sur l’écran : celui d’un refuge sous terre où l’humanité survit dans un futur post-apocalyptique pas très lointain.
Si la série n’a pas encore dévoilé les origines du Silo ni le devenir de l’humanité qui l’habite (spoiler alert !), les ouvrages nous amènent à explorer par l’excès (et parfois l’absurde) ce qu’adviendrait dans un monde où des élites politiques, économiques et militaires états-uniennes décideraient de créer elles-mêmes la catastrophe pour mieux dessiner leur monde de demain.
Ils nous proposent aussi de voir en quoi ce dessein peut être mis en cause par le besoin de vivre, et non pas de survivre, d’une humanité qui trouve les moyens de lutter en collectif même dans les fins fonds de la terre. Des réflexions pas si lointaines de notre réalité actuelle travaillée par les forces fascisantes qui crient de toute leur force, entre autres, depuis la Maison Blanche…
Pour Contretemps, Anne-Lise Melquiond, specialiste des séries apocalyptiques, revient sur la série et son originalité.
– Je ne sais pas où se trouve le Kansas, car je n’ai encore jamais entendu parler de ce pays. Mais, dites-moi, est-ce que c’est un pays civilisé ?
– Oh oui, répliqua Dorothée.
– Alors tout s’explique. Dans les pays civilisés, je crois bien qu’il ne reste plus de sorcières, ni de magiciens, ni d’enchanteresses ni d’enchanteurs. Par contre, voyez-vous, le pays d’Oz n’a jamais été civilisé, car nous sommes coupés du reste du monde. C’est pourquoi il existe encore des sorcières et des magiciens parmi nous.
LE MAGICIEN D’OZ, LYMAN FRANK BAUM
Dans un avenir ruiné et toxique, une communauté de 10 000 personnes survit cloîtrée dans un immense silo de 144 étages qui s’enfonce dans le sol, avec un unique escalier central, sorte de colonne hélicoïdale autour de laquelle s’organise une hiérarchie sociale depuis les classes dominantes au plus près de la surface jusqu’aux ouvriers tout au fond du silo.
Cette dystopie souterraine post confinement, énième série apocalyptique produite depuis 2001 est l’adaptation du livre éponyme de Hugh Howey écrit en 2011, petit miracle de microédition : d’abord conçu sous forme de nouvelles en version numérique publié sur Amazon à compte d’auteur, le premier tome connaît un succès immédiat au point que le réalisateur Ridley Scott décide d’en acheter les droits. C’est Apple TV+ qui développera une série créée et écrite par le canadien Graham Yost diffusée depuis 2023 et dont la seconde saison vient de se terminer.
La hiérarchie sociale du silo va donc du bas vers le haut, sorte de Snowpiercer à la verticale, où il est rare que les différentes classes interagissent en dehors des fonctions de travail nécessaires. Cet enfermement est à la fois une question de classe mais aussi une question d’espace : la barrière physique invisible est représentée par les immenses escaliers du silo difficiles à franchir puisqu’il faut plus de deux jours de marche pour en atteindre le sommet.
L’héroïne que nous suivons, Juliette Nichols, est une « transfuge de classe »1 : quand le récit débute elle travaille dans les bas-fonds du silo comme mécanicienne mais, à la mort de son amant, informaticien en possession illégale d’un disque dur, gravit les marches et devient shérif pour mener l’enquête. Ce n’est pas étonnant que ce soit elle qui franchit les étages : traumatisée par la mort de sa mère et de son petit-frère quand elle est encore enfant, elle décide de descendre dans le Deep Down– son père est médecin, pour devenir apprentie en mécanique.
Le système politique du silo où réside le pouvoir est un triumvirat comprenant le Maire – chef du pouvoir exécutif qui est tenu de respecter le Pacte (Constitution qui régit le Silo), Il semble y avoir un système de vote pour élire le Maire, mais on ne sait pas dans quelle mesure le processus est libre –, le Juge (qui contrôle le Judiciaire) – chef du pouvoir judiciaire en charge de prononcer des condamnations et de veiller à ce que le Maire respecte le Pacte et l’Ordre – et le shérif – pratiquement un ministre de l’Intérieur qui est chargé de maintenir l’ordre dans le Silo (traditionnellement nommé par le shérif sortant, approuvé par le maire).
Et dans ce microcosme souterrain, l’Histoire a été effacée : personne ne connait les raisons qui ont conduit ce monde à la ruine, les survivants ignorent quand, comment ou par qui le silo a été construit, ils n’ont pas la moindre idée de la raison exacte pour laquelle ils y vivent, ne savent rien de l’extérieur et n’ont aucune information sur ce qui existait avant. Tout ce qu’ils savent, c’est qu’il y a des centaines d’années, les Fondateurs ont logé la population à l’intérieur du silo pour la protéger d’un monde extérieur qui était dangereux pour eux :
« Nous ignorons pourquoi nous sommes ici. Nous ignorons qui a construit le silo. Nous ignorons pourquoi le monde à l’extérieur du silo est tel qu’il est. Nous ignorons quand nous pourrons sortir en toute sécurité. Nous savons seulement que ce jour n’est pas encore arrivé. » entend-t-on au commencement du récit.
Silo, mélange de l’univers Orwellien (véritable « Big Brother is watching you ! ») et de l’esthétique soviétique, rappelle la caractérisation même de ce qu’est la dystopie, à savoir un lieu qui dysfonctionne. À l’enfermement s’ajoute ici une disparition du temps, de la mémoire et de l’Histoire. Or, une humanité sans histoire ni mémoire est réduite à sa simple survie, une société docile que l’on peut contrôler. Si cette communauté ne connait pas son histoire, c’est que les archives auraient été détruites 140 ans auparavant lors d’un soulèvement de rebelles réprimé : la série commence le jour de la fête qui commémore ces événements, appelé, ironiquement, la Fête de la Liberté.
De fait, l’enquête que mène Juliette met en lumière des tensions profondes sous les structures apparemment normales et fonctionnelles du silo. L’information – souvent sous la forme de « reliques » du passé de l’humanité – comme les livres, la science, la culture et l’art sont interdits.
Personne ne doit poser des questions sur l’existence du silo et ce qui pourrait être à l’extérieur de ses murs. Leur seule vue sur le monde extérieur se fait à travers des caméras qui montrent un désert aride, parsemé de corps des condamnés à sortir nettoyer les capteurs des caméras du silo. Tout est contrôlé : les naissances, les communications, les sujets qu’il est permis d’évoquer ou non. Une véritable société totalitaire mais pas seulement.
Silo mélange noirceur et âpreté de la survie avec des moments de grâce, de poésie et de lumière. Dans ce monde qui ne connait pas l’existence des étoiles, certains les voient comme « des lueurs dans le ciel. » Un distributeur de Pez en forme de canard devient une précieuse relique à la base de nombreuses péripéties. Juliette qui écoute, sidérée, Audrey Hepburn chanter Moon River dans un épisode quasi muet alors qu’elle ne connait pas le concept de musique.
Le livre Le Magicien d’Oz que possède la Juge, véritable échappatoire (au même titre que l’alcool qu’elle consomme quotidiennement), lui donne des envies de fuir en montgolfière comme le Magicien à la fin du livre. D’un sens, la Juge porte en elle une certaine mémoire du monde ainsi que sa perte : « Comment ont-ils perdu ce monde ? » se demande-t-elle au milieu de la seconde saison.
Ce récit est une (en)quête, une recherche de la vérité (truth est écrit au dos du badge du shérif que reçoit Juliette) qui pose des questions métaphysiques : Qu’est-ce qu’il y a dehors ? Qu’est-ce qu’il y au-delà de ce que voit le capteur ? Pourquoi on est là ? Depuis combien de temps, on est là ? Combien de temps nous reste-t-il ? Et si tout ce qu’on tenait pour vrai, tout ce qui nous a été raconté par ceux qu’on aime n’était en fait qu’un énorme mensonge ? Ces grandes questions que (se) posent George (à Juliette) dans le sixième épisode de la première saison révèlent que l’illusion représente les bases de l’existence des habitants du silo.
Le silo de l’écran mural se trouve être une véritable métaphore de voir le monde comme si on était quelqu’un dans une caverne qui ne perçoit que les ombres des choses projetées par le feu sur le mur et qui doit deviner comment est le monde à partir de ces formes sombres : Silo est une revisitation high-concept du mythe de la Caverne de Platon.
Dans une très belle séquence du quatrième épisode de la seconde saison, Solo raconte à Juliette son histoire en projetant des ombres sur le mur- récit qui s’avérera mensonger. Quand les techniciens de l’Information du silo (IT) voient les « vraies » images que Juliette pirate, les autorités leur donnent des médicaments pour qu’ils les oublient. L’IT semble être le véritable pouvoir dans le silo, car il contrôle la quantité d’informations disponibles pour toutes les parties et est crucial pour l’espionnage des masses. Ici, dans le silo, il est toujours question d’illusion, de mensonge, de secret et de manipulation.
Ce que nous raconte ce mythe de la Caverne post-apocalyptique, c’est que celui qui n’a pas accès à la connaissance directe reste enfermé dans le mensonge ; pour accéder à la vérité, il doit sortir de la caverne… plutôt du silo comme le fera Juliette à la fin de la première saison. C’est ce qui lui permettra de comprendre la fragmentation de ce monde, l’existence d’autres mondes, d’autres silos puisqu’elle réussit à rejoindre le silo voisin, le 17, habité par une poignée de jeunes adultes. Et tout comme l’homme libéré de Platon retourne dans la caverne pour tirer ses semblables de l’ignorance, Juliette retourne à son silo pour leur faire part de l’intelligibilité du monde.
Mais avant de revenir, Juliette devient une figure héroïque, le symbole de la résistance qui se propage dans le silo. En effet, après avoir compris que le monde vert qu’elle voit à l’extérieur est une illusion générée par ordinateur pour inciter les personnes à nettoyer l’objectif de la caméra, elle décide de ne pas nettoyer comme l’ont fait, avant elle, ses prédécesseurs. Son geste, celui de jeter son matériel de nettoyage devant le capteur, vu par l’ensemble de la communauté – la cérémonie du nettoyage est publique -, et de s’éloigner dans ces ruines sans s’effondrer, en fera le symbole de la défiance contre les manipulations du silo.
« En cas de nettoyage raté, préparez-vous à la guerre » avait prévenu le livre référent L’Ordre. La vérité a un prix. Des émeutes éclatent. Des cocktails Molotov sont lancés contre ceux qui maintiennent l’ordre à tout prix. Un couvre-feu est décrété. Des graffitis apparaissent sur les murs : « JL » : Juliette Lives (en français : Juliette est vivante). Des banderoles sont brandies demandant la destitution de la Juge. Et quand la répression s’intensifie avec la volonté du Maire d’affamer les émeutiers (« Il y a une vérité qui se vérifie depuis les temps anciens jusqu’à aujourd’hui. Il suffit de 9 repas manqués pour plonger une société civilisée dans le chaos »), une véritable solidarité prolétarienne se met en place.
Parmi cette foule qui hurle sa peur de mourir de faim, une voix s’élève dans le sixième épisode de la deuxième saison qui s’intitule très justement « Barricades », celle de Martha Walker, une vieille femme qui avait recueillie Juliette enfant quand elle était devenue apprentie mécanicienne, une femme agoraphobe, qui s’était confinée depuis plus d’une vingtaine d’années :
« J’ai l’impression qu’ils ont déjà gagné. Regardez-nous. Prêts à lyncher deux des nôtres s’ils refusent d’aller au casse-pipe. Vous voulez m’y envoyer, moi aussi ? Ne vous gênez pas. Mais dans quelques jours, vous nous verrez nous écrouler en grimpant la colline sur les traces de Jules. Ou pendus haut et court par le Judiciaire. Mais votre bouffe sera livrée ! Et Bernard vous tapera la tête en disant : « Beau boulot- Allez, on se remet au turbin. » Ce serait une victoire pour vous ? Non. Mais pour eux, oui. C’est ce qu’ils veulent : qu’on s’entredéchire pour respecter leurs règles, qu’on se croie seuls responsables de tout ce qui ne va pas. Ça a toujours été comme ça. Mais ce n’est pas normal. La bouffe, chez nous, on ne se la dispute pas. On se la partage. On ne s’accuse pas mutuellement en cas de pénurie. On remet en commun. On se sert la ceinture. »
À la fin de son discours, des chariots de nourriture, provenant de l’étage des fermes, arrivent accompagnés d’un mot : « À nos amis des Machines. C’est grâce à vous qu’on a du jus. De la part de vos amis du 122. Juliette est vivante. » prouvant la solidarité des bas-fond du silo qu’énonçait Walker. Face aux mensonges et à la manipulation des autorités qui incriminent les Mécanos et liguent le peuple du silo contre eux pour garder le pouvoir, le peuple s’organise, lutte et se bat pour la vérité, pour la justice, pour enfin retrouver leur monde perdu.
Finalement, il n’y a rien de très nouveau dans ce récit de fin du monde où les mensonges d’un pouvoir totalitaire, basés sur la crainte d’un danger « extérieur », servent à maintenir les survivants dans la plus grande docilité. Dans la tragédie de l’apocalypse, des décisions brutales, parfois iniques, un chantage à l’injustice ou des menaces de mort sont toujours justifiés par l’enjeu de la survie.
Silo est l’une des fictions phares sur la fin des temps, qui se sont imposées dans les séries télévisées américaines depuis le traumatisme du 11 Septembre 2001, amplifiant un phénomène datant de la Seconde Guerre mondiale2.
Cet attachement à l’affect millénariste et à sa puissance subversive valide la vertu cathartique de ces images fictionnelles. Les fins de monde qui y sont racontées sont autant des théâtres d’effondrement que des moments de libération, de découverte ou de redécouverte de désirs réprimés par les événements réels. Ces représentations par écrans interposés assouvissent ce que le philosophe Henri-Pierre Jeudy appelle le « désir de catastrophe3 ».
La prise de conscience des problèmes sociaux, politiques et économiques de notre monde peut nous donner l’impression de vivre « le temps de la fin4 » comme le théorisait Günther Anders à partir d’Hiroshima. Aujourd’hui surgissent de nouvelles inquiétudes, le cataclysme écologique rejoint l’angoisse nucléaire réactivée par Fukushima, et le bouleversement de la marche du monde par le Covid exacerbe la fragilité de nos sociétés.
Hautement divertissants, les récits d’apocalypse possèdent également une fonction d’habituation qui prépare les spectateurs au pire en banalisant les images de la catastrophe. La diffusion permanente de l’évidence de la fin du monde se dote ainsi d’une fonction idéologique : faire accepter aux téléspectateurs la gestion politique de la catastrophe comme l’explique l’auteur de la trilogie Silo Hugh Howey à propos des caméras de surveillance filmant en permanence le paysage de la planète ravagée et diffusées sur l’écran du réfectoire de chacun des 144 étages du silo :
« C’est comme lorsque de chez moi, je regarde les nouvelles à travers l’écran de télé ou d’un ordinateur, on n’y voit toujours que le pire. Ce monde donne l’impression d’être dangereux. Pourquoi quelqu’un voudrait quitter son sweet home ?5 »
L’angoisse provoquée par la description terrible de ces temps d’après la catastrophe, sauvages, fratricides, imposant un mode de survie précaire, rend notre société contemporaine désirable, ou au moins rassurante.
Ce qui est assez inédit ici, c’est la capacité du récit à prendre en compte la dimension collective qui n’existe que trop rarement dans les récits apocalyptiques privilégiant l’individu, le héros, véritable figure katéchontique, qui va sauver le monde de sa fin. Ici, on n’a pas peur de tuer des personnages importants de manière réaliste et de mettre en avant une foule solidaire et combattive réclamant vérité et justice. Une cosmogonie pour les temps actuels.
Le 28 mars 2025
- 1
À proprement parlé, elle n’est pas une transfuge de classe puisqu’elle retrouve sa classe de naissance mais elle est traitée comme une Mécanicienne par l’ensemble du silo.
- 2
Anne-Lise Melquiond, Apocalypse Show, quand l’Amérique s’effondre, Playlist Society, 2021.
- 3
Le « désir de catastrophe » se définit par l’expectative d’un désastre fondé sur une heuristique de la peur. Henri-Pierre Jeudy, Le Désir de catastrophe, Paris, Aubier, 1990.
- 4
Günther Anders, Le Temps de la fin, Paris, Éditions de l’Herne, 2007.
- 5