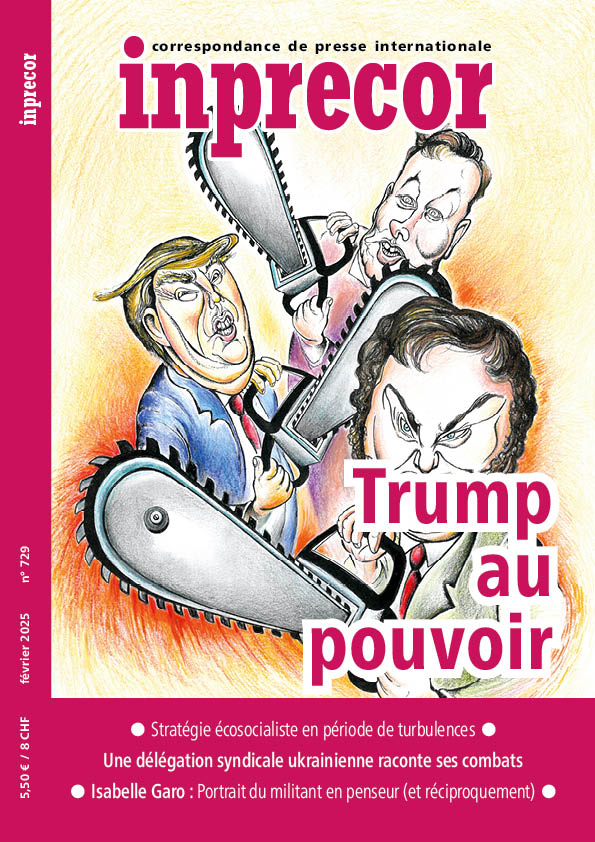À première vue, la publication libre sur les réseaux sociaux et l’accès illimité aux micros donnent à Donald Trump toutes les chances de se ridiculiser – et il en profite pleinement. Mais la question de savoir si ses délires annexionnistes concernant la conquête du Canada, du Groenland et du canal de Panama sont préoccupants en soi, ou s’ils sont des écrans de fumée destinés à dissimuler des projets impériaux plus profonds et plus sombres, suscite de nombreux commentaires et débats.
Donald Trump a la particularité de pouvoir déclarer n’importe quoi, même si c’est ridicule, au point de créer une parodie de lui-même, sans subir de dommages politiques. C’est une réflexion sur l’état actuel de la politique américaine et de l’organisation idolâtre qu’est devenu le Parti républicain – avec potentiellement de profondes implications déstabilisatrices pour le système politique du pays, qui a servi ses élites si longtemps et si bien – mais il s’agit d’une autre discussion.
Les délires de Trump
Même Trump ne peut changer le fait que nous sommes en 2025 – et non en 1825, au siècle où les jeunes États-Unis cherchaient à s’emparer de la plus grande partie possible de l’Amérique du Nord et des Caraïbes. En fait, la question de la conquête du Canada a été réglée par la guerre de 1812, au cours de laquelle les États-Unis espéraient s’emparer du Canada tandis que la Grande-Bretagne cherchait à bloquer l’expansion des États-Unis vers l’ouest (comme l’ont appris les deux camps, « on ne peut pas toujours obtenir ce que l’on veut »).
Selon une lecture rationnelle, pour autant qu’elle soit possible, les délires de Trump reflètent deux priorités essentielles, qui peuvent à certains moments entrer en conflit entre elles. La première est le nationalisme économique, une vision simpliste selon laquelle les États-Unis « subventionnent » les économies d’autres pays par leurs déficits commerciaux et leurs dépenses de défense, et que ces charges injustes devraient être compensées par des tarifs douaniers et des menaces radicales.
La seconde est la rivalité géopolitique impériale croissante entre les États-Unis et la Chine, qui inclut notamment l’obsession de Trump envers l’accès prétendument favorable de la Chine au canal de Panama, et l’importance croissante de l’Arctique pour le transport maritime international et les matières premières, ce qui explique le désir de Trump pour le Groenland et le Canada « pour notre sécurité nationale ».
Peut-être pense-t-il qu’Elon Musk apportera l’argent nécessaire à « l’achat » du Groenland, quel que soit l’avis des habitant·es de ce territoire, qui sont nombreux à réclamer l’indépendance, sans parler du Danemark, l’actuel détenteur colonial, qui se trouve être un allié stratégique essentiel de l’OTAN dans la région.
Abstraction faite de cette ambition paléo-colonialiste semi-comique, l’engagement de Trump d’imposer des droits de douane de 25 % sur toutes les importations en provenance du Canada constitue une menace extrême pour l’économie de ce pays, en particulier pour le secteur de la construction automobile, sans parler des dommages qu’il infligerait aux États-Unis eux-mêmes.
L’avenir du Canada
À un moment où le Canada traverse une transition politique fracturée – avec la démission du Premier ministre libéral Justin Trudeau, profondément impopulaire, une élection qui dans les prochains mois amènera probablement le Parti conservateur de droite au pouvoir et peut-être même l’accès d’un parti souverainiste québécois au statut d’ »opposition officielle » au Parlement canadien – les élites du pays sont véritablement paniquées par la façon dont le Canada pourrait se défendre contre un déchaînement de tarifs douaniers de la part de Trump.
Alors que les dommages subis par le Canada pourraient exacerber ses angoisses endémiques en matière d’« unité nationale », il est également possible que Trump réalise ce qu’aucun politicien canadien ne pourrait espérer – unifier les factions politiques et régionales en un front uni contre la menace étatsunienne, sous la forme de contre-tarifs et éventuellement de lourdes taxes à l’exportation sur les approvisionnements cruciaux en énergie et en minéraux du Canada dont l’économie américaine elle-même a cruellement besoin.
L’issue n’est pas facilement prévisible. Nous ne savons pas non plus si le Canada et le Mexique formeront un front commun de négociation commerciale ou si, comme le suggèrent certains politiciens canadiens cyniques, le Mexique sera laissé seul face au colosse du nord.
Des crises mondiales insolubles
Compte tenu de leurs préférences, Trump et son administration se concentreront très probablement sur la confrontation avec la Chine, comme les précédents présidents Biden et Obama l’ont également tenté. Mais même la présidence impériale des États-Unis doit faire face au monde tel qu’il se présente. Les crises s’y chevauchent et ne sont pas facilement contrôlables.
Les promesses de Trump de mettre rapidement fin aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient « dans les 24 heures » sont, bien sûr, vides de sens. L’administration risque d’être d’emblée fortement divisée entre les quasi-isolationnistes (et les nationalistes chrétiens sympathisants de Poutine) comme J.D. Vance qui se fiche ouvertement de ce qui arrive à l’Ukraine, et les guerriers néoconservateurs comme le futur secrétaire d’État Marco Rubio, qui considèrent la Russie comme une menace au service des ambitions plus vastes de la Chine.
Alors que Trump et certains libéraux de gauche bien intentionnés (ou pas) peuvent plaider en faveur d’un « marché » négocié pour mettre fin à la guerre, la vérité est que l’Ukraine n’a pas de « plan B » puisque la reddition signifie l’asservissement, et que les conditions de Poutine comprennent l’annexion par la Russie de tout ce dont elle s’est emparée ainsi que l’interdiction pour l’Ukraine de demander une protection internationale. Poutine voit sans aucun doute en Trump un personnage manipulable et finalement faible sous la façade d’un mâle alpha.
Trump est notoirement opposé à la poursuite de l’aide à l’Ukraine, mais il ne peut pas non plus se permettre de « perdre » l’Ukraine d’une manière qui rappellerait la débâcle de Biden en Afghanistan. Il est également clair que le projet impérialiste américain plus large, qui inclut la confrontation avec la Chine, nécessite une OTAN forte et des relations américaines avec les alliés, indépendamment des menaces grandiloquentes de Trump.
Les amis sionistes de Trump
D’un autre côté, il n’y a aucune raison de penser que Trump et la base nationaliste blanche, chrétienne et sioniste des Républicains ont des scrupules moraux ou politiques concernant le génocide israélien à Gaza et le nettoyage ethnique rampant en Cisjordanie, qui vont tous deux se poursuivre et probablement s’intensifier. Étant donné que les élites arabes de la région sont tout aussi indifférentes au sort des Palestiniens et à l’opinion de leurs propres populations, la politique américaine à l’égard de la guerre d’Israël contre la Palestine ne changera pas beaucoup, voire pas du tout, même si Israël officialise l’annexion de la Cisjordanie, qui est déjà un fait accompli sur le terrain.
La grande question, et crise potentielle pour la politique de Trump, sera de savoir s’il faut encourager ou soutenir directement le rêve du Premier ministre israélien Netanyahou de guerre avec l’Iran. Cette idée trouve un écho puissant parmi les néoconservateurs américains. Elle va à l’encontre de l’une des impulsions de Trump, qui veut éviter le marasme des guerres de « changement de régime », mais coïncide avec une autre, son désir d’être l’homme qui réorganise le monde et le domine.
Il ne fait aucun doute que l’année écoulée a été triomphante pour la puissance américaine au Moyen-Orient, mais elle comporte son propre lot de risques. Alors que le pouvoir régional de l’Iran a été anéanti au cours des quinze mois qui ont suivi le 7 octobre 2023, la perspective d’une occupation de l’Iran ou de sa fragmentation régionale est terrifiante pour les « penseurs stratégiques » impériaux rationnels, dans le sillage de ce qui s’est passé en Irak après 2003. C’est d’autant plus vrai que l’avenir de la Syrie est en suspens après le renversement de la brutale dynastie de la famille el-Assad.
En Asie
Il est également possible, bien que peut-être moins probable au vu des difficultés économiques internes de la Chine, que le régime chinois précipite une crise mondiale de grande ampleur en attaquant directement Taïwan, le territoire autonome que les États-Unis se sont engagés à défendre. Cela changerait toutes les hypothèses politiques sur la région Asie-Pacifique ; nous ne savons pas quelles seraient les conséquences possibles, et il vaudrait mieux que nous ne les découvrions pas…
Il y a d’autres phénomènes complexes et des crises qui ne sont pas encore prévues, mais beaucoup tourneront autour de la question de savoir si l’administration Trump gère les relations avec les alliés stratégiques des États-Unis d’une manière impérialiste plus ou moins normale, des relations conventionnelles prévalant sous la surface de la grandiloquence présidentielle, ou s’il y a une véritable rupture qui fait passer « l’Amérique d’abord » avant le réseau d’alliances qui a sous-tendu huit décennies de « leadership mondial américain. »
Climatosceptique et productiviste
Deux derniers points doivent être soulignés. Premièrement, tout cela se produit dans le contexte d’une catastrophe environnementale mondiale qui garantit que les quatre prochaines années et au-delà seront marquées par des catastrophes d’une ampleur que nous pouvons à peine imaginer aujourd’hui, même à la lumière des incendies de Los Angeles. L’abîme devant lequel nous nous trouvons peut difficilement être plus visible.
Avec son déni du changement climatique et sa promesse de « drill baby drill » (fore, chéri·e, fore) Trump est bien sûr profondément engagé à restaurer la domination des États-Unis dans la course vers l’effondrement civilisationnel. Il convient toutefois de noter que ce sont les années Biden qui ont permis aux États-Unis de se hisser au sommet du classement mondial de la production pétrolière.
Personne ne devrait d’ailleurs regretter le départ du misérable Joe Biden. Son « héritage » présidentiel, au-delà de toute autre chose, est le génocide de Gaza, qui, franchement, a été absolument bouleversant, même pour ceux d’entre nous qui pensaient n’avoir plus guère d’illusions sur ce que l’impérialisme et ses clients peuvent faire aux peuples du monde. C’est pourquoi une grande partie de la communauté arabo-américaine, qui ne se fait pas d’illusions sur la menace que représente Trump, a considéré Biden avec le mépris qu’il s’est efforcé de mériter.
Traduit par Laurent Creuse.
Le 15 janvier 2025
Cet article a été publié dans Against the Current n°227, novembre-décembre 2023.