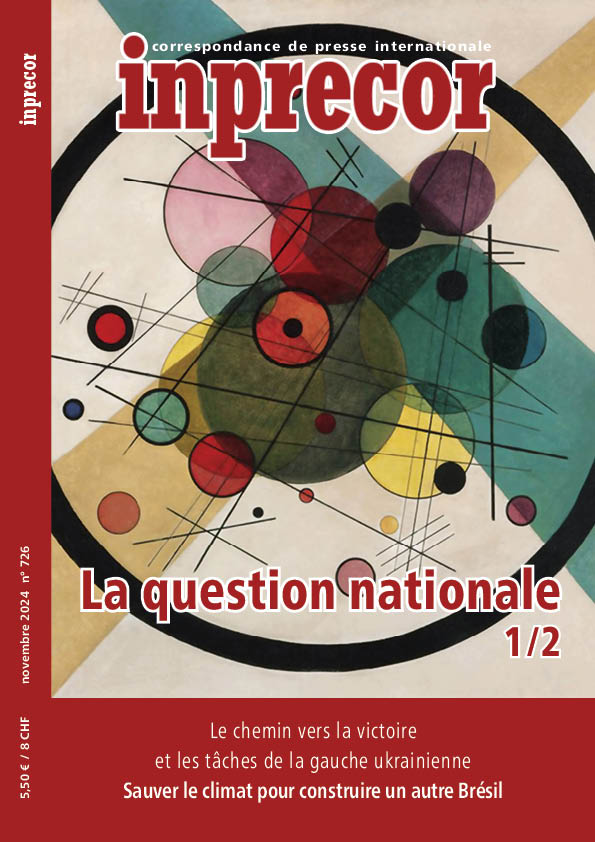L’articulation entre internationalisme et question nationale, entre revendications démocratiques et révolution, est l’enjeu d’un débat entre marxistes depuis le milieu du 19e siècle, débat dont Michael Löwy raconte l’évolution.
Marx et Engels n’ont proposé ni une théorie systématique de la question nationale, ni une définition précise du concept de « nation », ni une stratégie politique générale pour les socialistes dans ce domaine. Leurs articles sur le sujet étaient, pour la plupart, des déclarations politiques concrètes relatives à des cas spécifiques. En ce qui concerne les textes théoriques proprement dits, les plus connus et les plus influents sont sans doute les passages assez sibyllins du Manifeste concernant les communistes et la nation. Ces passages ont la valeur historique de proclamer de manière audacieuse et intransigeante la nature internationaliste du mouvement prolétarien, mais ils ne sont pas toujours exempts d’un certain économisme et d’un surprenant optimisme libre-échangiste. Cela se voit notamment dans la suggestion que le prolétariat victorieux poursuivra simplement la tâche d’abolir les antagonismes nationaux qui a été commencée avec « le développement de la bourgeoisie, le libre-échange, le marché mondial », etc. Cette idée est cependant contredite dans d’autres textes de la même époque, dans lesquels Marx souligne que « tandis que la bourgeoisie de chaque nation conserve encore des intérêts nationaux particuliers, la grande industrie créa une classe dont les intérêts sont les mêmes dans toutes les nations et pour laquelle la nationalité est déjà abolie » 1.
Dans ses écrits ultérieurs (notamment sur la question de l’Irlande), Marx a montré que non seulement la bourgeoisie tend à entretenir les antagonismes nationaux, mais qu’elle tend même à les accroître, car : 1. la lutte pour le contrôle des marchés crée des conflits entre les puissances capitalistes ; 2. l’exploitation d’une nation par une autre produit l’hostilité nationale ; 3. le chauvinisme est un des outils idéologiques qui permettent à la bourgeoisie de maintenir sa domination sur le prolétariat.
Marx et Engels ont souligné avec force l’internationalisation de l’économie par le mode de production capitaliste : l’émergence du marché mondial qui « a enlevé à l’industrie sa base nationale » en créant « une interdépendance généralisée des nations ». Cependant, il y a une tendance à l’économisme dans son idée que « l’uniformité de la production industrielle et les conditions d’existence qu’ils entraînent » aide à dissoudre les barrières nationales (Absonderungen) et les antagonismes, comme si les différences nationales pouvaient être assimilées à de simples différences dans le processus de production2.
Des principes généraux
Si le Manifeste communiste a jeté les bases de l’internationalisme prolétarien, il n’a guère donné d’indications sur une stratégie politique concrète par rapport à la question nationale. Une telle stratégie n’a été développée que plus tard, notamment dans les écrits de Marx sur la Pologne et l’Irlande (ainsi que dans la lutte qu’il a menée au sein de l’Internationale contre le nationalisme libéral-démocrate de Mazzini et le nihilisme national des Proudhoniens). Marx et Engels ont soutenu la Pologne non seulement au nom du principe démocratique général de l’autodétermination des nations, mais surtout en raison de la lutte des Polonais·es contre la Russie tsariste, le principal bastion de la réaction en Europe et la bête noire des pères fondateurs du socialisme scientifique.
Les écrits sur l’Irlande, en revanche, ont une application beaucoup plus large et énoncent, implicitement, certains principes généraux sur la question des nations opprimées. Dans une première phase, Marx était favorable à l’autonomie de l’Irlande au sein d’une union avec la Grande-Bretagne et pensait que la solution à l’oppression des Irlandais (par les grands propriétaires terriens anglais) passerait par une victoire de la classe ouvrière (chartiste) en Angleterre. Dans les années 1860, en revanche, il considère la libération de l’Irlande comme la condition de la libération du prolétariat anglais. Ses écrits sur l’Irlande à cette époque développent trois thèmes qui seront importants pour le développement futur de la théorie marxiste de l’autodétermination nationale, dans sa relation dialectique avec l’internationalisme prolétarien :
1. Seule la libération nationale de la nation opprimée permet de surmonter les divisions et les antagonismes nationaux et permet à la classe ouvrière des deux nations de s’unir contre leur ennemi commun, les capitalistes ;
2. La libération de la nation opprimée est une condition préalable à la libération du prolétariat anglais. L’oppression d’une autre nation contribue à renforcer l’hégémonie idéologique de la bourgeoisie sur les travailleurs de la nation opprimée : toute nation qui en opprime une autre forge ses propres chaînes ;
3. L’émancipation de la nation opprimée affaiblit les bases économiques, politiques, militaires et idéologiques des classes dominantes de la nation opprimée, ce qui contribue à la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière de cette nation.
Les positions de Friedrich Engels sur la Pologne et l’Irlande étaient largement similaires à celles de Marx. Toutefois, on trouve dans ses écrits un curieux concept théorique, la doctrine des « nations non historiques » – une catégorie dans laquelle il inclut, pêle-mêle, les Slaves du Sud (Tchèques, Slovaques, Croates, Serbes, etc.), les Bretons, les Écossais et les Basques. Selon Engels, « ces survivances d’une nation impitoyablement piétinée par la marche de l’histoire, comme le dit Hegel, ces “déchets de peuples” deviennent chaque fois les soutiens fanatiques de la contre-révolution, et ils le restent jusqu’à leur extermination et leur dénationalisation définitive ; leur existence même n’est-elle pas déjà une protestation contre une grande révolution historique ? » 3.
Engels a développé cet argument métaphysique pseudo-historique dans un article de 1855, qui affirmait que « le panslavisme est un mouvement qui s’efforce d’effacer ce qu’ont créé mille ans d’histoire, et qui ne peut se réaliser sans rayer de la carte la Turquie, la Hongrie et la moitié de l’Allemagne » 4.
Paradoxalement, le même Engels, dans un article de la même époque (1853), avait souligné que l’Empire turc était destiné à se désintégrer à la suite de la libération des nations balkaniques, ce qui ne l’étonnait nullement car, en bon dialecticien, il admirait dans l’histoire « les changements éternels de la destinée humaine [...] où rien n’est stable que l’instabilité, rien n’est immobile, que le mouvement » 5.
Pour la défense d’Engels, on pourrait avancer qu’il s’agissait d’articles de journaux, dépourvus du caractère rigoureux d’un travail scientifique, et qu’ils avaient donc un statut différent de celui de ses écrits théoriques proprement dits.
Le débat marxiste classique au sein de la IIe Internationale : la question nationale au tournant du siècle
C’est à la fin du 19e siècle et au début du 20e que se déroule la discussion la plus importante sur la question nationale parmi les marxistes de la Deuxième Internationale. Des contributions intéressantes traitent de questions spécifiques : la question juive – du bundiste Vladimir Medem au sioniste Ber Borochov – ou la question irlandaise, avec James Connolly. Mais les réflexions théoriques les plus générales sont celles des marxistes des Empires austro-hongrois et russe (tsariste) multinationaux : Otto Bauer, Rosa Luxemburg, Staline, Lénine, Trotsky.
La gauche radicale contre le séparatisme national : Rosa Luxemburg, Léon Trotsky
Le courant de la « gauche radicale » (Linksradikale) représenté par Luxemburg, Pannekoek, Trotsky (avant 1917) et Strasser se caractérisait, à des degrés divers et sous des formes parfois très différentes, par son opposition au séparatisme national, au nom du principe de l’internationalisme prolétarien. Si les marxistes occidentaux Pannekoek et Strasser ont eu peu d’influence, il n’en va pas de même pour la marxiste polonaise Rosa Luxemburg.
En 1893, Rosa Luxemburg fonde le Parti social-démocrate du Royaume de Pologne (PSDK), avec un programme marxiste et internationaliste, pour contrer le Parti socialiste polonais (PPS), dont l’objectif est de lutter pour l’indépendance de la Pologne. Dénonçant le PPS (avec une certaine justesse) comme un parti social-patriotique, Rosa et ses camarades du SDKP étaient résolument opposés au slogan de l’indépendance de la Pologne et soulignaient, au contraire, le lien étroit entre les prolétariats russe et polonais et leur destin commun.
En 1896, Luxemburg représenta le SDKP au congrès de la Deuxième Internationale. Les positions qu’elle défendit dans son intervention furent exposées dans un article ultérieur : « la libération de la Pologne est aussi utopique que la libération de la Tchécoslovaquie, de l’Irlande ou de l’Alsace-Lorraine […]. La lutte politique unificatrice du prolétariat ne doit pas être supplantée par une “série de luttes nationales stériles” ». 6.
Les bases théoriques de cette position seront fournies par les recherches qu’elle a effectuées pour sa thèse de doctorat, Le développement industriel de la Pologne (1898). Le thème central de ce travail était que, du point de vue économique, la Pologne était déjà intégrée à la Russie. Seules la petite bourgeoisie et les couches précapitalistes nourrissaient encore le rêve utopique d’une Pologne unie et indépendante.
Sa déclaration la plus controversée sur la question nationale (que Lénine, en particulier, a attaquée) est la série d’articles publiés en 1908 sous le titre « La question nationale et l’autonomie » dans le journal du Parti social-démocrate polonais (devenu le SDKPiL, après l’adhésion d’un groupe marxiste lituanien). Les principales idées avancées dans ces articles sont les suivantes : 1. le droit à l’autodétermination est un droit abstrait et métaphysique, comme le soi-disant « droit au travail » prôné par les utopistes du 19e siècle ; 2. Le soutien au droit de sécession de chaque nation implique en réalité le soutien au nationalisme bourgeois : la nation en tant qu’entité uniforme et homogène n’existe pas – chaque classe de la nation a des intérêts et des « droits » conflictuels ; 3. l’indépendance des petites nations en général, et de la Pologne en particulier, est utopique du point de vue économique et condamnée par les lois de l’histoire. Pour Luxemburg, il n’y a qu’une seule exception à cette règle : les nations balkaniques de l’Empire turc (Grecs, Serbes, Bulgares, Arméniens). Ces nations avaient atteint un degré de développement économique, social et culturel supérieur à celui de la Turquie, empire décadent dont le poids mort les opprimait.
Pour étayer son point de vue sur le manque d’avenir des petites nations, Luxemburg utilise les articles d’Engels sur les « nations non historiques » (bien qu’elle les attribue à Marx : leur véritable paternité n’a en fait été établie qu’en 1913, avec la découverte de lettres inédites de Marx/Engels) (6).
Des approches concrètes
Comme on le sait, en 1914 Luxemburg fut l’une des rares dirigeant·es de la IIe Internationale à ne pas succomber à la grande vague de social-patriotisme qui submergea l’Europe avec l’avènement de la guerre. Emprisonnée par les autorités allemandes pour sa propagande internationaliste et antimilitariste, elle rédigea en 1915 et fit sortir clandestinement de prison son célèbre Brochure de Junius. Dans ce texte, Luxemburg adopte dans une certaine mesure le principe de l’autodétermination : « le socialisme reconnait à chaque peuple le droit à l’indépendance et à la liberté, à la libre disposition de son propre destin ». Cependant, pour elle, cette autodétermination ne pouvait être exercée au sein des États capitalistes existants, en particulier les États colonialistes. À l’ère de l’impérialisme, la lutte pour « l’intérêt national » est une mystification, non seulement par rapport aux grandes puissances coloniales, mais aussi pour les petites nations qui ne sont « que des pions sur l’échiquier impérialiste des grandes puissances ». 7
Toutefois, dans un article, Luxemburg expose le problème dans des termes très proches de ceux de Lénine : l’introduction de 1905 au recueil La question polonaise et le mouvement socialiste. Dans cet essai, Luxemburg distingue soigneusement le droit indéniable de chaque nation à l’indépendance (« qui découle des principes élémentaires du socialisme »), qu’elle reconnaît, et l’opportunité de cette indépendance pour la Pologne, qu’elle nie. C’est aussi l’un des rares textes où elle reconnaît l’importance, la profondeur et même la justification des sentiments nationaux (tout en les traitant comme un simple phénomène « culturel »), et où elle souligne que l’oppression nationale est « l’oppression la plus intolérable dans sa barbarie » et ne peut que susciter « hostilité et rébellion »…8
Les écrits de Léon Trotsky sur la question nationale avant 1917 peuvent être qualifiés d’« éclectiques » (terme utilisé par Lénine pour les critiquer), occupant une position à mi-chemin entre Luxemburg et Lénine. C’est surtout après 1914 que Trotsky s’est intéressé à la question nationale. Il l’aborde dans sa brochure La guerre et l’Internationale 9 ouvrage polémique dirigé contre le social-patriotisme, sous deux angles différents, voire contradictoires :
1. Une approche historique et économique. La guerre mondiale est le produit de la contradiction entre les forces productives, qui tendent vers une économie mondiale, et le cadre contraignant de l’État-nation. Trotsky annonçait donc « la destruction de l’État-nation en tant qu’entité économique indépendante », ce qui, d’un point de vue strictement économique, était une proposition justifiable. Mais il en déduit l’« effondrement » et la « destruction » de l’État-nation dans son ensemble ; l’État-nation en tant que tel, le concept même de nation, ne pourra plus exister à l’avenir que comme « fait culturel, idéologique et psychologique ».
2. Une approche politique concrète. Contrairement à Luxemburg, Trotsky proclame explicitement le droit des nations à l’autodétermination comme l’une des conditions de la « paix entre les nations », qu’il oppose à la « paix des diplomates ». En outre, il soutient la perspective d’une Pologne indépendante et unie (c’est-à-dire libérée de la domination tsariste, autrichienne et allemande) ainsi que l’indépendance de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Serbie, de la Bohême, etc. C’est dans la libération de ces nations et leur association dans une fédération balkanique qu’il voyait la meilleure barrière contre le tsarisme en Europe. En outre, Trotsky défendait une relation dialectique entre l’internationalisme prolétarien et les droits nationaux : la destruction de l’Internationale par les social-patriotes était un crime non seulement contre le socialisme, mais aussi contre « l’intérêt national, dans son sens le plus large et le plus correct », puisqu’elle dissolvait la seule force capable de reconstruire l’Europe sur la base des principes démocratiques et du droit des nations à l’autodétermination.
Après 1917, Trotsky adopte la conception léniniste de la question nationale, qu’il défend à Brest-Litovsk (1918) en tant que commissaire du peuple aux affaires étrangères.
Les austro-marxistes et l’autonomie culturelle
L’idée principale des austro-marxistes – Karl Renner et Otto Bauer – par rapport à la question nationale, notamment dans le contexte de l’Empire austro-hongrois, est l’autonomie culturelle dans le cadre d’un État plurinational, par le biais de l’organisation des nationalités en corporations juridiques publiques, dotées de toute une série de pouvoirs culturels, administratifs et juridiques. Ils souhaitaient à la fois reconnaître les droits des minorités nationales et maintenir l’unité de l’État austro-hongrois.
Le grand ouvrage d’Otto Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie (1907), partageait le postulat fondamental de Karl Renner et des autres austro-marxistes : la préservation de l’État plurinational, en accordant une autonomie nationale culturelle aux différentes communautés ethniques…
La particularité de l’analyse de Bauer réside dans la dimension psycho-culturelle de sa théorie sur la question nationale, construite sur la base du concept de « caractère national », défini en termes psychologiques : « la diversité des objectifs, le fait qu’un même stimulus peut provoquer des mouvements différents et qu’une même situation extérieure peut conduire à des décisions différentes ». Ce concept d’origine néo-kantienne a été sévèrement critiqué par les adversaires marxistes de Bauer (Kautsky, Pannekoek, Strasser, etc.) 10
L’œuvre de Bauer a une valeur théorique indéniable, notamment en ce qui concerne le caractère historiciste de sa méthode. En définissant la nation comme le produit d’un destin historique commun, comme « l’aboutissement jamais achevé d’un processus constant », comme une cristallisation d’événements passés, un « morceau d’histoire figé », Bauer se place résolument sur le terrain du matérialisme historique et en opposition frontale avec les mythes réactionnaires de la « nation éternelle » et de l’idéologie raciste. Cette approche historique confère au livre de Bauer une réelle supériorité méthodologique sur la plupart des auteurs marxistes de l’époque, dont les écrits sur la question nationale avaient souvent un caractère abstrait et rigide. Dans la mesure où la méthode de Bauer impliquait non seulement une explication historique des structures nationales existantes, mais aussi une conception de la nation comme un processus, un mouvement en perpétuelle transformation, il a pu éviter l’erreur d’Engels en 1848-49 : le fait qu’une nation (comme les Tchèques) « n’ait pas eu d’histoire » ne signifie pas nécessairement qu’elle n’aura pas d’avenir. Le développement du capitalisme en Europe centrale et dans les Balkans ne conduit pas à l’assimilation mais à l’éveil de nations « non historiques » 11.
Il convient d’ajouter que le programme d’autonomie culturelle de Bauer avait une valeur significative en tant que complément – et non alternative – à une politique fondée sur la reconnaissance du droit à l’autodétermination. En effet, la première Constitution de l’Union soviétique intégrait en quelque sorte le principe de l’autonomie culturelle des minorités nationales.
Lénine, Staline et le droit à l’autodétermination
Staline a été le premier dirigeant bolchevique à écrire sur la question nationale. C’est Lénine qui l’a envoyé à Vienne pour étudier la question et, dans une lettre adressée à Gorki en février 1913, il a parlé du « merveilleux Géorgien qui s’est fait connaître dans le monde entier » 12. Mais une fois l’article de Staline « Le marxisme et la question nationale » 13 terminé, il ne semble pas que Lénine ait été particulièrement enthousiaste à son sujet, car il ne le mentionne dans aucun de ses nombreux écrits sur la question nationale, à l’exception d’une brève référence entre parenthèses dans un article daté du 28 décembre 1913. Il est évident que les idées principales de l’œuvre de Staline sont celles du parti bolchevique et de Lénine. Cela dit, la suggestion de Trotsky selon laquelle l’article a été inspiré, supervisé et corrigé « ligne par ligne » par Lénine semble discutable 14.
Au contraire, sur un certain nombre de points assez importants, l’ouvrage de Staline diffère implicitement et explicitement des écrits de Lénine, voire les contredit.
1. Le concept de « caractère national », de « constitution psychologique commune » ou de « particularité psychologique » des nations n’est pas du tout léniniste. Cette problématique est un héritage de Bauer, que Lénine a explicitement critiqué pour sa « théorie psychologique ». 15 En affirmant sans ambages que « ce n’est que lorsque toutes ces caractéristiques [langue commune, territoire, vie économique et formation psychique] sont réunies que nous avons une nation », Staline a donné à sa théorie un caractère dogmatique, restrictif et rigide que l’on ne retrouve jamais chez Lénine. La conception stalinienne de la nation était un véritable lit de Procuste 16 idéologique. Selon Staline, la Géorgie d’avant la seconde moitié du 19e siècle n’était pas une nation car elle n’avait pas de « vie économique commune », étant divisée en principautés économiquement indépendantes. Selon ce critère, l’Allemagne, avant l’Union douanière, n’aurait pas été une nation non plus… On ne trouve nulle part dans les écrits de Lénine une « définition » aussi rigide et arbitraire de la nation.
2. Staline a explicitement refusé d’admettre la possibilité d’une unité ou d’une association de groupes nationaux dispersés au sein d’un État multinational : la question se pose de savoir s’il est possible d’unir en une seule union nationale des groupes qui sont devenus si distincts. Est-il concevable, par exemple, que les Allemands des provinces baltes et les Allemands de Transcaucasie puissent être « réunis en une seule nation » ? La réponse donnée, bien sûr, était que tout cela n’était « pas concevable », « pas possible » et « utopique » 17.
Lénine, en revanche, défendait vigoureusement la « liberté d’association, y compris l’association de toutes les communautés, quelle que soit leur nationalité, dans un État donné », citant précisément en exemple les Allemands du Caucase, de la Baltique et de la région de Petrograd. Il ajoutait que la liberté d’association de toute nature entre les membres de la nation, dispersés dans différentes parties du pays ou même du globe, était « indiscutable et ne pouvait être contestée que du point de vue bureaucratique et borné » 18.
3. Staline ne faisait aucune distinction entre le nationalisme oppressif tsariste grand-russe et le nationalisme des nations opprimées. Dans un paragraphe très révélateur de son article, il rejette d’un même souffle « la vague de nationalisme belliqueux, partie d’en haut, tout une suite de répressions de la part des “détenteurs du pouvoir” » et la « vague de nationalisme montant d’en bas, qui se transformait parfois en un grossier chauvinisme » des Polonais, des juifs, des Tatars, des Géorgiens, des Ukrainiens, etc. Non seulement il ne fait aucune distinction entre les nationalismes « d’en haut » et « d’en bas », mais il adresse ses critiques les plus sévères aux sociaux-démocrates des pays opprimés qui n’ont pas « tenu bon » face au mouvement nationaliste.
Lénine, la question nationale et la stratégie
Le point de départ de Lénine pour élaborer une stratégie sur la question nationale était le même que pour Luxemburg et Trotsky : l’internationalisme prolétarien. Cependant, contrairement à ses camarades de la gauche révolutionnaire, il insiste sur la relation dialectique entre l’internationalisme et le droit à l’autodétermination nationale. Il estime, premièrement, que seule la liberté de faire sécession rend possible l’union libre et volontaire, l’association, la coopération et, à long terme, la fusion entre les nations. Deuxièmement, seule la reconnaissance par le mouvement ouvrier de la nation oppressive du droit de la nation opprimée à l’autodétermination peut contribuer à éliminer l’hostilité et la suspicion des opprimé·es et à unir le prolétariat des deux nations dans la lutte internationale contre la bourgeoisie.
D’un point de vue méthodologique, Lénine se distingue de la plupart de ses contemporains par sa tentative de « mettre la politique aux commandes », c’est-à-dire par sa tendance obstinée et inébranlable à saisir et à mettre en évidence l’aspect politique de chaque problème et de chaque contradiction. En ce qui concerne la question nationale, alors que la plupart des autres auteurs marxistes voyaient principalement la dimension économique, culturelle ou « psychologique » du problème, Lénine estimait que la question de l’autodétermination « appartient entièrement et exclusivement [au domaine de la démocratie politique] »19, c’est-à-dire au domaine du droit à la sécession politique et à l’établissement d’un État-nation indépendant.
Il va sans dire que l’aspect politique de la question nationale pour Lénine n’est pas du tout celui dont se préoccupent les gouvernements, les diplomates et les armées. Que telle ou telle nation ait un État indépendant ou que les frontières soient entre deux États lui est totalement indifférent. Son objectif est la démocratie et l’unité internationaliste du prolétariat, qui passent toutes deux, selon lui, par la reconnaissance du droit des nations à disposer d’elles-mêmes. De plus, précisément parce qu’elle se concentre sur l’aspect politique, sa théorie de l’autodétermination ne fait aucune concession au nationalisme. Elle se situe uniquement dans la sphère de la lutte démocratique et de la révolution prolétarienne.
Le principal défaut de la conception léniniste de la question nationale est que l’accent exclusif mis sur le choix entre l’unification et la sécession laisse peu de place à des alternatives telles que l’autonomie nationale et culturelle. Mais dans la pratique, Lénine et les bolcheviks y auront recours, par exemple en ce qui concerne les communautés nationales telles que les juifs en URSS.
Réflexions contemporaines, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm
Dans les décennies qui ont suivi la Révolution russe d’octobre 1917, la plupart des discussions sur la question nationale ont porté sur des problèmes nationaux spécifiques. En 1922, Lénine et Staline se sont affrontés sur la question de l’autonomie de la Géorgie soviétique – un conflit décrit par l’historien Moshe Lewin comme Le dernier combat de Lénine. Dans les années 1930, Léon Trotsky écrit sur le droit à l’autodétermination de l’Ukraine soviétique. La question juive continue de susciter des controverses, avec, entre autres, la contribution d’un jeune disciple de Trotsky, Abraham Leon. Plusieurs marxistes noirs publient d’importantes analyses sur la minorité afro-américaine aux États-Unis (W.E.B. Du Bois, CLR James). En 1935, le marxiste catalan Andreu Nin a publié un livre sur les mouvements d’émancipation nationale, mais il s’agit essentiellement d’un résumé du débat classique, de Marx et Engels aux révolutionnaires russes. Bien entendu, il existe une vaste littérature marxiste sur les mouvements coloniaux de libération nationale.
Ce n’est qu’à la fin du 20e siècle que de nouvelles réflexions théoriques marxistes générales sur la question nationale ont vu le jour. Deux d’entre eux sont les plus influents : Benedict Anderson et Eric Hobsbawm.
Dans son livre novateur de 1983, Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme), Benedict Anderson définit la nation comme « une communauté politique imaginée ». Il explique qu’une nation « est imaginée parce que les membres de la plus petite nation ne connaîtront jamais la plupart de leurs confrères, ne les rencontreront jamais, ni même n’entendront parler d’eux, mais dans l’esprit de chacun d’eux vit l’image de leur communion ». Les membres de la communauté ne connaîtront probablement jamais chacun des autres membres face à face ; cependant, ils peuvent avoir des intérêts similaires ou s’identifier comme faisant partie de la même nation.
Enfin, une nation est une communauté parce que, « indépendamment de l’inégalité et de l’exploitation réelles qui peuvent prévaloir dans chacune d’elles, la nation est toujours conçue comme une camaraderie profonde et horizontale. En fin de compte, c’est cette fraternité qui a permis, au cours des deux derniers siècles, à tant de millions de personnes, non pas tant de tuer, mais de mourir volontairement pour des objectifs aussi limités ».
Selon Anderson, la langue joue un rôle important dans la consolidation des « communautés imaginées » nationales. Commençant avec une petite élite cultivée, la langue devient de plus en plus importante avec la généralisation de l’imprimé après le 18e siècle et, après le 19e siècle, avec la diffusion de la langue à travers l’éducation publique et l’administration. – On peut considérer que l’accent mis par Anderson sur l’imaginaire est trop unilatéral, mais son livre est sans aucun doute l’une des contributions les plus novatrices à la réflexion marxiste sur la question nationale.
Le livre d’Eric Hobsbawm en 1991, Nations and Nationalism since 1780 (Nations et nationalismes depuis 1780 : programmes, mythe et réalité) est peut-être l’étude la plus importante de la question après les grands classiques de la Deuxième Internationale. En examinant les différents critères proposés pour définir une nation, tels que la langue, l’ethnicité, le territoire, etc., il conclut que ces définitions « objectives » ont échoué, car il y a toujours des exceptions évidentes. En outre, les critères adoptés à cette fin sont eux-mêmes changeants et ambigus. Il propose donc une attitude d’« agnosticisme » et refuse toute définition a priori de ce qui constitue une nation. La seule définition qu’il accepte comme hypothèse de travail initiale pour son livre est que « tout ensemble suffisamment important de personnes dont les membres se considèrent comme membres d’une “nation” sera traité comme tel ». Bien sûr, il reste la question du « seuil » : qu’est-ce qu’un « groupe suffisamment important » ? Au 19e siècle, comme le montre Hobsbawm, seules les grandes nations étaient considérées comme lebensfähig (viables) : non seulement les libéraux, mais même Marx et Engels considéraient les petits peuples comme des survivances du passé et des obstacles au progrès historique…
Pour Hobsbawm, les nations sont des formations modernes, c’est-à-dire relativement récentes, produites par l’idéologie nationaliste et par « l’invention de la tradition » – un concept qui n’est pas sans similitude avec les « communautés imaginées » de Benedict Anderson. Hobsbawm est d’accord avec le spécialiste (non marxiste) du nationalisme Ernest Gellner pour dire que les nations comportent un élément d’artefact, d’invention et d’ingénierie sociale, et il cite le commentaire ironique suivant de cet anthropologue britannique : « Les nations en tant que moyen naturel, donné par Dieu, de classer les hommes, en tant que destin politique inhérent, sont un mythe ; le nationalisme, qui parfois prend des cultures préexistantes et les transforme en nations, parfois les invente… : c’est une réalité ». Mais il n’est pas d’accord avec Gellner sur l’accent unilatéral qu’il met sur la modernisation nationale par le haut, en ignorant les développements populaires « par le bas » 20
Internationaliste impénitent, Eric Hobsbawm est sceptique quant au principe wilsonien d’autodétermination nationale : la tentative (après le traité de Versailles) de faire coïncider les frontières de l’État avec les frontières de la nationalité et de la langue. Il estime que cette politique, visant à créer des États ethniquement homogènes, a conduit, inévitablement, à l’expulsion massive ou à l’extermination des minorités : « Telle était et telle est la réduction meurtrière à l’absurde du nationalisme dans sa version territoriale, bien que cela n’ait pas été pleinement démontré avant les années 1940 » 21.
L’analyse historique de Hobsbawm est remarquable, mais sa conclusion selon laquelle, à la fin du 20e siècle, la nation et le nationalisme sont de moins en moins importants est douteuse. Si l’on peut admettre avec lui que l’État-nation a perdu une grande partie de son importance économique, il est beaucoup moins évident que, comme il l’affirme, « le nationalisme n’est plus un vecteur majeur du développement historique » et qu’il a une « signification historique déclinante ». Les exemples qu’il donne pour illustrer son argumentation, au moment où il écrit son livre (1988-89), ont été démentis par le cours des événements dans les années qui ont suivi. Ainsi, il souligne que les tensions nationales en Yougoslavie « n’ont pas encore fait un seul mort » et, à propos de la montée des groupes nationalistes xénophobes tels que le Front national en France, il insiste sur leur « instabilité et leur impermanence » 22.
Si l’internationalisme est la seule perspective cohérente, d’un point de vue marxiste, pour considérer la question nationale, cela ne doit pas conduire, comme cela a souvent été le cas, à sous-estimer la force, l’influence et la capacité de nuisance des nations et du nationalisme.
Le 21 mai 2024
Bibliographie
B. Anderson, L’imaginaire national : réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, La Découverte, 1996, 212 pages ; réédition poche 2006.
O. Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie, Paris, EDI, 1987, vol. 1 ; La question des nationalités, éditions Syllepse, 660 pages, 2017
F. Engels, «The Magyar Struggle» (1848), in Marx, Engels, The Revolutions of 1848, Londres, Penguin 1973.
F. Engels, «What is to Become of Turkey in Europe ?» New York Daily Tribune, 1853, et «Deutschland und der Panslawismus», Neue Oder Zeitung, 1855, dans Marx, Engels Werke, Berlin, Dietz Verlag, 1968, vol. XI.
E. Hobsbawm, Nations et nationalismes depuis 1780 : programmes, mythe et réalité, Gallimard, 1992, édition poche 2001.
V.I. Lénine, «The National Program of the RSDLP», Collected Works, Moskow, Progress, 1958, Vol. 19 ; V.I. Lénine, «The Right of Nations to Self-Determination», et «Critical Remarks on the National Question» in Collected Works, Vol. 20 ; V.I. Lénine, «The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination», Collected Works, Vol. 22 ; V.I. Lénine, Collected Works, Vol. 35. En ligne sur marxists.org : « La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes ».
M. Löwy, «Marxists and the National Question», New Left Review, Londres, avril 1976.
R. Luxemburg, « Thèses sur les tâches de la social-démocratie internationale » (1915), « La Brochure de Junius, La guerre et l’Internationale », Œuvres complètes, Tome IV, Agone, 256 pages.
R. Luxemburg, «Die Polnische Frage auf dem Internationalen Kongress in London», (1896), «Vorwort zu dem Sammelband “Die polnische Frage und die sozialistische Bewegung”» (1905), «Nationalität und Autonomie» (1908), in Internationalismus und Klassenkampf, Berlin, Luchterhand, 1971 (Rosa Luxemburg, la Question nationale et l’autonomie, Le temps des cerises, 2001 - épuisé).
K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, 1845.
R. Rosdolsky, Friedrich Engels et les peuples «sans histoire», 384 pages, Syllepse, 2018.
J. Staline, Le marxisme et la question nationale.
L. Trotsky, Les Bolcheviks et la paix mondiale.
L. Trotsky, Staline, Syllepse, 2021, 1008 pages.
- 1
- 2
- 3
- 4
F. Engels, “Deutschland und der Panslawismus”, Neue Oder Zeitung, 1855, cité par R. Rosdolsky, Friedrich Engels et les peuples « sans histoire », Syllepse, 2018.
- 5
F. Engels , “What is to Become of Turkey in Europe ?”, New York Daily Tribune, 1853, cité par R. Rosdolsky, op.cit. p. 174.
- 6
R. Luxemburg, “Die polnische Frage auf dem Internationalen Kongress in London”, 1896, Internationalismus und Klassenkampf, Berlin, Luchterhand, 1971, pp. 142-143 et pp. 236, 239.
- 7
- 8
R. Luxemburg, voir note 6, pp. 192, 217-218).
- 9
- 10
O. Bauer, La question des nationalités et la social-démocratie, Paris, EDI, 1987, vol. 1, p. 139, réédité par Syllepse en 2017.
- 11
Otto Bauer, 1987, vol. 1, p. 149, voir note 10.
- 12
Lénine, édition 1958, vol.35:84.
- 13
Staline, 1913.
- 14
Trotsky, Staline, édition 1969:233.
- 15
Lénine, édition 1958, vol. 20:31.
- 16
Dans la mythologie grecque, Procuste (littéralement « celui qui martèle pour allonger ») est le surnom d’un brigand de l’Attique connu pour ne vouloir héberger chez lui que des personnes d’une taille donnée : il contraignait les voyageurs à s’allonger sur un lit ; il leur coupait les membres trop grands et qui dépassaient le lit, et étirait les pieds de ceux qui étaient trop petits. On parlait couramment de « lit de Procuste » pour désigner les tentatives de contraindre les choses à un seul modèle, une seule façon de penser ou d’agir, en référence aux pratiques de ce personnage.
- 17
Staline, Le marxisme et la question nationale, édition 1953 : 306-7, 309, 305, 339.
- 18
Lénine, 1958, 19 : 543 et Lénine, 1958, 20 : 39, 50.
- 19
Lénine, « La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d’elles-mêmes », édition 1958, 22:145.
- 20
Hobsbawm, édition 1991 : 8-11.
- 21
Hobsbawm, édition 1991 : 133.
- 22
Hobsbawm, édition 1991 : 163, 170, 173, 179.