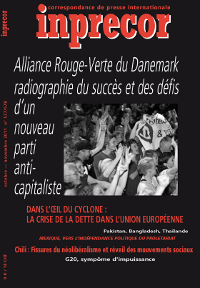Au début du mois d'octobre 2011, la faillite virtuelle de la banque franco-belge Dexia a été un signe supplémentaire de l'ampleur de la crise qui amène les pouvoirs publics à se mettre entièrement au service des intérêts privés en abusant des finances publiques.
En septembre 2011, devant l'ampleur des menaces qui pèsent sur l'ensemble du secteur financier privé confronté aux effets de sa politique aventuriste, les banques centrales d'Europe occidentale (la Banque centrale européenne - BCE, la Banque d'Angleterre et la Banque de Suisse) et la Réserve fédérale des États-Unis ont pris une mesure d'une exceptionnelle importance : elles mettent à disposition des banques privées toutes les liquidités nécessaires en dollars et en euros pour une période supérieure à trois mois afin de permettre aux organismes financiers de passer le cap de l'année 2011. C'est dire à quel point les gouvernants et les grands argentiers publics ont peur de ce qui peut arriver au dernier trimestre 2011. Les banques européennes qui empruntaient à court terme en dollars auprès des money market funds états-uniens ont vu se fermer le robinet. Il a fallu que les banques centrales prennent la relève sous peine d'assister à un possible krach bancaire d'organismes comme BNP Paribas, Dexia, la Société générale, le Crédit Agricole, Natixis pour ne parler que de quelques banques françaises et belges. Ce nouveau krach de Dexia (2) montre que cette mesure ne suffit pas à résoudre le problème perçu à tort comme un problème simple de liquidités. Dexia n'est peut-être que le premier domino à tomber en ce quatrième trimestre 2011.
Les pouvoirs publics comme le prêteur principal en premier et en dernier ressort
On assiste une fois de plus à une belle démonstration : dans l'UE, les banques centrales des pays membres et la BCE ne peuvent pas prêter d'argent aux pouvoirs publics qui doivent donc se financer auprès des banques et autres investisseurs institutionnels. Le secteur privé est donc supposé capable de financer seul et sans soutien étatique les besoins des pouvoirs publics, des entreprises et des ménages. Or voici que les banquiers centraux, c'est-à-dire les pouvoirs publics, apparaissent de plus en plus clairement comme le prêteur principal en premier et en dernier ressort. Les banques privées européennes se financent de cinq manières :
- elles empruntent aux autres banques sur le marché interbancaire ;
- elles empruntent aux ménages qui déposent en banque leurs liquidités — leur salaire en début de mois et leur épargne ;
- elles empruntent aux entreprises non financières ;
- elles empruntent en dollars aux money market funds des États-Unis (qui empruntent eux-mêmes auprès de la Réserve fédérale) ;
- elles empruntent aux banques centrales.
Or, le marché interbancaire s'est rétréci comme peau de chagrin car les banques doutent les unes des autres tant elles ont des actifs toxiques dans leur bilan ; les dépôts des ménages, en période de crise, ne sont pas extensibles et, plus grave, si les ménages perdent confiance dans une ou plusieurs banques, ils risquent de se ruer vers les guichets pour retirer leur argent et tenter de le mettre en sécurité (ce qui fait paniquer les banquiers, les banques centrales et les gouvernements dont certains, comme en France, ont limité les retraits de fonds par les particuliers) ; des entreprises non financières retirent leurs liquidités des banques — en septembre le Financial Times a révélé que la transnationale allemande Siemens avait retiré 500 millions d'euros de la banque française Société Générale pour les déposer à la BCE (3) ; les money market funds ont largement fermé le robinet de leur crédit à partir de juin 2011. Du coup, les banques privées se financent essentiellement auprès des banques centrales.
Rachat massif sur le marché secondaire de la dette par la BCE
Ce n'est pas tout. La BCE a poursuivi sa politique de rachat massif, sur le marché secondaire de la dette, de titres italiens, espagnols, grecs, portugais et irlandais. Entre le 8 août 2011 et le 12 septembre 2011, elle en a acheté pour 77 milliards d'euros, dont 40 milliards de titres italiens (4). L'objectif est double :
1. délester les banques privées d'Europe occidentale qui jusqu'en 2010 ont acheté à tour de bras des titres de la dette de ces pays considérés aujourd'hui à plus ou moins haut risque ;
2. essayer d'éviter que l'Italie et l'Espagne ne se retrouvent dans la situation de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal qui, à cause des taux d'intérêt qui ont explosé, ne peuvent plus emprunter sur les marchés au-delà d'un an.
Les besoins d'emprunts de l'Italie d'ici juillet 2012 s'élèvent à 300 milliards d'euros et ceux de l'Espagne à 80 milliards. Si l'Italie et l'Espagne devaient renoncer à emprunter sur les marchés financiers à cause de taux d'intérêt trop élevés, le Fonds européen de stabilité financière (FESF) ne disposerait pas des moyens suffisants pour répondre aux besoins de financement de ces deux pays, d'autant qu'il devra aussi acheter des titres grecs, portugais, irlandais, et peut-être d'autres pays membres de la zone euro (5)… De plus, le FESF est un instrument très peu pratique créé par les pays de la zone euro en mai 2010 pour répondre à la tourmente dans laquelle la Grèce se trouvait. Preuve du peu de maniabilité du FESF : la décision d'augmenter son volume d'intervention et de lui permettre de racheter des titres sur le marché secondaire ou d'injecter du capital dans des banques défaillantes prise par les gouvernements européens, la Commission européenne et la BCE le 21 juillet 2011 doit être ratifiée par chacun des 17 parlements de la zone euro. Dix semaines plus tard, le processus de ratification par les parlements n'est pas terminé.
Depuis le 21 juillet, la crise s'est encore accentuée : les Bourses ont continué à être très instables avec une très forte tendance à la baisse en particulier pour la capitalisation des banques ; la croissance économique a fléchi partout, même en Allemagne qui jusqu'en juin affichait des résultats supérieurs à la moyenne européenne ; la chute de la production et de la consommation en Grèce s'est aggravée ; le chômage augmente presque partout ; les recettes fiscales baissent partout, ce qui réduit les ressources des États pour rembourser la dette ; la possibilité de nouvelles faillites d'institutions financières privées est dans tous les esprits.
Les gouvernements européens sont pris à leur propre piège
Les gouvernements européens sont pris à leur propre piège : lors de la création de l'UE et de la BCE, ils ont décidé que la Banque centrale européenne et les banques centrales des États membres de l'UE n'avaient pas le droit de prêter directement aux États. Ceux-ci doivent s'en remettre aux institutions financières privées (banques, assurances, fonds de pensions…) pour se financer. Si la BCE et les banques centrales des États membres pouvaient prêter aux pouvoirs publics comme le fait la Réserve fédérale des États-Unis, la crise de l'UE serait atténuée. Sans prendre les États-Unis pour modèle, loin de là, il faut signaler que la FED a acheté au Trésor des titres de la dette publique (Treasury bonds) pour un peu plus de 1700 milliards de dollars, dont 900 milliards depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 (6).
D'autres caractéristiques de l'UE renforcent la crise. Le budget de l'Union est minuscule et les transferts fiscaux en faveur des économies les plus faibles sont très limités. A titre de comparaison, si les États-Unis étaient régis par les mêmes contraintes et que les transferts du budget fédéral états-unien vers les États membres étaient aussi faibles que dans l'UE, une dizaine d'États seraient dans la même situation que la Grèce ou le Portugal : la Virginie, le Maryland, le Nouveau Mexique, la Floride…
Les économies faibles de la zone euro qui accusent un déficit commercial par rapport aux pays les plus forts (Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Autriche…) n'ont pas la possibilité de jouer sur leur taux de change afin d'augmenter leurs exportations. L'appartenance à la zone euro s'est transformée en une camisole de force. C'est pourquoi l'éventualité d'une sortie de la zone euro fait partie du débat sur la sortie de la crise tant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique.
La crise de la zone euro et, au-delà, de l'UE est patente. C'est bien connu, le poisson pourrit en commençant par la tête. La crise traverse toutes les instances de centralisation de l'UE et de la zone euro, les gouvernements des principaux pays s'opposent sur les politiques à suivre. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ne s'entendent pas sur les mesures à prendre. Le gouvernement allemand est favorable a une réduction plus importante de la valeur des titres grecs dans les bilans des banques privées qui les détiennent tandis que le gouvernement français fait pression pour qu'on s'en tienne à la décote de 21 % acceptée le 21 juillet sur proposition de l'Institut international de la finance (IIF), le cartel des principales banques créancières de la Grèce. En claire opposition à son gouvernement, Josef Ackermann, président de ce cartel et directeur exécutif de la Deutsche Bank, a affirmé lors de la réunion annuelle de la Banque mondiale et du FMI tenue à Washington fin septembre 2011 qu'il était opposé à toute révision de l'accord sur une décote limitée à 21 %. Il a martelé : " Si on commence à rouvrir cette boîte de Pandore, on va perdre beaucoup de temps… » (7). Il y a donc une mésentente franco-allemande sur le sujet au niveau gouvernemental (8) tandis que le front entre banquiers tient bon pour le moment. La crise de l'UE et de la zone euro se répercute aussi directement dans les institutions : Jürgen Stark, l'administrateur allemand de la BCE, a démissionné avec fracas en septembre 2011 et a exprimé publiquement son désaccord avec la politique suivie par l'institution sous la conduite de Jean-Claude Trichet. Il a dénoncé le rachat par la BCE des titres grecs, italiens…
De son côté, le gouvernement britannique campe sur des positions autonomes. Trop heureux de ne pas être entré dans la zone euro, il peut jouer sur le taux de change de la livre sterling. Alors que la dette publique de la Grande Bretagne est bien plus élevée que celle de l'Espagne, le gouvernement britannique, grâce à la livre sterling, dispose d'une marge de manœuvre beaucoup plus importante que le gouvernement espagnol. Le gouvernement britannique s'oppose par ailleurs à la majorité de ses collègues européens en ce qui concerne la proposition d'une taxe sur les transactions financières. Si elle voit le jour, il est probable qu'elle ne sera appliquée que par les États membres de la zone euro (9). La résistance du gouvernement britannique ne s'arrête pas là : il envisage sérieusement de porter plainte contre la BCE pour entrave à la libre circulation des capitaux ! En effet, la BCE veut que les entreprises financières par lesquelles passent d'importantes transactions en euro (notamment sur les produits dérivés comme les CDS) soient domiciliées dans la zone euro, ce qui va à l'encontre des intérêts du paradis fiscal qu'est la City de Londres (10).
Du côté des gouvernements des pays membres de la zone euro, certains comme les Slovaques et les Finnois ont manifesté leurs doutes concernant les décisions du 21 juillet, ce qui a fait planer un climat d'incertitude quant à la ratification de l'accord par leur parlement.
La crise de la dette dans la zone euro a fait en juillet 2011 une nouvelle victime dont la grande presse internationale et les dirigeants de l'UE ont très peu parlé. Il s'agit de Chypre dont les banques sont touchées directement par la crise grecque. Une raison majeure du silence autour de Chypre, c'est que le gouvernement de ce pays échaudé par les politiques d'austérité imposées à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal essaye de se passer de l'aide de la Troïka (Commission européenne, BCE et FMI) et est en négociation avec la Russie pour un prêt de 2 milliards d'euros. Le gouvernement italien cherche d'ailleurs lui aussi à éviter de passer sous les fourches caudines de la troïka : les autorités de Rome font la cour à la Chine pour qu'elle augmente ses achats de titres italiens.
L'expérience de 2007-2008 n'a absolument pas amené les gouvernements à imposer des règles prudentielles strictes. Au contraire, il s'agit de prendre des mesures pour empêcher les institutions financières, banques, assurances, fonds de pension et autres hedge funds de continuer à nuire.
► Il est nécessaire de traduire en justice les autorités publiques et les patrons d'entreprises responsables directs ou complices actifs des débâcles boursières et bancaires.
► Dans l'intérêt de l'écrasante majorité de la population, il est urgent d'exproprier les banques et de les mettre au service du bien commun en les nationalisant et en les plaçant sous le contrôle des travailleurs et des citoyens. Non seulement il faut se refuser à une quelconque indemnisation des grands actionnaires, mais il convient en outre de récupérer sur leur patrimoine global le coût de l'assainissement du système financier.
► Il s'agit également de répudier les créances illégitimes que les banques privées réclament aux pouvoirs publics.
► Il faut bien sûr adopter une série de mesures complémentaires: contrôle des mouvements de capitaux, interdiction de la spéculation, interdiction des transactions avec les paradis fiscaux et judiciaires, mise en place d'une fiscalité qui a pour objectif l'établissement de la justice sociale…
► Dans le cas de l'Union européenne, il convient d'abroger différents traités dont ceux de Maastricht et de Lisbonne.
► Il faut aussi modifier radicalement les statuts de la Banque centrale européenne.
Alors que la crise n'a pas encore atteint son apogée, il est grand temps de prendre un tournant radical afin de donner une issue anticapitaliste aux convulsions bancaires et boursières. ■
* Cet article complète la série : " Dans l'œil du cyclone : la crise de la dette dans l'Union européenne ».
2. Dexia en failllite début octobre 2008 a été renflouée par l'action conjointe des gouvernements français, luxembourgeois et belge. Ce sauvetage coûteux pour les États et les collectivités locales a laissé intacte la structure de direction et le fonctionnement de cette banque privatisée au cours des années 1990.
3. http://www.lepoint.fr/economie/banque-siemens-a-retire-500-millions-d-e…
4. Financial Times " Central banks walk a monetary tightrope », 23 septembre 2011, voir aussi dans la même édition : " Italy : Fight for credibility continues ». Le montant total des rachats effectués par la BCE entre mai 2010, date du début des rachats de titres grecs sur le marché secondaire, et le 12 septembre 2011 s'élève à 143 milliards d'€. En mai 2010 et mars 2011, la BCE avait acheté des titres grecs pour 66 milliards €. Ensuite, elle n'a, selon ses propres dires, plus acheté de titres jusqu'au 8 août 2011. Voir à ce sujet : Eric Toussaint " La BCE, fidèle serviteur des intérêts privés » http://www.cadtm.org/la-BCE-fidele-serviteur-des
5. En septembre 2011, près de la moitié de la dette publique de l'eurozone (qui totalise 6 500 milliards euros) est passée dans la catégorie à risque élevé. La nouveauté c'est que la dette publique de la Belgique est dorénavant considérée par les marchés financiers comme à risque élevé. La dette publique belge représente 5 % de la dette publique de l'eurozone, la Grèce représente 4 %, le Portugal 2 %, l'Irlande 1 %, l'Espagne 9 % et l'Italie… 26 % ! (Voir Martin Wolf, " Fear and loathing in the eurozone », Financial Times, 28 septembre 2011).
6. Financial Times, " Central banks walk a monetary tightrope », 23 septembre 2011. Un des gros défauts de la politique de la FED est d'avoir acheté aux institutions financières privées des actifs toxiques (liés au marché des subprime) pour un montant de 1 250 milliards de dollars et d'avoir prêté des montants astronomiques à ces mêmes institutions afin de les maintenir à flot alors que l'État aurait dû les exproprier.
7. Financial Times, " IMF/World Bank meetings : Debt talks fail to agree solution », 26 septembre 2011.
8. Financial Times, " Splits over Greek bail-out », 28 septembre 2011.
9. Ce qui représente néanmoins une masse critique suffisante. Le défaut de cette taxe est sa timidité.
10. Financial Times, 14 septembre 2011.