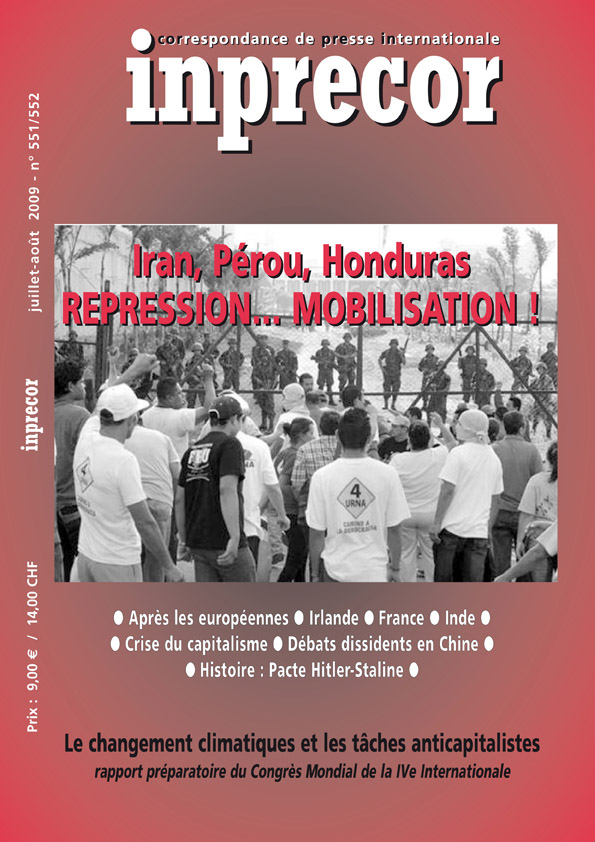Nous publions ci-dessous une version retravaillée du rapport présenté par Daniel Tanuro au Comité international de la IV<sup>e</sup> Internationale en février 2009 (les intertitres sont de la rédaction d'<i>Inprecor</i>). Ce rapport a été adopté pour servir de base à la rédaction d'une résolution au prochain congrès mondial. Nous souhaitons que ce rapport suscite d'autres contributions — que ce soit de la part de membres du Comité international de la IV<sup>e</sup> Internationale qui ont participé à la discussion du texte, ou de la part de militants engagés dans le combat sur le changement climatique et travaillant notamment le lien entre l'écologique et le social. Nous espérons alimenter un effort de réflexion collective en publiant de telles contributions.
I. LA MENACE CLIMATIQUE : CAUSES, RESPONSABILITES, IMPACTS SOCIAUX ET ECOLOGIQUES
1. Le changement climatique est un fait sans précédent
Le changement climatique est un fait. Au XXe siècle, la température moyenne de surface de la Terre s'est accrue de 0,6°C, le niveau des mers a monté de 10 à 20 cm, les glaciers ont presque partout reculé dans des proportions importantes, la violence des cyclones a augmenté dans l'Atlantique Nord, et on a enregistré davantage d'événements météorologiques extrêmes tels que tempêtes, inondations et sécheresses.
Il ne s'agit pas de variations périodiques (comme le phénomène " El Niňo », par exemple) mais de changements profonds et à long terme, traduisant un important déséquilibre global du système climatique. Le moteur de ces déséquilibres — la hausse de la température moyenne de surface — est d'une ampleur sans précédent depuis au moins 1300 ans. Cette hausse est fortement corrélée avec un autre phénomène, qui est lui sans précédent depuis 800 000 ans : l'augmentation de la concentration atmosphérique en carbone, sous la forme de gaz carbonique et de méthane — deux gaz dont la contribution à l'effet de serre est bien établie depuis longtemps par la physique.
L'explication du réchauffement actuel par la hausse des émissions des gaz à effet de serre en tant que cause majeure est certaine à plus de 90 % et ne fait plus l'objet de contestations crédibles sur le plan scientifique. Il est bien établi que le réchauffement actuel est unique et diffère radicalement des autres phases de réchauffement que la Terre a connues au cours de son histoire. Lors des périodes interglaciaires du passé, les variations naturelles dans la position de la Terre par rapport au Soleil, ou de l'activité solaire, créaient un réchauffement, celui-ci favorisait le développement de la vie, et ce développement à son tour entraînait une hausse de la concentration atmosphérique en CO2, laquelle accentuait encore le réchauffement. Aujourd'hui, la chaîne de causalité est inversée : les facteurs naturels n'expliquent qu'une part très limitée du réchauffement (5 % à 10 % environ) ; l'essentiel de celui-ci découle d'une hausse très rapide des concentrations atmosphériques en CO2 et en méthane, due aux activités humaines. En d'autres termes : jadis le changement climatique causait l'augmentation de l'effet de serre, aujourd'hui l'augmentation de l'effet de serre entraîne directement le changement climatique.
2. Basculement brutal, irréversible à l'échelle humaine des temps
L'expression " changement climatique » est trompeuse : nous sommes confrontés à un basculement brutal, irréversible à l'échelle humaine des temps.
L'expression " changement climatique » est trompeuse : elle évoque une modification graduelle alors que nous sommes confrontés à un basculement brutal, dont la vitesse s'accélère. Il est dû à trois types d'activités économiques qui accroissent les concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre :
(i) Les forêts, les prairies naturelles, les sols et les tourbières stockent le carbone sous forme de matière organique. La déforestation, la transformation des prairies en terres de culture, l'assèchement des zones humides et les mauvaises pratiques culturales ont pour effet de libérer ce carbone. Par ailleurs, l'emploi excessif d'engrais nitrés artificiels (17,9 % des émissions) provoque des émissions d'oxyde nitreux, un autre gaz à effet de serre ;
(ii) Toute combustion se traduit par l'émission de gaz carbonique (CO2). Mais il y a une grande différence entre le CO2 provenant de la combustion de biomasse, d'une part, et le CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel). Le premier est recyclé sans problème par les écosystèmes (plantes vertes et océans) qui absorbent et rejettent en permanence du CO2 (" cycle du carbone »). Le second, par contre, ne peut être recyclé que dans certaines limites. Or, depuis deux siècles, la combustion des combustibles fossiles injecte dans l'atmosphère très rapidement et en continu d'importantes quantités de CO2 (56,6 % des émissions) ;
(iii) Certains processus industriels sont responsables de l'émission de gaz à effet de serre (gaz fluorés) inconnus dans la nature. Le carbone n'est présent naturellement dans l'atmosphère qu'à des concentrations très faibles. C'est précisément pour cette raison que les activités humaines peuvent avoir un impact aussi important sur le système climatique. Actuellement, la quantité globale de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère est près de deux fois supérieure à la capacité d'absorption naturelle. Le reste s'accumule, entraînant l'augmentation de l'effet de serre, donc de la température, et cette accumulation tend à augmenter avec le réchauffement. Le mécanisme principal du réchauffement se résume ainsi en une saturation du cycle du carbone par les émissions de gaz provenant des activités humaines.
Ce réchauffement est irréversible à l'échelle humaine. Même si les concentrations atmosphériques en gaz à effet de serre (GES) étaient stabilisées immédiatement, le réchauffement ferait sentir ses effets pendant près de mille ans, parce que la température des énormes masses d'eau océaniques met très longtemps à s'homogénéiser. En l'absence de toute stabilisation, le mécanisme s'emballerait inévitablement et déclencherait des phénomènes fort dangereux, tels que la désintégration des calottes glaciaires, ou la libération des énormes quantités de méthane contenues dans les sols gelés (pergélisols), voire dans les fonds océaniques.
Il serait erroné et dangereux de miser sur le fait que l'épuisement des stocks de charbon, de pétrole et de gaz naturel surviendrait à temps pour protéger l'humanité de ces risques majeurs. En effet, les réserves prouvées de combustibles fossiles (notamment de charbon) sont amplement suffisantes pour provoquer un emballement incontrôlable. Dans ce cas, la Terre risquerait en fin de compte de retrouver des conditions qu'elle n'a pas connues depuis 65 millions d'années et que l'humanité n'a par conséquent jamais expérimentées : un globe sans glaces, où le niveau des mers dépasserait de cent mètres environ le niveau actuel.
3. Le basculement climatique et " l'activité humaine »
Le bouleversement climatique n'est pas dû à " l'activité humaine » en général, comme disent les médias et les rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), mais bien au mode de cette activité depuis la Révolution industrielle capitaliste, en particulier à la combustion des combustibles fossiles. La cause du phénomène réside fondamentalement dans la logique capitaliste et productiviste d'accumulation, dont le centre de gravité historique est situé dans les métropoles impérialistes.
Le décollage économique de la Révolution industrielle n'aurait pas pu se faire à grande échelle sans le charbon. Il serait pourtant réducteur d'imputer indistinctement le changement climatique au " progrès » en général. En effet, assez rapidement, de nouvelles possibilités d'exploitation des énergies renouvelables sont apparues, qui auraient permis de concilier un développement raisonnable et la protection de l'environnement. Elles ont été écartées systématiquement par la logique capitaliste d'accumulation. A cet égard, le contraste est criant entre le désintérêt durable pour le photovoltaïque (découvert en 1839) et l'engouement immédiat des pays capitalistes (et non-capitalistes) pour la fission atomique. Le développement de la filière nucléaire n'aurait pas été possible sans des investissements publics considérables, consentis en dépit des dangers terribles de cette technologie. Le potentiel solaire n'a jamais bénéficié d'un tel intérêt.
Au fur et à mesure du développement capitaliste, les grands groupes énergétiques ont acquis un poids déterminant qui leur a permis de façonner le système énergétique en fonction de leurs intérêts. Le pouvoir de ces groupes résulte non seulement du fait que l'énergie est indispensable à toute activité économique et que les investissements énergétiques sont à long terme, mais aussi du fait que le caractère limité et appropriable des gisements de combustibles fossiles offre la possibilité d'imposer des prix de monopole, donc de prélever un surprofit important, stabilisé sous la forme de rente énergétique.
Le rôle clé du pétrole, en tant que source abondante et bon marché de carburant liquide à haut contenu énergétique, a notamment permis aux capitaux de plus en plus concentrés et centralisés qui contrôlent ce secteur d'occuper une position stratégique, à la fois sur le plan économique et politique. Ensemble avec les producteurs de charbon, les électriciens et les grands secteurs dépendant du pétrole (automobile, construction navale et aéronautique, pétrochimie), les multinationales pétrolières ont empêché l'utilisation de ressources énergétiques, de technologies et de schémas de distribution alternatifs, tout en poussant à la surconsommation et en limitant les progrès de l'efficience énergétique, tant au niveau des systèmes que des produits.
Pour comprendre l'engrenage du changement climatique, il convient de compléter l'analyse en intégrant la tendance du capitalisme en général à la concentration et à la centralisation, au remplacement incessant du travail vivant par du travail mort, à la standardisation des techniques et à la surproduction de biens de consommation de masse pour le marché mondial. Après la deuxième guerre mondiale, cette tendance s'est traduite notamment par la fabrication de millions d'automobiles individuelles. Tout en " tirant » l'onde longue expansive des " trente glorieuses », cette production a contribué à faire exploser l'usage des combustibles fossiles, donc les émissions.
Plus près de nous, la mondialisation capitaliste néolibérale, l'exportation massive des capitaux vers les pays émergents, la production à flux tendu pour le marché mondial, le démantèlement des transports publics (notamment du rail), et l'accroissement spectaculaire des transports par avion et par bateau sont venus donner une nouvelle impulsion au phénomène.
4. Responsabilité du " socialisme réel »
Les pays du " socialisme réel » portent aussi une lourde responsabilité : renonçant à la révolution mondiale, ils ont singé le productivisme et copié les technologies capitalistes
Dans l'analyse du changement climatique, la responsabilité des pays qui ont tenté de s'engager sur une voie alternative au capitalisme ne peut être éludée. Du fait de leur dégénérescence bureaucratique, principalement, ces pays ont renoué avec le productivisme et ont porté le gaspillage des ressources naturelles, notamment énergétiques, à un niveau sans précédent.
La Russie tsariste était un pays arriéré. Après la guerre, la révolution et la guerre civile, il n'aurait pas été possible de le redresser sans recourir aux combustibles fossiles. Ceci contribue en partie à expliquer l'absence de réflexion prospective des théoriciens soviétiques sur l'impasse inévitable à terme d'un système basé sur des sources non renouvelables, mais d'autres éléments doivent sans doute être pris en compte (cf. chap. 5. infra). Ce qui semble certain, c'est que le développement économique ultérieur de l'URSS aurait permis d'explorer d'autres choix énergétiques, mais que la dictature stalinienne et la dégénérescence du " socialisme dans un seul pays » ont bouché cette possibilité.
En abandonnant la perspective de la révolution mondiale, en misant sur une coexistence pacifique avec l'impérialisme dans l'espoir de sécuriser ses propres privilèges, en étouffant la pensée créatrice, la bureaucratie stalinienne a choisi du même coup de se mettre à la traîne du développement technologique des pays capitalistes développés — tiré en avant par les technologies militaires — et d'imiter le système énergétique capitaliste — taillé sur mesure pour les besoins du capital. Cette logique culmina sous Khrouchtchev avec l'illusion d'un rattrapage et d'un dépassement des USA. Elle entraîna notamment le développement insensé de l'énergie nucléaire, qui devait déboucher sur la catastrophe de Tchernobyl.
Basé sur un système de primes au tonnage de matières consommées, le mode bureaucratique d'intéressement matériel des directeurs aux résultats de la production a constitué un facteur de gaspillage spécifique. Le résultat fut un système énergétique encore plus polluant et gaspilleur que le modèle capitaliste de référence, et encore moins efficace.
Enfin, le mépris pour les besoins des masses, leur exclusion des décisions politique et la volonté de les maintenir dans un état d'atomisation sociale ont conduit à des choix largement irrationnels dans toute une série de domaines (aménagement du territoire, architecture, urbanisme… pour ne pas parler de la collectivisation forcée de l'agriculture). Ces choix ont eu pour effet d'aggraver le gaspillage des ressources et l'inefficacité énergétique de l'ensemble, sans compter les graves conséquences dans d'autres domaines, notamment en matière de pollution et de santé publique.
C'est ainsi que, après la deuxième guerre mondiale, les émissions de l'URSS et de certains pays d'Europe centrale ont commencé à représenter une part significative des émissions mondiales. La comparaison des tonnages de gaz carbonique émis par personne et par an dans ces pays avec les tonnages émis à l'époque dans les pays capitalistes développés montre bien la responsabilité spécifique du " socialisme réel » dans le détraquement du climat. Juste avant la chute du Mur, par exemple, la Tchécoslovaquie émettait 20,7 tonnes de CO2/hab/an et la RDA 22 tonnes CO2/hab/an. A titre de comparaison, les USA, le Canada et l'Australie — les plus importants émetteurs de CO2 du monde capitaliste développé — émettaient à cette époque respectivement 18,9, 16,2 et 15 tonnes de CO2/hab/an, pour un PNB par habitant largement supérieur.
5. Conséquences catastrophiques
Le changement climatique est porteur de conséquences catastrophiques pour l'humanité ainsi que pour les écosystèmes. Il n'y a aucun doute que ses effets négatifs l'emportent nettement sur les effets positifs, même pour une hausse de température limitée. Selon le GIEC (1) :
— Pour tout accroissement de température entre +1°C et +5°C, la sécheresse devrait s'intensifier dans les régions subtropicales et dans les régions tropicales semi-arides. A partir de +2°C, des millions de gens supplémentaires pourraient être soumis à des inondations côtières chaque année. A partir de +3°C, 30 % environ des zones humides côtières seraient perdues.
— Dès maintenant, le réchauffement diminue les récoltes des petits fermiers et les prises des petits pêcheurs, qui produisent des moyens de subsistance pour les populations locales. A partir de +1°C, on projette des pertes accrues de productivité de certaines céréales dans les régions tropicales et, à partir de +3,5°C, une perte de productivité pour toutes les céréales à ces latitudes. Dans les régions tempérées (haute latitude), les modèles indiquent une hausse de productivité pour certaines céréales à partir de +1°C, mais une baisse de productivité de plus en plus généralisée à partir de + 3,5°C.
— Dès maintenant aussi, les systèmes de santé sont confrontés à une charge supplémentaire due à la malnutrition, à la diarrhée, aux maladies cardio-respiratoires et infectieuses, dont l'augmentation est une conséquence des changements climatiques. La morbidité et la mortalité accrues lors des canicules, inondations et sécheresses se font déjà sentir, de même que la modification des aires de distribution de certains insectes vecteurs de maladies (anophèles transmettant la malaria, tiques transmettant la maladie de Lyme, ...). De plus, la combustion des combustibles fossiles contribue à la pollution de l'air, notamment par les particules fines qui sont une cause majeure de l'accroissement extrêmement préoccupant des maladies respiratoires telles que l'asthme.
— A partir de +1°C, on estime que 30 % des espèces animales et végétales courront un risque accru d'extinction. Quant à une hausse de +5°C, elle signifierait des extinctions significatives d'espèces dans toutes les régions du globe. Ces projections sont d'autant plus alarmantes que d'autres facteurs (tels que l'utilisation des sols) contribuent aujourd'hui déjà à une vague d'extinction plus importante et plus rapide que celle que la Terre a connue lors de la disparition des dinosaures, il y a soixante millions d'années. Outre ses importants aspects esthétiques, affectifs et culturels, cet appauvrissement radical du vivant constitue une grave menace. La biodiversité conditionne en effet les capacités d'adaptation des écosystèmes, notamment des écosystèmes cultivés, par exemple les possibilités de sélection de plantes de culture adaptées aux changements climatiques.
— A partir de +2,5°C environ, de 15 % à 40 % des écosystèmes terrestres commenceraient à émettre plus de CO2 qu'ils n'en absorbent, ce qui signifie que la saturation du cycle du carbone s'accroîtrait et que le réchauffement s'auto-alimenterait selon un effet boule de neige incontrôlable (" runaway climate change »).
Sur le plan humain, d'après certaines projections, le nombre de victimes supplémentaires de ces fléaux tendrait à augmenter de plus en plus rapidement en fonction de la hausse de température. Pour une hausse de +3,25°C (par rapport à la période pré-industrielle), située à peu près au milieu des projections du GIEC, les inondations côtières feraient entre 100 et 150 millions de victimes d'ici 2050, les famines jusqu'à 600 millions et la malaria 300 millions, tandis que la pénurie d'eau pourrait frapper jusqu'à 3,5 milliards de personnes supplémentaires.
Ces estimations sont évidemment frappées d'incertitudes plus ou moins fortes. De plus, les impacts sont fonction de facteurs sociaux qui peuvent les accroître ou les réduire dans une certaine mesure, surtout si le réchauffement reste limité. Il reste que, à politique inchangée, l'ampleur générale des menaces est considérable.
6. Lourd tribut des peuples du Sud
Dès à présent, les peuples du Sud paient un lourd tribut au basculement climatique dont ils seront les principales victimes.
326 catastrophes climatiques ont été enregistrées en moyenne chaque année entre 2000 et 2004 ; elles ont fait 262 millions de victimes — près de trois fois plus qu'entre 1980 et 1984. Plus de 200 millions d'entre elles vivaient dans des pays non-membres de l'OCDE qui ne portent qu'une responsabilité marginale dans l'accroissement de l'effet de serre. Pour les années 2000-2004, un habitant sur 19 a été affecté par une catastrophe climatique dans les pays en développement. Le chiffre correspondant pour les pays de l'OCDE est de 1 sur 1500 (79 fois moins). (2)
Faute de politique adéquate, cette injustice climatique est appelée à s'accentuer pour atteindre des proportions dramatiques. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) le reconnaît : du fait du changement climatique, même les " Objectifs du Millénaire » ne seront pas réalisés, alors qu'ils sont notoirement insuffisants. En cas de catastrophe climatique, certains pays parmi les plus pauvres risquent d'entrer dans une spirale de régression sociale et économique sans issue. Par exemple, l'immense majorité des centaines de millions d'êtres humains menacés par la montée du niveau des océans vivent en Chine (30 millions), en Inde (30 millions), au Bangladesh (15-20 millions), en Egypte (10 millions), ou dans d'autres deltas — notamment Mékong, Niger… (10 millions). Pour une hausse d'un mètre du niveau des océans, un quart de la population du Vietnam devrait déménager.
La montée de l'insécurité alimentaire est une autre manifestation criante de l'injustice climatique. Selon certaines sources, le potentiel de production agricole des pays développés pourrait augmenter de 8 % à l'horizon 2080 alors que celui des pays en voie de développement diminuerait de 9 %. L'Amérique latine et l'Afrique seraient les continents les plus affectés, avec des pertes de productivité supérieures à 12 %, voire à 15 %. Dans certaines régions d'Afrique subsaharienne et d'Asie, la productivité de l'agriculture non irriguée pourrait être réduite de moitié dans les 20 ans qui viennent, selon le GIEC. Les conséquences risquent de se décliner en termes de dépendance renforcée vis-à-vis de l'agrobusiness capitaliste, de mainmise croissante des latifundistes, de pauvreté et de famine accrues frappant les petits paysans, d'exode rural et de dégradations environnementales.
7. Travailleurs et pauvres des pays développés en danger
L'exemple du cyclone Katrina montre les dangers pour les travailleurs et les pauvres des pays développés également
En septembre 2005, le cyclone Katrina qui a frappé la Nouvelle Orléans a montré que les fractions les plus pauvres de la classe ouvrière dans les pays développés sont à peine mieux loties face au changement climatique que les masses des pays dominés : elles habitent dans les zones les plus exposées aux catastrophes, n'ont pas les moyens de fuir (ou craignent de le faire par peur de ne pas pouvoir revenir et de tout perdre), leurs biens ne sont pas ou insuffisamment assurés.
Katrina a entraîné la mort de 1500 personnes et le déplacement de 780 000 autres. 750 000 d'entre elles n'étaient couvertes par aucun régime d'assurances. La Nouvelle Orléans comptait 28 % de pauvres (moyenne des États-Unis : 12 %) et 35 % de pauvres parmi la population afro-américaine (moyenne des États-Unis : 25 %). Les quartiers où ils vivaient ont été les plus touchés. 75 % de la population dans les quartiers inondés était noire.
Faute d'évacuation prise en charge par les pouvoirs publics, 138 000 des 480 000 habitants de la ville ont été pris au piège. Sans eau potable, sans électricité, sans téléphone, ils ont attendu plus de cinq jours avant d'être secourus. L'immense majorité d'entre eux étaient des travailleurs pauvres, des chômeurs, des enfants pauvres, des personnes âgées sans ressources. Ce bilan est inséparable de la politique de classe, impérialiste et raciste de la bourgeoisie états-unienne en général, et de l'administration Bush en particulier. A partir de 2003, pour financer la " guerre contre le terrorisme », l'État fédéral a diminué systématiquement les budgets du service chargé de l'entretien des digues ; pour l'année 2005, ce service avait reçu à peine le sixième des moyens demandés. Cette politique arrogante et brutale s'est poursuivie après la catastrophe, à travers une stratégie de reconstruction visant à chasser les pauvres de la ville et à attaquer les acquis sociaux des travailleurs (suppression du salaire minimum, notamment).
Ce bilan est inséparable aussi des autres inégalités sociales qui caractérisent la société capitaliste, en premier lieu les inégalités imposées aux femmes. Ce n'est pas par hasard que les femmes afro-américaines (et leurs enfants) ont payé le plus lourd tribut à la catastrophe. D'une part, les femmes sont en première ligne face aux menaces climatiques parce qu'elles représentent 80 % des 1,3 milliards d'êtres humains vivant sous le seuil de pauvreté. D'autre part, elles sont frappées d'une manière spécifique, du fait de leur oppression. Dans les pays les moins développés, les changements climatiques entraînent par exemple l'alourdissement de la collecte du bois de chauffe et la réduction des revenus provenant des travaux agricoles, deux tâches assumées majoritairement par les femmes. Dans les pays plus développés, la précarité de l'emploi, le travail à temps partiel et les bas salaires touchent en particulier les femmes, et celles-ci ont de ce fait moins de possibilités de se prémunir contre les effets des changements climatiques. Dans les deux cas, les conséquences touchent encore plus durement les femmes seules avec enfants et, parmi ceux-ci, les filles.
II. LES CONTRAINTES PHYSIQUES ET HUMAINES DU SAUVETAGE DU CLIMAT
8. Urgence
L'urgence est maximale. Même une réduction très radicale et rapide des émissions de gaz à effet de serre ne semble plus permettre de ne pas franchir le seuil de dangerosité.
Selon le GIEC, le maintien des tendances actuelles en matière d'émissions impliquerait, d'ici 2100, une hausse de la température moyenne de surface comprise entre +1,1 et +6,4°C par rapport à 1990. L'ampleur de la fourchette s'explique par la double incertitude qui découle des modèles climatiques, d'une part, et des scénarios de développement humain, d'autre part.
Entre 1990 et 2006, la hausse observée des températures s'est située dans la partie haute de la fourchette des projections. Sur cette base empirique, on est amené à conclure que l'humanité risque d'être confrontée, à relativement court terme, à un écart thermique d'au moins +4,5°C par rapport à la fin du XVIIIe siècle.
Un tel écart représenterait un changement des conditions d'existence au moins aussi considérable que celui qui sépare l'époque actuelle de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans. Mais, loin de prendre des millénaires, le changement pourrait s'opérer en quelques siècles, voire moins. Cette rapidité diminue sérieusement les possibilités d'adaptation, tant pour les sociétés humaines que pour les écosystèmes.
En 1996, l'UE faisait d'une hausse maximale de 2°C l'objectif de sa politique climatique. La décision était prise sur base des estimations de l'époque concernant le seuil de dangerosité. Depuis lors, ces estimations sont revues à la baisse, les experts situant le seuil plutôt autour de 1,7°C. On constate en effet que, pour une telle hausse, les risques sont déjà élevés, tout particulièrement dans trois domaines : déclin de la biodiversité, hausse du niveau des océans et productivité agricole des pays tropicaux ou subtropicaux.
La température moyenne de surface de la Terre a déjà augmenté de 0,7°C depuis la période pré-industrielle et un réchauffement différé de 0,6°C est probablement déjà " dans le pipe-line ». Par conséquent, la marge de manœuvre pour sauver le climat est extrêmement étroite. L'urgence doit être considérée comme maximale.
Les gaz à effet de serre ont une durée de vie plus ou moins longue dans l'atmosphère (150 ans environ pour le CO2). Il en découle que la stabilisation de la température implique non pas une stabilisation des émissions mais une réduction, d'autant plus rapide et sévère que l'objectif de stabilisation est bas.
Le scénario le plus radical testé par le GIEC dans le cadre de son quatrième rapport d'évaluation (2007) consiste en une stabilisation de la concentration atmosphérique en CO2 entre 350 et 400 parts par millions (ppm), correspondant à 445-490 ppm d'équivalents CO2 (3). Ce scénario implique (i) de réduire les émissions globales de 50 % à 85 % d'ici 2050 et (ii) que la quantité de gaz à effet de serre émise au niveau mondial commence à décliner au plus tard en 2015.
Les pays développés sont responsables à plus de 70 % du changement climatique, parce qu'ils brûlent des combustibles fossiles depuis plus de deux cents ans. Les efforts des pays développés et des pays dominés doivent donc être ventilés en fonction des responsabilités historiques. Dans ce cas, les premiers devraient diminuer leurs émissions de 80 % à 95 % d'ici 2050, en passant par une réduction de 25 % à 40 % d'ici 2020. Quant aux seconds, il faudrait que leurs émissions " dévient substantiellement par rapport au scénario de référence » d'ici 2020, selon le GIEC (2050 pour l'Afrique). (4)
Le CO2 est un produit inévitable de toute combustion et la combustion des combustibles fossiles assure 80 % de la fourniture d'énergie au niveau mondial. Les objectifs ci-dessus représentent donc un défi colossal. Ils ne signifient rien moins qu'un abandon quasi-total de l'usage des combustibles fossiles, à réaliser en moins d'un siècle, ce qui nécessite une mutation socio-économique extrêmement profonde.
Même si les objectifs ci-dessus étaient atteints, la hausse de température dépasserait légèrement 2°C : le GIEC la chiffre entre 2°C et 2,4°C à l'équilibre (dans un millénaire environ). En d'autres termes, il ne semble plus possible de ne pas dépasser le seuil de dangerosité. On ne peut en tirer qu'une seule conclusion rationnelle : les objectifs de réduction les plus contraignants s'imposent, non comme une vague indication d'un but à atteindre dans la mesure du possible, mais comme un " must » incontournable.
9. Objectifs impératifs
Les objectifs à adopter sont d'autant plus impératifs que les rapports du GIEC sous-estiment certains paramètres des changements climatiques.
Pour prendre toute la mesure du défi, il convient de préciser que leurs conclusions reposent sur des hypothèses conservatrices, de sorte que la prudence devrait commander de prendre les projections les plus pessimistes comme base de l'action à mener, et de les considérer comme le minimum nécessaire.
La nécessité de cette prudence ressort notamment de deux éléments :
a) le GIEC sous-estime les phénomènes non-linéaires. Un des principaux facteurs d'incertitude des projections réside dans la grande complexité des phénomènes dits " non-linéaires », tels que la dislocation possible des calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. Contrairement à la fonte des glaces, qui est un phénomène continu, la dislocation des calottes progresse par bonds et, jusqu'à présent, elle n'est pas modélisable. Ceci contribue sans doute à expliquer que la montée observée du niveau des océans ait été de 3mm/an de 1990 à 2006, soit 60 % de plus que les projections des modèles. La quantité totale de glace accumulée au Groenland et en Antarctique équivaut respectivement à 6 mètres et à 60 mètres environ de hausse du niveau des océans. Or, selon certains spécialistes, la concentration atmosphérique en CO2 est en train de franchir — dans l'autre sens — le seuil qualitatif correspondant à la formation de la calotte antarctique, il y a 35 millions d'années. Une débâcle partielle brutale serait dès lors possible à court ou moyen terme. Elle pourrait entraîner une hausse de plusieurs mètres du niveau des océans en moins d'un siècle. C'est une des menaces les plus sérieuses que le changement climatique fait peser à court et moyen terme.
b) le GIEC surestime la baisse spontanée de l'intensité en carbone de l'économie. Produire une unité de PIB nécessite une certaine quantité d'énergie fossile, donc un certain volume d'émissions. On constate empiriquement que cette " intensité en énergie » et cette " intensité en carbone » de l'économie ont diminué assez régulièrement depuis la révolution industrielle (5). Si cette tendance se poursuivait, il va de soi que l'effort à consentir pour réduire les émissions dans une proportion donnée serait moins grand que si l'intensité était stationnaire, ou augmentait. Les travaux du GIEC sont basés sur cette hypothèse. Or, celle-ci est contredite par la réalité observée ces dernières années : depuis 2000, on note un dépassement par rapport aux projections. Il est dû notamment aux investissements massifs du capital en Chine et en Inde, qui ont entraîné la construction dans ces pays de nombreuses centrales au charbon, produisant une électricité à bon marché — et des produits à bon marché pour le marché occidental. Selon certaines sources, 17 % de la hausse des émissions mondiales depuis 2000 serait dus à la hausse de l'intensité en carbone de l'économie, autrement dit à l'emploi de technologies plus polluantes.
10. Stratégie et priorités
La réduction des émissions à la source est la seule stratégie structurelle. La réduction des émissions provenant de la combustion des combustibles fossiles est prioritaire.
Théoriquement, la réduction de la concentration atmosphérique en carbone peut être envisagée selon trois voies : protection et développement des forêts (" puits de carbone »), capture et séquestration géologique du CO2, réduction des émissions à la source. Seule la réduction des émissions offre une solution structurelle.
La déforestation étant la deuxième cause d'émission de gaz à effet de serre, la protection des forêts existantes est un moyen de ne pas aggraver le changement climatique. Mais ce n'est pas une solution structurelle : (i) parce qu'une forêt mâture émet autant de carbone (par la respiration) qu'elle en absorbe (par la photosynthèse), (ii) parce que le réchauffement, à partir d'un certain point, amènera comme on l'a vu les forêts à émettre plus de carbone qu'elles n'en absorbent.
Les arbres en croissance absorbent plus de carbone qu'ils n'en émettent. A certaines conditions sociales et écologiques, planter des arbres peut donc être un moyen transitoire de lutter contre les changements climatiques. Mais il ne s'agit pas non plus d'une solution structurelle, car : (i) l'extension des forêts est limitée par les surfaces disponibles et (ii) le carbone stocké est libéré quand on abat les arbres (ou un certain temps après, en fonction de l'usage du bois).
La " capture et séquestration du carbone » consiste à isoler le CO2 des fumées à la sortie des usines polluantes pour l'injecter ensuite à grande profondeur dans des couches géologiques étanches. Les sites de stockage possibles semblent d'une grande capacité. L'engouement pour cette technologie s'explique du fait qu'elle permettrait d'utiliser les réserves de charbon, qui sont beaucoup plus importantes que les réserves de pétrole et de gaz. Cependant, il est clair que la " capture et séquestration du carbone » n'est pas non plus une solution structurelle : les réservoirs ont forcément une capacité finie et seul le CO2 émis par les grandes entreprises peut être capté.
La réduction à la source des émissions de gaz à effet de serre constitue donc fondamentalement la seule réponse structurelle au problème de la saturation du cycle du carbone. Des stratégies de réduction peuvent être mises en œuvre pour tous les gaz concernés, mais la réduction radicale des émissions de CO2 provenant de la combustion des combustibles fossiles constitue l'axe stratégique du sauvetage du climat : (i) parce que la combustion des combustibles fossiles est la cause principale du réchauffement, (ii) parce que le CO2 est de loin le principal gaz à effet de serre et (iii) parce que sa durée de vie dans l'atmosphère est relativement longue.
Outre ces motifs techniques, il va de soi que, du point de vue social, on ne peut pas mettre sur le même pied la réduction des émissions de CO2 fossile résultant du transport automobile ou aérien, d'une part, et celle des émissions de méthane résultant de la culture du riz, ou les émissions de CO2 non fossile résultant de l'agriculture sur brûlis pratiquée par des peuples indigènes vivant de la forêt, d'autre part.
11. Baisse absolue de la consommation d'énergie et passage aux renouvelables
La baisse absolue de la consommation d'énergie dans les pays développés conditionne le passage aux renouvelables et le sauvetage du climat.
La réduction radicale des émissions de CO2 fossile implique de recourir conjointement à deux leviers : (i) le remplacement du pétrole, du charbon et du gaz naturel par des énergies renouvelables ; (ii) la réduction de la consommation énergétique.
Le potentiel technique de l'énergie solaire sous ses différentes formes (éolienne, solaire thermique, solaire photovoltaïque, hydraulique, marine) équivaut 7 à 10 fois la consommation mondiale d'énergie (6). Il pourrait augmenter très considérablement dans les décennies qui viennent, grâce aux progrès de la recherche scientifique et technique. La décarbonisation totale de l'économie mondiale sans recours au nucléaire et sans recul social n'est donc pas une abstraction.
Cependant, cet énorme potentiel technique ne valide pas un scénario dans lequel les sources renouvelables viendraient simplement remplacer les sources fossiles, toutes autres choses restant égales par ailleurs. En effet, (i) l'énergie solaire est diffuse, (ii) elle se présente sous diverses formes plus ou moins utilisables en différentes régions du globe, (iii) la plupart de ces formes sont intermittentes, de sorte que leur emploi nécessite le développement de systèmes de stockage de l'énergie, avec recours à de nouveaux vecteurs et infrastructures ad hoc.
C'est dire que la transition vers les renouvelables implique la construction d'un nouveau système énergétique international, décentralisé, diversifié, économe, orienté vers la maximisation de l'efficience, basé uniquement sur l'exploitation du potentiel solaire. Il s'agit d'une entreprise gigantesque et qui nécessite des investissements importants. Donc une énergie qui, au moins dans les premières phases de la transition, ne peut être que d'origine majoritairement fossile — donc source d'émissions supplémentaires — ou… nucléaire — donc source de dangers écologiques, sociaux et politiques inacceptables (cf. infra).
On a vu que, pour ne pas trop dépasser 2°C de hausse de la température, les émissions mondiales devraient commencer à diminuer au plus tard en 2015. Il en découle que les émissions supplémentaires générées par la transition doivent impérativement être compensées par ailleurs. En d'autres termes, concrètement, l'urgence et la gravité de la situation climatique sont telles que le passage aux renouvelables, dans l'état actuel des connaissances, n'offre une issue que s'il est strictement conditionné par une réduction draconienne de la consommation d'énergie dans les pays les plus " énergivores ». Une telle réduction implique à son tour une baisse — non proportionnelle mais néanmoins importante — des échanges de matières, c'est-à-dire de la production et de la consommation matérielle.
La lutte contre le changement climatique vient ainsi confirmer de façon décisive les considérations environnementales plus générales sur l'insoutenabilité du rythme de plus en plus rapide auquel l'économie capitaliste prélève des ressources dans l'environnement naturel, sans tenir compte du temps nécessaire à leur renouvellement.
12. Consommation d'énergie et progrès social
La diminution de la consommation d'énergie des pays développés doit être draconienne… mais peut être synonyme non seulement de maintien des acquis mais aussi de progrès social
La réduction de la consommation d'énergie concerne essentiellement les pays capitalistes développés, où le potentiel de réduction des émissions par économie d'énergie est extrêmement considérable. Les différences entre pays en attestent : par exemple, un habitant des États-Unis consomme en moyenne 8 tonnes d'équivalent pétrole par an, un Suisse 4 tonnes, pour un niveau de vie comparable.
Quoique très élevées, les estimations courantes des potentiels de réduction sont largement sous-estimées. En effet, elles ignorent la plupart des mécanismes structurels qui font de la société capitaliste une machine à gaspiller l'énergie et les ressources : tendance à la surproduction et à la surconsommation, productions inutiles ou nuisibles (industrie de la publicité, fabrication d'armes, etc.), production séparée de chaleur et d'électricité, médiocre efficience énergétique des appareils de toutes sortes, délocalisation massive de la production vers les pays émergents produisant pour le marché des pays capitalistes développés, hypertrophie du transport due à la production " just in time » pour le marché mondial et à la flexibilité du travail, obsolescence accélérée des produits, aberrations des destructions/reconstructions dues aux guerres, absurde aménagement capitaliste du territoire (expansion des banlieues, parcs industriels, etc.), sans compter la frénésie de possession matérielle des riches et la compensation du mal-être social de masse par la consommation compulsive.
Diviser le besoin d'énergie par deux dans l'Union européenne et au Japon et par quatre aux États-Unis est un objectif techniquement réalisable. Au vu des mécanismes concrets du gaspillage énergétique, c'est peu dire que cet objectif est compatible avec un maintien des acquis sociaux : il peut être synonyme d'un important progrès social. Cela dépend de choix politiques.
13. Développement des peuples du Sud et technologies propres
Il n'est plus possible de sauver le climat sans la participation du Sud. Le droit au développement des peuples du Sud ne peut se concrétiser que par le recours à des technologies propres.
Même les efforts les plus draconiens au niveau des pays développés ne suffiraient plus à sauver le climat. Au-delà d'un délai de quelques années à peine, une certaine participation des pays dominés, en priorité des grands pays émergents, est devenue indispensable. Les chiffres du GIEC, établis sur base des responsabilités historiques différenciées, stipulent que ces pays doivent " dévier substantiellement par rapport au scénario de référence » à l'horizon 2020 (2050 pour l'Afrique). Une déviation de 15 % à 30 % par rapport au scénario d'émissions " business as usual » peut être réalisée par une combinaison de protection des forêts et de hausse de l'efficience énergétique. Mais, indépendamment des stratégies sociales, la concrétisation du droit fondamental au développement social et économique nécessite impérativement la mise en œuvre de technologies propres, afin que ces pays puissent sauter par-dessus le schéma économique basé sur les combustibles fossiles.
14. Enjeu majeur pour les peuples du Sud
Il ne suffit pas de lutter contre les changements climatiques, il faut s'adapter à la partie désormais inévitable du phénomène. C'est un enjeu majeur pour les peuples du Sud.
Même une réduction extrêmement radicale et rapide des émissions de gaz à effet de serre ne permettrait plus d'empêcher le changement climatique, dont les effets se font déjà sentir. Toute stratégie de lutte, quelle qu'elle soit, doit donc articuler l'atténuation du phénomène et l'adaptation à la partie désormais inévitable de ses effets, et ce à l'échelle mondiale, en fonction des responsabilités historiques des pays et de leurs capacités. D'une manière générale, atténuation et adaptation sont liées de telle sorte que, plus la première sera forte et rapide, plus la seconde sera limitée, et inversement. Au-delà de 2°C de hausse de la température par rapport à la période pré-industrielle, l'adaptation deviendra de plus en plus problématique et coûteuse. A partir d'un certain niveau, elle sera impossible — sauf au prix de catastrophes humaines faisant des centaines de millions de victimes et des désastres écologiques de très grande ampleur.
L'adaptation ne se limite pas à la construction ou au renforcement d'infrastructures de protection des populations (digues contre les inondations ou la montée du niveau des eaux, bassins d'orage, systèmes d'égouttage, etc.), d'une part, et à l'accroissement des moyens mobilisables en cas de catastrophe, d'autre part. Le changement climatique affecte toutes les sphères de la vie sociale, tous les écosystèmes et risque de les affecter encore plus à l'avenir. Des mesures d'adaptation doivent être prises dans de très nombreux domaines : gestion des ressources hydriques, aménagement du territoire, agriculture, sylviculture, santé publique, politique environnementale (sauvegarde des zones humides et des mangroves, notamment), habitudes alimentaires, assurance contre les risques, etc.
L'adaptation constitue un défi majeur pour les pays dominés, où les effets du changement climatique se font déjà sentir de la façon la plus nette. Les pays développés investissent massivement dans l'adaptation chez eux. Or, étant les principaux responsables du changement climatique, il leur revient de payer les frais afférents à l'adaptation des pays moins développés. Selon l'estimation du PNUD, cela implique un transfert financier Nord-Sud de 86 milliards de dollars par an à l'horizon 2015.
Au-delà des aspects techniques, la mesure d'adaptation la plus importante est en réalité la suppression de la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. En effet, la capacité d'adaptation est directement fonction des ressources, des droits sociaux et de l'efficacité des systèmes de protection sociale. L'adaptation constitue donc un enjeu particulièrement important pour les femmes des pays les plus pauvres, et partant pour la société dans son ensemble, puisque le travail des femmes assure quelque 80 % de la production alimentaire.
15. Population et climat
Le niveau de la population est un paramètre de l'évolution du climat, pas une cause du changement climatique. La poursuite de la transition démographique est souhaitable, mais aucune politique de contrôle de la population ne permet de relever le défi climatique.
L'évolution de la population mondiale influe évidemment sur les scénarios de stabilisation du climat : pour une population de six milliards, diviser les émissions par deux revient à dire que chaque être humain peut émettre 0,5 tonnes de carbone par an ; pour une population de neuf milliards, toutes autres choses étant égales, les émissions devraient être divisées par trois, de sorte que le quota annuel de carbone serait ramené à 0,25 tonnes/personne environ. Mais cette présentation agrégée escamote le fait qu'un pays comme les États-Unis, par exemple, avec 5 % de la population mondiale, consomme 25 % des ressources énergétiques et est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre.
Les pays développés émettent entre huit et vingt fois plus de CO2 par habitant et par an que les pays dominés. Si on considère la période 1950-1990, on constate que : (i) la hausse de la population dans les pays dits " en développement » a contribué nettement moins à l'augmentation des émissions de CO2 que la hausse de la consommation dans les pays développés, et même que la hausse de la population dans ces pays ; (ii) si les pays du Sud avaient bloqué leur population au niveau de 1950 tout en adoptant le niveau d' émissions de CO2 par habitant du Nord, le réchauffement serait beaucoup plus grave que ce que nous connaissons ; (iii) par contre, si les émissions par habitant des pays du Nord avaient été égales aux émissions par habitant des pays du Sud, le réchauffement serait nettement moins grave que ce que nous connaissons, même en l'absence de toute politique de contrôle démographique.
La démographie, celle des pays en développement en particulier, ne peut donc pas être désignée comme la cause principale, ni même comme une cause majeure du changement climatique. L'augmentation de la population, dans les pays développés d'abord, dans les pays dominés ensuite, est elle-même un produit du mode de production et de consommation créé avec la Révolution industrielle. La surpopulation relative est un trait majeur de la loi de population du capitalisme, qui a besoin en permanence d'une " armée de réserve ». Il ressort des rapports du GIEC que ce système menace de provoquer une catastrophe climatique. Il faut donc le mettre en cause, d'urgence. C'est le seul moyen de relever le défi du réchauffement dans les délais très brefs qui nous sont impartis, d'une part, et dans le respect des droits humains, des droits des femmes en particulier, d'autre part.
La transition démographique est largement entamée dans les pays en développement, où elle progresse plus vite que prévu. Pour une série de raisons environnementales, il est souhaitable que cette transition se poursuive. Cela passe par le progrès social, le développement de systèmes de sécurité sociale, l'information des femmes et l'extension de leur droit à contrôler leur propre fécondité (y compris le droit à l'avortement dans de bonnes conditions). Il s'agit forcément d'une politique à long terme. Sauf à recourir à des moyens d'une barbarie inouïe, aucune politique de contrôle de la population ne permet de répondre à l'urgence climatique.