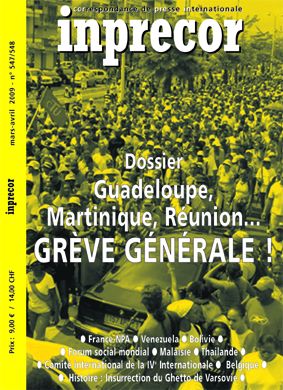Les politiques économiques contemporaines, Keynes et le changement climatique.
Thadeus Pato, dirigeant du Revolutionõr Sozialistische Bund (RSB, Ligue socialiste révolutionnaire, une des deux fractions publiques de la section allemande de la IV<sup>e</sup> Internationale — l'autre étant l'internationale sozialistische linke, isl, Gauche socialiste internationale), est membre du Bureau exécutif de la IV<sup>e</sup> Internationale.
Les keynésiens ont été durant trente ans mis au ban de l'économie bourgeoise. L'école radicale mercantile de la Mount-Pelerin-Society, avec ses porte-drapeaux tel Milton Friedman, semblait avoir triomphé sur les économistes keynésiens classiques, sur ceux qui prônaient une régulation gouvernementale de l'économie (capitaliste) et sur les " néokeynésiens » — une école combinant les éléments fondamentaux de Keynes avec les idées de l'économie dite néoclassique (1) — apparus au cours des années 1980. Dans l'ère de la déréglementation et de la foi dans le pouvoir mythique du " marché libre », toutes ces écoles économiques semblaient vouées à la végétation ou, au mieux, à l'existence fantomatique en marge des sociaux-démocrates désespérés et des syndicalistes.
Mais Keynes est de nouveau réhabilité et il pourrait sembler aux yeux d'un non- spécialiste que tous les experts de la politique économique, à l'Est comme à l'Ouest, se soient détournés du mercantilisme débridé qui était leur credo durant les trois décennies passées, aient repris pour devise " qui peut se soucier des absurdités que j'ai dit hier » et se souviennent tout d'un coup de leur sympathie pour le vieux John Meynard Keynes. Mais attention : si vous vous penchez avec plus d'attention sur la pensée de Keynes, vous arriverez à des résultats différents.
Les intentions de Keynes
Dans son principal ouvrage (2), Keynes a pris comme point de départ que — pour le dire de la manière la plus succincte — les cycles économiques conjoncturels peuvent être considérés comme " la conséquence d'un changement cyclique du rendement marginal du capital ». Il a identifié la demande globale en tant qu'élément essentiel non seulement du niveau de la production, mais aussi de l'emploi, rejetant ainsi la théorie néoclassique selon laquelle le chômage ne peut être résorbé que par l'abaissement du niveau des salaires. Il a fait valoir que, en schématisant, les effets positifs de la baisse des salaires seraient immédiatement déjoués par la réduction du pouvoir d'achat, donc de la demande.
Keynes a écrit son œuvre principale — publiée en 1936 — sous l'impact d'une situation historique particulière. Premièrement, il s'agissait de la crise économique mondiale commencée en 1929 avec toutes ses conséquences. Deuxièmement, les économies étatiques dictatoriales, telles celle de l'Union Soviétique mais aussi de l'Allemagne nazie (Keynes était un ami personnel du président de la Reichsbank allemande, Hjalmar Schacht), connaissaient leur période ascendante. Troisièmement, le gouvernement Roosevelt aux États-Unis a de manière pragmatique intégré une série d'éléments keynésiens dans sa politique de restructuration, appelée le " New Deal » au cours des années 1930. La théorie de Keynes est sans aucun doute fondée sur ses objectifs, qui furent d'une part d'éviter ce qu'il qualifiait de " système politique autoritaire » et, d'autre part, d'éliminer le chômage de masse. " Il est certain que le monde ne tolérera pas le chômage beaucoup plus longtemps, car ce dernier, en dehors de courtes périodes de récupération — à mon avis inévitables — est associé à l'individualisme capitaliste contemporain. Mais grâce à une analyse correcte du problème, il devrait être possible de guérir la maladie tout en conservant l'efficacité et la liberté en même temps » (3) Ce que les " systèmes autoritaires » ne pouvaient pas faire selon Keynes.
Sans aucun doute Keynes avait conscience de la domination de l'inégalité sociale, mais il la considérait comme inévitable, même s'il pensait qu'elle pouvait être réduite : " personnellement je considère que d'importantes inégalités des revenus et de la richesse sont justifiées socialement et psychologiquement, mais pas des inégalités aussi grandes qu'elles le sont actuellement » (4). De son point de vue, l'État devrait donc par ses interventions agir en faveur du plein emploi et de l'atténuation des crises cycliques d'une part et , de l'autre, en faveur d'une limitation des inégalités de revenus. Il a donc proposé une série de mesures visant une intervention continuelle de l'État en ce qui concerne l'orientation des investissements et l'accroissement de la consommation. Sur ce point son argumentation contre les protagonistes du marché libre semble être d'une grande actualité : " Si l'extension des tâches du gouvernement qu'impliquent l'égalisation de l'accès à la consommation et l'incitation à l'investissement peuvent apparaître comme une terrible ingérence dans le domaine de la liberté personnelle aux yeux d'un penseur du XIXe siècle ou d'un courtier américain, je défends au contraire que c'est l'unique instrument viable pour éviter la destruction de l'ensemble des formes existantes de l'économie ainsi que la condition préalable à la réussite de l'exercice de l'initiative individuelle; » (5)
Keynes est allé très loin sur ce terrain — ce qui est de préférence dissimulé de nos jours. De son point de vue l'État devrait augmenter les impôts sur les héritages et les hauts revenus et il a déclaré qu'une " socialisation très large de l'investissement s'avérera être l'unique mesure permettant de tendre vers le plein emploi » (6). Et parce que — contrairement à d'autres protagonistes de la science économique bourgeoise — il ne considérait pas le capitalisme du marché libre comme la fin de l'histoire, il est arrivé à des conclusions fort radicales : " Ce n'est pas l'acquisition de la propriété des moyens de production qui est importante pour l'État. Si l'État est en mesure de décréter le montant total des ressources servant à la croissance de ces biens ainsi que le taux d'intérêt pour leurs propriétaires, il aura rempli complètement son rôle. Les mesures nécessaires de socialisation peuvent être en plus introduites graduellement et sans une rupture avec les traditions communes de la société… » (7)
Et les néokeynésiens ?
Le modèle de Keynes d'une économie réglementée par l'intervention et la redistribution de l'État semble naturellement bizarre aux yeux des protagonistes d'une " économie de marché libre ». En accord avec cela, les " néokeynésiens » ont mis la barre plus bas, se contentant de demander une soi-disant politique économique anticyclique, conduite non seulement au coup par coup, mais de manière planifiée et continue : réduction des impôts, financement déficitaire des investissements publics et baisse du taux d'intérêt en temps de crise , afin de renforcer la demande et de faciliter les investissements ainsi que — théoriquement — le contraire dans les phases de forte croissance. Lorsque cette orientation a été mise en œuvre, elle a conduit à un accroissement continu de l'endettement public. Car ce que ni Keynes, ni ses misérables épigones n'ont pris en compte, l'État bourgeois n'est en aucun cas une instance neutre. Un détournement ne serait-ce que d'une partie des profits lors des phases de croissance, ce qui aurait permis de maintenir la capacité de l'intervention de l'État en vue de la prochaine crise, n'a simplement pas eu lieu (pour ne pas mentionner les impôts sur l'héritage…).
La réalité
Ce qui est fait aujourd'hui, face à la crise économique mondiale, par les principales puissance économiques tels les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, etc., n'a presque rien de commun avec le projet original de Keynes. Superficiellement les " aides à la consommation », les programmes conjoncturels, la baisse des taux d'intérêt et des impôts pourraient faire penser à ce que les économistes néokeynésiens ont demandé. Mais les " dépenses déficitaires » des gouvernements ne sont en aucun cas destinées à une redistribution progressive. Au contraire : le rapport entre le montant dépensé pour l'aide financière directe, la garantie des dettes et l'aide à l'investissement offert au capital financier d'une part et l'argent destiné à l'investissement public est très asymétrique. En Allemagne, par exemple, 500 milliards d'euros ont servi pour sauver les banques alors que seulement 50 à 80 milliards ont été promis pour les investissements publics et le renforcement du pouvoir d'achat. A titre de comparaison seulement, rappelons que lors de la crise de la fin des années 1970 le ministre social-démocrate allemand des finances avait lancé un programme d'investissements de 40 milliards de Deutsche Marks de l'époque ; par rapport au PNB cela voudrait dire aujourd'hui 400 milliards d'euros…
Il est clair qu'il n'y a aucun signe d'un changement général de la politique des gouvernements respectifs. Au lieu de cela au cours des derniers mois les divers protagonistes ont proclamé des mesures isolées comme si la théorie de Keynes et de ses épigones était une sorte de self-service, où chacun pourrait piocher ses besoins fiscaux mais aussi politiques. Les uns appellent à la réduction des impôts, les autres veulent des aides à la consommation, les troisièmes des emprunts forcés auprès des riches (mais avec un bon taux d'intérêts, évidemment !). Personne n'envisage une redistribution semblable à ce que proposait Keynes ou le New Deal des années 1930 (qui, par ailleurs, ne fut nullement un succès… c'est la seconde guerre mondiale qui avait sauvé l'économie des États-Unis). Ils agissent, comme si tout cela ne devait être qu'une aide gouvernementale, une issue de secours, après quoi tout pourra continuer comme auparavant. Par conséquent partout les politiciens affirment que l'État se retirera lui-même des affaires immédiatement, dès que l'économie sera de nouveau repartie. Il y a toujours des néokeynésiens, comme le président du parti allemand Die Linke, Oskar Lafontaine, qui demandent un investissement public. Mais il n'a d'autres idées que la construction de nouvelles autoroutes, montrant clairement (entre autres) le talon d'Achille de l'approche keynésienne.
Le keynésianisme et le changement climatique
Keynes et ses successeurs se sont concentrés de manière conséquente sur la croissance. Le problème, c'est que de nos jours nous sommes confrontés à une crise combinée, face à laquelle l'économie bourgeoise n'a pas de réponses. D'un côté nous avons la plus profonde crise du système capitaliste depuis 1929, une crise de surproduction classique, et, de l'autre, la menace de changements climatiques résultant de 150 années d'exploitation illimitée de l'environnement à travers justement cette croissance économique quantitative exponentielle. Cela prouve que les politiques qui mettent l'accent sur la poursuite de la croissance quantitative sont obsolètes. Nous n'avons pas besoin, par exemple, de plus de voitures, de plus de routes et d'autoroutes, mais d'un système de transport public dont l'impact environnemental serait neutre. Le trafic individuel dans sa forme actuelle est arrivé à son terme du point de vue écologique. Lutter contre le changement climatique signifie mettre à l'ordre du jour un ordre économique qui évalue tous les mécanismes de production et de distribution sous l'angle de leur impact écologique et non de gérer leurs conséquences écologiques au travers des mécanismes du marché ou de la politique fiscale (taxes, certificats CO2) ou encore d'y répondre en établissant une " industrie climatique » supplémentaire.
Mais pour cela, ce qui est réellement nécessaire, c'est une économie soutenable fondée sur le recyclage, qui persévère dans la neutralité climatique et environnementale. L'économie capitaliste, tant dans sa version keynésienne ou néokeynésienne que dans sa version radicalement mercantiliste, n'offre aucune solution. Par conséquent, nous avons besoin d'une façon de produire et de distribuer fondamentalement différente, fondée d'une part sur les besoins de la population et de l'autre sur la préservation de l'environnement et c'est crucial pour la survie du genre humain.
Pour ce faire — et c'est l'aspect aveugle des théories de Keynes et de ses successeurs — il faut un État qui ne soit pas dans les mains des lobbies du capital industriel ou financier.
En guise de conclusion
Ce que les gouvernements des pays industrialisés accomplissent actuellement n'est pas une mise en pratique des théories de Friedmann, ni le néokeynésianisme, ni le keynésianisme. Il s'agit simplement d'une politique économique dépourvue de tout concept, aveugle et du point de vue climatique, désastreuse. Les États et leurs trésoreries sont siphonnés par les groupes dominants du capital industriel et financier. Pour le reste de la population, qui est en premier lieu concerné par les effets de la crise au cours des années à venir — par les salaires en baisse, le chômage, la paupérisation des personnes âgées — il ne restera que des miettes. Outre le fait que le succès des " plans de sauvetage » des gouvernements est plus que douteux, ils provoqueront une nouvelle expropriation de la classe ouvrières au travers de l'inflation qui sera le résultat inévitable de l'énorme expansion de l'endettement.
En réalité les gouvernements exécutent la redistribution en faveur des riches, au détriment des travailleurs et de l'environnement. L'étiquette du " néokeynésianisme », collée sur cette politique par certains propagandistes, suggère à tort qu'il y a une gestion de la crise fondée théoriquement et cohérente. Ce n'est pas vrai : il s'agit d'un étiquetage fallacieux dont l'impuissance constitue l'origine. ■
2. John Meynard Keynes, Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie (1936), rééd. Payot, Bibliothèque scientifique, Paris 1988. Toutes les citations de cet article sont traduites de l'édition allemande (J.M. Keynes, Allgemeine Theorie der Beschõftigung, des Zinses et des Geldes, Duncker und Humblot, Berlin 1983) et peuvent donc être légèrement différentes de la traduction française mentionnée.
3. Keynes, op. cit., p. 321
4. Keynes, op. cit., p. 315
5. Keynes, op. cit., p. 321
6. Keynes, op. cit., p. 319
7. Keynes, op. cit., ibid.